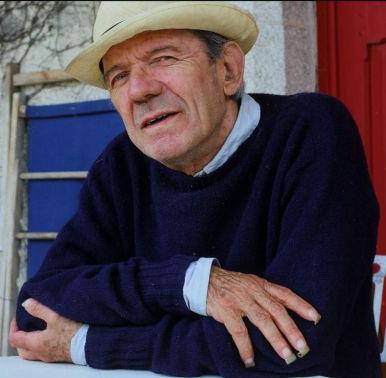Présenter la philosophie de Deleuze est audacieux, tant les textes de cet auteur foisonnent de concepts et de notions qui semblent échapper à la systématisation. Il se pourrait même qu’il n’y ait pas une, mais plusieurs philosophies deleuziennes, de par la volonté même de l’auteur de rompre avec le primat de l’Un et de l’Etre. Non une pensée, mais des pensées, des actes multiples pour comprendre à chaque fois une réalité singulière, sans référence à une totalité -de sorte qu’il n’y aurait pas chez Deleuze de fondement ni de logique d’ensemble. Or, s’en tenir à l’hétérogénéité des textes, n’est-ce pas se vouer à la dispersion, s’interdire tout simplement de lire ? Il se trouve que Deleuze n’a jamais rejeté la notion de système en tant que telle, refusant d’en faire un point de crispation.
Les trois articles qui composent ce volume 1 proposent chacun un parcours thématique dans l’oeuvre de Deleuze. François Zourabichvili étudie la notion d’évènement et montre pourquoi elle est au service d’une philosophie de l’immanence. Anne Sauvagnargues étudie l’esthétique deleuzienne dans son rapport à l’animalité. Enfin, Paola Marrati commente les deux livres que Deleuze a consacrés au cinéma. Aucune préface d’ensemble ne vient en fait justifier le regroupement de ces trois textes (pourquoi ceux-là ? pourquoi pas davantage ?), ce qui n’enlève heureusement rien à l’intérêt de chacun. Quoiqu’elles puissent être lues indépendamment les unes des autres, ces trois études forment quand même un ensemble relativement cohérent et ouvrent chacune de nombreuses portes d’entrées dans l’oeuvre deleuzienne.
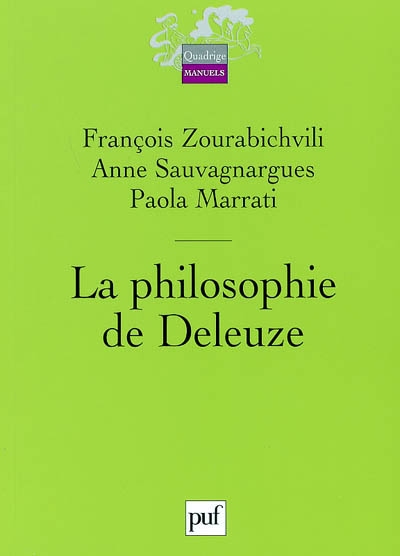
1) Une philosophie de l’événement
La deuxième édition de ce livre d’abord paru en 2004 est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir un des grands commentateurs de Deleuze, François Zourabichvili, mort en 2006, qui signait en 1994 une étude sur la notion d’évènement. En suivant ce concept comme fil conducteur, Zourabichvili explique comment Deleuze repense en métaphysicien le temps, l’espace, le concept et la pensée. A quelle condition peut-on penser l’évènement ?
Deleuze, qui n’a jamais cherché à s’inscrire dans la fin ou le dépassement de la métaphysique, entendait en revanche rompre avec l’ontologie. Zourabichvili note que cette rupture se retrouve dans un fait lexical simple et remarquable : la substitution au « EST » du « ET », ou « ce qui revient au même, substitution du devenir à l’être » 2. Par cet usage de la conjonction de coordination, Deleuze substitue, à une logique de la substance, du solide et du fixe, une logique de la relation, du mouvement. Davantage qu’à un renversement ou une critique, Deleuze se livre à une perversion de l’ontologie, en s’appuyant notamment sur Duns Scot et la thèse de l’univocité de l’être : être se dit en un seul et même sens de toutes choses. La perversion n’est pas ici l’acte de faire le mal ou de laisser faire le mal par d’autres mais, étymologiquement, de détourner et de faire sortir de son usage « normal ». Une telle déclaration pourrait paraître bien banale (l’univocité de l’être n’est-elle pas acceptée sans discussion par toutes les philosophies modernes ? Quel philosophe reprend encore l’ontologie de la forme unitaire ?) : c’est pourquoi, si elle n’est pas qu’une déclaration verbale, une rupture superficielle, il faut en montrer toutes les conséquences sur la philosophie, sur notre pensée, sur notre vie. C’est à ce travail que se livre François Zourabichvili.
« D’une logique de l’être et du savoir, la philosophie bascule vers une logique de la relation et de la croyance. » 3. Seule une telle logique, que Deleuze décrit dès les premières pages d’Empirisme et subjectivité (1953), permet de penser l’évènement, la nouveauté, l’inédit. La croyance devient alors une condition de la pensée, plus fondamentale que la raison. « « Croyance » se rapport au retour inlassable, dans l’esprit, d’une relation inédite et problématique, d’une conjonction de termes aussi imprévisible qu’injustifiable, dont l’affirmation difficile assume l’ouverture par effraction d’un nouveau champ d’expérience, capable d’apprivoiser une part des occurrences chaotiques de la vie et de transmuer leurs coups en signes » 4. Rompre avec le modèle de la recognition dégage une pensée de l’inédit, de l’original, en quoi consiste proprement l’évènement. Loin de faire s’effondrer la pensée dans le chaos, Deleuze cherche à trouver de nouvelles manières de vivre ce hasard. Le modèle de l’éternel retour -qui est pour Deleuze sélection- permet d’approuver à ce hasard chaque fois rencontré et d’y approuver une fois pour toutes (comme le joueur qui approuve au hasard à chaque nouveau coup de dé). Je connais ainsi la joie d’aimer ce à quoi je ne m’attends pas et qui me dépasse : l’évènement.
Or, l’évènement pose à la pensée un problème : soit il est pensable, mais dans ce cas, sa part de nouveauté nous échappe, soit il n’est pas pensable mais dans ce cas, nous ne pouvons même pas nous rendre compte de son existence. L’évènement doit donc se situer hors du champ de la pensée. L’obstacle est ici l’image même d’une pensée qui se règle sur l’opinion, qui assigne d’avance des conditions à toute expérience à venir, qui présuppose donc formellement ce qu’elle doit rencontrer. Une fois entrée dans ce carcan, l’expérience constitue une extériorité, mais une extériorité déjà intériorisée par le penseur -qui n’aura plus qu’à faire preuve de bonne volonté, pour étudier une matière empirique qu’il connaît déjà selon ses conditions de possibilité. Zourabichvili explique de manière tout à fait intéressante la critique deleuzienne de l’image de la pensée : critique de la bonne volonté, de la pensée comme recognition, comme recherche de la vérité et établissement du fondement. Cette image, Deleuze montre qu’elle a fini par se transformer en un cliché, une image morte qui empêche la pensée -une platitude. Cet épuisement devrait inciter à inventer une nouvelle façon de penser pour répondre précisément de cet évènement : nous ne pouvons plus considérer que la vérité est là, qui attend que nous la découvrions. La tâche que se proposait Deleuze en philosophie était de se montrer à la hauteur d’une telle mutation et d’une telle chance. « Il se peut que nous éprouvions une grande lassitude, une fatigue qui pourrait suffire à définir notre modernité : mais la sensibilité à l’intolérable, cet affect qui nous laisse paradoxalement sans affect, désaffectés, désarmés face aux situations élémentaires, impuissants face à l’universelle montée des clichés, constitue une émergence positive au sens le moins moral du mot, l’émergence de quelque chose qui n’existait pas avant auparavant, et qui induit une nouvelle image de la pensée » 5. La philosophie s’efforcera de tirer l’esprit de son indifférence. Indifférence qui est peut-être l’ennemie principale de la philosophie de Deleuze, d’autant plus que cette indifférence est caractéristique de l’époque. A cette indifférence, Deleuze ne répond pas par l’imprécation ou l’ironie, mais par l’humour -art de tirer les conséquences- et une attitude nietzschéenne de pessimisme joyeux : trouver dans ce qui m’accable la force de me dépasser.
Une pensée de l’immanence
La pensée qui s’efforce de penser l’événement ne peut être que philosophie de l’immanence : « C’est en même temps que la pensée affirme un rapport absolu à l’extériorité, qu’elle récuse le postulat de la récognition, et qu’elle affirme le dehors dans ce monde-ci : hétérogénéité, divergence. Quand la philosophie renonce à fonder, le dehors abjure sa transcendance et devient immanent » 6. La philosophie est affirmation en tant qu’elle montre que la pensée est de même nature que la réalité. Et parce que la réalité est différence, différenciation, la pensée peut rencontre un véritable dehors, pas du déjà-connu. Elle ne se place pas pour autant hors de la réalité. Zourabichvili explique les conséquences de cette rupture avec la métaphysique de l’identique : il rend de ce fait compte de la nécessité selon laquelle Deleuze est amené à créer ses concepts et à faire évoluer sa philosophie.
Le passage suivant, très dense, rend compte de cette nécessité :
« Une conception de l’objet philosophique se dégage. La pensée ne s’exerce pas à dégager le contenu implicite d’une chose, mais le traite comme un signe -le signe d’une force qui s’affirme, fait des choix, marque des préférences, affiche en d’autres termes une volonté. Affirmer, c’est toujours tracer une différence, établir une hiérarchie, évaluer : instituer un critère qui permet d’attribuer des valeurs.» 7.
Le philosophe est critique, au sens où il cherche à discerner le vrai et le faux, le bon et le mauvais, mais pas à partir d’une représentation de ce que serait la vérité ou le bien hors d’une évaluation. Cette évaluation portera d’abord sur les questions : seront vraies ou fausses, bonnes ou mauvaises, non plus d’abord les réponses mais les questions (détecter et détruire les faux problèmes pour poser les vrais). L’évaluation remontera alors des questions aux forces qui s’affirment dans ce questionnement (qu’est-ce qui nous fait penser ? -cf. en particulier Nietzsche et la philosophie). Cette critique aboutit à un critère immanent, hérité de Spinoza et Nietzsche : jauger les valeurs d’après leur puissance d’intensification de la vie, non d’après leurs conformités à une morale transcendante. La pensée se confronte à ce monde de tendances et de forces multiples, toujours changeantes, tendances qui se déploient autant qu’elles le peuvent (conception là encore héritée de Spinoza).
Capter ces forces ne se fait pas dans une confrontation brutale, aveugle. Les forces elles-mêmes sont inséparables de l’évaluation d’autres forces avec lesquelles elles se composent. La force est déjà en ce sens douée d’esprit. Le critique doit alors se faire clinicien, au sens où il évalue ces forces à partir des signes produits, par un examen de cas singuliers, jamais donnés d’avance. Et comme c’est d’un même mouvement que l’on comprend et que l’on explique, le clinicien est à son tour pédagogue : par le concept, il comprend une multiplicité singulière et en transmet les virtualités propres (la notion de pli dans le baroque, par exemple). La pensée n’est pas autre chose qu’un tel complexe de forces, une onde que nous « captons » ou non, qui nous convient ou pas. La philosophie trouve là sa dimension pédagogique : est pédagogue celui qui aide à rendre les forces pensantes actives.
Cette pensée de l’activité supporte dès lors une éthique : quelle vie selon quelles pensées ? Quelles pensées selon quelles forces ? « Ce qui intéresse avant tout la pensée, c’est l’hétérogénéité des manières de vivre et de penser » 8. Vivre la différence de valeurs, chercher des critères de vie, en cela consiste l’éthique de Deleuze : autrement dit encore, expérimenter « la différence qualitative et intensive des modes d’existence » 9.
C’est avec la théorie des multiplicités que Deleuze tire toutes les conséquences de l’univocité de l’être, et c’est en se donnant les moyens de penser l’évènement (qu’est-ce qui se passe ? qu’est-ce qui m’arrive ?) que Deleuze peut proposer une philosophie de l’immanence : croire en ce monde-ci et en ses potentialités.
Empirisme et multiplicités
La dernière partie de l’article de François Zourabichvili approfondit la réflexion sur l’éthique en prolongeant l’étude de la notion de force. Les forces composent un champ transcendantal qui conditionne la pensée, et peut la faire advenir ou au contraire l’empêcher. Il faut alors comprendre les conditions de l’expérience en même temps que celles de la pensée. Or, l’expérience ne peut être constituée que par un sujet mis au contact du devenir, et opérant une synthèse de celui-ci. Sur ce point, Deleuze reprend Kant tout en se séparant profondément de lui. En s’appuyant sur la critique bergsonienne du possible, Deleuze refuse la notion d’expérience possible, et cherche -avec Hume- les conditions de l’expérience réelle. Cette reprise du kantisme opérée grâce à Hume et Bergson aboutit à l’empirisme transcendantal [A ce sujet, voir le livre d’Anne Sauvagnargues, Deleuze. L’empirisme transcendantal. [Compte-rendu sur ce site.[/efn_note], qui cherchera des conditions précisément adaptées à l’expérience en question (un conditionnant pas plus large que le conditionné). Le concept même de sujet est retravaillé par Deleuze : il n’est plus une forme a priori, mais le produit d’une synthèse passive opérée à même l’expérience. La synthèse du divers n’est plus unification, mais synthèse disjonctive, produite par le jeu des différences elles-mêmes. Le sujet est contraction, contemplation : je contemple, donc je suis. Là encore, nous retrouvons l’exigence d’immanence : le sujet n’est pas au-delà ou hors de l’expérience, et l’homme n’a même pas de privilège spécifique à se constituer en sujet. Même une tique qui se chauffe au soleil « contemple » le soleil ou, pour reprendre un autre exemple de Deleuze, le lys des chants contemple le soleil dont il procède, et ainsi « chante la gloire des cieux ».
Cette reprise de la notion de contemplation nous montre que Deleuze, adversaire des philosophies de l’Etre ou de l’Un, pouvait être un grand lecteur et admirateur de Plotin. Le sujet compose avec ce qu’il contemple une individuation singulière -une héccéité. La dernière conséquence métaphysique du refus de l’Un sera le refus du temps chronologique, au profit d’un temps qui sera retour de la différence.
Zourabichvili conclut son très riche article -dont je n’ai exposé que quelques thèmes- par une étude de l’écriture deleuzienne : quel langage pour dire la multiplicité, le devenir, l’évènement ? Comment contenir dans un sujet d’énonciations plusieurs voix, plusieurs rythmes et plusieurs perspectives, sans se perdre dans la confusion ?
C’est avec grand intérêt que l’on suit ce premier parcours dans l’oeuvre de Deleuze. Le texte est très dense et bien des passages ne seront accessibles qu’à ceux qui fréquentent déjà assidûment Deleuze, mais les passages cruciaux sont tout à fait lisibles par un néophyte, notamment ceux qui se rapportent à l’idée d’une pensée sans image. Comment commencer véritablement en philosophie, si nous supposons déjà ce que c’est que penser ?…
2) De l’animal à l’art
Anne Sauvagnargues étudie les textes relatifs à l’esthétique et montre que l’art n’est pas pensé chez Deleuze par rapport à la forme, au sentiment esthétique ou à la vie, mais par rapport à l’animalité et à l’habitat.
« Le Scenopoïetes dentirostris, oiseau des forêts pluvieuses d’Australie, fait tomber de l’arbre les feuilles qu’il a coupées chaque matin, les retourne pour que leur face interne plus pâle contraste avec la terre, se construit ainsi une scène comme un ready made, et chante juste au-dessus, sur une liane ou un rameau, d’un chant complexe composé de ses propres notes de celles d’autres oiseaux, qu’il imite dans ses intervalles, tout en dégageant la racine jaune de plumes sous son bec : c’est un artiste complet » 10.
Il n’y a pas selon Deleuze de privilège humain quant à l’art : l’animal peut déjà être artiste. L’artiste humain poursuit quant à lui un processus déjà engagé par les animaux qui tracent et marquent un territoire, puis sont pris dans des mouvements de sortie de ce lieu : la déterritorialisation. Thèse qui paraît à première vue étrange. N’a-t-on pas l’impression, à suivre Deleuze, que l’art se réduirait à peu de choses ? N’est-il pas absurde d’affirmer -même métaphoriquement- que c’est un « instinct » identique qui pousse l’animal à marquer un territoire et l’artiste à peindre une toile ?
Le rapprochement opéré par Deleuze entre art et animalité suppose d’une part qu’il n’y ait pas de spécificité humaine à l’art -que la conscience ne soit pas un trait distinctif de l’activité humaine ni une condition de la création, et d’autre part, suppose que l’homme s’engage dans un autre rapport à l’animal et au non-humain : il convient donc de revoir les relations entre homme et animal -de voir s’il s’agit bien de relations entre deux sortes d’êtres absolument distincts. C’est le mode même de relation qui mérite d’être repensé :
« Deleuze ne s’intéresse pas à l’animal comme espèce dominée, ou comme vivant mineur par rapport à l’espèce dominante majeure que serait l’homme. Il s’y intéresse comme phénomène anomal, comme phénomène de bordure, comme devenir qui permet à l’humanité de penser la culture comme pluralité et la vie comme diversité d’allures et d’ethos 11»
« Site de parade d’un Jardinier à bec denté… Ces grands oiseaux trapus ont un cri extrêmement puissant. Ils enlèvent les feuilles du sol de la forêt puis le redécorent avec les feuilles qui leur plaisent. Le mâle pousse alors son cri et danse dans l’espoir d’attirer une femelle ». [/efn_note]
Ce sont ces processus propres à l’habitat d’un territoire (marquage, sortie, retour) qui se retrouvent dans la création artistique : le travail effectué sur un matériau pour en extraire des sensations et fixer ces sensations dans un matériau, tel est le lien entre l’animal et l’artiste.
« Et le territoire s’avère l’“effet de l’art”, au sens où se territorialiser, c’est déterritorialiser des matières et des qualités dans un devenir-expressif sans lequel le territoire ne s’arracherait pas au milieu (Mille Plateaux, page 388) ». 12
L’artiste quant à lui s’engage dans des devenirs en poussant ses moyens d’expression vers leurs limites. Le devenir-animal constitue alors une telle approche des limites, mais sans privilège sur d’autres (devenir-animal, devenir-végétal, devenir-femme…). L’artiste pousse à ses limites une culture (Kafka et la langue allemande) et invente de nouvelles puissances de vie, faites d’intensités inédites.
C’est en ce sens qu’il peut y avoir devenir-animal chez l’artiste : quand il prélève sur le flux des sensations des images, tout comme l’animal prélève des qualités sur son milieu de vie. Nous retrouvons ici la notion d’héccéité : avec celle-ci, « le devenir-animal laisse la place à une éthologie des affects. Cela permet de conclure sur les devenirs-animaux, qui ont un rôle méthodologique, celui d’insister sur la bordure intense des multiplicités […] L’animal est une puissance de déterritorialisation, non une forme d’existence donnée » 13.
Là encore, on retrouve le souci d’univocité de Deleuze : la déterritorialisation se dit aussi bien d’un animal quittant son territoire que de la création d’une oeuvre. Ce qui intéresse Deleuze, ce sont les intensités et les affections produites dans ce processus.
C’est pourquoi le détour par la notion de virtuel est indispensable, car c’est cette notion qui va conditionner de part en part la compréhension de cet usage littéral du langage. En même temps, il sera possible de comprendre ce qui m’affecte dans une déterritorialisation et pourquoi l’art peut nous faire éprouver de grandes émotions. L’article de Sauvagnargues retrace ce parcours : en prenant l’animal et l’habitat comme concepts centraux de l’esthétique deleuzienne, elle propose une remontée en amont vers la notion de virtuel, et en aval, vers l’aboutissement de l’esthétique deleuzienne dans la théorie des affects et des percepts. Les analyses d’Anne Sauvagnargues sur l’oeuf, puis le corps sans organe et les machines désirantes sont très éclairantes. Toujours nous retrouvons un complexe d’actuel et de virtuel -une héccéité- qui est production de désir, et qui ne peut produire qu’en traçant un plan de consistance, territoire animal ou agencement.
En particulier, l’auteur approfondit la filiation avec les théories simondoniennes de la disparation et de la transduction : on voit comment Deleuze étend une théorie du vivant et de la technique à l’art, puis à l’habitat : l’artiste poursuit un mouvement d’individuation qui commence avec l’animal. Tout passe en fait par le virtuel. Le virtuel a pour Deleuze une consistance propre : pleinement réel sans être actuel, il ne manque de rien [« Il n’y a pas d’objet purement actuel. Tout actuel s’entoure d’un brouillard d’images virtuelles. » ( « [L’actuel et le virtuel » (1995).)[/efn_note] Sans cette théorie du virtuel (qui n’a plus, comme chez Aristote, à être sous la dépendance d’un acte), on ne peut comprendre ce qui se passe dans l’art, dans ses devenirs et dans les héccéités qu’il produit.
« Milieu et animal composent ainsi une heccéité définie par ses compositions de rapports et ses affects qui taillent dans le milieu un territoire expressif […] L’art doit être rigoureusement compris comme une circulation d’affects et de percepts sur ce plan. C’est au niveau de cette éthologie qu’il faut saisir le rapport expressif, et du coup, l’art apparaît comme phénomène vital, comme phénomène de territorialisation. Deleuze propose ainsi une «bio-esthétique» originale » 14. Le lien avec l’animalité débouche sur un rapprochement entre art et habitat : c’est le thème de la ritournelle -judicieusement entendu par Zourabichvili comme retour éternel 15 – qui va finalement conférer à l’art une dimension cosmique : nous ne sommes que ces intensités, que l’artiste capture dans un matériau et qui nous mettent en contact avec ce monde que nous habitons. La subjectivité est alors déplacée, attribuée non à l’artiste ni à l’oeuvre mais à la sensation, percept ou affect trop forts et qui subsiste au-delà de celui qui l’a ressenti et l’a traduit en oeuvre.
« Si l’art émeut, c’est justement à cause de cette improbable émancipation d’une sensation hors de son porteur, d’une sensation portée à une intensité telle qu’elle subsiste seule… » 16 Francis Scott Fitzgerald a senti une fêlure qui brisait sa vie et a transmis cet affect puissant ; de même Beckett avec l’épuisement (qu’est-ce que c’est qu’être à bout, qu’avoir tout donné ?), Nietzsche avec l’ivresse. Comment sentir, comme Kandinsky ou Van Gogh, l’affect violent de la couleur ?
Deleuze se propose de parachever l’esthétique en revenant à la rencontre avec une sensation porteuse d’affects et de percepts qui excèdent mes facultés. Si l’artiste met de lui dans l’oeuvre, s’il s’y met « tout entier », c’est en tant qu’il parvient à capter et à « emprisonner » dans la matière des forces. Ces forces sont captées, prélevées dans le flot continu des sensations pour former des images. L’animal sert alors à nous entraîner vers des devenir-animaux, c’est à dire à nouer ou renouer des alliances créatrices avec certaines potentalités vitales. « Partout l’animal fait passer de la vie, une vie immanente, « une puissante vie inorganique » […] Servant d’opérateur privilégié pour les analyses de l’intensité dont il rend perceptibles les forces agissant dans les formes stabilisées, l’animal permet d’aborder les phénomènes d’involution, larves et embryons, et de penser l’art comme accès direct aux forces intensives (corps sans organes) ».
En substituant la force à la forme, Deleuze dégage une logique de la sensation qui est méthode de compréhension et d’expérimentation : mettant en question les catégories du sujet-spectateur, et sans prétendre à une psychanalyse de l’artiste créateur, elle nous introduit directement dans le processus de l’art 17.
3) Cinéma et philosophie
L’article de Paolo Marrati s’intéresse aux deux volumes Cinéma 1 : L’image-mouvement et Cinéma 2 : L’image-temps. Qu’est-ce que la philosophie peut nous dire du cinéma ? Deleuze ne veut pas que la philosophie soit réflexion sur un objet : personne n’a besoin du philosophe pour réfléchir sur son domaine propre. S’il ne s’agit pas de faire une philosophie du cinéma, ni une théorie ni une histoire de celui-ci, quel est l’objet de ces deux volumes ? Paola Marrati explique ce que Deleuze reprend de Bergson pour comprendre la spécificité de l’image au cinéma. Trois thèses sont mobilisées :
Le mécanisme du cinéma reprend un mécanisme de perception à l’oeuvre déjà dans les paradoxes de Zénon : la recomposition du mouvement par une suite de positions. La caméra filme une suite d’images à une fréquence régulière et c’est l’enchaînement de ces images fixes qui créera l’illusion du mouvement : de l’artificiel recrée du réel. Deleuze peut dire que l’image au cinéma est faite d’instants quelconques : non pas le moment remarquable restitué sur la toile du peintre, mais n’importe quel instant du geste d’un acteur, de la course d’un cheval. Ce fonctionnement habituel du schème sensori-moteur explique les métaphysiques antiques et moderne du temps et de l’espace : « Le mouvement, indivisible et hétérogène, est irréductible à l’espace parcouru qui est au contraire divisible et homogène. C’est la première thèse. La deuxième… concerne la manière différente qu’ont les Anciens et les Modernes de reconstituer le mouvement avec des instants ou des positions. Quant à la troisième thèse […] c’est celle qui affirme que tout n’est pas donné » 18. C’est en articulant ces trois thèses que Deleuze dégage la nouveauté propre au cinéma.
L’image-mouvement
L’intérêt de l’étude des images du cinéma sera de comprendre ce qu’elles nous donnent à voir du mouvement, et surtout quels mouvements. « A côté des images instantanées, qui sont les coupes immobiles du mouvement, il y a aussi des images-mouvements qui sont des coupes mobiles de la durée […] A notre perception, habituée à saisir les mouvements comme déplacement dans l’espace, il n’est pas facile de concevoir des images qui nous présentent directement, à même la translation spatiale, un changement qualitatif, mental ou spirituel changement dans le tout » 19. Si le cinéma est, étymologiquement, kinesis, mouvement, Deleuze s’efforce de comprendre ses potentialités propres, sa dynamis, autant dire ses virtualités. En prenant l’image cinématographique comme un virtuel, Deleuze peut ainsi montrer pourquoi la philosophie peut s’intéresser au cinéma -en tant qu’il s’inscrit dans une vision du monde qui a une dimension métaphysique (la perception du changement, que Bergson a étudié en dégageant un temps non-chronologique), et, en retour, en quoi le cinéma est porteur d’une dynamique pour la philosophie : « Il faut analyser ce que le cinéma donne à penser à la philosophie. Un enjeu central est le statut de la représentation. Le cinéma, loin de confirmer les thèses célèbres de Heidegger sur la modernité comme époque de la représentation, les met radicalement en cause […] Le cinéma ne convoque pas un monde-image devant le regard d’un sujet-spectateur. Le propre du cinéma est au contraire de produire des images qui sont irréductibles au modèle d’une perception subjective » 20.
L’image-temps
Partant de cette spécificité du cinéma, Deleuze décrira les signes produits à même ces images : opsignes, noosignes, lectosignes… L’originalité de cette lecture est de ne pas rapporter les images à des énoncés (tel plan nous dit que, tel cadrage signifie que), de proposer donc une sémiotique originale des images, qui ne méconnaisse pas ce qu’un film donne à voir et à penser. L’image ne se rapporte pas à des signes qu’elle illustre, elle émet elle-même des signes, qui entrent par effraction dans notre champ sensoriel et perturbent nos habitudes perceptives (là où l’habitude restreint la perception à ce qu’il est utile de voir -le feu rouge, les voitures qui démarrent, etc.- le cinéma donnera à voir la totalité du mouvement : la grande rue, la foule, la circulation dans son entier…). On peut regretter que l’article ne s’intéresse pas à ces signes. C’est parce qu’il est comme attaqué, happé, par ces signes que le spectateur est amené à rompre avec sa vision banale, convenue du réel.
Néanmoins, Paola Marrati restitue très bien l’articulation entre les deux volumes sur le cinéma, lorsque Deleuze voit dans le cinéma d’après-guerre, un nouveau type d’images, qui va rompre à son tour avec l’image-mouvement. Parce que la guerre a produit des chocs trop violents, trop énormes, qui ont bouleversé l’homme, le cinéma, cherchant à traduire ce traumatisme des combats et des destructions, invente l’image-temps -par exemple avec le réalisme italien et les villes en ruines. Le schème sensori-moteur se trouve cette fois non pas perturbé mais provisoirement suspendu, voire brisé. L’objectif de la caméra prend alors tout son sens, devenant vraiment un oeil non-humain (le kinoglaz de Vertov) : « la perception, au lieu de s’enchaîner à l’action, ne cesse de revenir à l’objet […] A quoi donnent-elles lieu, ces situations sonores et optiques pures, si elles ne se prolongent plus en action ? Elles ne sont pas simplement des images-affection, ne viennent remplir aucun écart entre une perception qui reconnaît et une action qui répond : si elles sont pures, c’est qu’elles ne font que donner à voir et à entendre. » 21.

L’acmé de La dame de Shanghaï d’Orson Welles (1948) se déroule dans un labyrinthe de miroirs. La femme, l’amant et le mari se retrouvent pour une confrontation dramatique. Ce qui vient se condenser dans cette scène de tragédie, ce sont des années de cruauté et de rancœurs entre des êtres qui sont, ainsi que le dit le héros, « comme des requins attirés par l’odeur du sang ». Un échange de tirs s’ensuit, qui fait éclater les miroirs. Les personnages deviennent peu à peu indiscernables de leurs innombrables reflets : l’actuel se confond avec le virtuel. Le mouvement perçu ne correspond alors plus du tout au mouvement attribuable à un individu agissant, à un centre d’action en général.
L’éclatement de l’image-mouvement provoque une situation optique et sonore pure (fracas de verre et de reflets) : ce qui transparaît alors est la profondeur même du temps.
Au-delà du mouvement, le cinéma redécouvre la profondeur du temps -en quoi il peut être dit profondément bergsonien. La profondeur de champ dans Citizen Kane « n’est pas un simple acquis technique : elle a une fonction esthétique et ontologique, elle sert à chaque fois à explorer une région du passé, une “nappe du passé” »22. L’espace lui-même affecté : « les lieux bien définis et reconnaissables disparaissent à la faveur de ce que Deleuze appelle des « espaces quelconques ou déconnectés » qui ne sont plus le décor approprié d’une action ou d’une situation déterminée » 23. (S’il est vrai que l’apparition des espaces-quelconques s’inscrit dans la création d’images-temps, Paola Marrati commet l’erreur de citer à ce moment un article de Réda Bensmaïa qui fait plusieurs contresens sur la notion d’espace-quelconque. J’y reviens dans le post-scriptum de cet article).
Cinéma et révolution
Paola Marrati s’attache enfin à expliquer ce qu’était selon Deleuze le grand cinéma et pourquoi il avait un sens philosophique. On l’a vu, les images des cinéastes rompent avec les perceptions habituelles du mouvement, de l’espace, du temps. Elles combattent les clichés -et selon Deleuze, beaucoup plus que dans une civilisation de l’image, nous vivons dans une civilisation du cliché. En éliminant ce que nos habitudes et notre paresse ont interposé entre le monde et nous, le cinéma renoue un lien profond, direct, avec le monde. Le cinéma devient art des mouvements de monde, art qui restitue le temps comme tel -art des potentialités immanentes.
Cette puissance a donné aux premiers temps du cinéma leur dimension révolutionnaire : art populaire, art des masses, le cinéma pouvait, selon Eisenstein ou Vertov, provoquer un choc, éveiller les consciences. Tant le cinéma soviétique que le cinéma américain ont rêvé d’un bouleversement total : utopie de la patrie de tous les prolétaires ou de tous les déracinés. « Le rêve d’Hollywood, Deleuze y insiste, n’était pas moins celui d’une transformation radicale du monde et de la création d’une nation nouvelle, du peuple à venir de tous les immigrés […] C’est pourquoi Deleuze peut affirmer que, dans ses meilleurs moments, le cinéma aura toujours été révolutionnaire et catholique […] Le catholicisme du cinéma tient au fait que, à la différence du théâtre, celui-ci met nécessairement en jeu le lien de l’homme et du monde […] La foi chrétienne et la foi révolutionnaire, loin de s’opposer, se relayaient l’une l’autre et convergent vers le nouveau à créer » 24.
On sera peut-être surpris de découvrir un Deleuze qui, loin de se rattacher au “post-moderne”, en était plutôt le critique, et n’était pas non plus dogmatiquement anti-chrétien -comme si, d’une certaine façon, il fallait sauver du dogmatisme le potentiel révolutionnaire de la religion. Deleuze nous montre qu’il ne faut pas oublier quelle a été le choc de cette invention, le cinéma -et aussi comment il a pu se dégrader à son tour, pour tomber dans les plus mauvaises formes de cinéma commercial (par exemple, le cinéma d’action qui ne cesse de de reprendre les clichés, les mots d’ordre, les mouvements et énoncés stéréotypés : un héros doit agir pour sauver le monde). Et si les images-mouvements ont pu finir dans la propagande, il demeure une potentialité contenue dans ces images plus rares que sont les images-temps, moins facilement récupérable par une idéologie, plus aptes à rompre avec l’image dogmatique de la pensée. Comment, dans ces conditions, en appeler à une révolution si le peuple manque, si le peuple uni n’est qu’une abstraction monstrueuse provoquée par l’embrigadement collectif ? Comment ne plus penser le peuple comme une masse ? L’élan de départ était là, qui était révolutionnaire et qui, virtuellement, demeure. On le voit, tout se passe comme si l’histoire du cinéma avait rejoué l’histoire des révolutions américaine et russe, et que le cinéma véhiculait ces devenir-révolutionnaires qui demeurent après l’échec des utopies.
L’étude Paola Marrati nous montre bien comment, par le cinéma, nous pouvons retrouver espoir dans le monde, dans une époque qui affiche volontiers qu’elle ne croit plus en rien tout en s’amusant à faire semblant (ironie post-moderne). Renouer un lien de croyance avec le monde, c’est croire en ce monde-ci, malgré tout. L’article montre enfin comment les deux volumes sur le cinéma influeront sur la théorie de l’art dans Qu’est-ce que la philosophie ?, en somme comment le cinéma a permis à Deleuze de renouveler sa pensée.
Conclusion
Sans prétendre offrir une présentation exhaustive de la philosophie de Deleuze, ce volume a le mérite d’offrir des analyses riches et précises en variant les angles d’approche. Il propose de ce fait nombre d’entrées dans une pensée apparemment éclectique, dont la singularité échappe aussitôt qu’on ne fait plus l’effort de la comprendre pour elle-même et d’en suivre les fines ramifications. De nombreux concepts se retrouvent d’un article à l’autre (le virtuel, les forces, l’héccéité…), autant de rhizomes parcourant les textes. Ces articles montrent de ce fait les liens entre les différentes périodes de la philosophie de Deleuze, comment et pourquoi il a renouvelé ses questionnements et ses concepts. La nécessité de la pensée de Deleuze, nécessité immanente sans laquelle il ne peut y avoir création, y est patiemment et rigoureusement exposée.
Trois parcours cohérents, pour tracer autant de plans de consistance dans l’oeuvre de Deleuze, pour retrouver l’émotion de la rencontre avec un grand philosophe.
- François Zourabichvili, Anne Sauvagnargues, Paola Marrati, La philosophie de Deleuze, PUF, 2010.
- Page 7.
- Page 9.
- Page 11.
- Page 26.
- Page 23.
- Page 35.
- Page 36.
- Page 51.
- Qu’est-ce que la philosophie ?, page 174, cité page 211.
- Page 123.
- Page 214.
- Page 202.
- Page 206.
- Cf. Le vocabulaire de Deleuze, par François Zourabichvili, chez Ellipses.
- Page 216.
- Dans son livre, Sahara. Esthétique de Gilles Deleuze (avec une lettre-préface de ce dernier), Mireille Buydens a vu nombre d’aspects intéressants de cette esthétique : le Sahara comme image du plan d’immanence, de la déterritorialisation, des devenir-imperceptibles. Cependant, elle a choisi de centrer son étude sur la notion de forme, ce qui constitue finalement un handicap lourd, puisque c’est précisément ce concept qui, selon Deleuze, est un obstacle à la compréhension de l’expérience esthétique
- Page 250.
- Page 255.
- Pages 234-235
- Page 295.
- Page 313.
- Page 296.
- Page 317.