- Spinoza anthropologue
Depuis le colloque de Cerisy de 2002 (« Spinoza aujourd’hui ») et les travaux de Frédéric Lordon (L’intérêt souverain. Essai d’anthropologie spinoziste, 2006), notamment (mais pas seulement, on peut également penser au récent ouvrage de Chantal Jaquet, Les transclasses, 2014, qui questionne la reproduction bourdieusienne à partir de Spinoza), Spinoza revient en force au cœur de nouveaux débats politiques et sociaux en philosophie. Le philosophe hollandais élabore une pensée immanente du social et du politique assez éloignée des théories de la justice qui tendent à monopoliser le champ de la philosophie sociale et politique. Certes, les travaux séminaux de Matheron (Individu et communauté chez Spinoza, 1988) ont déjà ouvert la voie en ce domaine. Mais le présent ouvrage Spinoza et les passions du social[1], tout en rendant hommage au célèbre historien de la philosophie, a une autre ambition. Plus précisément encore qu’une actualisation de la pensée spinoziste, il se propose d’établir le portrait-robot d’un Spinoza anthropologue. L’ouvrage cherche, par un dialogue de Spinoza avec les sciences sociales, à montrer ce que sa pensée peut leur apporter, voire à montrer ce qui, dans sa pensée, relève de la science sociale comme telle. A ce titre, il ne s’agit pas véritablement d’un ouvrage d’histoire de la philosophie, mais plutôt d’un ouvrage de philosophie sociale.
Le livre est composé des actes d’une journée d’études organisée à l’université François Rabelais de Tours en 2011 enrichis d’autres contributions. Mais contrairement à ce que l’on peut souvent redouter dans ce genre d’exercice l’ouvrage n’est pas un patchwork mais a une véritable cohérence d’objet. Il est, en outre, très agréable à lire malgré son niveau théorique. Il constitue une sorte de second volet du Spinoza et les sciences sociales. De la puissance de la multitude à l’économie des affects (2008) dirigé par Yves Citton et Frédéric Lordon. Il réunit des contributions d’importants chercheurs spécialistes de Spinoza ou du XVIIe siècle comme Frédéric Lordon, Kim Sang Ong-Van-Cung, Pierre-François Moreau ou Pascal Séverac pour n’en citer que certains. Il contient, en outre, un très stimulant article de Judith Butler discuté de façon fine par Kim Ong-Van-Cung.
Au cœur de l’ouvrage il y a l’anthropologie spinoziste que l’on pourrait réduire à trois affirmations centrales : l’être humain est un être d’affects, il est déterminé dans ses comportements ceux-ci, ceux-ci sont eux-mêmes déterminés par les ensembles plus larges dans lesquels ils s’insèrent. Loin de l’homme conçu comme rationalité pure, doué d’un libre-arbitre lui permettant de s’arracher à son contexte et d’acquérir une position de transcendance lui permettant de déterminer des principes de justice impartiaux, l’anthropologie spinoziste propose de penser l’homme comme un être d’affects (susceptible même d’en être prisonnier) pris dans l’immanence de ses relations aux autres. De ce fait, il propose de penser les rapports de l’individu à l’ensemble social et donc des parties de l’ensemble social sur le mode d’une réflexion sur la codétermination des affects entre les individus qui composent la multitude.
- Penser l’individu
L’ouvrage est constitué de trois chapitres qui déclinent cette thèse sous différents angles et points de vue. Le premier chapitre porte sur la façon dont le conatus (l’effort pour persévérer dans l’être) offre une approche fructueuse pour penser l’individu et les mobiles de son action. Ce chapitre commence par un dialogue entre la contribution de Judith Butler et la réponse que lui fait Kim Sang Ong-Van-Cung. Judith Butler propose de rapprocher Spinoza, Freud et Lévinas, tout en maintenant les différenciations qui sont les leurs, pour penser ce qu’elle appelle une « éthique sous pression ». Cette éthique se caractérise par la désabsolutisation de l’ego toujours exposé aux forces menaçantes que sont le rapport essentiel à la collectivité (Spinoza), la pulsion de mort (Freud) ou la transcendance du visage (Levinas). Chez Spinoza, la vie éthique est toujours fondée sur un effort de vivre. Mais cet effort n’est pas sans négativité, sans un principe dissolvant. En effet, le conatus individuel est toujours impliqué dans la socialité qui le soutient ou lui fait obstacle. Cette implication essentielle de l’individu dans la collectivité explique le caractère vulnérable de l’effort pour persévérer dans son être qui caractérise l’éthique spinoziste. C’est cet effort fragile et inquiet que Butler nomme l’ « éthique sous pression » chez Spinoza, c’est-à-dire une éthique qui ne découle pas de l’autodétermination spontanée d’un sujet moral désencastré comme dans les philosophies morales classiques. L’éthique est toujours affirmation face à ce qui expose le sujet à la possibilité de se renforcer ou au risque de sa dissolution.
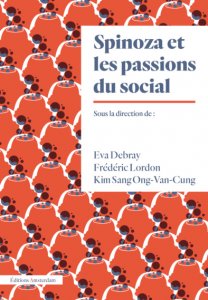
Kim Sang Ong-Van-Cung s’étonne de l’insistance de Butler sur l’usage de Spinoza dans le cadre d’une éthique de la vulnérabilité et de son rapprochement avec Freud et Levinas. Spinoza n’est-il pas un penseur de l’affirmation ? Kim Sang Ong-Van-Cung met en question l’exactitude historique de la lecture que Butler fait de Spinoza. En effet, il n’y a pas, à proprement parler, chez Spinoza de « puissance du négatif » à l’image de la pulsion de mort freudienne. Chez Spinoza, tout est affaire de relations entre des forces d’être. Kim Sang Ong-Van-Cung reconnaît néanmoins la fécondité et le caractère inspirant de la lecture butlérienne. Il est vrai, en effet, que la conception spinoziste de l’individu n’est pas individualiste. Sa conception de l’individu « est relationnelle et ouverte sur l’autre » (p. 88). De ce fait, le mode d’être du conatus spinoziste est, bien, d’une certaine manière, marquée par la précarité et la vulnérabilité bien que celle-ci ne s’explique pas par le travail de la négativité mais par le caractère interdépendant et relationnel des individus. En s’efforçant de réinvestir le conatus moins comme une pulsion de vie centrée sur soi que comme une vie engagée dans la collectivité, Butler propose bien une lecture stimulante et originale de Spinoza permettant de penser les phénomènes sociaux actuels marqués par précarité et la vulnérabilité.
Frédéric Lordon se propose de revenir sur le refus par Spinoza du libre-arbitre. Spinoza affirme l’universalité causale au sens où « rien n’existe ni ne se produit qui n’ait été déterminé par quelque cause antécédente » (p. 104). Cette pensée commence par l’idée que le conatus individuel ne s’autodétermine pas parce qu’il est toujours déterminé du dehors par des affections qui orientent sa trajectoire en produisant, en lui, des affects. Cette approche n’est qu’apparemment individualiste. En réalité, chaque conatus est affecté par la rencontre avec les autres et par la manière dont il s’insère dans des ensembles sociaux qui le conditionnent largement. Ce faisant, Lordon se propose de répondre à plusieurs objections faites par les tenants du libre-arbitre aux défenseurs du déterminisme. Il rappelle notamment les explications déterministes que l’on peut donner au phénomène des transclasses, c’est-à-dire des individus qui semblent ne pas être soumis au mécanisme bourdieusien de la reproduction sociale – reprenant, ce faisant, la thèse de Chantal Jaquet. Il montre que le passage d’une classe à l’autre peut souvent bien mieux s’expliquer par la biographie individuelle (les rencontres ou les événements fortuits) que par des décisions libres. Il pourfend également la croyance selon laquelle on doit être tenu pour responsable de nos choix parce que l’ « on a toujours le choix. » L’illusion de la réflexivité qui nous donne le sentiment que nous sommes à l’origine de nos propres choix cache, en réalité, le fait que les processus mentaux obéissent à des chaînes de causes et d’effets. Par ailleurs, l’existence de changements historiques et de transformations sociales ne prouve pas davantage que l’homme soit libre. Ils peuvent en effet s’expliquer par des rapports de force, des équilibres sans cesse mouvants qui peuvent conduire à des bifurcations historiques. Aussi pour accoucher du nouveau, l’histoire n’a pas besoin d’être animée par des sujets libres, mais peut aussi bien être le fait par d’êtres soumis aux déterminismes multiples qui les animent et expliquent leurs rapports mutuels. Spinoza permet ainsi d’échapper à une vision simpliste et pauvre du déterminisme pour permettre une compréhension complexe et fine des phénomènes sociaux.
- Logique des institutions et dynamiques socio-historiques
Le deuxième chapitre porte sur la logique des institutions. Le texte d’Eva Debray propose une lecture de Spinoza à l’aune de la théorie de l’imitation de René Girard pour penser la dynamique de la production de l’ordre social. En suivant Matheron, Eva Debray montre avec beaucoup de rigueur et de finesse que Spinoza, bien avant Girard, a proposé une théorie de l’imitation sociale et que celle-ci permet de surmonter les difficultés et limites propres à l’analyse girardienne en particulier concernant le lynchage fondateur au principe des interdits sociaux. Christophe Miqueu suggère une lecture stimulante de Spinoza au prisme de la liberté comme non-domination de Philippe Pettit. Spinoza n’appartient pas à une tradition qui place l’idéal de rationalité au cœur de la pensée politique, mais il propose, au contraire, une conception conflictuelle de la vie politique fondée sur une économie des passions. De ce point de vue, la lutte pour la liberté comme non-domination est toujours liée non pas à un point de vue rationnel mais à l’effort pour échapper aux différentes formes de servitudes qui menacent toujours de s’installer dans l’espace social. De point de vue, l’expérience de la contestation plébéienne est, en même temps, celle de son accès au statut de sujet politique. Le texte touffu et foisonnant de Nicolas Marcucci insiste sur l’importance qu’a pu avoir la lecture de Spinoza pour les pères de la sociologie française dans la deuxième moitié du XIXe siècle en vue d’affranchir la sociologie de la pensée philosophique de la morale issue de l’idéalisme kantien.
La dernière partie est composée de cinq textes portant sur les rapports de Spinoza à la compréhension des dynamiques socio-historiques. Kim Sang Ong-Van-Cung propose, à la suite d’Hadi Rizk, de faire dialoguer la pensée sartrienne des collectifs dans La critique de la raison dialectique avec la pensée spinoziste. Malgré leurs différences réelles, il y aurait, chez les deux auteurs, une pensée de la multitude se constituant en corps collectif indépendamment de tout contrat social mais par la pure et simple dynamique d’une praxis instituante. Yves Citton montre, lui, l’importance des narrations collectives (médiatiques) sur la façon dont les collectifs sont capables de s’autoaffecter, de produire et de façonner des affects communs. Les comptes (statistiques) et le conte (médiatique) peuvent alors être deux façons différentes de forcer l’agrégation des multitudes en un corps social. Nicolas Israël se propose de lire le Traité théologico-politique comme un ouvrage d’anthropologie sociale au sens d’Evans-Pritchard. Il s’attache en particulier à l’analyse spinoziste de la nature tribale-fédérative des premières formes politiques prises par le peuple hébreu pour montrer à quel point certains aspects de la pensée de Spinoza peuvent être considérées comme précurseurs de l’anthropologie sociale. Ce qui intéresse Pierre-François Moreau dans son texte est le rapport entre l’ingenium individuel et l’ingenium collectif. Pour ce faire, il propose de faire dialoguer Spinoza avec l’anthropologie culturelle. Il étudie d’une façon extrêmement fine l’action réciproque entre ingenium individuel et ingenium collectif et la façon dont ce qui est collectif trouve à s’incarner dans l’individu. Cela lui permet ainsi d’éclairer d’une façon originale et forte la récusation de la version hobbésienne du contrat pour repenser les mécanismes de l’obéissance. Enfin, la contribution de Pascal Séverac propose de mobiliser l’analyse spinoziste da la figure du prophète et la force politique du ressentiment dans le Traité théologico-politique et dans le Traité politique pour comprendre l’efficacité avec laquelle le nazisme a pu s’installer en Allemagne dans les années 1930 en suivant les analyses de Philippe Burrin (Ressentiment et apocalypse. Essai sur l’antisémitisme nazi, 2004).
Conclusion
On aura compris à l’issue de ce parcours, beaucoup trop allusif, la richesse et en même temps la cohérence d’objet qui structure cet ouvrage collectif. Si les directeurs avaient pour objectif d’accréditer la thèse selon laquelle Spinoza propose une philosophie sociale puissante et susceptible d’éclairer, aujourd’hui, les mécanismes sociaux et les questions contemporaines des sciences sociales, celui-ci est atteint. Spinoza offre un arsenal théorique puissant et fin pour établir les bases d’une science sociale complètement affranchie de la métaphysique du sujet et du libre-arbitre, sans pour autant offrir une conception simpliste ou caricaturale du déterminisme social. Que l’on soit d’accord ou non avec ce principe d’explication du social, il n’empêche que Spinoza offre un soutien de poids pour le penser. On pourra peut-être reprocher à ce collectif de manquer de systématicité, mais n’est-ce pas le propre de ce type d’ouvrage ? Il n’en reste pas moins que la plupart des contributions offrent un éclairage fin, original et rigoureux sur un Spinoza anthropologue. L’ensemble est donc particulièrement convaincant et participe, de façon salutaire, à renouer les liens distendus entre philosophie et sciences sociales.
[1] Spinoza et les passions du social sous la direction d’Eva Debray, Frédéric Lordon et Kim Sang Ong-Van-Cung, Paris, Editions Amsterdam, 2019








