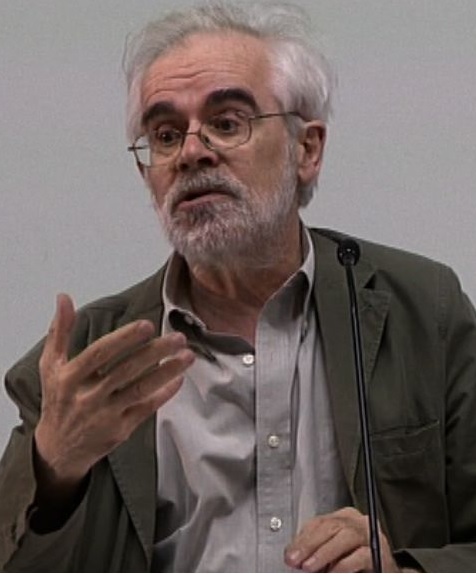Vincent Descombes est philosophe, directeur de recherches à l’EHESS. Il nous a accordé un entretien autour de son dernier livre, Les embarras de l’identité 1. Le mot identité désigne traditionnellement le référent du discours. L’identité est le nom que nous mettons sur un individu pour le désigner : « voici monsieur Dupont » ou, selon l’exemple de Frege, l’étoile du matin est aussi l’étoile du soir. Mais l’identité a acquis un nouveau sens dans les revendications politiques contemporaines ainsi que dans les sciences sociales. Voici maintenant que l’identité devrait désigner ce que je suis, ce à quoi je suis attaché, ce que je revendique comme mien.
L’identité serait désormais pourvue d’une fonction descriptive et revendicatrice. Elle serait en fait une qualité ou un ensemble de propriétés attachés à des êtres. On parle ainsi d’identité culturelle, ou encore sexuelle, nationale, religieuse etc. Elle serait éventuellement à défendre par crainte de la perdre (préserver l’identité d’une région) ; il faudrait l’affirmer (l’identité homosexuelle)… au risque de « figer » les choses dans le carcan d’une dénomination (l’identité de groupe) ; or, pour se prémunir de ce risque, des théoriciens sont amenés à forger des expressions aberrantes d’un point de vue logique (l’identité « plurielle », « multiple »…). A cause de cette confusion sur le sens des mots, nombre de discours scientifiques ou politiques n’ont aucune chance de parvenir à un minimum de cohérence. La tâche de la philosophie est de nous tirer d’embarras sur ces thématiques, en analysant l’usage des mots afin de mieux comprendre ce qu’on veut dire, aujourd’hui, quand on utilise le terme d’identité. Dans cet entretien, Vincent Descombes revient sur le passage du sens logique au sens moral et politique du mot, et il explique comment et pourquoi l’identité est devenue un marqueur de reconnaissance sociale.
Je remercie Vincent Descombes pour cet entretien vif et stimulant, et pour la minutie socratique avec laquelle il a rendu compte de son questionnement.
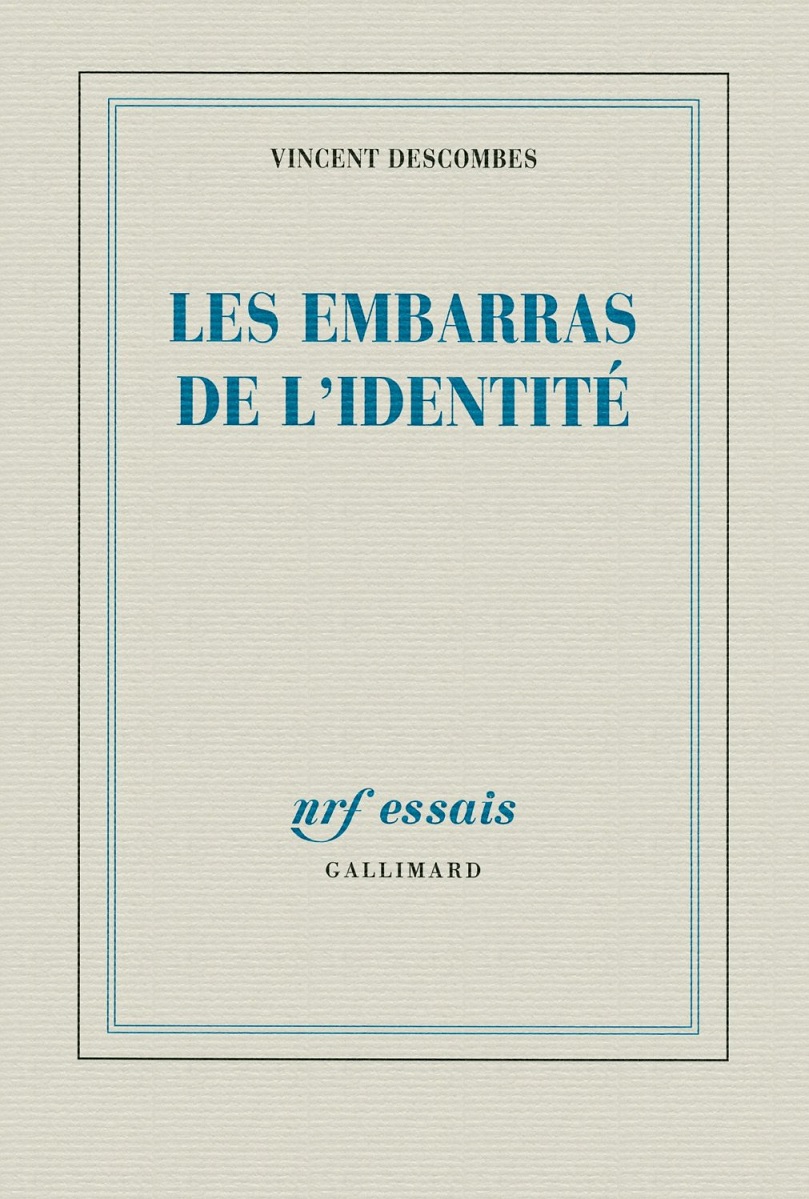 La crise d’identité
La crise d’identité
Actu-Philosophia : Comment avez-vous été amené à travailler sur la question de l’identité ?
Vincent Descombes : J’ai donné un séminaire à l’EHESS pendant six ans sur l’identité, dans le sillage de mon travail publié dans Le complément de sujet, qui en restait à un niveau assez général. Il y a dans ce livre un chapitre intitulé « L’individu moderne », où le thème de l’identité apparaît déjà. Je m’interrogeais déjà dans ce livre sur un contraste souvent noté : traditionnellement, le progrès de l’émancipation se faisait par le sujet contre l’identité -on ne parlait pas encore d’identité, mais l’idée y était. C’était l’individu contre les appartenances, les attachements… Si le sujet s’affirmait, c’était contre la tradition. Le jour où l’on s’est mis à parler des questions d’identité, l’individu s’est mis à revendiquer son identité. C’est ce renversement qui m’a intéressé. J’ai senti l’envie de reprendre ces questions de subjectivité et d’interrogation sur soi sous un angle plus contemporain. J’ai commencé à mettre le nez dans la littérature qui parle de l’identité, et je me suis rendu compte que c’était un méli-mélo complet !… Il fallait donc partir des phénomènes qualifiés d’identitaires, en posant la question « bête », la plus élémentaire : pourquoi « identitaires » ? Que vient faire l’identité là-dedans ? Que vient faire le mot « identité », dans ces revendications ? On comprend très bien ces revendications par ailleurs : les uns veulent parler leur langue et pas celle du voisin, manger leur cuisine, porter leurs vêtements… Tout ceci, on le rassemble sous le vocable de « l’identité », c’est-à-dire d’un concept qui vient de la philosophie. C’est comme cela que je suis entré dans le sujet.
AP : De quand date ce tournant dans l’usage du mot identité ?
VD : Cela vient des Etats-Unis et très exactement du transfert d’un vocabulaire de la psychologie clinique, destiné à qualifier des troubles personnels, vers la sociologie. Erikson a inventé le diagnostic de « crise d’identité ». Il précise lui-même qu’il dit « identité » là où avant lui on aurait dit « caractère ». Il cite une lettre de William James où celui-ci dit « caractère » et Erikson dit que c’est ce qu’il appelle « identité ». De la même façon, Erikson a travaillé avec les anthropologues de l’école culturaliste américaine nommée « Culture et personnalité », qui traite du caractère national. Erikson dit qu’il aime mieux dire « identité », parce que c’est plus dynamique… Pourquoi plus dynamique, je n’en sais rien, mais c’est le mot qu’il emploie !>
AP : Erikson part de l’étude de troubles individuels et il essaie ensuite de faire le lien avec des troubles collectifs.
VD : Oui, il fait ce lien. Il rattache le trouble personnel au milieu social, parce que ce trouble se produit dans des situations collectives. Par exemple, pour les émigrés qui doivent changer de repères. Ils vivent un conflit entre les attentes qu’ils ont acquises et celles de leur nouveau milieu de vie. Le trouble psychologique est donc la marque de l’inscription de l’individu dans ses différents milieux. Pour Erikson, la crise d’identité s’explique par la Umwelt, le milieu ambiant, le milieu de vie. Il y a crise d’identité quand on change de milieu. Dans un certain milieu, on a les bonnes réactions, les bonnes anticipations. On sait ce qu’on peut demander etc. Lorsqu’on change de milieu, tout cela est perdu et on est donc complètement désorienté. Cette désorientation est la marque que l’individu vit dans un groupe et même dans plusieurs groupes successivement. La crise d’adolescence est le passage d’un milieu enfantin où tout est organisé pour soi à un milieu où il faut se débrouiller sinon tout seul, du moins tout à fait différemment de ce qui était attendu d’un enfant. Erikson lui-même transpose le concept d’identité et l’étend au groupe. Il y a deux exemples intéressants : son étude sur les jeunes Sioux, qui vivent dans deux milieux, le milieu native et le milieu yankee. Rien de ce qu’ils font n’est bien puisque c’est toujours condamné dans l’autre milieu. On gagne aussi à lire l’étude d’Erikson sur la jeunesse d’Hitler. C’est un travail qui répond à une commande du département de la Défense américaine pendant la guerre. Les sciences sociales américaines avaient été mobilisées pour fournir des expertises sur l’Allemagne et sur la façon de la dénazifier après-guerre. Erikson avait semble t-il un certain génie pour la psychanalyse d’enfant. Il a donc lu les écrits d’Hitler et il rattache sa crise à une configuration de la famille allemande. Il insiste sur le fait que le jeune adolescent de la famille moyenne allemande (parfaitement illustré dans le cas d’Hitler) voit son père avec deux faces : au-dehors, le père est soumis à ses chefs, il est plat devant eux ; une fois à la maison, c’est un despote. Ce renversement est insupportable, si bien que l’adolescent allemand se révolte, devient ensuite père de famille et reproduit alors la figure détestée du père.
AP : Est-ce qu’il y a vraiment là de quoi devenir un Führer ?…
VD : Non, ce n’est pas la clef, parce que tous les Allemands ne deviennent pas le Führer ! La trajectoire psychologique d’Hitler résonne avec une insécurité des Allemands comme peuple. Il y a une incertitude des Allemands sur leur situation : sont-ils en Europe occidentale ou de l’est ?… Ils se sentent menacés de partout et c’est là-dessus qu’a joué Hitler.
AP : De là le thème de « l’espace vital ».
VD : Le succès de ce thème s’expliquerait par ces questions : qui sommes-nous (face aux Anglais, aux Russes…) ?
AP : On retrouve ces questions, sous une forme transposée, chez Heidegger, quand il parle du destin du peuple allemand et de l’insertion du Dasein dans la communauté : comment y vivre authentiquement, sans se perdre dans le « On », la moyenne…
VD : Oui mais chez Heidegger, c’est plus fumeux… Chez Erikson, c’est une brillante analyse littéraire de quelques pages de Hitler sur sa mère et sur son père, qu’il a honte de voir obséquieux devant ses chefs. Dans cette analyse, la psychologie devient sociologique, elle saisit quelque chose de collectif.
AP : Qu’est-ce que cette figure du père expliquerait chez Hitler ? Sa personnalité autoritaire, un sentiment de détresse en tant qu’Allemand ?…
VD : Le but n’est pas d’expliquer la personnalité d’Hitler. Il s’agit de comprendre pourquoi Hitler a pu signifier tant de choses pour les Allemands. L’incertitude allemande est quelque chose de beaucoup plus profond que la seule adhésion au nazisme. Erikson ne le dit pas comme ça, mais si on suit l’analyse de Plessner sur la nation allemande, nation « retardée » (die verspätete Nation), on voit que l’Allemagne n’avait pas trouvé sa définition ni ses limites. Chez Erikson, l’identité renvoie souvent aux limites à l’intérieur desquelles je me sens légitime pour m’affirmer. Nous nous situons tous entre deux pôles pathologiques : soit qu’on n’ait aucune limite, dans ce cas, on ne sait pas où s’affirmer, soit qu’on ait des contours trop rigides, qui interdisent tout échange et on aurait alors la personnalité autoritaire d’Adorno. On n’a alors plus de frontières pour délimiter l’endroit où l’on rencontre les autres, mais des murs fantastiques au sein desquels il est difficile de se définir.
Le problème identitaire
AP : Dans le livre, vous faites la comparaison avec les patients de Freud qui, eux, souffrent de ne pas être à la hauteur d’un idéal trop exigeant. Les patients d’Erikson n’ont pour leur part aucun idéal auquel se mesurer.
VD : Les patients d’Erikson sont les Américains. Ce ne sont pas les Allemands dont on vient de parler. Erikson lui-même vient d’Allemagne (même si son père était peut-être Danois). Il a lui-même vécu une crise d’identité, puisqu’il a eu une adolescence instable. Il a quitté sa famille, il a erré… Il a reproduit ce schéma romantique du jeune Allemand qui veut être artiste et dit non au monde bourgeois. Quand il parle de Hitler, il y met aussi toute son expérience personnelle. Un des problèmes d’Erikson était d’être psychanalyste mais pas médecin. Je crois que c’est un cas presque unique dans le cercle freudien. Il n’avait aucun diplôme alors que les autres freudiens étaient psychiatres. Anna Freud l’avait « authentifié » donc il tenait beaucoup à être un freudien orthodoxe.
AP : Il se raccrochait à Freud comme à une figure de père ?
VD : Non, le problème n’est pas là. Cette question d’identité n’est pas dans Freud, mais Erikson se voulait orthodoxe. Anna Freud, elle-même émigrée aux Etats-Unis, lui faisait comprendre que sa notion d’identité était trop sociale : pour elle, la psychanalyse s’occupe de l’inconscient, de phénomènes intra-psychiques. La société est quelque chose de superficiel, elle ne joue presque aucun rôle… En réalité, Erikson introduisait quelque chose de nouveau mais pour justifier son écart, il a expliqué que les troubles avaient changé par rapport à l’époque de Freud. Ce dernier avait des patients qui se sentaient insuffisants, tandis qu’Erikson avaient des patients sans modèle par rapport auquel ils auraient pu se sentir insuffisants.
AP : Comment expliquer cela ? Parce que la société américaine serait trop libérale, trop permissive ?
VD : Nous parlons de l’Amérique des années 50. Pour autant qu’Erikson donne un tableau général, ce serait dû à une transformation de la société américaine, qui sortirait du modèle de la famille rurale au 19e siècle, avec des membres aux rôles bien définis et la perspective d’une avancée possible vers l’Ouest. La question est de savoir s’il y a toujours eu des crises d’identité ou si elles apparaissent à cette époque. Je cite dans mon livre Charles Taylor, qui dit qu’à l’époque de Luther, il ne peut pas y avoir crise d’identité : Luther ne veut pas être lui-même, il veut être un pur chrétien. Il ne cherche pas à se singulariser. Taylor conclut que la crise d’identité dont parle Erikson ne commence qu’avec le romantisme, ou peut-être avec Rousseau.
AP : C’est un problème typiquement moderne, qui suppose que l’individu veuille s’affranchir et s’affirmer comme individu contre les normes sociales.
VD : C’était le schéma classique : le jeune individu, scandalisé par l’hypocrisie générale, choqué par le conformisme, mécontent qu’on veuille le diriger, décide de vivre sa vie. Ce serait la crise d’identité. Mais le phénomène identitaire se trouve au contraire chez des individus qui veulent retrouver une identité. Voilà le paradoxe dont je suis parti.
Être ou ne pas être soi-même
AP : Entendu en ce sens, vous dites que l’identité serait quelque chose qu’on pourrait perdre, donc qu’on pourrait aussi revendiquer ou vouloir changer.
VD : Où est le problème de ces phénomènes identitaires ? Bien sûr ils entraînent des conflits sociaux, des revendications politiques etc. Mais où est le problème philosophique ? Nous n’arrivons pas à penser ces phénomènes, car il y a une obscurité logique dans le qualificatif lui-même. « L’individu craint de perdre son identité », c’est une proposition complètement absurde !… Si je veux changer d’identité, je m’en vais et je vous cède la place par exemple. Mais qui craint de « perdre son identité » ?… Si nous avons un ministre qui nous déplaît, nous dirons : « nous voulons changer l’identité du ministre ». Cela signifie : « renvoyez ce type et mettez-en un autre à la place » ! Or, tout au contraire, quand l’individu dit qu’il veut changer d’identité, ce n’est pas pour devenir quelqu’un d’autre, c’est pour être lui-même (pour l’être encore plus). Alors pourquoi ce mot « identité » dans un certain emploi où il crée un paradoxe ? Voilà le problème philosophique. Il y a les problèmes politiques, les diagnostics qu’on peut porter (faut-il avoir peur des revendications identitaires ?…) Je me suis attaqué au problème conceptuel.
AP : Au chapitre III, vous faites une analyse de la fameuse tirade de Hamlet, où vous relisez le « To be or not to be » comme « To be or not to be… oneself ».
VD : Je m’y réfère pour m’attaquer au paradoxe que l’on vient de voir : comment pourrait-on changer d’identité ? Changer d’identité, littéralement, ce serait s’en aller et laisser la place à quelqu’un d’autre. Maintenant, si on entend « changer d’identité » au sens de changer de nom, au sens figuré, je peux être un espion et vouloir changer mon identité. C’est comme si je disparaissais et que quelqu’un d’autre que j’incarne prenait ma place. Mais si je dois changer d’identité au sens littéral, je dois céder la place à mon successeur. Voilà le paradoxe. Au chapitre III, je me demande comment s’emploie le mot identité en première personne, quand je parle de « mon » identité. Voilà comment j’en arrive à Hamlet. Pour qu’il y ait phénomène identitaire, il faut passer à la première personne. On peut faire une crise d’urticaire et ne pas le savoir, mais pour la crise identitaire, c’est impossible ! On ne peut pas ne pas le savoir. La crise d’identité est le nom que met la psychologie sur un trouble, un désordre de l’individu ou du groupe, qui est manifeste dans le propos, les comportements, les affects du sujet en question (individu ou sujet collectif). Il fallait trouver une explication pour la question « qui suis-je ? » Qui peut se demander qui il est ? Comment est-il possible de poser la question de l’identité en première personne ? Si je me présente devant un public, je peux dire : « Vous vous demandez qui je suis, alors je vous réponds, je suis Vincent Descombes etc. » Mais là, nous cherchons une question que le sujet se pose à lui-même. Est-il possible de se demander : « qui suis-je ? »
AP : Le sujet cherche le fond de sa personnalité, qui il est authentiquement, substantiellement, pas seulement en apparence.
VD : Oui, mais ce qu’il faut expliquer, c’est ce que vient le mot identité vient faire là. C’est la question d’un bout à l’autre.
AP : On l’emploie peut-être pour signifier qu’on recherche une singularité : ce qui me définit moi en propre et personne d’autre… Vous dites que le terme d’identité brouille ces questionnements.
VD : Il les brouille tant qu’on n’a pas trouvé un chemin pour aller de l’identité au sens que tout le monde comprend, tel que vous venez de l’employer, à la question identitaire. Au sens courant, si je demande « Qui est monsieur Dupont ? », je peux répondre : « C’est cet homme assis au fond de la salle. » Il n’y en a qu’un et nous l’avons identifié en indiquant où le trouver. Mais ce n’est pas le sens identitaire, il faut encore trouver le chemin qui mène au nouveau sens. La question de Hamlet vient de ce que « to be or not to be » est interprété au sens d’une question existentielle. Erikson lui-même y a consacré un chapitre, très supérieur aux psychanalyses habituelles de Hamlet. Pour Erikson, Hamlet pourrait venger son père. Il serait alors un bon fils, qui se conformerait à la morale traditionnelle de la vendetta. Il ferait justice au sens demandé par son père. Mais en même temps, Hamlet est un jeune intellectuel moderne. Il est étudiant en Allemagne dans une des universités les plus éclairées de l’époque. Ce système de vendetta lui répugne. Voilà où se situe la crise d’identité selon Erikson. Alors à ce moment, Erikson corrige Shakespeare – pas gêné, pourrait-on dire ! – et ajoute : « être ou ne pas être… soi-même ». « To be or not to be » est incomplet, il y a des points de suspension. Selon la compréhension habituelle de la scène, on pense qu’il faut compléter en disant : « être ou ne pas être en vie ». Accepter ou non l’existence. Mais l’idée n’est pas : « vais-je me suicider ou pas ? » Le reste de la scène ne dit pas cela. Le vrai problème de Hamlet serait plutôt le suivant : venger le père ou retourner faire des études. Mettre à mort l’assassin ou pas. Mais dans lequel des deux choix la conduite adoptée consistera-t-elle à « être soi-même » ? Faut-il choisir d’être le bon fils selon la tradition ou bien être l’individu libre qui participe aux idées modernes ? Etre soi-même ne fournit pas un critère de décision. Hamlet peut décider d’être un justicier ou un esprit moderne, mais il ne peut pas traduire son désir d’être soi-même dans une position plutôt que l’autre, puisqu’il n’y a pas de contenu à « être soi-même ».
AP : Etre soi-même supposerait de l’être avant même d’être mis face à l’alternative, d’avoir fait un choix avant même de se déterminer pour une voie plutôt que l’autre.
VD : C’est cela l’idée. Pour que je puisse faire un choix entre des possibilités qui s’offrent à moi, il faut que je puisse faire entre elles une différence de valeurs.
Le choix sartrien
AP : Mais s’il n’y a plus d’instance ultime de décision, y a-t-il vraiment un choix ? Ou bien ne suis-je pas toujours déjà déterminé ?… Dans ce cas, peut-être que j’ai toujours choisi secrètement, et la délibération n’est alors qu’une comédie que je me joue à moi-même, pour me donner des raisons après coup ? Je pense à ce que dit Sartre à ce sujet.
VD : C’est ce genre d’analyses que je voudrais contester. Pourquoi, selon Sartre, n’y aurait-il jamais de vraie délibération ? C’est parfaitement dogmatique. Sartre ne l’a pas découvert, il l’a décidé, parce qu’il en a besoin pour son système. Son système exige que je ne choisisse pas vraiment au moment où je choisis. Pour Sartre, il faut que le vrai choix soit le choix des critères du choix… Autrement dit, il faut que, derrière l’application des critères du choix qui s’offre à moi, il y ait un choix encore antérieur –celui des critères du choix ! A la fin, il n’y a aucun choix raisonné, car les raisons de choisir, je dois encore les choisir moi-même !…
AP : Vous dites qu’il n’y a pas d’identité subjective, si par là on entend une identité dont je définirais moi-même non seulement le contenu, mais encore les critères permettant de la comprendre.
VD : Oui, et c’est ce que voudrait Sartre. Et il faudrait que je choisisse le critère, mais sans critère ! J’ai parfois à choisir un critère : l’importance, la vérité, la justice, l’utilité etc. Mais il faut bien que je me reporte à un critère préexistant. Cela signifie t-il qu’il n’y a pas des cas « sartriens » où je dois choisir le critère pour sortir de l’indécision ? Non, sans doute y en a-t-il. Ce que je conteste est le dogmatisme de Sartre. Tout choix serait de ce type, purement indéterminé. Tout choix serait un non-choix. Il consisterait à tirer à pile ou face. Or, choisir, c’est préférer, selon des critères. Cette idée de préférence, Sartre n’en veut pas, car elle évoque une nature, un caractère, une histoire, des convenances personnelles… Tout cela est de « l’en-soi » qui met en danger la conscience qui néantise. La position de Sartre est donc cohérente par rapport à son système, mais elle est d’un dogmatisme invraisemblable.
AP : Vous présentez d’ailleurs une résolution au cas d’Hamlet : si on a à choisir entre la tradition et la modernité, c’est qu’on est de toute façon déjà dans la modernité, puisque dans la tradition, un tel choix ne se poserait pas.
VD : Oui, Hamlet est dans la modernité, il va à l’université.
AP : Même si Hamlet choisit la tradition, il le fait en homme moderne, puisque dans la tradition, il n’y aurait même pas à choisir, juste à respecter la coutume qui s’imposerait d’elle-même, sans que l’individu songe même à s’en détacher.
VD : Vous avez raison. C’est le problème de l’intégrisme. A une époque où une tradition est vivante et se perpétue d’elle-même, il n’y a pas de possibilité d’intégrisme. L’intégrisme est un combat moderne pour revenir à la tradition. Comme le montrent les travaux des historiens des religions, l’intégrisme accentue certains traits pour défendre ce qu’Erikson appellerait une « identité rigide » : appliquer une loi du tout ou rien à des préceptes. Par exemple, les Talibans disent que tous les hommes Afghans doivent avoir une barbe. Pas de barbe, c’est l’infidèle ; une barbe, je fais partie des fidèles. C’est l’identité intégriste, dont on montre qu’elle ne vient pas de la tradition. Les traditions sont faites pour définir les choses, mais de façon souple, tandis que l’intégrisme veut fixer les choses une fois pour toutes. Il exprime un désir d’être traditionnel alors même qu’on est coupé de ses racines. C’est une pathologie. Ce ne sont pas des phénomènes de survivances de gens sortis du passé et qui seraient brusquement amenés dans la modernité. C’est une réaction de gens modernes. Ceux qui ont commis les attentats du 11-Septembre sont des gens qui se voudraient plus fidèles à Mahomet que les musulmans.
AP : C’est la rage des nouveaux convertis.
VD : Ils en font trop. Là c’est un problème de sociologie moderne : est-ce que le mouvement de modernisation favorise l’émergence d’intégrismes ? La réponse est oui.
 Erik Erikson (1902-1994). Dès son enfance, il est confronté à un problème d’identité : « His parents kept the details of his birth a secret. He was a tall, blond, blue-eyed boy who was raised in the Jewish religion. At temple school, the kids teased him for being a Nordic ; at grammar school, they teased him for being Jewish » (Wikipédia). Il porte d’abord le nom de famille de son beau-père, Homberger. Lorsqu’il se fait naturaliser américain, il prend le nom d’Erikson, devenant littéralement Erik, fils d’Erik !
Erik Erikson (1902-1994). Dès son enfance, il est confronté à un problème d’identité : « His parents kept the details of his birth a secret. He was a tall, blond, blue-eyed boy who was raised in the Jewish religion. At temple school, the kids teased him for being a Nordic ; at grammar school, they teased him for being Jewish » (Wikipédia). Il porte d’abord le nom de famille de son beau-père, Homberger. Lorsqu’il se fait naturaliser américain, il prend le nom d’Erikson, devenant littéralement Erik, fils d’Erik !
Jugement et relation d’identité
AP : Dans le livre, vous partez d’une définition étonnante de l’identité, qui est celle du dictionnaire de l’Académie française de 1794 : « ce qui fait que deux ou plusieurs choses ne sont qu’une même ». Ce n’est pas celle qu’on a spontanément aujourd’hui. On aurait au départ l’illusion qu’il y a deux choses, et grâce à l’identité, on va dissiper cette illusion et ne plus en voir qu’une seule. Le concept d’identité aurait une vertu pédagogique corrective : « non il n’y a pas deux choses, il n’y en a qu’une seule ».
VD : Oui, c’est cela l’identité. C’est l’exemple du jugement d’identité de Frege : l’étoile du matin est aussi l’étoile du soir. Vous auriez pu penser qu’il y a deux planètes, mais nous avons découvert qu’il n’y en a qu’une. Ce qui est curieux dans cette définition de l’Académie est qu’elle vérifie par avance les remarques de Wittgenstein. Les Académiciens succombent à l’illusion que l’identité vérifie le caractère identique de la chose, comme si être identique était une qualité propre à une chose. Il y aurait deux choses et il faut maintenant concevoir une qualité par laquelle ces deux choses n’en feraient qu’une. C’est incompréhensible ! On peut concevoir deux partis politiques qui fusionnent : par exemple, le Parti Socialiste Unifié des années 1960 réunissait bien deux partis. Deux gouttes d’eau se réunissent. La fusion est possible pour certains types d’identité. Les fleuves peuvent se rejoindre et n’en former plus qu’un. >
AP : Mais dans la définition de l’Académie, il n’y avait même pas deux choses au départ, c’était une illusion. Cela me fait penser à ce que dit Clément Rosset sur l’hallucination du double. Ce double n’est qu’un fantôme. Le réel n’est que ce qu’il est, il est « idiot ».
VD : Chez Rosset, l’illusion du double sert à se consoler de la réalité. Dans la définition de l’Académie, on a exactement la difficulté d’ordre logique, qui est de concevoir l’identité comme une relation. Quelle relation, demande Wittgenstein ? Si c’est une relation entre deux choses, alors il y a contradiction, car si ce sont deux choses semblables, elles sont bien deux choses distinctes. Mais l’identité dit qu’il n’y en a qu’une. On écarte le cas où il y en a deux. La définition du dictionnaire justifie les conceptions dialectiques de l’identité. Pour concevoir l’identité d’une chose à elle-même, je dois d’abord la dédoubler, et après faire une Aufhebung.
AP : Selon Hegel, l’identité est la relation de soi à soi, donc la différence avec soi ; l’identité spéculative est donc la relation de l’identité et de la différence…
VD : Vous y êtes complètement. C’est de cette façon que l’idéalisme allemand a repris cette définition qui est celle de l’Académie français, avec cette identité double qui n’est pas double. Cette identité nous donnerait la structure de la conscience de soi. Pour qu’il y ait conscience de soi, il faut que je me dédouble en jetant un regard sur moi-même, sur un objet qui n’est pas distinct du sujet. La relation d’identité serait celle de la conscience. Mais l’objection de Wittgenstein montre l’inanité de cette définition. Si pour être conscient de soi, il faut accepter la contradiction de se penser autre que soi, tout en se pensant comme identique à soi, qu’est-ce que cela montre ? Que nous n’avons pas le bon concept de conscience de soi. Le passage par la dialectique montre qu’il ne faut pas appliquer à la conscience de soi la polarité sujet-objet. Ce serait sans doute la leçon de Hegel. Le point important pour Wittgenstein est que la définition de l’Académie est au mieux elliptique. Il n’y a jamais eu deux choses, mais deux manières différentes de désigner la même chose, comme l’étoile du matin et l’étoile du soir. Ces manières différentes de désigner la chose correspondent à des observations différentes sur elles. L’explication complète consisterait à dire qu’on croyait qu’il y avait deux choses, mais il n’y en a qu’une. Il y a identité. Non pas identité entre deux choses différentes ; mais identité de la référence des deux noms qui, eux, sont différents : « étoile du matin » et « étoile du soir ». C’est la leçon de Wittgenstein dans le Tractatus : l’identité s’exprime dans notre langage par la relation, en particulier par le jugement d’identité (l’étoile du matin est la même planète que l’étoile du soir), mais ce qui est exprimé dans un jugement de relation n’est pas une relation. Ou c’est seulement une relation entre deux désignations d’une même chose, pas une relation entre deux choses. La conclusion de Wittgenstein est celle-ci : si nous avons besoin du concept d’identité, c’est parce que nous acceptons d’avoir plusieurs noms pour une chose. Dans ce cas, il faut indiquer les cas où il y a plusieurs noms mais une seule chose.
AP : Mais quel est le rapport entre la question « qu’est-ce que c’est ? » et la question « qui suis-je » ?
VD : Le point important est que le concept d’identité n’est pas descriptif. Il sert à fixer de quoi nous faisons la description. L’identité ne dit pas quelque chose d’un objet. On ne peut pas dire d’une chose qu’elle est « identique ». « Cette chose-ci est très identique… Celle-là n’est pas très identique… » Cela ne veut rien dire. De quoi parlons-nous ? Parlons-nous de la même chose ? Voilà à quoi sert l’identité. Le sens du concept se révèle à l’usage. Qu’est-ce qu’on en fait ? La solution que j’adopte est celle de Wittgenstein : la logique de l’identité s’éclaire considérablement si on considère que c’est la logique du nom propre. De la désignation, de la référence par un nom à quelque chose. C’est en partant de là qu’on peut passer à la première personne, c’est-à-dire au nom propre. Au niveau purement logique, donner un nom à l’objet, c’est identifier l’objet qui porte le nom. C’est l’imposition du nom lors de la cérémonie à l’état civil ou du baptême. C’est le moment fondamental : donner un nom propre à quelque chose, c’est individuer ce dont on parle. Je ne parle d’un homme encore indéterminé, mais de cet homme-ci en particulier. J’individue une maison en parlant de la maison qui est là. Une fois qu’on a compris cela, on évacue tous ces problèmes d’identité rigide, ou flexible, dynamique… Identifier le porteur d’un nom n’a rien à faire avec qualifier cet objet. On donne aujourd’hui des noms à des ouragans. Le fait qu’ils portent un nom ne dit rien sur eux. Cela ne les décrit pas. Ce n’est pas la même chose de dire : « cet homme-là est monsieur Dupont » et « monsieur Dupont a beaucoup changé ». Une fois qu’on a compris cela, on a alors fait un grand pas en avant dans la clarification du concept d’identité. Dire que c’est monsieur Dupont n’a rien à voir avec dire qu’il n’a pas changé. L’identité n’est pas une qualité. Elle ne décrit pas. Elle intervient quand on doit savoir de quoi on parle, pas ce qu’on dit de la chose.
La revendication en première personne
AP : Un cas-limite est présenté par Spinoza : c’est celui de ce poète (on suppose que c’est Calderón, mais Spinoza ne le nomme pas) qui a subi une crise de folie 2. Il a oublié complètement son passé. Il ne sait plus qui il était avant, de sorte qu’il n’a plus l’air d’être la même personne. C’est toujours le même individu mais on a l’impression qu’il a changé d’identité.
VD : La décision philosophique à prendre dans ce cas est de savoir si nous dirons : c’est un changement tellement important que ce n’est plus lui mais une autre personne.
AP : En fait, on suppose que c’est toujours la même personne, puisqu’on dit que c’est bien lui qui a subi cette crise grave. Il y a eu changement, mais c’est bien lui qui a changé.
VD : Si vous faites ce choix-là (qui est celui que j’approuve !), vous dites bien que la personne, après la crise, a les mêmes parents, le même passé, la même ville de naissance etc. que la personne avant la crise. Quand on donne un nom à quelque chose, c’est pour pouvoir utiliser ce nom par la suite. Si on donne un nom au bébé, c’est pour la vie. On fixe une identité. Si le critère pour donner un nom à un nouveau-né, c’est d’être vivant, alors toutes les crises concevables sont des accidents dans sa biographie. Mais si vous étiez disciple de John Locke, à ce moment, vous diriez qu’après la crise, c’est une autre personne, puisque pour lui, la personne est le self conscient. Le self de l’amnésique ne peut pas être celui de la personne avant la crise, car il n’a pas de souvenir de son passé. Donc c’est une nouvelle personne. C’est le dualisme à l’état pur, puisqu’autre chose est le corps vivant, autre chose est la conscience.
AP : Dans les revendications identitaires, l’identité est prise en un sens différent. Ce n’est pas seulement le référent du discours. L’identité est censée dire ce qu’est la personne authentiquement. L’identité est chargée de porter des valeurs, donc de justifier des droits.
VD : Oui, une fois qu’on a clarifié la logique de l’identité, comme étant la logique du nom propre, il faut passer à la première personne du singulier. Pour résumer la dérivation que j’ai proposée, revenons à Hamlet. Comment comprendre la question « qui suis-je ? » posée par moi à moi-même ? Une des options qui se propose, c’est de dire que je suis le fils de mes parents. Ce que je serai dans le futur est fixé par la naissance. Alors on accepte une conception traditionnelle de la vie humaine. Ou bien on décide que ce que je serai dans le futur, je le choisirai moi-même –comme si ce que je suis ne dépendait pas de qui je suis dans l’état civil. Au fond, le choix est de savoir si j’ai tout dit quand j’ai décliné mon nom, mon ascendance, mon peuple… Ou bien, selon la modernité, si je dois plutôt mentionner mes performances personnelles. Voilà comment je rends compte de la dérivation du sens moral, qui est celui de la revendication de reconnaissance, à partir du sens logique. Je veux que vous jugiez non comme héritier, mais sur ce que j’ai fait. Le jugement sur moi sera le jugement sur mes actes.
AP : Si je peux choisir entre deux critères d’identité personnelle, entre mon ascendance et mes actes, qui choisit ?… Deux chemins s’offrent à moi : la modernité ou la tradition. Mais qui suis-je au moment où je me trouve devant ces deux chemins ?
VD : C’est pour résoudre cette question que je conclus le chapitre sur l’identité personnelle par le fait qu’on ne peut pas passer à une société entièrement individualiste. Qui suis-je avant d’avoir choisi ? Je suis l’individu vivant, celui qui n’a d’autre corps que le sien. La coupure avec le passé ne peut jamais être radicale. A moins de supposer comme Sartre la capacité à se choisir entièrement soi-même, en un choix transcendantal ou prénatal, comme si je m’étais toujours choisi de toute éternité. Tout ce que je suis, je l’ai déjà choisi. Si je ne me révolte pas contre mes parents, je l’ai déjà choisi… En réalité, celui qui choisit est nécessairement un être humain, fini, limité… Tout ce qu’il peut faire, c’est dire : moi qui suis tout cela, je vous demande néanmoins de reconnaître ce que j’ai fait moi-même –pour autant qu’on puisse identifier ce que serait ma propre contribution au monde. Ne me cherchez pas dans ma biographie, dit le grand artiste, cherchez-moi dans mon œuvre. Le même qui est pitoyable dans sa vie peut être admirable dans son œuvre. Mais la plupart des gens n’ont pas une œuvre… Que vont-ils montrer ? Quelque chose qui est entrelacé de ce qu’ils ont fait et de ce qu’ils ont reçu. On arrive à des résultats tempérés… Ceci dit, il est tout à fait légitime de vouloir être défini par rapport à ses œuvres.
Décliner son nom
AP : Vous partez comme Wittgenstein d’une analyse de notre usage du langage. Il y a deux aspects que j’arrive mal à discerner : l’aspect descriptif, où l’on s’intéresse à nos façons de parler et l’aspect normatif, où il s’agit de trier entre des usages légitimes, qui sont tout simplement compréhensibles, et des usages aberrants, confus…
VD : Ce qui est encombrant, c’est de partir du substantif identité, et d’en faire une qualité, comme s’il y avait en nous de l’identité, comme il y aurait de l’humidité etc. Cela ne concerne pas que le langage commun, mais surtout le langage des théoriciens. Le côté normatif de Wittgenstein s’exerce sur les pseudo-théories. La pseudo-théorie de l’identité est de vouloir en faire une qualité. Si vous regardez la façon dont des sociologues emploient le terme, vous aurez l’impression qu’ils l’emploient comme « solidité ». On parle d’une « forte identité », ou d’une identité fragile, qui serait plus ou moins une force de résistance face au changement. Le fait de reprendre sans examen le substantif, impose aux chercheurs de construire toute une théorie aberrante. On n’arrive pas à définir ce que serait cette « identité » propre aux choses. Alors le discours se détruit lui-même.
AP : Vous parlez de cet exemple pris dans un guide de voyage : « ce quartier populaire a su conserver son identité ». On comprend qu’il a su garder son charme, sa spécificité… Mais cette façon de parler paraît illégitime.
VD : Oui, l’exemple du guide est amusant. Il parle du charme qu’a gardé pour nous ce lieu, des gens qui habitent là, qui ont conservé ce qui les distinguait des voisins etc. C’est tout cela qui est résumé par le mot d’identité. Il montre à quel point ce sens est entré dans le langage courant. Mais ce que je conteste, ce n’est pas cet usage, que l’on comprend très bien, ce sont des théories aberrantes (les discours sur l’identité plurielle par exemple), qui omettent de nous dire comment le mot peut changer de catégorie logique. Comment passe-t-on de l’identité comme référent à l’identité comme ensemble des choses que je revendique, auxquelles je suis attaché dans ma vie ? Si on développe aujourd’hui des théories paradoxales de l’identité, c’est selon moi parce qu’on est embarrassé d’employer l’identité au sens logique. Les chercheurs auront peur d’identifier, car ils croient que cela va figer, homogénéiser, s’opposer au devenir etc. Ils s’imaginent congédier ce risque en parlant d’identités multiples, d’identités changeantes. Ce qui est incompréhensible. Si j’ai plusieurs identités, c’est que j’existe à plusieurs exemplaires. C’est que quelqu’un me succède sans arrêt. Or, ce n’est pas cela qu’on voulait dire. Si on n’a pas expliqué cette nouvelle signification, on est amené à produire des pseudo-théories qui encombrent l’espace de la recherche, qui brouillent la compréhension de nos situations contemporaines.
AP : Faudrait-il se contenter de l’identité au sens logique, et trouver d’autres mots à la place de l’identité des identitaires ?
VD : C’est là une mesure qui a été proposée par des auteurs qui condamnent le mot. Quelqu’un peut, en tant qu’écrivain, trouver que le mot n’est pas gracieux… Mais notre rôle, en tant que philosophes, n’est pas de légiférer. Si le mot est entré dans le langage commun, nous n’avons pas à dire que ce que font les gens est illégitime. Ce que nous avons à faire est de comprendre. Si l’on parvient à faire la dérivation correctement, alors on a fait le travail. Il se trouve qu’identité a remplacé caractère, personnalité… Il est plus vague, donc il a permis à ceux qui l’utilisent de développer un champ sémantique plus vaste, en y associant d’autres phénomènes, y compris la subjectivité et la première personne. Le caractère national est visible pour l’observateur. Quand Emile voyage en Europe avec son précepteur, Rousseau dit qu’ils iront surtout voir des populations aux mœurs bien marquées. Il n’y a pas encore le mot identité, mais l’idée est là : ces peuples sont bien distincts, leurs manières de vivre témoignent d’une vigueur nationale. Par exemple, le voyageur sera frappé par le caractère des gens du Tyrol. Mais les intéressés ne sont pas tout à fait au courant de leur couleur locale en tant que telle. Les Bretonnes ont leurs coiffes mais elles ne se sont pas demandé comment sont les coiffes des autres. Identité a été employé dans ce nouveau sens, car tout le monde sait ce que signifie se présenter devant les autres. « Veuillez vous présenter »… On décline son identité. Le mot s’est imposé car il renvoie à cette opération de la vie sociale où l’on se présente aux autres. Si l’on remonte à cette opération, on retrouve la logique du nom propre, que ce soit à l’échelle individuelle ou à l’échelle collective (la communauté à laquelle nous nous rattachons : tel hôpital, l’EHESS etc.). Le nom est chargé de toutes sortes de significations, car il y a une histoire collective. Si on dit identité, c’est pour renvoyer à ce moment de la présentation. On s’adresse aux autres. Si nous n’avions de débat qu’avec nous-mêmes, il n’y aurait pas de problème d’identité.
L’identité collective
AP : A quelle condition cette identité peut-elle être réelle, pas fantasmée ? Je prends un exemple simple : Nietzsche se réclame dans Ecce Homo d’une ascendance polonaise 3. Il dit appartenir à cette race-là (et pas à la race allemande, qu’il méprise). Comment faire le tri entre les revendications qui ont un sens et celles qui sont aberrantes ?
VD : C’est le problème des généalogies fantasmées, que ce soit par ironie, ou par folie (car il y a aussi les cas de délires, comme celui du président Schreber). Il est intéressant d’abord car il montre que la rêverie sur la généalogie a une fonction de légitimation. Une signification est investie dans le fait d’avoir des ascendants polonais, dans le cas de Nietzsche. Comment se fait-il qu’on aille chercher un fondement, un renfort, dans le passé ? L’exemple de Nietzsche est d’autant plus frappant qu’il appartient à la modernité la plus extrême. On voit bien la bifurcation, comme chez Hamlet. Dans le cas des peuples, il y a une course à la légitimation par le passé. Si on va à Bologne, on constate que les gens n’y sont pas peu fiers d’avoir la plus vieille université d’Europe. Les gens de la Sorbonne disent que c’est presque eux qui sont les plus anciens. Est-ce du traditionalisme, une sorte d’imbécillité conservatrice ? Oui, parfois. Mais dans le cas des collectivités, s’il y a un passé illustre, alors nous avons des exemples de gens avant nous qui ont mis la barre très haut. Marcel Gauchet fait le constat qu’il y a une déprime dans la France d’aujourd’hui. Une hypothèse que l’on pourrait faire, c’est que nos concitoyens ne se sentent pas à la hauteur de leur passé. Voilà le premier point. Dans le passé, on cherche une légitimité qui est aussi une admonestation : nous devons être à la hauteur. Cela permet bien sûr toutes les mystifications.
AP : « Nos Ancêtres les Gaulois… » La France d’après la défaite de 1870 se cherche une grandeur dans le passé, face aux Allemands sur qui il y a une revanche à prendre.
VD : D’après Claude Nicolet, on avait là un débat plutôt franco-français, sur l’origine des classes. Le populo descendrait des Celtes, alors que la noblesse viendrait des envahisseurs germains… Laissons cela, qui n’intéresse pas directement notre discussion. Il y a une raison de se tourner vers le passé, qui est en réalité l’avenir. On se légitime par le passé, mais contrairement à ce que dit Popper (qui déplore qu’on se sente affecté par le passé), c’est l’avenir qui explique cela ! Le passé est là pour donner des repères afin de se projeter dans le futur. La crise d’identité survient au moment où je ne peux pas me projeter dans l’avenir, car mon passé ne me donne aucune lumière. C’est le cas d’Erikson, l’Allemand qui débarque aux Etats-Unis, qui doit apprendre toutes les pratiques locales. Il doit renaître en quelque sorte.
AP : Bourdieu parlerait d’un habitus clivé. Erikson doit devenir un vrai Américain et faire oublier qu’il était Allemand.
VD : Tout à fait. La thèse d’Erikson est que les psychanalystes ont fait l’impasse sur la vie sociale. Il fait remarquer que lorsqu’un psychanalyste publie un cas, il change le nom et la profession de son patient. Erikson dit que si on ne connaît pas cela, on ne peut pas comprendre le problème de quelqu’un. Si je change un professeur en charcutier, cela ne va pas ! Il est rare qu’Erikson fasse une critique. Or, il dit que les psychanalystes ignorent la Umwelt, le milieu ambiant de la personne. La réalité extérieure, welt, peut avoir une définition physique. Tandis que la Umwelt, je la porte en moi. C’est l’habitus des sociologues. Je porte en moi les pratiques d’un milieu. Il y a donc crise si j’entre dans un milieu qui n’est pas le mien. L’autre point intéressant sur les généalogies fantastiques est que l’ascendance des parents, des grands-parents existe, indépendamment des moyens qu’on a de la connaître (si les documents manquent par exemple). La généalogie est réelle. Peut-être est-elle moins glorieuse que celle à laquelle je prétends. Le moment délirant serait celui où un sartrien dirait : je choisis mes ancêtres ! Même chose dans le cas des collectivités, quelle que soit l’échelle. Les gens racontent l’histoire de leur groupe. Toutes sortes de mystifications peuvent s’introduire, y compris des mystifications intéressées, afin de se glorifier. Il y avait l’idée que notre capitale s’appelle Paris car nous descendrions des Troyens, de Pâris… C’est plus chic ! Absurdité, bien sûr. Il y a des identités à toutes les échelles, des esprits de corps très marqués : les grands corps de l’Etat. Le quai d’Orsay, la Marine Nationale, les facultés de droit… Cette référence au passé n’est pas une science historique. Mais si tout n’est pas vrai, est-ce que tout est faux ?
AP : Il est courant d’embellir le passé.
VD : Oui, certainement. Et on a intérêt à avoir une solide école historique pour critiquer ces dérives. Mais il n’en reste pas moins qu’on ne peut pas ignorer sa propre histoire. Ici, dans cette École, nous avons fêté il y a quelques années notre anniversaire. Nos historiens ont alors fait une histoire de l’EHESS. Cela fait partie d’un groupe d’avoir à se présenter lui-même, s’il se conçoit pour lui-même un avenir. La façon de le faire est de se nommer, donc de se réclamer de son histoire. Au Japon, l’Empereur descend d’une déesse. Bien entendu, c’est un mythe. Mais est-il surprenant que les sociétés se pensent elles-mêmes dans des mythes ? Les sociétés se construisent selon des représentations, qui sont leurs propres productions. Je distingue donc avec Castoriadis deux sens du mot « imaginaire » : d’abord, irréel, au sens d’inexistant, et ensuite, imaginaire au sens d’instituant. L’imaginaire instituant n’est pas la re-production de quelque chose d’absent. Ce serait l’imaginaire trompeur (comme dans les promesses imaginaires). L’imaginaire instituant reprend des éléments de notre histoire en vue d’exprimer la représentation et la volonté collectives. Le « nous » d’une collectivité repose sur l’acte d’imagination, mais cela ne veut pas dire que cela soit une mystification. C’est une création humaine.
AP : Castoriadis s’oppose à l’idée marxiste que la survivance des mythes serait la preuve qu’une société est encore aliénée et n’a pas atteint la conscience réelle d’elle-même. Le mythe serait aliénant (l’ascendance divine de l’Empereur du Japon masquerait les luttes de pouvoir pour conserver l’ordre social).
VD : Oui, il s’oppose à cette idée de survivance et aussi à l’idée que le mythe serait un reflet sans intérêt de la réalité sociale. Si le mythe est utilisé pour justifier le maintien de l’ordre établi, alors Castoriadis dirait que c’est l’hétéronomie à l’état pur. Le mythe peut justifier une domination oppressive. Mais ce n’est pas parce qu’il y a un élément imaginaire que c’est oppressif. Les gens acceptent le mythe car cela leur donne une certaine idée d’eux-mêmes. Il faut que nous puissions dire de ce que nous sommes et ce que nous voulons continuer à être. C’est la volonté générale de Rousseau. Ce « nous », quand il existe, fait l’objet d’une acceptation collective.
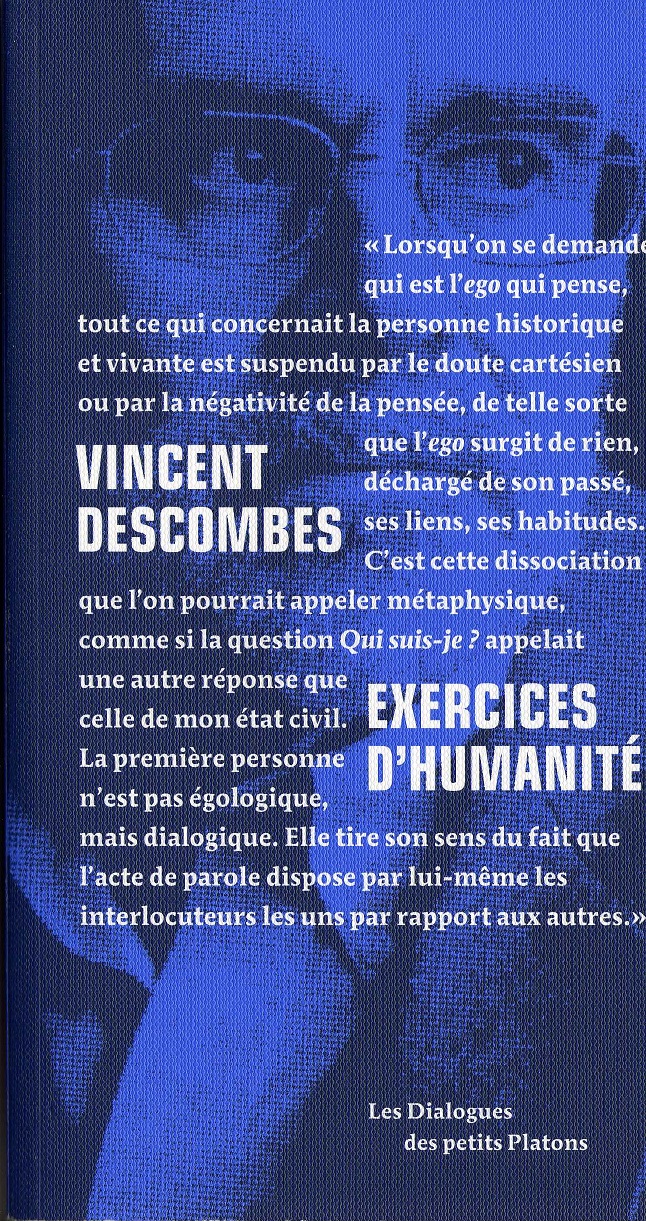 L’identité politique
L’identité politique
AP : La question est : comment instituer un collectif, un tout ? Dans votre livre d’entretien 4, vous faites une distinction entre deux sens de totalité : le tout comme omnis ou comme totus. Pouvez-vous l’expliquer ?
VD : Je crois ce point décisif en philosophie politique. Accepte-t-on ou non un concept de tout comme totus, c’est-à-dire un tout composé de parties ? Ce point est fondamental. La sociologie durkheimienne est globale : la société est un tout. Au contraire, les anti-durkheimiens veulent bien des individus sociaux, mais sans totalité sociale.
AP : Vous faites référence à l’individualisme méthodologique.
VD : Oui. Les gens croient avoir un concept de totalité, mais ils le tirent d’omnis. Qu’est-ce qu’omnis ? C’est le quantificateur qui permet de former la proposition universelle de la logique : tout Athénien est Grec. Voilà omnis. Ce tout revient à dire que nous considérons un exemplaire quelconque dans un genre donné au sein d’une classification. Un Athénien, quel qu’il soit, est Grec. Prenez un homme, celui que vous voulez : si c’est un Athénien, c’est un Grec. Nous retrouvons là l’opposition universel/particulier. Ce qui introduit en pratique la question de l’universalisme. Le mot vient de la théologie : tout homme est appelé au Salut. Sur le terrain politique, on dira que tout homme est destiné à jouir des droits de l’homme. Avec omnis, il y a un tout, mais il n’y a pas de parties. C’est le tout de l’individualisme méthodologique. Vous trouverez des philosophes très sophistiqués qui croient qu’appartenir à un groupe est un phénomène de classification. Appartenir à l’ensemble des Français, c’est comme appartenir à l’ensemble des gauchers. Je fais partie d’une liste. Les obèses, les maigres, ce sont des ensembles au sens purement logique. Or, appartenir à un tel ensemble n’a aucune dimension sociale. Pour avoir la dimension sociale, il faut le tout comme totus, car le sort de la partie est alors liée au tout. En latin, on ne peut pas faire la confusion. Totus veut dire tout entier, par opposition aux parties. Le mot totus nous donne la société au sens de Durkheim, avec les solidarités mécaniques ou organiques. L’idée qu’on aurait des droits du seul fait d’appartenir à une totalité – les droits du citoyen – découle donc de totus. La métaphore organique de la société ne convient pas à la totalité sociale, pour la raison que je développe au chapitre IV des Embarras de l’identité : si on devait penser une totalité sociale comme organique, il faudrait la concevoir, à la façon des théologiens médiévaux, comme un corps mystique. Pour eux, l’Eglise chrétienne est un tout dont les parties ne sont pas données simultanément, mais dans une suite de générations. Une collectivité est une suite de générations. Les membres en sont donnés les uns à la suite des autres. Cette succession, c’est le collectif au sens de la société globale. L’identité collective pose question quand une génération se demande qui elle est par rapport au passé et à l’avenir. Voilà le moment de vérité.
AP : Il faut alors que cette collectivité s’affirme par l’emploi d’un nom qui reste fixe, alors même que les membres particuliers changent au cours du temps.
VD : L’intérêt de revenir aux noms est de faire le lien avec la logique. Les gens se disputent sur l’identité nationale, européenne, bretonne… On comprend pourquoi politiquement. Alors, à quoi sert la philosophie dans ce genre de débats ? Elle doit être éclaircissement de concept. Quel critère donnons-nous à un être collectif national ? Qu’appelle-t-on Europe ? Si on n’est pas capable de le préciser, on ne sait pas de quoi on parle.
AP : Ce qu’on craint par exemple, ce sont les pertes de souveraineté des nations, par transfert de responsabilités à des entités supra-nationales. La nation craint de perdre son identité en se dissolvant dans un tout supérieur.
VD : Ce que j’espère avoir fait dans le livre, par l’analyse menée, c’est de poser la question : nous parlons de perte d’identité, oui, mais que perd-on si on perd son identité ? Chez les Allemands, la Nation précède la souveraineté populaire. Quand Fichte écrit un discours à la nation allemande, il n’y a pas encore de nation allemande politique, seulement culturelle. Il s’adresse aux peuples de langue allemande et de descendance germanique. Aujourd’hui encore, les Allemands de Russie peuvent revenir en Allemagne. Pour nous, c’est inouï ! C’est comme si les Québécois pouvaient entrer automatiquement en France (chose qu’ils n’ont pas envie de faire, mais c’est une autre affaire) ! Quelle idée bizarre… pour nous ! En revanche, la Nation au sens français est fondée par la République. A Grenoble, il y a un monument qui célèbre la réunion du parlement local en 1788, où les trois ordres se sont réunis, avant même l’assemblée au Jeu de paume. Les Dauphinois prétendent qu’ils ont été les premiers à faire la Révolution un an avant Paris. Le monument porte une inscription qui rend gloire aux parlementaires d’avoir affirmé les droits de la Nation. La Nation est prise là au sens politique. Que craint-on de perdre avec la Nation ? L’identité de la Nation politique, linguistique, ethnique ?… Si vous dites que vous avez peur de perdre la souveraineté, alors vous parlez de la Nation politique. Vous pouvez craindre de ne plus avoir l’exercice de la souveraineté de la Nation, ou bien de perdre tout exercice de souveraineté. Ce qui est en cause est l’identité européenne. Est-ce l’identité d’une nation européenne à venir, d’un continent ?… Nous sommes censés débattre de nos identités, mais ce concept d’identité est employé d’une telle façon qu’il n’y aura pas de solution à ces débats. Faut-il aller vers une identité non-politique ? Si l’Europe exerce une souveraineté, ce sera face à d’autres États nationaux. Mais si l’Europe est post-nationale, quelle souveraineté pourrait-elle exercer ? Et si elle est souveraine, comment évitera-t-elle d’être, vue du dehors, une puissance nationale, tout comme les États-Unis d’Amérique ?
AP : Comment peut se faire le choix du critère de l’identité collective ? Par un appel à la volonté générale ? Par l’imaginaire instituant dont parle Castoriadis ?
VD : Si on ne se contente pas de perpétuer la tradition sans y réfléchir, cela passe par un acte d’institution. Cela doit être un moment de l’imaginaire instituant. Qu’est-ce qui en résulte pour nous, individus citoyens ? C’est à chacun de se poser la question du critère. Dans les débats sur le communautarisme, demandons à chacun : quel critère pour l’entité collective que vous défendez ? A quelle condition est-elle légitime ? Le résultat de l’explication logique du concept d’identité peut être résumé par le mot de Quine : pas d’entité sans identité. Je dois avoir un critère d’identité pour savoir que je parle de la même chose que tout à l’heure. Par conséquent, l’identité collective que quelqu’un reconnaît est celle de l’entité collective dont il pose la réalité. Si des gens veulent une identité ethnique mais pas d’identité nationale, cela veut dire qu’ils croient à la réalité d’un groupe ethnique mais pas d’une nation. En revanche, si l’on croit que l’existence d’un corps politique est légitime, alors on pose la réalité de la nation au sens moderne, celle d’une communauté politique des citoyens. Auquel cas les identités communautaires ou religieuses ne peuvent être que subordonnées. C’est cet ordre des priorités qui est en question. On ne peut pas commencer à les discuter si on n’est pas conscient qu’à chaque fois, on applique un critère d’identité, celui qui permet de nommer le groupe auquel on se rattache.