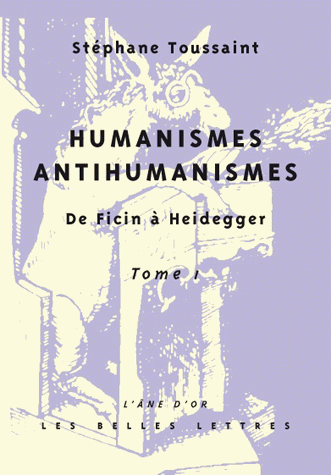Entretien avec Stéphane Toussaint : Autour d’Humanismes et antihumanismes (partie 1)
Propos recueillis par Thibaut Gress
Actu Philosophia : Avant d’aborder en profondeur les réformes que vous dénoncez dans le cadre européen, et puisque vous l’évoquiez à l’instant, je souhaiterais éclaircir la place qui revient à Heidegger au sein de votre pensée ; il ne fait aucun doute que la pensée heideggérienne est antihumaniste, ou, à tout le moins, fortement hostile à l’autoposition du sujet ainsi qu’à son autonomie, puisqu’avant le sujet, il y a en permanence ce phantasme de l’origine, ce phantasme de l’Etre. Néanmoins, votre ouvrage clôt la première partie sur Heidegger et ouvre la seconde sur la rentabilité comme forme maximale de l’antihumanisme : comment faut-il comprendre cet enchaînement ? Est-ce une manière implicite de poser Heidegger comme un penseur de la rentabilité ? Il est en effet tentant de répondre non, et il suffirait de songer aux multiples condamnations heideggériennes de la technique comme moyen d’arraisonnement, dont on pressent que derrière cela se profile un refus de la rentabilité économique liée à cette exploitation de la nature. De surcroît, la vulgate heideggérienne ou l’image que l’on a de ce penseur évoque davantage celle d’un penseur fondamentalement hostile à la rationalisation des rapports et donc hostile à une certaine forme de rentabilité, à laquelle il préfère une ressaisie de l’Origine par une écoute accrue de l’Etre, grâce, notamment, au langage poétique. Cette image là de Heidegger fait de celui-ci un penseur certes antihumaniste mais que l’on ne saurait rallier à une quête de la rentabilité.
Pourtant, à mieux y regarder, on pourrait penser que la notion d’outil, telle qu’est développée dans Sein und Zeit, est très problématique. Levinas, dans Totalité et infini, avait noté à juste titre que l’outil ou l’ustensile renvoyait nécessairement à un monde d’exploitation et excluait toute satisfaction dans le cadre d’une quête indéfinie d’efficacité[1]. Hubert-Louis Dreyfus a, lui aussi, noté l’ambivalence de la notion d’ustensilité heideggérienne, faisant de la nature une région d’être qui ne peut être rencontrée que sur le mode de l’utilité. La priorité ontologique est accordée à la fonction ustensilaire faisant de tout étant une réserve de fonds par essence inépuisable[2] si bien que l’on est désormais en droit de se demander si, malgré les condamnations répétées de la technique, Heidegger n’aurait pas, par la médiation de l’ustensile, pensé le monde sous des rapports utilitaires et, partant, sous les rapports de la rentabilité. Pourrait-on ainsi penser, selon vous, une assise théorique de la rentabilité chez Heidegger, et ce nonobstant l’image courante que l’on a de celui-ci ?
Stéphane Toussaint : Le problème de Heidegger s’est imposé à ma recherche différemment, tout à fait en marge de la « question de l’outil » qui se met en place à partir du paragraphe 15 de Sein und Zeit. Vous vous souvenez de ces fameux passages où Heidegger définit l’utilisation de l’outil par son acte (comme le marteau qui martèle) et par le «ce pour quoi» il est fait. Heidegger montre qu’il n’y a nulle «pureté» dans les choses ainsi réduites à l’état d’outil. En bref, l’ustensilité heideggerienne, pure utilisation ou « utilisabilité », finit par effacer l’existence de choses gratuitement données, à tel point que l’outil n’a plus d’être au sens fort. Or, une contradiction cruelle traverse l’œuvre de ce Heidegger « antiutilitaire » : c’est, bien sûr, son soutien à l’utilitarisme nazi. Utilitarisme qui commence par l’asservissement de la paideia, à laquelle l’auteur de Sein und Zeit a librement contribué, et se termine par les usines de morts, pour lesquelles il n’a jamais montré aucune douleur ni aucune honte. Que se passe-t-il de 1933, Discours du rectorat, à 1949, Conférences de Brême ? Les apologies nous disent que tout a changé. Mais rien n’a changé dans le bilan moral heideggérien, ni sur la prétendue « grandeur du nazisme », ni sur l’incapacité à penser la mort des innocents. La seule « innocence » que Heidegger tenta de sauver fut la sienne. Attitude typiquement nazie. Voyez Carl Schmitt, Ernst Jünger ou encore Leni Riefenstahl. Mais passons. La question de fond se présente sous un autre jour. Heidegger semble ne pas « voir » les millions de Juifs et autres victimes d’Hitler, opposants politiques et religieux, malades mentaux, tziganes, homosexuels, comme s’il était littéralement privé d’yeux philosophiques pour leur être authentique, donc pour leur mort authentique. S’ouvre le gouffre du ténébreux regard heideggérien, avec tout son insondé phénoménologique. J’insiste : quel rapport entretiennent l’outil sans être et la victime sans être ? Tout se passe bien comme si l’utilisation de l’homme – dont je traite dans l’étude sur la rentabilité – justifiait la soustraction ontologique pure et simple des victimes.
AP : Venons-en, après cette sévère mise au point sur Heidegger, au cœur de ce qui ressemble à un drame, à savoir à la rentabilité et son produit, l’employabilité.
Pardonnez-moi si, avant de vous poser des questions plus précises, je fais une pause sur un mot qui m’était rapidement venu à l’esprit en lisant votre ouvrage et que vous avez-vous-même employé spontanément au cours de l’entretien ; ce mot est celui d’aristocratie. Vous parlez de la « qualité de l’aristocratie morale » du lettré, aristocratie morale emportée au tombeau par le rouleau compresseur de la rentabilité ; votre ouvrage est lui-même émaillé d’un certain vocabulaire confinant à ce que j’appellerais un « esthétisme aristocratique » ; vous évoquez par exemple page 198 de « misérables serments linguistiques » ; de même, page 230, au sujet de Readings vous écrivez qu’une « performance aussi derridienne sur l’educatio ne serait pas méprisable si elle s’appuyait sur une autre philologie. » Il serait aisé de multiplier les exemples d’un vocabulaire qui procède d’un champ lexical qui me paraissait justement tout à fait aristocratique, non pas au sens social, mais au sens intellectuel. De là ma question : considérez-vous votre position comme intellectuellement aristocratique et, si oui, en quel sens faudrait-il l’entendre ?
ST : Pourriez-vous me dire en quoi « misérables » et « ne serait pas méprisable » sont plus aristocratiques qu’« il serait aisé » ou « et ce nonobstant », que vous employez ? À l’évidence (autre expression aristocratique ?) nous manions tous deux une langue châtiée, fruit de notre bonne éducation et de nos bonnes lectures. À moins que nous ne détestions tous deux la vulgarité ? Auquel cas vous visez un ton plus qu’un lexique, et derrière le ton, l’essence d’une attitude morale : un souci d’élégance jusque dans la lutte d’idées. Dans le passage incriminé, que je décrypte pour vous, j’épingle ce que je crois être une méprise philologique de Readings, lequel interprète educare, éduquer, comme e-ducare, extirper ; après quoi je me plais à qualifier sa méprise de « non méprisable » si seulement l’auteur avait accepté, comme Derrida, de jouer à fond le jeu de la pure association d’idées : une philologie « autre » pour une philosophie de l’Autre. Pourquoi ai-je parlé d’un souci d’élégance ? Par pure esthétique ? Non pas. Ce que vous touchez de votre remarque, apparemment personnelle, sur ma position intellectuelle intéresse, en réalité, la nature d’une politique générale entre le nombre et la valeur, le peuple et l’individu. Peut-on encore penser aristocratiquement en démocratie ? Je serais tenté de répondre par l’affirmative, puisque le philosophe devrait refuser la massification des idées par le nivellement médiatique. Le premier pas consiste, pour lui, à maintenir une finesse de langage dans la clarté. Finesse à l’égard des concepts ; clarté à l’égard des lecteurs. Par ce biais, l’aristocratie intellectuelle véritable, je dirais même nécessaire à la démocratie, consiste à s’adresser en toute circonstance à la meilleure part des individus, à leur intelligence, sans altérer ce rapport ni par la vulgarité, ni par l’obscurité. Car l’aristocratie intellectuelle s’érige aussi, à l’inverse, contre le snobisme conceptuel. Certaines pages de Heidegger, de Derrida et de leurs disciples procèdent d’une attitude délibérément antidémocratique, méprisante envers l’intelligence collective, qui n’a rien d’aristocratique pour autant.
AP : Certes, mais en posant la question de l’esthétique aristocratique, je visais à travers votre lexique non pas un style de langage mais une disqualification de thèses en fonction de termes impliquant une certaine valeur : « méprisable » renvoie à l’idée d’honneur, « misérable » renvoie à l’idée de grandeur ; ce n’est pas le cas d’un « nonobstant » qui, tout au plus, indique une certaine préciosité de langage. A mes yeux, on ne peut employer le terme de « misérable » que si l’on fait sien le souhait de la grandeur, et à ce titre, on pourrait y voir une marque aristocratique. Mais cela n’était qu’une remarque incidente ; nous pouvons à présent pénétrer le cœur de votre seconde partie consacrée à la rentabilité ; c’est une partie plus polémique, plus politique ai-je envie de dire, très informée, où certains documents sont cités longuement, par exemple la déclaration de Bologne, le Discours de la Sorbonne, et où sont analysés l’impératif dévoyé d’excellence, l’exigence d’employabilité à l’issue du cursus universitaire, autant de points que l’on pourrait résumer par cette citation de la page 216 : « Concevoir que le marketing puisse diriger l’éducation et la culture n’est pas vraiment troquer la vieille âme humaniste, épuisée par les siècles, contre un jeune esprit européen, mais renier en bloc l’humanitas avec tout l’héritage philosophique qu’elle a préservé. C’est encore contrevenir délibérément aux lois de l’humanité, puisque l’humanité n’a pas seulement des droits mais des lois, dont la première est inscrite dans cette maxime de Friedrich Niethammer, l’inventeur même du mot Humanismus : « chaque tentative d’employer une éducation assertive est une atteinte à l’humanité ». »
Ma première question portera justement sur l’origine destructrice de ce qui se joue aujourd’hui dans la mort de l’humanitas : le constat que vous faites est quasiment implacable, et l’on peut donc se demander si ce mouvement que vous décrivez si bien procède d’un moteur conscient. En d’autres termes, la fin des humanités est-elle clairement programmée ou n’est-elle qu’un dommage collatéral de l’impératif généralisé de rentabilité ?
ST : Le seul moteur conscient que nous proposait la philosophie était Dieu, et peut-être les intelligences angéliques. Pour le reste, je ne connais que des moteurs inconscients ; des mécaniques tristes transmettant des ordres rentables. Ces ordres, dans quel esprit sont-ils donnés ? Afin de tirer un maximum de profits économiques de l’éducation. Et dans quels buts ? Pour ne plus dépenser un seul sou dans les disciplines dites inutiles, comme le grec ou la philosophie, et pour mieux vendre aux étudiants les disciplines marchandes, celles qui donnent, dit-on, un métier. Sur ce point, l’actualité me donne raison chaque jour. D’où la nécessité, pour les réformateurs, de transformer, de gré ou de force, l’art d’enseigner et l’art d’apprendre des humanistes en un « lifelong learning » ou une «formation tout au long de la vie» qui se situe aux antipodes d’une transmission des savoirs, puisque le « lifelong learning » réduit les études à l’acquisition de compétences au service des entreprises. Deux types d’acteurs rendent ces décrets : les illettrés au pouvoir, grande majorité ; et les lettrés honteux, leurs complices, minorité redoutable. Les premiers écrasent les lettres par aveuglement ; les seconds les disqualifient par ressentiment.
AP : J’ai tout de même l’impression que, pour échapper aux accusations de « théories du complot », vous ayez évacué la possibilité d’un programme conscient de destruction des humanités, notamment page 193 : « Vigilants mais naïfs, beaucoup d’humanistes croient alors discerner les agissements d’un être malveillant, d’un complot à grande échelle : le grand dessein d’un cerveau ennemi. Or, il n’y a nul docteur Mabuse dans les parlements, puisqu’il n’y brille aucun génie, pas même celui du crime. En définitive, il semble que la forme contemporaine de la fausse volonté n’accumule pas tant de haine envers les humanités qu’un mépris affiché pour leur rentabilité ridicule. » Je dois avouer que cette réfutation me semble plus rhétorique qu’autre chose ; tout se passe comme si vous transfériez la conscience d’un programme à un marché hypostasié en une personnalité certes abstraite afin d’échapper à l’idée d’un docteur Mabuse et donc au complot mais quelque chose semble relever davantage de la prudence que de la conviction ; je préfère donc reposer la question sans détours : vous semble-t-il qu’il y ait un dessein organisé de destruction de l’homme, car c’est cela qui est en jeu si l’on tire les conséquences de vos propos.
ST : Un complot supposerait une conspiration subversive, or, il n’y a plus rien de subversif dans une doctrine européenne officielle, imposée aux peuples par en haut, votée par des parlements, appliquées par des ministres. Il existe, par contre, des conjonctions d’intérêts où des gens s’activent par ambition ou par goût du pouvoir. Sans aucun doute, les plus habiles escomptent un profit de la rentabilisation du savoir, pour laquelle ils sont prêts à ruiner l’art d’enseigner et d’apprendre. Ce phénomène n’est pas d’origine récente, mais ses effets visibles envahissent nos vies. Voyez comme la rentabilisation de la paideia et la destruction des savoirs humains s’accélèrent autour de nous ! Vous pensez, sans doute, que j’ai construit là un théorème. Détrompez-vous. J’ai simplement beaucoup lu. Dans mon livre, je cite en note un article de 1988, paru sur la revue Pangloss, n° 18, sous le titre Entreprise et système éducatif. Fondation nationale entreprise et performance, p. 275-298, où il est énoncé clairement que l’école est le « lieu de production d’une ressource humaine apte à évoluer ». L’article critique vigoureusement « l’archaïsme » de la définition classique de formation générale (p. 281) et défend la promotion de «l’aptitude à l’évolution », en somme, de la flexibilité de la ressource humaine. Tout cela implique des « modifications radicales » dans les contenus et les méthodes pédagogiques. De 1988 à 2008, en vingt ans, ces idées se sont imposées et dominent à présent notre monde. Elles émanent indubitablement de certains milieux d’entreprise et de certaines castes financières et politiques, dont tout l’intérêt consiste à faire croire aux masses que l’éducation classique est néfaste, inutile et dépassée. Ces castes comptent sur le fait que les médias sous-estiment la froideur et la détermination avec lesquelles elles agissent. Elles jouent psychologiquement sur le discrédit associé à la théorie du complot, théorie sur laquelle toute critique à leur égard est impitoyablement rabattue. La réduction des élèves à une ressource humaine, des étudiants à du matériel flexible et de la paideia à une école d’entreprise, nous ramène directement à l’utilisation de l’homme et au problème heideggérien du non-être d’une humanité-outil.
AP : On observe dans cette seconde partie, outre un changement d’objet, un certain changement de ton. Si vous me permettez cette comparaison un peu familière, la première partie m’évoquait Foule sentimentale de Souchon, la seconde s’oriente davantage vers un article de Marianne, et ce, sans arrière-fond péjoratif. Plus précisément, à une recherche de l’essence de l’humanitas sur fond d’une certaine quête de l’idéal humaniste se substitue une critique acerbe du fonctionnement contemporain du marché et, partant, du commerce rentable. Ainsi trouve-t-on des accusations de principe à l’encontre de l’argent et du commerce ; page 202 : « On sait depuis des siècles que la poursuite de la vérité n’emprunte pas les voies du commerce. Conformément à cet adage, les formes du savoir intellectuel européen, bourgeois ou académique, selon les appréciations et les dépréciations d’autrefois, étaient jusqu’alors orgueilleusement isolées du rendement. » Ou page 210 : « Mais depuis longtemps le philosophe sait que l’argent ne contient nul principe de vie ou d’intelligence. L’argent n’a que du mouvement. Il revient à l’homme de lui imposer sa direction, afin que le marché n’élimine pas le commerce des idées. » Et page 239 : « Les vertus du marché sont les vertus de Mercure, dieu qui commande du bout de son bâton aux intellectuels, aux marchands, aux voyageurs et aux voleurs. » Page 287 enfin, où l’adjectif « délirant » me semble hautement significatif : « L’économie rentable et délirante est devenue magique, tout autant que l’astrologie, mais sa magie noire ne participe pas au don multiple – intellectuel, social, et artistique – que Ficin serre dans les liens érotiques d’un monde bienfaisant. Elle en serait plutôt jalouse. »
Ces quelque quatre citations – non exhaustives – dressent un tableau fort sombre du marché, du commerce et de l’argent ; et cela ne se cantonne pas à une critique du monde contemporain, mais dépeint l’essence même, si je vous suis bien, de l’argent et du commerce par essence privé de vérité et d’intelligence. Je vous pose la question un peu directement mais elle me semble inévitable : n’est-ce pas là une présentation quelque peu manichéenne – ou, à tout le moins, excessivement définitive – du rôle de l’argent et du marché ? Que l’argent ne soit rien, certes nous le savons, mais ne pourrait-on pas imaginer comme le fit Simmel que, sans être quelque chose, il engendre des effets parfois positifs ou non exclusivement maléfiques ?
ST : D’aristocrate intellectuel à émule de Jean-François Kahn, ma cote a considérablement baissé ! Il est temps de conclure, avant que je ne vous fasse songer à BHL. Quant à « Foule sentimentale », ce titre décrit mal ma première partie, qui serait plutôt une «fouille sentimentale », une archéologie du sentiment d’humanitas…
AP : Oui, en effet. C’était plus une boutade qu’un résumé sérieux…
ST : Cela dit, enseignez-moi comment la quête des valeurs humanistes peut faire abstraction de ses propres possibilités d’existence parmi les hommes ? Les humanités sont l’une des trois possibilités que la rentabilité neutralise. Les humanités sont ruinées par un gaspillage commercial sans précédent de nos ressources intellectuelles. À ce stade de notre entretien, votre façon de réduire mon analyse philosophique à un anticapitalisme manichéen me trouble, car vos citations se dispensent de dire que j’ai, presque partout, parlé aussi d’une «magie blanche» de l’argent, donc d’une magie bénéfique, après avoir averti (semble-t-il à votre intention) à la page 22 : « Après cela, doit-on le dire, on ne confondra pas dans une malédiction grossière, la rentabilité, l’économie et le capitalisme, qui sont trois réalités distinctes. La rentabilité actuellement programmée en Europe paupérise l’intelligence dont elle tire bénéfice. Telle n’était pas l’aspiration du capitalisme des origines, tourné vers la promotion des arts et des sciences ». Vous pourriez, de plus, vous souvenir que mes chapitres sur l’économie du don, qui équilibrent la pars destruens sur la rentabilité, décrivent dans le détail les rapports entre l’humanitas ficinienne, la philanthropia et le « capitalisme » des marchands florentins. Sans compter tout ce que j’évoque à propos de la philanthropie anglo-saxonne, qui va à l’encontre de la mauvaise réputation néolibérale des Etats-Unis en France. Autrement, à quoi servirait la lecture de Derek Bok et du marketing universitaire, que je fais justement page 202 et dans le chapitre Ce que signifie le marché ? Est-ce vraiment une accusation de principe que d’observer combien les humanités se sont tenues jadis à l’écart du rendement financier et combien le problème de la recherche en France est inexorablement conditionné par la domination du marché sur les découvertes scientifiques et savantes ? Permettez-moi d’en douter et de vous conseiller la consultation hebdomadaire de Sauvons la recherche. Partout en Europe les réformes rentabilistes suscitent des réactions en comparaison desquelles mes analyses paraissent pondérées. Enfin, l’adjectif délirant, qui vous semble hautement significatif d’un antilibéralisme à l’emporte-pièce, est pourtant emprunté aux commentaires économiques de notre temps, riches en expressions comme « spéculation délirante », « surévaluation délirante », « spirale délirante des crédits ». C’est un moyen de souligner la nature irrationnelle de certains processus financiers hors contrôle. Mes analyses de Max Weber et de Marcel Hénaff tentent justement d’expliquer comment la rentabilité n’est plus soumise à une discussion rationnelle à partir du moment où des décisions antidémocratiques éliminent le débat d’idées.
AP : Je vois ce que vous voulez dire, mais je ne puis être entièrement convaincu : en effet vous évoquez la philanthropie anglo-saxonne, mais c’est pour justement mieux ériger cela même qui échappe au marché en modèle. De la même manière, le don échappe par définition à toute forme marchande. Je dirais que votre réponse, qui rappelle ce que mes citations ont un peu occulté, à savoir que vous n’identifiez pas automatiquement rentabilité et capitalisme ni argent et magie noire, réfute une lecture manichéenne de l’argent et du marché à partir d’un éloge de ce qui y est soustrait. Cela me semble malgré tout très paradoxal.
Restons dans la question de la rentabilité et prenons un exemple qui nous est cher : vous évoquez en tout début de cette seconde partie le cas de l’Ecole Normale Supérieure, particulièrement celles de la rue d’Ulm et de Cachan et la note 4 de la page 170 rappelle les difficultés que rencontrèrent ceux qui cherchèrent à s’opposer au projet de rapprochement mettant en péril la pérennité des humanités. « Ceux qui ont défendu la ligne des humanités lors des assauts de rentabilité contre Normale Sup’ de 2004 à 2007, se souviennent d’avoir été ridiculisés pour leur combat « nostalgique » dans la presse et dans des émissions dites « culturelles » de grande écoute. » Je suis un peu surpris par cette note car j’ai souvenir que des intellectuels aussi médiatiques que Jacques Julliard à gauche, ou que Nicolas Baverez à droite, avaient été fort écoutés lors de ces débats, et leur défense des humanités fut, me sembla-t-il, plus que bien accueillie dans les media. Baverez – qui emploie dans l’article suivant à plusieurs reprises le mot d’ « excellence » qui n’a guère vos faveurs – avait ainsi écrit le 8 octobre 2005 que le projet de fusion avec Cachan amènerait un grand nombre d’incohérences, dont la suivante : « Incohérence du projet scientifique, qui verrait la recherche fondamentale – pourtant vitale – marginalisée au profit de la recherche appliquée et les humanités placées en voie d’extinction (il n’existe pas de section littéraire à Cachan mais des études d’art appliqué et de design). »[3] C’est intéressant car son angle d’attaque, on s’en doute, n’est pas celui de la dénonciation de l’exigence de rentabilité, mais plutôt celui de l’incohérence bureaucratique ; ne peut-on pas alors imaginer que la ruine des humanités ne résulte pas d’un facteur unique – la rentabilité – mais bien plutôt d’une coagulation de forces parfois contradictoires ? Comment comprendre sans cela que Baverez, penseur libéral s’il en est, ait sautillé de plateaux télé en tribunes médiatiques, pour défendre les humanités et s’opposer à un tel projet de fusion ? En d’autres termes, je me demande si c’est vraiment le marché et la rentabilité qui expliquent à eux seuls la fin des humanités, si l’on peut en rester à une explication de type monocausal.
ST : Mais d’où naît l’incohérence ? De la volonté folle de rentabiliser en hâte les grandes écoles. En outre, vous omettez de dire que Baverez parle, dans le même paragraphe, d’incohérence de « formation », notamment celle de la professionalisation à outrance, indissociable de la rentabilité. Pour la fusion Ulm-Cachan, ce fut en 2005, lors d’une émission radiophonique (Travaux Publics du 24/10/05) qu’un sentiment d’occasion manquée, mêlée de ridicule, avait saisi les auditeurs opposés à la fusion. Puis, ce fut en 2006, quand vint le tour du scandaleux péage de 100€ imposé arbitrairement par la direction à la bibliothèque de lettres de la rue d’Ulm, que des démonstrations d’hostilité furent relayées à l’enseigne de «les normaliens sont des privilégiés, qu’ils payent donc pour leur instrument de travail». Les partisans de cette dîme de recherche se gardaient bien d’avouer que de nombreux lecteurs autorisés – non-normaliens qui bénéficient des services de la bibliothèque – eussent été pénalisés par cette injustice.
En second lieu, l’apparente monocausalité dérive d’un mode de recherche qui vise à isoler les causes les unes des autres. J’espère vous avoir convaincu en posant une triple définition de l’humanitas, et en montrant, textes et faits à l’appui, que la rentabilité de l’éducation ne peut pleinement réussir que si elle élimine les humanités, cette part d’eruditio indispensable à la triple humanitas. Je reconnais avec vous l’existence de nombreux phénomènes qui, par leurs effets secondaires, mériteraient le nom d’antihumanismes, mais il n’en existe qu’un seul prônant, par principe, le refoulement des humanités ou leur asservissement total au commerce : la rentabilité. Par comparaison, cet asservissement ne me semble pas la condition sine qua non de la bureaucratie incohérente, de l’incompétence administrative, des carrières sans mérites intellectuels, des arrivismes ravageurs qui comptent au nombre des forces que vous voyez coagulées contre l’humanisme. En revanche, Claude Allègre signant un pamphlet grotesque contre Platon, ou Luigi Berlinguer déplorant les méfaits du « liceo classico » (l’enseignement des humanités en Italie) sont ceux-là qui firent passer les réformes européennes gorgées d’employabilité et de rentabilité, décrétées soudain obligatoires pour tous.
AP : Cette dernière question cherchait au fond à signaler une réserve que je me permets de formuler à l’égard de votre travail que je trouve par ailleurs admirable et très convaincant : identifier la rentabilité comme source même d’un antihumanisme en acte ne me semble pas signifier que la rentabilité épuise les raisons de la mort des humanités et d’un certain humanisme.
ST : Mais nous sommes bien d’accord. De fait, je cite au moins deux autres causes accompagnant la rentabilité européenne : la déshumanisation de type heideggérien et la post-humanité de type postmoderne, auxquelles le second tome d’Humanismes/Antihumanismes sera largement consacré. La rentabilité était l’antihumanisme pratique et commercial qui relevait de ces premières recherches : celui qui s’oppose le plus concrètement à l’eruditio, telle que je l’ai définie. Voyez-vous, les antihumanismes sont corrélatifs, ce qui signifie : indépendants mais convergents. Voilà ce que j’écris d’ailleurs page 26, sur le refus d’humanitas : « N’oublions pas que Prométhée, en libérant les hommes, va expier le sacrilège de leur avoir donné le feu, les arts et l’espérance : le destin personnifié par les Moires punit la philanthropie prométhéenne par l’aigle de Zeus, qui déchire éternellement le flanc du héros. Sur l’humanité pèse donc une menace terrible et originelle. Traduite sur le plan historique, cette fable préfigure la loi fatale que l’antihumanisme veut toujours opposer à l’humanitas : l’effort d’humanisation par la culture se heurte cycliquement à des forces suprêmes, souvent sombres et tyranniques. Tout progrès humain sera expié. La morale est antique et contemporaine aussi bien, car il existe des Moires modernes. Ces déesses sans pitié se cachent derrière trois antihumanismes, qui sont la rentabilité, la déshumanisation et la posthumanité. La première est une vaste destruction des humanités par la « marchandisation » de l’éducation humaine. La seconde est une philosophie de la puissance et du temps, fécondée par Nietzsche et par Heidegger, également fascinés par l’effacement du visage humain de l’homme. La troisième annonce un âge imminent, situé au-delà de toute nature humaine. Il se peut donc que l’humanitas s’éteigne brusquement dans la conscience européenne. Mais l’extinction de l’humanitas n’était pas imprévisible : des tragédies l’ont annoncée et des écrivains l’ont prophétisée. Créatures d’épilogue, nous vivons au crépuscule de l’idéal humain. Le soleil de l’homme va se coucher. »
AP : De façon générale, je crois que votre ouvrage se trouve embarqué dans un paradoxe qui transparaît dans la première partie de notre entretien : d’une part, il n’est pas vraiment délicat de mener un réquisitoire contre le marché en France, pays où la perception de celui-ci est la plus négative de l’OCDE ; on sait que seuls 36 % des Français jugent que l’économie de marché constitue la meilleure chose pour l’avenir ; de ce point de vue, donc, votre ouvrage s’insère fort bien dans la pensée dominante ; mais d’un autre côté, les penseurs emblématiques de l’hostilité au marché se trouvent être également hostiles – pour de mauvaises raisons selon vous – à une certaine forme d’humanisme lettré qu’ils associent à une forme sociale de « reproduction » et de normes essentiellement ostentatoires, bref une « faculté de nantis », disiez-vous tout à l’heure. Si bien que votre ouvrage se trouve mener un combat extrêmement apprécié en France qui est celui de la lutte contre une certaine rentabilité mercantile ou, disons-le, contre une certaine forme de libéralisme économique, tout en promouvant comme indispensable le symbole même de ce qui est honni par les penseurs les plus en pointe de la lutte antilibérale, à savoir les humanités. Là me semble être un des paradoxes les plus intéressants de la situation de votre ouvrage et je souhaiterais savoir si vous pensez qu’un tel paradoxe parcourt réellement votre ouvrage.
Et si oui, ne pourrait-on pas penser Readings comme le paradigme même de ce paradoxe ?
ST : Ce paradoxe ne parcourt pas ma réflexion, mais il la cerne et je tente de le briser. Je vous dirai comment dans un instant. Commençons par Bill Readings. Qui l’a lu en France ? Je l’ai étudié d’assez près, quoiqu’il reste à l’opposé de ma pensée, ce qui fait qu’il est devenu, lors de l’écriture de la seconde partie de ce livre, une sorte de démon familier. Est-ce en raison de sa mort précoce, dans un accident d’avion en 1994 – mort, comme l’on dit, injuste – et que le fait de prendre souvent l’avion m’inspire quelque philanthropie posthume (et égoïste) à son égard ? Est-ce parce qu’il était un déconstructeur particulièrement vif mais sans ruse aucune dans sa générosité destructrice, contrairement au beau renard argenté qu’était Derrida ? Les deux explications, l’affective et la rationnelle, se mêlent sans doute. Sans conteste, Readings a posé très tôt le verdict de l’université sans culture, la « market-model university » comme disent les américains, où seules les disciplines rentables survivent. Nous y sommes.
Vous soulignez ensuite un paradoxe externe à ma démarche, la « situation » même où elle se trouve, que je résume ainsi page 211 : « Dans son cas particulier, la France souffre déjà d’une longue et mauvaise prédisposition, déchirée entre l’eruditio et la philanthropia, entre l’élite et le peuple. La mentalité française, partagée entre Nietzsche et Bourdieu, entre l’élite sans pitié pour le peuple et la revanche sociale du peuple contre l’élite, imagine, sans pouvoir la saisir ni l’analyser, l’existence d’un humanisme intégral au fond du vieux rêve européen. La diffusion du savoir rencontrerait le bien de l’humanité. Mais ici encore, la fatalité sociale s’en mêle : si le bien signifie le bonheur sur le plan philosophique, sur le plan économique le bonheur signifie le métier. » Rassurez-vous, je ne consulte pas les sondages avant d’écrire mes livres, mais mon éditeur, Alain Segonds, sera fort aise de savoir que 64% de français sont des lecteurs potentiels de mon ouvrage. Redevenons sérieux. Si universaliser l’humanisme signifie supprimer l’humaniste qui fait obstacle à la société de masse, alors les humanités seront rayées de la carte des savoirs pour crime d’élitisme et de reproduction sociale des privilèges. Je suis enclin, au contraire, à critiquer la notion de masse et le réflexe économique qu’elle induit chez les rentabilistes : multiplier les effectifs d’étudiants en réduisant la qualité des savoirs et la quantité des enseignants. Voyez l’actualité. Critiquer la notion de masse ne m’isole donc pas du grand nombre, si j’obtiens du jugement collectif qu’il commence à considérer la massification du savoir comme une création totalitaire. Pourquoi les totalitarismes ont-ils exigé le serment des intellectuels ou leur rééducation « populaire » ? Pour les lier indéfectiblement à l’opinion de masse et à l’image de leurs régimes. Qu’aucune tête ne dépasse, où puisse germer la critique et la sécession, telle est la clef d’une massification réussie. La vocation du philosophe est de démassifier les esprits. En commençant par introduire en eux de l’eruditio.
AP : La massification pourrait aussi être appréhendée comme un effet de la démocratie ; on parle souvent de la « démocratisation » de l’enseignement, au sens où l’accès massifié à l’université est vécu comme un progrès démocratique. Je crois que nous sommes ici justement au cœur du problème : les humanités humanisent, l’humanitas accorde à l’homme un surcroît d’humanité à l’homme dites-vous. Cela signifie que l’on devient humain et non que l’on naît humain, l’homme s’humanise par l’humanité ; cette idée d’une humanisation de l’homme ne heurte pas tant l’économie rentable, à mon sens, que la démocratie libérale pour laquelle l’homme est homme par lui-même. C’est pourquoi je pense très profondément que si les humanités sont aujourd’hui menacées, c’est peut-être par le moyen de l’économie rentable, mais c’est d’abord et surtout parce qu’elles heurtent chaque jour davantage l’essence de la démocratie libérale : c’est du reste la question que Gallo avait posée à Fumaroli il y a peu, et à laquelle ce dernier ne put répondre clairement : pouvons-nous attendre la même chose de l’homme en démocratie et de l’homme non-démocratique ? A mes yeux, la réponse est très nettement non.
ST : Vous pensez donc que la massification est un effet de la démocratie ? Je pense qu’elle est une perversion de la démocratie ; perversion par une volonté de dictature, avouée ou latente. Toute la différence est là. Aucun peuple démocratique ne souhaite l’état de masse. La massification est un état subi, jamais une condition choisie. Le choix responsable des conditions d’existence et le choix intelligent des raisons d’être inspirent toute culture démocratique : les humanités forgent la mémoire historique, l’esprit critique et l’esprit de liberté qui tiennent cette culture en vie. Par conséquent, je crains que vous ne simplifiiez. Du moins, le problème se pose-t-il autrement. Il ne suffit pas de naître en démocratie pour être démocrate, encore faut-il apprendre à le devenir sur le modèle permanent d’une paideia. Libre à vous d’énoncer l’antinomie abstraite des « humanités qui humanisent » avec l’essence de la démocratie libérale, si vous le faites sur la base d’une opposition radicale (que je juge hâtive) entre l’humanité par naissance et l’humanité par éducation. Mais les démocraties historiques concrètes, soucieuses jusqu’au XXe siècle – même la démocratie américaine « libérale » – de perpétuer les humanités dans leur enseignement, semblent contredire ce propos. Il est une opposition beaucoup plus cruelle et profonde, celle entre les humanités et les démocraties dites «populaires», la Russie soviétique, la RDA ou la Chine de Mao, qui persécutèrent la culture classique et humaniste avec tous ceux qui s’en réclamaient. Les naïfs croient que ce trait appartient au passé. Mais la persécution des humanités reste une question fondamentalement actuelle pour les vrais démocrates.
AP : Je suis entièrement d’accord avec vous, à ceci près que décrire la massification comme un effet de la démocratie n’exclut pas que ce dernier soit un effet pervers de celle-ci plus qu’une perversion. L’exemple des dictatures socialistes que vous abordez abonde du reste dans le sens d’une ruine des humanités que l’on ne saurait, dans le cas de la Chine, de la RDA et de l’URSS attribuer à une économie de marché fondée sur la rentabilité mais bien plutôt à quelque chose de l’ordre d’un égalitarisme forcené, et de la haine de toute « distinction ». La rentabilité marchande n’explique pas, dans les exemples des régimes socialistes que vous citez, la ruine des humanités, et impose de penser de manière plus générale la fin des humanités à l’aune de questions non seulement économiques mais aussi et surtout politiques.
En conclusion, je souhaite aborder un excellent article de Frédéric Worms, Peut-on encore être humaniste, paru il y a peu dans un hebdomadaire de grande diffusion. Après que Worms eut brillamment restitué l’exigence du détour dans la fondation du sujet à partir de Ricoeur – détour par l’histoire et le récit – et Levinas – détour par autrui –, il formule le souhait programmatique d’un humanisme encore possible mais qui, pour cerner la singularité humaine, passerait « par le cerveau, le langage, la société, mais aussi par des comportements bien précis. »[4] Un tel programme, on le devine, est fort éloigné de l’humanitas élaborée à la Renaissance ; mais n’y a-t-il pas dans ce besoin d’enraciner l’humanisme dans les neurosciences ou dans la linguistique une profonde exigence de vérité sans sombrer dans un positivisme asséchant, seule condition possible pour penser un humanisme fécond dans les décennies à venir ?
ST : Worms est un bon bergsonien. Sa page, que je lis grâce à vos bon soins, est brillante, dites-vous, mais d’un néohumanisme fort vague. Quels sont les « comportements bien précis » qui nous adapteront à ce nouvel humanisme, un de plus, serais-je tenté de dire ? Mystère. Où se situent exactement les champs d’humanisation du savoir dans cette volonté de tout concilier, l’humain et l’inhumain ? À mon humble avis, ce type de réflexion enchaîne les apories anthropologiques actuelles, à la lumière de Lévi-Strauss, de Foucault et de Lévinas, mais ne ressaisit pas l’enracinement culturellement profond de la « question de l’homme » dans l’histoire perdue de son humanitas. La faiblesse théorique dont elle est entachée tient à « la voie facile » de l’anthropologisme, qui prend pour un humanisme tout ce qui vient des hommes. Sans quoi Worms ne nous inviterait pas, dans la même page, à prendre, suprême paradoxe, l’inhumanité en considération. Je cite : «Il y aussi désormais un humanisme indirect, qui nous dirait : Rien d’inhumain ne nous est étranger ». Qu’est-ce que l’inhumain sinon le cruel dans toute l’étendue de son spectre, depuis le cruel sadien jusqu’au cruel du sacré, de Bataille à Artaud ? Au contraire, l’humanitas commence où termine l’inhumain, que Worms définit, à juste titre, comme une « expérience morale de la destruction humaine ». Ainsi, définir l’homme par l’homme, par son « espèce » et par son « soi », conduit invariablement à une aporie de l’«autre» – bon autre ou mauvais autre, altérité messianique ou maléfique – que je critique dans mon livre en écrivant : « Une alternative radicale, incarnée par des protagonistes irréconciliables, plongés dans une polémique sans repères communs sur la «mort de l’homme », a donc placé des générations d’historiens, de philosophes et de critiques littéraires devant ce choix cornélien : l’humanitas serait amalgamée à un continuum anthropologique dont elle ne se distingue plus ou serait évacuée a priori d’une archéologie épistémologique sans sujet humain. Voilà un dilemme sans échappatoire. » Et plus loin : « La dissociation entre la triade humaine et l’anthropologie philosophique s’accentue donc jusqu’à l’antinomie consommée entre l’homme humaniste et l’homme technologique du XXe siècle, quand l’humanitas ficinienne a sombré dans l’oubli depuis longtemps. Tels sont, à peine esquissés, les glissements anthropologiques qui se sont produits dans la notion d’humanité. Et ainsi s’achève le périple étonnant d’une science comme l’anthropologie, partie pour expliquer la nature humaine mais finissant par expliquer pourquoi elle ne l’a pas trouvée. » Je doute que Levinas ou que Worms nous sortent de ce pas. C’est bien pourquoi j’ai parlé, au début de mes recherches, d’une « voie difficile » et nouvelle, celle d’une génétique historique des concepts, celle d’une philologie philosophique de l’humanitas. Comme disait Pic de la Mirandole dans le De ente et uno : « homo est humanitate homo ». L’homme est homme par humanité. Mais ôtez le mot humanitas et vous n’obtiendrez qu’un truisme : l’homme est homme. Truisme dont les normes fondamentales de l’humain seront absentes. Sommes-nous en droit de les attendre de la science ? Je le souhaite tout comme vous. Mais ce n’est qu’un désir et la philosophie ne s’écrit pas à coup de désirs. En tout cas, après 1914 et après 1933, elle ne peut plus le faire. L’homme est capable de perdre à tout moment son humanitas et c’est une grande ingénuité de croire que des normes humaines nous attendent dans l’avenir, puisqu’elles nous servent tout de suite. Convenez que tout ce que l’homme découvre n’est pas humanisant. Là est l’immense problème de la divergence croissante entre la technologie scientifique et l’humanisation. N’attendons pas trop d’humanisation de sciences dont la légitimité initiale n’est pas d’humaniser la vie, mais d’arracher les secrets du vivant. En général, aucune physique, aucune biologie, aucune science cognitive n’a pour premier but de définir l’humain, mais la matière, la vie, la connaissance, attributs de l’homme qui ne livreront pas le dernier mot de son énigme. L’homme humain se sera évaporé entre-temps. La linguistique préservera peut-être les cendres de son logos éteint. Parlons, en particulier, des neurosciences. Quand les neurosciences auront expliqué l’animal hyperneuronal que nous sommes – mission essentielle – nous diront-elles comment il se décida un jour à devenir humain ? Prenons un exemple précis, que je tire du bel essai de Giacomo Rizzolati et Corrado Sinigaglia, intitulé Je sais ce que tu fais (So quel che fai), sur les neurones-miroirs, ces neurones députés au décodage des actions des autres. Le livre s’achève sur le problème considérable de l’empathie, étroitement lié à la philanthropia, l’un des trois fondements de notre humanitas. La théorie des neurones-miroirs permet d’établir que la saisie immédiate des émotions d’autrui, joie et douleur, est un mécanisme préalable à toutes les relations interindividuelles normales, celles que nous dirions empreintes de philanthropie. Conclusion : la philanthropie présuppose le neurone-miroir et non l’inverse, parce que la compassion humaine surgit au carrefour d’un nombre incalculable de facteurs affectifs et culturels, qui coiffent le mécanisme neuronal. Gageons ensemble que vos lecteurs en apprendront un peu plus sur la philanthropia et l’humanisme dans mon livre. Si l’humanitas n’est pas féconde, et critiquement féconde dès à présent, elle ne le sera jamais.
[1] Cf. Emmanuel Levinas, Totalité et infini, LGF, 1990, p. 140, sq.
[2] Cf. Hubert-Louis Dreyfus, de la technè à la technique in Cahier de l’Herne, Heidegger, LGF, 1986
[3] Nicolas Baverez, La mort programmée de l’Ecole Normale, in Le Figaro, 8 octobre 2005
[4] Frédéric Worms, Peut-on encore être humaniste ?, in Hors-série du Point N° 17, Penser l’homme, avril-mai 2008, p. 17