Entretien avec Romain Laufer : Autour de Tocqueville au pays du Management (partie 1)
B : Les créations institutionnelles de 1968 : la FNEGE et loi Faure
AP : Une fois ces éclaircissements apportés, je crois que l’on peut pleinement rentrer dans votre Tocqueville au pays du management. Nous avons déjà évoqué la première raison pour laquelle vous établissez un lien entre Tocqueville et le management qui est celle des analyses tocquevilliennes de la démocratie américaine, mais le fait est que vous mobilisez trois autres justifications de ce lien : 2) la question des analyses tocquevilliennes de la Révolution française que vous mettez en lien avec la « révolution » (introuvable ?) de mai 1968 qui constitue le point de départ des nouvelles universités, de la création de Dauphine, et donc de l’enseignement français du management, 3) l’importance cruciale de l’administration concrète dans la vie de Tocqueville et 4) l’analyse institutionnelle qu’il place au cœur de sa compréhension des sociétés.
Le quatrième point, quand je l’ai découvert, m’a étonné ; pourquoi la question institutionnelle serait-elle directement liée à celle du management ? On peut penser les institutions sur un plan politique qui ne se ramène pas à celui de l’organisation efficiente. Le lien institution / management ne me semble valable que si l’on présuppose la non-politicité des institutions.
RL : La difficulté, ou peut-être plutôt le malentendu, vient de la façon dont on définit la notion d’institution. C’est pourquoi je pense que le mieux pour moi est de répondre dans l’ordre inverse de vos questions en commençant par ce dernier point relatif à la définition de la notion d’institution, en continuant par la place que l’analyse institutionnelle occupe dans l’œuvre de Tocqueville, en poursuivant par la place de l’administration dans ses analyses, pour finir par la question des évènements de 68 et leur lien avec la fondation de l’Université de Paris Dauphine.
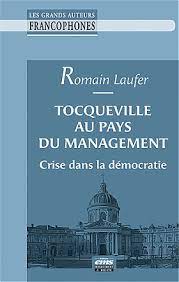
Pour « institution » le dictionnaire Robert distingue deux sens principaux : 1/ premier sens, « l’action d’instituer » (création, établissement, fondation) ou encore « désignations, nomination », il ajoute, par extension la chose instituée (personne morale, groupement, régime), 2/ deuxième sens : « action d’instruire et de former par l’éducation. ». Considérer le management comme institution, ou d’un point de vue institutionnel c’est, donc, en particulier, le considérer comme étant ce qu’il devient quand il fait l’objet d’un enseignement, et qui plus est d’un enseignement universitaire. Or, on peut vérifier que même aux Etats-Unis l’intitulé « school of management » n’apparait qu’après 1954, tout d’abord exceptionnel (3 occurrence avant 1968) et de manière de plus en plus fréquente, après 1968. C’est cette mutation du sens de la notion de management qui est le sujet de l’ouvrage. Comme on peut supposer que la question de l’efficience des organisations a pu se poser bien avant cette date on peut supposer que la notion de management au sens institutionnel ne se réduit pas à celle d’efficience organisationnelle. La difficulté que l’on peut avoir à reconnaître l’importance de l’apparition du mot management dans ce nouvel usage tiens au fait qu’en France il sera facilement tenu à l’écart en tant qu’anglicisme alors même qu’en Amérique, le fait qu’il s’agisse d’un mot de la langue courante rend plus difficile la perception de la portées de ce nouvel usage. La portée de l’inscription du mot management dans le nom des écoles se vérifie en particulier par le fait que la première forme d’institutionnalisation du management aux Etats-Unis (c’est-à-dire de création d’établissements universitaires spécialisés) s’est opérée dans des écoles intitulées « school of commerce » ou « schools of business ». Ceci indique que, dans un premier temps, le management qu’il s’agit d’institutionnaliser est interne à une entité intitulée « commerce » ou « business » qui sont de ce fait désignés comme objet d’étude principal, le management n’apparaissant que dans l’intitulé de cours relatifs à des processus internes à ces entités.
Au tournant de la Deuxième Guerre Mondiale) le management émerge de sa coquille pour se déployer dans l’espace public. Désormais, en vertu de la crise du critère du droit administratif et de la crise de l’épistémologie dont elle est contemporaine, il s’applique tant aux organisations publiques que privée, voire aux associations, aux églises, aux clubs sportifs ainsi que le dit explicitement Chester Barnard, un précurseur de la pensée moderne du management, en 1938 dans The Function of the Executive. On peut noter le caractère problématique (ou si l’on préfère complexe) de la notion d’efficience dans le cas du management public (c’est ce que montrent les discussions relatives à la notion d’indicateurs sociaux) et, ce qui est peut être moins intuitif, que du fait de la crise du critère du droit administratif, la limite du public et du privé n’étant plus clairement définie, le management public concerne désormais aussi bien les personnes morales de droit privé que sont les entreprises (ce qui s’exprime explicitement par exemple dans ce qu’il est convenu d’appeler la responsabilité sociale des entreprises).
Ceci implique-t-il que les institutions doivent être alors considérées comme n’étant pas politiques ? La réponse à cette question dépend à son tour de la définition que l’on donne du politique. Il me semble que l’on peut distinguer trois définitions : une définition institutionnelle (est politique ce qui est défini comme tel juridiquement, par exemple par le droit constitutionnel), une définition épistémologique (est politique ce qui concerne tous les membres de la polis, par exemple une pandémie, un risque majeur), enfin une définition pragmatique (est politique l’exercice du pouvoir dans un espace social donné par la recherche d’influence ou la constitution de coalition etc.). Du fait que la crise de l’épistémologie se manifeste dans la façon dont on représente désormais le monde à l’aide de systèmes ouverts, l’absence de limite définie de manière claire implique que toute action peut, en principe, affecter l’ensemble de l’environnement : c’est ce qu’évoque le fameux « effet papillon ». C’est encore l’exigence, déraisonnable de « zéro défaut », apparue dans le dernier quart du XXème siècle, qui signifie qu’un seul défaut peut avoir des conséquences si funestes pour l’organisation concernée qu’il doit être évité à tout prix (ou, au moins compensé à chaque réclamation). Ceci donne un sens précis à la proposition « tout est politique », puisque tout acte peut potentiellement, affecter toute la polis et même au-delà, un pas au-delà impliquant la mise en crise de la polis elle-même.
AP : Vous relevez un point très intéressant sur le plan lexical qui est celui du choix français du terme même de management ; le Littré indique qu’existe le mot « ménagement » au sens d’administration, de conduite, de soin même ; or ce mot ancien n’a pas été repris, ce en quoi vous voyez un symptôme, celui du malaise français face à cette nouvelle discipline qu’elle ne sait pas nommer et que finalement elle nomme dans une langue étrangère.
RL : Ecrire ce livre a été pour moi l’occasion d’apprendre bien des choses que j’ignorais, une des plus surprenante (et des plus logique du point de vue de la problématique développée) est que la notion de management n’était guère plus évidente, tant dans son contenu que dans son statut institutionnel, aux Etats-Unis qu’en France. C’est ainsi qu’un des fondateurs de « The Academy of Management », peu avant la seconde guerre mondiale, écrit qu’ils auraient bien besoin d’un néologisme pour désigner ce dont il s’agit. Il propose alors « planaction » condensation de « plan of action in action ». Ceci permet de rappeler qu’il y a deux étymologies du mot management dans les dictionnaires et qu’il semble utile d’en tenir compte : s’il y a bien ménagement d’origine française, on trouve également maneggiare d’origine italienne. La première fait référence à un espace qu’il s’agit d’organiser, le second à un cheval qu’il s’agit de diriger. De là le sens des deux périodes de l’histoire de cette notion : un management délimité et subordonné, puis un management qui exerce en même temps les fonctions de direction et de mise en œuvre. Ceci peut se traduire par le passage de la formule gaullienne : « l’intendance suivra », à celle qui lui a succédé, et qu’il a eu beaucoup de mal à admettre, à savoir que « l’intendance précède ».
Ainsi la France en réimportant un mot de son propre dictionnaire a réalisé l’exploit de fabriquer un néologisme sans peine. Sans peine mais non sans gêne, la gêne étant ce qui exprime la nature paradoxale du statut actuel du management et de manière plus générale des institutions par temps de crise.
AP : Ce ménagement ou management fait l’objet depuis 1968 d’un enseignement universitaire auquel vous accordez une grande attention et que vous corrélez aux événements de mai. Vous rappelez à cet effet que Pompidou crée la Fondation Nationale pour organiser, l’Enseignement de la Gestion des Entreprises – la FNEGE – qui existe toujours aujourd’hui[1], et qu’en même temps la loi Faure crée l’actuelle Université Paris Dauphine (véritablement effective en 1971) s’installant dans les anciens bâtiments de l’OTAN. Ce qui est en jeu dans cette double création, c’est, dites-vous, « une subversion de la notion de gestion elle-même, l’ordre de la mise en œuvre étant désormais placé avant la politique qui définit les finalités qu’elle est supposée poursuivre. C’est ce renversement qu’exprime et dissimule à la fois la substitution du mot management au mot gestion. Pour comprendre le secret de ce tour de passe-passe, il suffit de considérer avec un peu d’attention la double étymologie du mot management. En effet, à côté du français ménagement, ménage, il y a l’italien maneggiare, que le dictionnaire relie au fait de guider un cheval comme on le fait dans un manège, mais qui comporte aussi le sens de manier, guider, régir, gouverner voire manipuler. Dans ces conditions, dire que l’intendance précède, c’est dire que l’ordre des moyens est mis devant l’ordre des fins, le cheval (qu’il s’agit de ménager) avant le cavalier (censé le diriger), en d’autres termes c’est mettre la charrue avant les bœufs[2]. » On voit ici tout l’enjeu du retournement de la phrase apocryphe de De Gaulle selon laquelle « l’intendance suivra »…
RL : Ce qui souligne la force de ce retournement c’est que la FNEGE a été fondée en 1968 non par Pompidou, mais par nul autre que par Michel Debré (juste avant de perdre le pouvoir), le fondateur en 1945 de L’ENA. Il ne semble pas abusif de lire dans cette évolution l’expression d’un puissant mouvement historique conduit par le plus souverainiste des ministres de De Gaulle.
AP : Si vous me le permettez, j’aimerais vous faire part d’une objection à l’endroit de l’interprétation que vous menez de la création de la FNEGE et de Dauphine. Vous dites que cette année révolutionnaire de 1968 est celle de la triple transgression institutionnelle avec l’introduction du management en France, puisque cela modifie la relation traditionnelle du public au privé, introduit dans les tâches de l’Etat les questions d’intendance et suppose une certaine reconnaissance de l’avance américaine qui dispose, ainsi que vous le rappelez, de business schools depuis fort longtemps. Or vous affirmez que cela infléchit et altère les institutions dans le sens du libéralisme ou, en tout cas, vous dites que c’est perçu ainsi, votre conclusion étant assez nuancée puisque vous parvenez à l’idée que le management n’est pas libéral : « Contrairement à une idée répandue, écrivez-vous, nous avons montré que l’émergence du management ne correspond pas au triomphe du libéralisme et des logiques du marché mais à leur crise[3]. » Mais cette « idée répandue » que vous évoquez est très troublante, et même incompréhensible. Le libéralisme, quelle qu’en soit la version, est une pensée de la liberté individuelle et non une pensée de l’organisation ; le management suppose précisément qu’il y aurait une forme d’organisation efficiente indépendante de la liberté humaine, et donc introduit une certaine forme d’automatisme dans la manière même de penser les rapports humains. Il me semble donc que le management est une pensée constructiviste, pour parler comme Hayek, dont le présupposé est précisément l’inverse de celui du libéralisme, à savoir que la liberté individuelle et la spontanéité de l’ordre social sont à proscrire. S’il existe une « gestion » optimale des hommes, et si cette gestion est scientifique, c’est donc que la contingence portée par la liberté de l’individu ne peut être prise en compte car elle menace l’efficience de l’organisation ; il me semble qu’il y a un contresens général sur la nature supposément libérale du management et des sciences de gestion ; ce sont des disciplines constructivistes et antilibérales, et la meilleure preuve (pragmatique ?) en est que la plupart des professeurs de Dauphine sont keynésiens, à la notable exception de Pascal Salin qui est justement le libéral du lieu.
RL : Il est sans doute difficile de décrire une transgression sans que les mots que l’on utilise au passage ne soient eux-mêmes quelque peu tordus dans l’opération. Ainsi, dire que l’introduction du management en France modifie « la relation du public et du privé (et donc altère les institutions dans le sens du libéralisme) »,suppose que le libéralisme dont il s’agit là est le libéralisme économique qui domine les institutions des Etats-Unis, où prédomine la légitimité du secteur privé. C’est la fonction de la théorie économique du marché d’assurer la compatibilité du libéralisme économique avec le libéralisme politique. Elle le fait grâce à l’hypothèse d’atomicité qui suppose que tous les acteurs économiques sont infiniment petits par rapport au marché et qu’en conséquence aucun, à lui seul, ne peut exercer de pouvoir sur aucun autre, toutes les relations économiques se justifiant par leur soumission à « la main invisible du marché ». On mesure l’importance de ce fait à l’intensité des luttes politiques qui, ont conduit, à la fin du XIXème siècle aux Etats-Unis, à l’institution des lois antitrust. Celles-ci peuvent s’interpréter comme le fait d’introduire dans un droit qui désormais prend l’eau de toute part du fait de la taille excessive des entreprises une « rustine symbolique », à savoir une norme juridique qui énonce qu’ il est interdit d’être trop grand. On peut remarquer que la mise en place de cette norme suppose la création d’une juridiction spéciale, le juge antitrust étant chargé de juger, dans chaque cas, de la compatibilité de la taille des entreprises avec la part de concurrence nécessaire pour tenir à l’écart la constitution d’un quelconque pouvoir monopolistique ou oligopolistique. La notion de système de légitimité rationnel-légal, par la façon dont il articule norme juridique et norme scientifique permet de rendre compte de la façon dont la légitimité des décisions du juge antitrust peut reposer sur l’épistémologie positiviste (comtienne) qui caractérise la seconde période de son histoire. C’est la même épistémologie qui permet au management scientifique taylorien de faire régner au sein de l’entreprise (considérée comme un système fermé) la loi du « one best way ». Le caractère politique de ces mutations peut être vérifié à travers le développement d’un mouvement social qualifié à l’époque de « populiste »qui conduisit à l’institution des lois antitrust. La première institutionnalisation du management apparait donc aux Etats-Unis 1/ à la suite d’une crise de légitimité du libéralisme économique classique, et 2/ comme une composante du nouveau dispositif de légitimation de celui-ci. Ceci permet peut être de comprendre par analogie comment l’institutionnalisation du management en France, symbolisée par la création de l’Université de Paris Dauphine, peut être associé au libéralisme économique ou, plus précisément, au néolibéralisme dans la mesure où il signifie à la fois la fin de la soumission radicale du secteur privé au secteur public et l’importation à partir des Etats-Unis de la forme de management (management « systémique ») correspondant, à l’épistémologie de la troisième période de l’histoire du système de légitimité.
Pour tenter de clarifier les choses il importe de mettre à plat les définitions que l’on utilise. La notion de libéralisme est particulièrement difficile à manier dans l’espace des relations entre la France et l’Amérique.
Pour prendre le problème par un bout je commencerais par ce que vous dites de l’opposition entre Pascal Salin qui pour vous semble être l’exemple même du tenant du libéralisme que vous opposez à des Keynésiens que vous excluez du libéralisme (d’une façon qui évoque l’opposition des thèses de Keynes et de celle de Hayek). Si l’on se donne comme critère du libéralisme la part que les économistes accordent au fonctionnement spontané des mécanismes de marché, il semble que l’on puisse, que l’on doive, distinguer des « degrés » de libéralisme. La position de Pascal Salin semble (sauf erreur de ma part) relever d’un libéralisme radical pour lequel tout problème économique provient de la part insuffisante accordée aux mécanismes de marché et toute solution résulte nécessairement du fait d’accorder une part accrue aux mécanismes de marché (Là où Toinette dans Le Malade Imaginaire dit « le poumon », le libéralisme économique radical dit « le marché »). Si pour Keynes les mécanismes de marché laissés à eux-mêmes ne permettent pas de résoudre les problèmes économiques de son temps (en particulier le chômage massif qui a suivi la crise de 29), on ne peut qualifier sa position de non libérale dans la mesure où il accorde un rôle important, aux mécanismes de marché : le fait que ce rôle ne soit pas exclusif d’un rôle accordé à l’Etat ne saurait suffire à l’exclure du libéralisme économique, disons un libéralisme économique modéré, ou bien tempéré.
Comme vous le dites justement, le management, qui est un processus organisationnel, implique des relations hiérarchiques qui s’opposent à l’absence de hiérarchie que supposent (et que permettent par principe ) les théories de la libre concurrence. « Liberté individuelle » et « organisation indépendante de la liberté humaine » sont rendues compatibles par une tautologie que n’eût sans doute pas dédaignée Lewis Carroll : du fait que les acteurs économiques sont supposés « atomistiques » et que donc, par définition, ils n’ont aucun pouvoir, ils peuvent l’exercer librement.
Par cette disposition les processus administratifs (dont on peut penser pourtant qu’ils sont en fait indispensables au fonctionnement de toute entreprise) peuvent être ignorés (cette invisibilisation institutionnelle des relations hiérarchiques internes aux entreprises se traduit en droit français par la notion de louage d’industrie).
Le grand mérite de Tocqueville est, du fait de son intérêt pour les processus administratifs, d’interroger cette absence de visibilité des processus administratifs. Il le fait non pas à partir de la théorie micro-économique mais à partir d’une réflexion institutionnelle centrée sur la notion de démocratie, c’est-à-dire sur le fait que les relations sociales (en Amérique) sont fondée sur l’égalité de statut entre citoyens Cela le conduit à énoncer que tant que les « petites sociétés » que sont les entreprises, les associations etc., restent petites par rapport à la « grande société » la contradiction entre hiérarchie administrative et égalité de principe entre citoyen est résolue par le contrat qui limite d’un commun accord des relations de subordination dans le temps et dans l’espace.
Ce que montre l’histoire des entreprises aux Etats-Unis c’est qu’un tel état de chose ne peut survivre sans modification profonde à partir du moment où la « petite société » devient aussi grande que la grande.
AP : Oui, j’émets une réserve car je crois que votre propos présuppose l’identité de l’économie de marché et du libéralisme, ce qui me semble discutable. Mais je souhaiterais vous interroger sur un autre point : pourquoi ne mentionnez-vous pas Hayek ? C’est un auteur qui est très intéressant, qui a écrit contre l’organisation, contre le management, et qui a même écrit un célèbre article contre Polytechnique et l’esprit polytechnicien[4] qui diffuse l’illusion selon laquelle il y aurait de super-organisateurs qui disposeraient d’un savoir « scientifique » les rendant aptes à organiser de manière coercitive vie économique et vie sociale ; on voit très bien chez Hayek à quel point le management est quelque chose qui est structurellement incompatible avec le libéralisme et le néo-libéralisme rigoureusement défini. Voici d’ailleurs quelques lignes traduites en français de ce qu’il dit au chapitre XI de La Contre-révolution de la Science, chapitre intitulé « La source de l’orgueil scientiste : L’Ecole Polytechnique » et dans lequel il fustige la question des « applications pratiques » et ce que cela induit quant aux croyances qu’un savoir théorique pourrait organiser artificiellement et de manière volontariste la vie humaine :
« On a bien décrit comment tout l’enseignement de l’École polytechnique fut pénétré de l’esprit positiviste de Lagrange et comment tous les cours et manuels utilisés étaient construits sur son exemple. Peut-être encore plus important, toutefois, pour la formation des polytechniciens fut le penchant pratique de tous les cours, le fait que toutes les sciences étaient enseignées pour leurs applications pratiques et que tous les élèves cherchaient à appliquer leur savoir comme ingénieurs civils ou militaires. Le type même de l’ingénieur avec sa conception, ses ambitions et ses limitations caractéristiques était créé. Cet esprit de synthèse qui ne verrait aucun sens dans quelque chose qu’il n’aurait pas délibérément construit, cet amour de l’organisation qui émerge des sources jumelles des pratiques militaires et des pratiques d’ingénierie, la préférence esthétique pour tout ce qui a été consciemment construit sur tout ce qui s’est contenté de « pousser, » fut un nouvel élément fort qui s’ajouta – et au cours du temps commença même à remplacer – l’ardeur révolutionnaire des jeunes polytechniciens. On constata rapidement les caractéristiques étranges de ce nouveau type qui, comme nous l’avons dit, « tiraient orgueil d’avoir des solutions plus précises et plus satisfaisantes que tout autre pour toutes les questions politiques, religieuses et sociales, » et qui « se risquaient à créer une religion comme on apprend à créer un pont ou une route à l’École. » Leur propension à devenir socialiste a souvent été soulignée. Nous devons ici nous restreindre à montrer que c’est dans cette atmosphère que Saint-Simon a conçu certains de ses premiers et plus extraordinaires plans pour organiser la société. Et que c’est à cette École polytechnique que, durant les vingt premières années de son existence, Auguste Comte, Prospère Enfantin, Victor Considérant et plusieurs centaines de futurs Saint-Simoniens et Fouriéristes, reçurent leur formation, suivis par une succession de réformateurs sociaux au cours du siècle, jusqu’à Georges Sorel[5]. »

RL : Il y a au moins trois raisons pour lesquelles je ne cite pas Hayek. La première est qu’il ne concerne pas le sujet du livre qui ne cite pour ainsi dire aucun économiste. Le but était de montrer que la considération attentive de l’histoire du management à travers son institutionnalisation et un certain nombre d’auteurs était un objet qui mérite qu’on s’y attarde. La difficulté vient de ce que les disciplines traditionnelles, économie, sociologie, mais aussi philosophie sont trop occupées à dénier son existence ou à le dénigrer pour prendre le temps d’un examen critique (au sens de criticiste) plus réfléchi. Cette façon d’éviter l’analyse des processus proprement administratifs et de leur conséquences se retrouve dans les lectures les plus fréquentes de l’œuvre de Tocqueville, dont il me semble que l’on peut montrer que c’est un auteur particulièrement attentif et subtil, en même temps que rigoureux sur le plan théorique, des phénomènes administratifs et de leurs conséquences pour la démocratie.
S’agissant de Hayek, à savoir qu’il critique le management l’organisation et le savoir, on peut tout d’abord remarquer qu’écrire contre l’organisation, le management et un savoir scientifique trop sûr de lui-même, est tout à fait compatible avec la notion de crise du système de légitimité rationnel-légal. Le succès de sa théorie tient sans doute à la façon dont elle avait le mérite de s’adresser directement au trait central de la notion de crise du système de légitimité à savoir la reconnaissance de la présence d’une incertitude qui implique de renoncer à toutes référence à une science déterministe du type de celle qui caractérisait « l’orgueil scientiste » de l’école Polytechnique qui dominait au XIXème siècle. L’incertitude est traitée de deux façons différentes : au niveau de la théorie du marché et au niveau des lois chargées de réguler les actions sociales. Au niveau de la théorie du marché la notion de concurrence parfaite dont le caractère optimal reposait sur l’hypothèse d’une information parfaite des acteurs économique est abandonnée. Dans le monde de l’incertitude chacun dispose non d’une information parfaite mais d’une « connaissance diffuse ». Le marché est alors conçu comme un processus dynamique par lequel les acteurs parviennent à poursuivre les finalités qui leur sont propres en orientant leurs actions grâce à la façon dont le système des prix les informe sur l’état des échanges à un moment donné. Quant au niveau de l’élaboration des institutions sociales requises pour le bon fonctionnement de ces mécanismes, la reconnaissance de la faillibilité des connaissances humaines qui est associée à la notion d’incertitude conduit Hayek à préférer s’en remettre à un ordre spontané, résultant de l’usage et de l’expérience qui résulte du passage du temps.
Ce mode de régulation pose au moins deux problèmes. Le premier est de savoir comment un tel système spontané d’adaptation des normes sociales peut être compatible avec les ruptures qui caractérisent l’évolution d’un monde dominé par des processus aussi dynamiques que l’entreprise, la recherche scientifique et le développement des technologies. Question qui se pose par exemple à propos du rôle de la transformation des rapports sociaux occasionnée par le développement des GAFAM.
Pour qu’un système institutionnel soit accepté il est nécessaire qu’il suscite la confiance dans le fait que le respect de ses règles sera associé à un résultat positif, une promesse, qu’il s’agisse d’une promesse de bien être, de justice ou de salut. La deuxième question est donc relative au fait de savoir d’où Hayek parvient à puiser un optimisme que ses thèses ne semblent pas pouvoir impliquer par elles-mêmes. Ceci à conduit à chercher du côté de la structure sous-jacente à l’école d’économie autrichienne à laquelle Hayek appartient. Pour cette école l’acteur économique est considéré non comme un décideur maximisant un profit ou optimisant une fonction d’utilité, comme dans les théories de la concurrence parfaite des écoles anglo-saxonnes, mais comme un acteur agissant animé par une finalité intrinsèque, une entéléchie devrait-on dire en reprenant le vocabulaire d’Aristote. Il est possible de relier cette approche aristotélicienne à son lien avec la façon dont les institutions de l’Empire des Habsbourg trouvent leur salut dans une inspiration jésuitique. Par exemple on pourra vérifier comment à l’occasion du discours délivré lors la réception de son prix « Nobel », Hayek fait référence à deux précurseurs du XVIème siècle espagnol :
“Indeed, the chief point was already seen by those remarkable anticipators of modern economics, the Spanish schoolmen of the sixteenth century, who emphasized that what they called pretium mathematicum, the mathematical price, depended on so many particular circumstances that it could never be known to man but was known only to God.5 I sometimes wish that our mathematical economists would take this to heart. I must confess that I still doubt whether their search for measurable magnitudes has made significant contributions to our theoretical understanding of economic phenomena – as distinct from their value as a description of particular situations.;”
En note il est indiqué :
See, e.g., Luis Molina, De iustitia et iure, Cologne 1596-1600, tom. II, disp. 347, no. 3, and particularly Johannes de Lugo, Disputationum de iustitia et iure tomus secundus, Lyon 1642, disp. 26, sect. 4, no. 40 »
Il faut croire que l’école de Chicago avait un besoin impératif d’une réponse plus optimiste à la question de l’émergence de l’incertitude que le sombre diagnostic qui résultait des analyses strictement rationalistes que Frank Knight, leur maître respecté, avait formulé dans Risk Uncertainty and Profit (publié en 1921 et sans cesse republié depuis par les Presses de l’Université de Chicago) puisqu’en adoptant les thèses de Hayek ils acceptaient de prendre pour référence un auteur qui semblait, par ailleurs, exprimer le plus grand mépris pour le caractère de plus en plus mathématique de leurs propres travaux. Il est vrai qu’il s’agissait d’un mépris d’où la théologie n’était pas absente si l’on en croit le texte que nous venons de citer. Or la place des questions théologiques dans les institutions américaines ne sauraient être négligées.
AP : Je n’accorde pas à ces citations d’Hayek la même importance que vous, ni même la dimension théologique que vous leur prêtez ; je crois qu’il veut simplement montrer que ce qu’il dit est si évident que cela se sait depuis des siècles, y compris dans des cercles où l’on ne s’attendrait pas à cela, mais où une certaine exigence logique régnait. Par ailleurs, je crois que c’est plutôt la Société du Mont Pèlerin qui opère le lien entre l’école de Chicago et l’école autrichienne ; c’est cette médiation qui est en jeu, plus qu’une continuité entre les deux « écoles ». Mais peu importe la lecture que je fais d’Hayek et celle que vous en proposez a peut-être le mérite de pointer un élément trop peu aperçu chez Hayek.
Il y a un autre auteur avec qui vous n’entrez pas en discussion et qui, pourtant, attribue à ce qu’il appelle les « universités edgar-fauristes » un rôle crucial de transformation sociale : cet auteur vous l’avez au moins rencontré une fois puisqu’il était présent avec vous et Jacques Séguéla lors d’une mythique émission de Pivot consacrée au marketing[6]. Je pense bien sûr à Michel Clouscard ; celui-ci, notamment dans Néofascisme et idéologie du désir, consacre de longues analyses aux mutations de l’université sous l’impulsion de la loi Faure. Certes, son angle est plutôt celui de la transgression érigée en norme, et de son relai culturel et universitaire ; cela l’amène à considérer que la transgression managériale est une transgression générale impliquant l’ensemble du social de sorte que les nouveaux modes transgressifs de production aient un reflet institutionnel par la nouvelle université ; c’est « là que le modèle d’émancipation transgressive cherchera et proposera ses fondements scientifiques (psychanalyse) et ses alibis libérateurs et révolutionnaires. La mondanité sera donc culturelle : le pouvoir de séduction passe par la « culture ». Elle est le pouvoir des signes et des moyens de cette culture (qui est une anticulture). [7]» Et Clouscard ajoute même ceci :
« C’est à partir de la nouvelle université que seront « transfigurées » en utopie libératrice les mœurs du libéralisme libertaire, alors justifiées. La mondanité, nouvelle pratique du modèle d’émancipation transgressive, sera un double terrorisme culturel. Elle se justifiera, d’une part, par le néo-positivisme scientiste, par une anthropologie d’extrapolation idéologique à partir des nouvelles sciences (ethnologie, linguistique, psychanalyse, etc.), par une épistémologie néo-kantienne…, etc. Elle se justifiera, d’autre part, politiquement, par l’utopie libertaire, habillée de cette pseudo-scientificité et elle fera la leçon au monde du travail, à l’ « économisme », aux organisations ouvrières, etc. »[8]
Ce qui me paraît intéressant, ce sont deux choses ; la première est que, comme vous, s’il parle de néo-positivisme c’est pour ne pas parler du positivisme de Saint-Simon et de Comte ; chez lui, ce sont les néo-kantiens qui ont en fait gagné la partie ; il y a donc un point amusant de contact négatif entre vous, c’est le refus de faire du saint-simonisme un élément explicatif.

RL : J’ai fait la connaissance de Clouscard à l’occasion de l’émission que vous évoquez dont le thème général était la séduction. Par la suite j’ai eu plaisir d’échanger avec lui à plusieurs reprises sur la façon d’interpréter les évolutions du monde politique et culturel. Ce qui rendait la discussion intéressante c’était de voir la façon dont un même constat pouvait être interprété de façons différentes en fonction, en particulier, des cadres théoriques que nous étions prêts à mobiliser. L’originalité de l’approche de Clouscard résidait dans la façon dont il réconciliait une approche marxiste de l’histoire du capitalisme avec les aspects les plus contemporains d’une politique et d’une culture dominées par le développement des logiques de séduction. C’était un peu comme si tout l’espace politique, économique et culturel était envahi par une proliférante fétichisation de la marchandise. Mais au-delà de l’accord sur la description de l’évolution des rapports sociaux, la discussion portait sur une différence dans les intérêts théoriques. Le but de Clouscard était de réconcilier ces descriptions avec des analyses marxistes traditionnelles qui avaient tendance à minimiser, voire parfois à mépriser, une approche trop « culturelle »des choses. Ma préoccupation était à l’époque à propos du marketing, comme elle est aujourd’hui à propos du management, la question des enjeux liés à l’analyse des processus administratifs. Il s’agit, par rapports aux interrogations que soulèvent les phénomènes décrits par Clousard, ou Baudrillard, de proposer de détourner un instant le regard de la fascination qu’exerce le spectacle de « la société du spectacle » pour le porter sur ses coulisses, les univers bureaucratiques où se décident, se fabriquent et se financent les programmes d’actions.
Lors de l’émission d’Apostrophe consacrée au thème de la séduction à laquelle vous faite allusion, je devais essayer de faire part du message spécifique du Prince Bureaucrate, écrit avec Catherine Paradeise, qui participait également à l’émission. Pour moi, après réflexion, et prise en compte des contraintes de la communication télévisée j’avais défini mon propos en deux propositions : 1/ on peut traiter du marketing de manière intellectuellement rigoureuse et 2/ pour cela il suffisait de comprendre que le marketing était la forme moderne (bureaucratique) de la sophistique. Pour donner un caractère plus concret à mon propos je soulignai la facilité avec laquelle Séguéla, un spécialiste du marketing par excellence présent lors de l’émission, pouvait énoncer sans gêne aucune une chose et son contraire. Curieusement ce message longuement argumenté dans un ouvrage de près de 350 pages, publié depuis aux Etats-Unis (en 1989 et en 2016 sous le titre Marketing democracy : public opinion and media formation in democratic society), n’a guère intéressé les philosophes, sauf Barbara Cassin qui m’invita à la décade de Cerisy sur la sophistique qu’elle organisait en 1985, décade qui a donné lieu à un ouvrage aux Editions de Minuit, Le Plaisir de Parler, dans la collection Argument, où il est possible de lire, sur le quatrième de couverture, le mot marketing, et deux disciples de Chaïm Perelman, Michel Meyer et Guy Harrcher qui me fit l’honneur de m’inviter à participer à deux ouvrages dédiés à la mémoire du fondateur du Centre de philosophie du Droit de l’ULB.
Un des objets de l’ouvrage dont nous parlons aujourd’hui est de montrer la façon dont il est presque impossible de tenir ensemble dans un même lieu et dans un même temps, le management et une pensée du management sans que celle-ci ne cherche immédiatement à le condamner avant même de reconnaître la place centrale qu’il occupe dans les rapports sociaux en tant que symptôme, et non en tant que cause, de la crise institutionnelle que subissent les démocraties.
AP : Oui je vois assez bien le problème du jugement de valeur qui, presque mécaniquement, vient parasiter l’analyse du phénomène. L’autre élément qui me semble intéressant, c’est le sens légèrement différent que vous attribuez à l’Université façon Edgar Faure. Chez vous, Dauphine m sure semble être un symptôme qui ne peut advenir que parce que le modèle traditionnel est en crise ; chez Clouscard, Dauphine est un acte créateur, un moteur de transformation effective plus qu’un symptôme, qui déborde Dauphine et devient une sorte de moteur paradigmatique de la subversion que, comme vous d’ailleurs quoique dans une autre optique, il relie au pragmatisme :
« Elle est aussi constituée (comme nous le venons de le dire) du courant néo-positiviste, empiriste, pragmatiste, des sciences humaines comme elles s’enseignent dans certaines universités edgar-fauristes. Cet enseignement révèle sa vocation avec le service publicitaire du néo-capitalisme. L’investigation quasi-policière autorisée par ces fausses sciences permet les études de marché, etc., mais surtout justifie expérimentalement les modèles de l’émancipation progressive, et, à partir de ces modèles, manipule les besoins[9]. »
Ma question est au fond la suivante : ce que Clouscard appelle la « subversion » et la « transgression » n’est-il pas l’équivalent de ce que vous analysez dans votre ouvrage sous le terme de « révolution » ?
RL : La façon dont la notion de révolution est traitée dans le livre ne consiste pas à lui donner un contenu conceptuel précis mais plutôt à suivre l’usage qui en est fait par certains auteurs. Par Tocqueville tout d’abord (comme par exemple quand il oppose une France qui a des « passions révolutionnaires » à une Amérique qui connait des « états révolutionnaires »), ou encore par les historiens ou les sociologues à propos des évènements de 1968, ou encore, et peut-être surtout, s’agissant du thème du livre, par cinq auteurs américains dont les ouvrages permettent de baliser l’émergence du management au premier plan des institutions sociales à savoir, Adolphe Berle et Gardiner Means, Chester Barnard, James Burnham et Alfred Chandler.
Ceci permet de rendre compte d’une différence avec Clouscard dans l’interprétation de phénomènes tels que la création de l’Université de Dauphine et ou la nature transgressive de la généralisation des approches managériales. Là où l’approche socio-historique de Clouscard reconnaît des causes des transformations sociales, une approche en termes de causalité structurelle centrée sur une théorie de l’institution à travers la définition de la notion de système de légitimité, préfère voir les conséquences d’une crise des limites mêmes (limites institutionnelles), qui permettaient de définir ce qui constituait une transgression.
AP : Restons peut-être dans les questions de détermination de la transgression et de la révolution mais en rejoignant Tocqueville. Un point très stimulant dans votre dernier ouvrage tient au rapport de la démocratie et de la hiérarchie – et donc du principe de légitimation de l’autorité pour reprendre un vocabulaire qui vous est cher. Votre but est de trouver chez Tocqueville une sorte de thématisation de ce que la démocratie pourrait avoir de révolutionnaire, mais pas à partir de l’approche traditionnelle consistant à convoquer l’égalisation des conditions comme rouleau compresseur de la transformation sociale. Chacun a en tête les pages célèbres sur les eaux du Déluge qui détruisent et engloutissent tout, qui deviennent l’élément métaphorique de l’égalisation des conditions chez Tocqueville :
« Marche fatale de la démocratie. La démocratie ! N’apercevez-vous pas que ce sont les eaux du Déluge ? Ne les voyez-vous pas s’avancer par un lent et irrésistible effort ? Déjà elles couvrent les campagnes et les villes, elles roulent sur les créneaux détruits des châteaux forts, et viennent baigner jusqu’aux marches des trônes. Vous reculez, le flot poursuit sa marche, vous fuyez, il court derrière vous. Vous voici enfin dans votre dernier asile et à peine êtres-vous assis pour reprendre haleine qu’il a déjà couvert l’espace qui vous séparait encore de lui. Sachons donc envisager l’avenir d’un œil ferme et ouvert. Au lieu de vouloir élever d’impuissantes digues cherchons plutôt à bâtir l’arche tutélaire qui doit porter le genre humain sur cet océan sans rivages. Quelles seront les conséquences probables de cette immense révolution sociale ? Quel ordre nouveau sortira des débris de celui qui le tombe ? Qui peut le dire ?[10] »
A cet égard, vous vous détournez de l’approche traditionnelle et questionnez plus volontiers la manière dont Tocqueville saisit une tension entre la notion aristocratique de la sujétion et la notion démocratique de l’obéissance – ce sont ses termes. Qu’est-ce qui est en jeu dans cette tension ?
RL : Le texte que vous citez est une évocation puissante, lyrique de la façon dont la tendance providentielle à l’égalité s’impose de façon telle que toute résistance, toute digue, est destinée à céder tôt ou tard. Ce discours semble bien s’adresser à ceux, nombreux alors, qui pensent pouvoir maintenir un système monarchique. Il s’agit là du thème central de son œuvre qu’il prolongera avec L’Ancien Régime et la Révolution. Si la démocratie peut avoir quelque chose de révolutionnaire c’est d’abord dans ce sens, proprement politique et historique, d’un mouvement irrésistible, qui menace, par sa logique propre d’aboutir à la tyrannie de l’Etat ou à la tyrannie de la majorité. Ce dont il s’agit c’est de mettre en évidence l’importance des développements que Tocqueville consacre à la notion d’administration.
La question que pose la présence du phénomène administratif dans une démocratie c’est la façon dont la présence de hiérarchie semble bien entrer en contradiction avec le principe démocratique, à savoir l’égalité. C’est à cette occasion qu’il est amené à dire que l’Amérique connait des « états révolutionnaires » là où la France connait des « passions révolutionnaires ». L’adjectif révolutionnaire » dans ce contexte désigne moins un moment historique qu’un état psychosociologique qui résulte, en Amérique, des occasions où se manifeste la contradiction entre l’égalité de principe entre les citoyens et la présence de relation hiérarchique qu’implique l’existence d’administration au sein de la société.
C’est le maintien de relations hiérarchiques héritées de l’Ancien Régime dans une France du XIXème siècle marquée par la résurgence de périodes de Restaurations à la légitimité régulièrement contestée par des épisodes révolutionnaires qui conduit Tocqueville à s’interroger sur ce que peut être le fonctionnement d’une démocratie dans un pays de grande taille. Etant contradictoire avec l’idée de démocratie la présence de relations hiérarchiques en Amérique a quelque chose de révolutionnaire, au sens de contraire aux principes mêmes de fonctionnement de la société. C’est pourquoi Tocqueville consacre des développements particulièrement importants et significatifs à la façon dont de telles relations hiérarchiques (telles celles qui peuvent exister entre un employé et son patron) sont vécues par les citoyens américains. Il le fait de façon suffisamment attentive et précise pour décrire comment ces relations ne peuvent manquer, même dans le meilleur des cas (celui où la relation hiérarchique est limitée dans le temps et dans l’espace par les termes d’un contrat accepté par les deux parties ) de produire, à certains moment, (pour être plus précis au moment même de la fin du contrat) ce qu’il désigne lui-même d’ « état révolutionnaire ». C’est la prise en compte de ce genre de relations dans un monde où se développent de grandes entreprises qui conduit Tocqueville à esquisser la formulation de ce qu’on pourrait appeler sa « troisième prophétie », prophétie qui désigne la possibilité d’une troisième menace liée au développement de l’économie dans une société démocratique à savoir la menace du retour d’un « aristocratie industrielle ». S’il s’agit bien là d’une révolution, au sens de bouleversement de l’ordre politique (mais en l’occurrence aussi dans le sens de retour à un état antérieur) on pourrait dire que du point de vue de la démocratie il s’agit de contre -révolution, C’est du reste sans doute parce que cette évolution contredit l’hypothèse centrale qui sous-tend l’œuvre de Tocqueville (à savoir la marche providentielle vers l’égalité) que Tocqueville ne fait qu’indiquer cette possibilité au passage à l’intention « des amis de la démocratie ».
AP : Une manière stimulante de penser les choses est l’analogie que, à la suite de Tocqueville vous réactivez, en cherchant à déterminer une « grammaire du social » qui renvoie à la nécessaire soumission à l’autorité tout comme les langues doivent se soumettre à une grammaire pour produire un sens intelligible.
RL : Il arrive que dans la lecture d’un texte, une phrase donne le sentiment de contenir l’essentiel de ce dont il est question. La densité de cette formulation correspond au caractère éminemment théorique du propos de Tocqueville, même si le style général du texte est plutôt celui d’un essai écrit dans une langue d’une exceptionnelle élégance. Cette phrase est la suivante :
« Cependant, de même que tous les peuples sont obligés , pour exprimer leur pensées, d’avoir recours à certaines formes grammaticales, constitutives des langues humaines, de même, toutes les sociétés, pour subsister, sont contraintes de se soumettre à une certaine somme d’autorité sans laquelle elles tombent en anarchies[11] »
Cette analogie entre la grammaire et la hiérarchie permet de comprendre pourquoi les faits d’organisation et plus encore de management, peuvent être tenus à l’écart par les discours (que ce soit ceux du droit, ou ceux des sciences économique et sociales) dont la fonction est de les légitimer. De la même manière les règles de grammaires peuvent être ignorées de ceux-là mêmes qui ne peuvent manquer de les respecter à la mesure de leur « compétence linguistique ». La mise à l’écart du phénomène administratif sera d’autant plus radicale que ses manifestations viennent contredire les principes de la démocratie. D’où la difficulté qu’il y a à faire se rencontrer, dans une démocratie, la pensée et le management.
AP : Vous citez un long passage qui clôt le chapitre V de la troisième partie de la Démocratie en Amérique et qui envisage les rapports de subordination et d’autorité ; or, Tocqueville finit sur une phrase étonnante pour caractériser la tension dont nous parlions précédemment, à savoir : « un pareil état n’est pas démocratique mais révolutionnaire ». Comment interprétez-vous le fait que Tocqueville peigne un système social, la démocratie, selon la logique révolutionnaire du mouvement et du changement permanents, tout en considérant que les rapports d’autorité débouchent sur une situation révolutionnaire s’opposant à une démocratie pourtant définie selon une transformation révolutionnaire constante ? Comment rendre compte que la démocratie soit en tant qu’égalisation des conditions une révolution constante et que, par ailleurs, des situations révolutionnaires soient non-démocratiques ?
RL : C’est qu’il s’agit à la fois de structure (démocratie = égalité par exemple) et d’histoire (liée aux processus essentiellement dynamiques sous-jacents au développement des sociétés occidentales que sont l’entreprise, la science et la technologie. Si l’on ajoute qu’il est dans la nature des institutions de devoir être suffisamment stables pour permettre d’une part la socialisation des citoyens qui sont supposés en avoir intériorisé les principes et d’autre part pour assurer la sécurité juridique dont ils ont besoin pour guider leurs actions (ceci pourrait justifier une évocation du fantôme de la Reine de Cœur d’Alice au Pays des Merveilles). La contradiction entre stabilité des normes juridiques et dynamique des processus sociaux est source de tension. Etant donnée l’importance sociale de l’existence d’un système de normes acceptées (de droit) par tous, le système de normes tiendra tant qu’il le pourra (c’est à dire tant que les normes ne deviennent pas si contraires aux faits qu’il devient impossible de représenter les uns par les autres ou, si l’on préfère, de dissimuler les uns derrière les autres). Mais tôt ou tard la digue ne peut manquer de céder : d’où la périodisation de l’histoire du droit. Chaque mutation des normes institutionnelles se traduit par une période de crise que l’on peut associer à la notion de révolution dans les deux sens du terme : période de tension sociale, dont la résolution, si l’on en croit Machiavel ne peut se résoudre que par un retour aux fondements mêmes de la légitimité du système en crise. Telle est la leçon que nous communique l’auteur du Prince dans le Discours sur la Première Décade de Tite live à propos de la façon dont la fondation des ordres mendiants, franciscains et dominicains, a sauvé une église que la simonie et le nicolaïsme risquaient de séparer définitivement du principe de pauvreté supposé la fonder.
AP : Pour rester avec Tocqueville et revenir à lui, il y a deux passages que vous citez à plusieurs reprises et qui revêtent une importance cruciale dans votre démarche. Le premier évoque l’aristocratie manufacturière qui « est une des plus dures qui aient paru sur la terre » mais aussi « une des moins dangereuses » ; l’autre passage, plus récurrent encore, est celui de l’introduction de De la Démocratie en Amérique, dans laquelle Tocqueville écrit ceci : « Ce livre ne se met précisément à la suite de personne ; en l’écrivant, je n’ai entendu servir ni combattre aucun parti ; j’ai entrepris de voir, non pas autrement, mais plus loin que les partis ; et tandis qu’ils s’occupent du lendemain, j’ai voulu songer à l’avenir. ». Pourquoi insistez-vous autant sur ces deux citations ?
RL : Je trouve particulièrement opportun d’associer ces deux citations (ces deux répétitions) même si, (sauf erreur de ma part) elles ne sont pas associées de cette façon dans mon texte. Pour répondre complètement il faudrait considérer chaque occurrence.
Mais pour répondre de manière plus précise, la discussion des menaces que fait peser sur la démocratie le développement d’une véritable aristocratie industrielle qui figure pleinement dans tout un chapitre de la Démocratie en Amérique, se prête facilement à une lecture idéologique en termes de prise de parti pour ou contre le développement industriel, pour ou contre la démocratie etc. C’est sans doute pourquoi il est peu discuté par des auteurs dont le souci est 1/ soit de donner en exemple la démocratie américaine, une société pragmatique, supposée ignorer le type de conflits idéologiques relatifs au développement du capitalisme qui caractérisent les sociétés européennes, ou 2/ soit de montrer que le destin fatal des démocraties résulte des principes démocratiques eux-mêmes et non de l’émergence de phénomènes hiérarchiques en leur sein.
La référence au caractère non partisan des analyses tocquevilliennes a une double fonction : la première est de voir dans cette affirmation le credo d’un véritable théoricien, qui, sans mettre de côté tous les faits, accepte de les schématiser de manière radicale à travers deux catégories (égalité, hiérarchie) et d’autre part assume de mettre de côté tous les affects idéologiques (une « époché » qu’il réserve à ses textes théoriques comme le montre, par contraste, ce qu’il a pu écrire de la façon dont il a ressenti les événement de 1848). De ce point de vue, qui est celui de la relation entre la théorie et la pratique, on ne saurait sans doute mieux faire que de citer les derniers mots de l’introduction de la Démocratie en Amérique :
« Il ne faut pas non plus oublier que l’auteur qui veut se faire comprendre est obligé de pousser chacune de ses idées dans toutes leurs conséquences théoriques, et souvent jusqu’aux limites du faux et de l’impraticable ; car s’il est quelquefois nécessaire de s’écarter des règles de la logique dans les actions, on ne saurait le faire de même dans les discours, et l’homme trouve presque autant de difficultés à être inconséquent dans ses paroles qu’il en rencontre d’ordinaire à être conséquent dans ses actes. Je finis en signalant moi-même ce qu’un grand nombre de lecteurs considérera comme le défaut capital de l’ouvrage. Ce livre ne se met précisément à la suite de personne ; en l’écrivant, je n’ai entendu servir ni combattre aucun parti ; j’ai entrepris de voir, non pas autrement, mais plus loin que les partis ; et tandis qu’ils s’occupent du lendemain, j’ai voulu songer à l’avenir. »[12]
Il serait présomptueux de se prévaloir pour soi-même de ce qui vaut pour Tocqueville.
Aussi ai-je préféré trouver l’autorisation d’interpréter son œuvre à ma manière : dans la tolérance avec laquelle Tocqueville accueille la diversité des interprétations dont elle a fait l’objet :
« Je plais à des gens d’opinions opposées, non parce m’entendent, mais parce qu’ils trouvent dans mon ouvrage, en ne le considérant que d’un seul côté, des arguments favorables à leur passion du moment »[13]
A cela je voudrais ajouter deux points. Tout d’abord marquer ma gratitude à l’égard de l’ouvrage de Serge Audier, Tocqueville Retrouvé : genèse et enjeux du renouveau tocquevillien français, qui donne un accès exceptionnellement généreux à la variété des interprétations de l’œuvre de Tocqueville et de leur signification. Ensuite, mais cela va de soi, les interprétations que je propose ont moins pour but de convaincre d’un point de vue ou d’un autre que de susciter la réflexion à propos d’une dimension particulière de son œuvre : la place qu’il donne à une analyse précise des phénomènes administratifs.
AP : Pour finir sur ce point, j’aimerais vous soumettre un – long – passage de L’Ancien Régime et la Révolution dans lequel Tocqueville juge que ce sont les écrits des économistes qui permettent de saisir la nature intrinsèque de la révolution en tant qu’événement et non en tant que processus démocratique ; cela confère à la nature même des écrits de philosophie d’économie politique une visée programmatique intrinsèquement révolutionnaire :
« Vers le milieu du siècle, on voit paraître un certain nombre d’écrivains qui traitent spécialement des questions d’administration publique, et auxquels plusieurs principes semblables ont fait donner le nom commun d’économistes ou de physiocrates. Les économistes ont eu moins d’éclat dans l’histoire que les philosophes ; moins qu’eux ils ont contribué peut-être à l’avènement de la Révolution ; je crois pourtant que c’est surtout dans leurs écrits qu’on peut le mieux étudier son vrai naturel. Les philosophes ne sont guère sortis des idées très générales et très abstraites en matière de gouvernement ; les économistes, sans se séparer des théories, sont cependant descendus plus près des faits. Les uns ont dit ce qu’on pouvait imaginer, les autres ont indiqué parfois ce qu’il y avait à faire. Toutes les institutions que la Révolution devait abolir sans retour ont été l’objet particulier de leurs attaques ; aucune n’a trouvé grâce à leurs yeux. Toutes celles, au contraire, qui peuvent passer pour son œuvre propre ont été annoncées par eux à l’avance et préconisées avec ardeur ; on en citerait à peine une seule dont le germe n’ait été déposé dans quelques-uns de leurs écrits ; on trouve en eux tout ce qu’il y a de plus substantiel en elle. Bien plus, on reconnaît déjà dans leurs livres ce tempérament révolutionnaire et démocratique que nous connaissons si bien ; ils n’ont pas seulement la haine de certains privilèges, la diversité même leur est odieuse : ils adoreraient l’égalité jusque dans la servitude. Ce qui les gêne dans leurs desseins n’est bon qu’à briser. Les contrats leur inspirent peu de respect ; les droits privés, nuls égards ; ou plutôt il n’y a déjà plus à leurs yeux, à bien parler, de droits privés, mais seulement une utilité publique. Ce sont pourtant, en général, des hommes de mœurs douces et tranquilles, des gens de bien, d’honnêtes magistrats, d’habiles administrateurs ; mais le génie particulier à leur œuvre les entraîne. Le passé est pour les économistes l’objet d’un mépris sans bornes. « La nation est gouvernée depuis des siècles par de faux principes ; tout semble y avoir été fait au hasard », dit Letronne. Partant de cette idée, ils se mettent à l’œuvre ; il n’y a pas d’institution si vieille et qui paraisse si bien fondée dans notre histoire dont ils ne demandent l’abolition, pour peu qu’elle les incommode et nuise à la symétrie de leurs plans. L’un d’eux propose d’effacer à la fois toutes les anciennes divisions territoriales et de changer tous les noms des provinces, quarante ans avant que l’Assemblée constituante ne l’exécute. Ils ont déjà conçu la pensée de toutes les réformes sociales et administratives que la Révolution a faites, avant que l’idée des institutions libres ait commencé à se faire jour dans leur esprit. Ils sont, il est vrai, très favorables au libre échange des denrées, au laisser faire ou au laisser passer dans le commerce et dans l’industrie ; mais quant aux libertés politiques proprement dites, ils n’y songent point, et même quand elles se présentent par hasard à leur imagination, ils les repoussent d’abord. La plupart commencent par se montrer fort ennemis des assemblées délibérantes, des pouvoirs locaux et secondaires, et, en général, de tous ces contre poids qui ont été établis, dans différents temps, chez tous les peuples libres, pour balancer la puissance centrale. « Le système des contre forces, dit Quesnay, dans un gouvernement est une idée funeste. – « Les spéculations d’après lesquelles on a imaginé le système des contre poids sont chimériques », dit un ami de Quesnay[14]. »
RL : La citation est longue et la question ne me paraît pas clairement.
AP : Je la précise. Tocqueville semble attribuer aux économistes (et non aux philosophes) un rôle révolutionnaire, quelle que soit leur école de pensée, et plus encore un rôle activement et concrètement révolutionnaire. Pourquoi dans votre ouvrage, qui aborde la question révolutionnaire, ne vous servez-vous pas de ces passages ?
RL : S’il s’agit de comparer le rôle des philosophes et des économistes dans la Révolution, la question est de savoir sur quoi peut reposer ma réponse. Tout l’effort de travail théorique et d’élaboration d’une problématique (approche que j’ai tendance de plus en plus souvent à désigner du nom d’essai d’anthropologie institutionnelle des sociétés occidentales) consiste à essayer de donner des réponses fondées à des questions du type de celles que vous posez. Par exemple le système de symboles constitutif de la notion de notion de système de légitimité rationnel-légal « bien formée » (ou, si l’on préfère idéal-typique) comporte quatre niveaux dont les lignes qui suivent donnent une description simplifiée
Un niveau cosmologique constitué d’un monde sur lequel est définie une dichotomie (nature/ culture), cette dichotomie ne pouvant être perçue correctement qu’à l’aide de lunettes spéciales, en l’occurrence la science (par exemple la physique newtonienne).
Un niveau social ou sociétal, qui résulte de la projection de la dichotomie précédente sur la culture et ce grâce aux lunettes fournies par des sciences sociales construites par analogie avec les sciences de la nature (par exemple une économie politique construite sur le modèle de la physique newtonienne).
Le troisième niveau est celui du droit lui-même divisé, en France, entre un secteur privé qui relève de la Cour de Cassation, et un secteur public qui relève du Conseil d’Etat (le secteur privé étant rationnel parce que légal et le secteur public légal parce que rationnel)
Enfin le quatrième niveau est occupé par les administrations publiques et privées suivant qu’elles relèvent de l’un ou l’autre de ces deux systèmes de juridiction.
Ce schéma permet de comprendre comment le système rationnel-légal peut dépendre de la philosophie, en l’occurrence l’épistémologie qui définit la science de la nature (par exemple La Critique de la Raison Pure comme épistémologie correspondant à la physique de Newton) d’où se déduit la possibilité d’une science de la culture construite sur le modèle des sciences de la nature (La Critique de la Raison Pratique qui donne une place centrale à la notion de « typique » que l’on retrouve dans la notion wébérienne d’ idéal-type), la conception du droit qui en résulte, et enfin la description de processus administratifs dont la légitimité dérive de leur soumission aux normes définies par les trois autres niveaux. (Une validation de cette structure peut être tentée en rappelant que l’Ancien Régime était fondé sur un principe articulant charisme et tradition et reposant de manière essentielle sur la Bible comme texte sacré. Or les quatre premiers livre du Pentateuque correspondent à chacun des niveaux que nous venons de définir : la Genèse nous dit d’où vient le monde, l’Exode nous dit d’où vient le peuple, le Lévitique nous dit quels rituels doivent être accomplis : c’est-à-dire quelles procédures opposables aux tiers doivent être respectées pour assurer l’accord des actes avec les deux niveaux précédents qui appartiennent au domaine de l’invisible, qu’ils résident dans les cieux ou dans l’histoire, enfin les Nombres marquent le début de l’administration de la société.)
La place occupée par la science économique dans un tel système peut se comprendre à partir du fait que la condition requise par l’impératif catégorique (à savoir le fait de devoir souhaiter que chacun soit traité comme on souhaite l’être soi-même) est sous-déterminée. D’un point de vue institutionnel, la théorie classique du marché permet de spécifier une loi acceptable du point de vue de cette exigence. Un lien entre philosophie et l’économie politique peut ainsi être établi. Quant au droit il assure (comme doit le faire tout rituel) la soumission des actions individuelles à la source des normes qui reste invisible, aussi invisible du moins que la main invisible du marché.
Pour qui trouverait que cette proposition met dans la philosophie de Kant des idées qui lui seraient étrangère il suffit de se reporter à un passage du Conflit des Facultés pour trouver au moins une référence explicite à une notion de laissez-faire.
Toutefois les remarques de Tocqueville à propos du rôle respectif des philosophes et des économistes dans la révolution ne doivent pas faire oublier la nécessité où se trouvait la France, du fait de l’absence d’alliance entre l’aristocratie et la classe bourgeoise (contrairement à la situation de l’ Angleterre qui par ailleurs avait pris de l’avance non seulement en matière d’industrialisation mais aussi de régicide), de surmonter un clivage qui était contraire au développement des économies. C’est ce que nous dit Tocqueville dans l’introduction à l’Ancien Régime et la Révolution lorsqu’il précise que ce dont il est question dans son ouvrage c’est des classes « car c’est d’elles qu’il s’agit ». Pour surmonter ce blocage social, le discours des économistes était impuissant, et les idées révolutionnaires des philosophes, du moins de ceux que l’on désigne de ce nom en France (comme par exemple Jean-Jacques Rousseau) ont pu se révéler nécessaires. On peut rappeler à ce propos ce que dit Marx de sa théorie qui puisait la théorie économique de l’Angleterre, le socialisme de la France (les idées aussi bien que les mouvements animés par ces idées qui ont donc eu un rôle déterminant dans événements révolutionnaires, On peut noter à ce propos la description peu amène que Tocqueville fait des écrit de Morrely) et la philosophie à l’Allemagne (« idéalisme » allemand qui effectivement n’a pas eu en lui-même le pouvoir, ni peut-être l’intention, de générer une révolution politique ou sociale). Le rapport entre la philosophie allemande et les philosophes français pendant la période révolutionnaire sont multiples et non négligeables : c’est la relation d’Emmanuel Kant à Jean-Jacques Rousseau et au 14 Juillet, c’est l’importation de la philosophie de Kant en France au moment de la Révolution décrite par François Azouvi et Dominique Bourel dans De Königsberg à Paris : la réception de Kant en France 1788-1804, échanges couronnés, si l’on ose dire, par la façon dont Hegel pense voir l’incarnation de l’esprit à cheval dans la figure de Napoléon à Iéna en 1806).
Entretien avec Romain Laufer : Autour de Tocqueville au pays du management (partie 3)
[1] On peut en consulter le site : https://www.fnege.org/
[2] Tocqueville au pays du management, op. cit., p. 23.
[3] Ibid., p. 123.
[4] Cf. Friedrich von Hayek, The Counter Revolution of Science. Studies of the Abuse of Reason, Liberty Fund, 1952.
[5] J’emprunte la traduction au site suivant : http://herve.dequengo.free.fr/Hayek/Crs/Crs11.htme
[6] On peut consulter l’émission intitulée « Images de marque » ici : https://archive.org/details/ApostrophesImagesDeMarque
[7] Michel Clouscard, Néofascisme et idéologie du désir, Paris, Delga, 2013, p 95-96.
[8] Ibid., p. 96.
[9] Ibid.
[10] Tocqueville, De la Démocratie en Amérique, in Tocqueville, Œuvres, Tome II, Gallimard, coll. Pléiade, 1992, note a., p. 937-938. T. 1
[11] Ibid.
[12] Tocqueville A. de, De la Démocratie en Amérique, ibid. p. 51voquer F
[13] Tocqueville A. de (2003). Lettres choisies-souvenirs, coll. Quarto-Gallimard, p.315
[14] Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, III, 3, in Tocqueville, Œuvres, Tome III, Paris, Gallimard, coll. Pléiade, 2004, p. 186-187. C’est moi qui mets en gras.








