La première partie de l’article se trouve à cette adresse.
C : Approche ontologique du désir
AP : Peut-être est-ce alors l’occasion d’en arriver à la partie ontologique qui constitue la seconde partie de votre ouvrage. Très vite apparaît la notion d’exil qui est peut-être ce qui vous différencie le plus de Merleau-Ponty puisque chez ce dernier la relation au monde est plutôt pensée à partir de la familiarité et de l’appartenance. Qu’est-ce qui vous a amené à forger cette notion d’exil et à prendre ainsi vos distances sur ce point avec Merleau-Ponty ?
RB : Tout d’abord, en toute rigueur, le concept d’exil, qui est élaboré dans Dynamique de la manifestation, prend sens dans le cadre d’une réflexion sur la différence entre l’homme et l’animal et doit alors être distingué du concept d’exode. En effet, s’il est vrai, comme je le montre, que tout vivant procède d’une scission archi-événementiale qui affecte la surpuissance du monde, scission à la faveur de laquelle celle-ci tombe en quelque sorte hors d’elle-même, il reste à rendre compte de la différence entre l’homme et l’animal dans ce cadre désormais résolument continuiste. Or, si tous deux procèdent de l’archi-mouvement du monde et en sont séparés par l’archi-événement, la tension entre ces deux dimensions peut être hiérarchisée ou polarisée de deux façons. Même si, en tant qu’individu vivant, l’animal est séparé du monde, il n’en reste pas moins qu’il demeure sous son emprise, encore traversé par sa puissance. L’animal est un vivant cosmologique, ce qui s’atteste par le fait qu’il dérive au sein du monde, qu’il est plutôt mouvement que conscience et que son désir trouve certaines voies de satisfaction (que l’on nomme notamment instinct). C’est cette situation que je résume par le concept d’exode. Ce qui caractérise au contraire le vivant humain, c’est qu’il prend la scission événementiale pour ainsi dire de plein fouet, qu’il se situe au lieu même de la séparation, de sorte qu’il est radicalement éloigné de sa patrie ontologique tandis que l’animal erre encore en elle. Dans le cas de l’homme, la dimension de la scission l’emporte sur celle de l’appartenance et donc de la continuité avec le monde. C’est la raison pour laquelle l’homme est pour ainsi dire plus conscience que mouvement et son désir est un désir pur, où domine la dimension de l’insatiabilité. C’est aussi pourquoi on peut dire que l’homme est un animal métaphysique plutôt que cosmologique, étant entendu que l’objet propre de la métaphysique, comme je l’ai montré dans ce livre, est l’événement de la scission, l’archi-événement. C’est cette situation que je rassemble sous le concept d’exil pour décrire une perte de l’origine, une existence qui est dominée par la séparation avec le monde dont elle procède. Tel est le sens pour ainsi dire technique du concept d’exil ; mais cela ne m’empêche de l’utiliser pour désigner la situation de séparation qui caractérise tout vivant et, au premier chef, celui que nous sommes. Il y a donc, dans mes livres, deux usages du terme d’exil. L’un, technique et circonscrit, qui est celui que je viens d’exposer ; l’autre, métaphorique et plus général pour désigner la séparation ontologique qui est au cœur du désir et en commande la dynamique propre.
En vérité, cette notion, qui m’éloigne en effet beaucoup de Merleau-Ponty, a été forgée dans le cadre de mon débat critique avec Patočka, tel que je le conduis dans mon second ouvrage consacré à cet auteur, L’ouverture du monde. La question la plus difficile que soulève la phénoménologie asubjective est celle du passage de la manifestation primaire, qui se confond avec l’individuation des étants par le monde et au sein du monde, à la phénoménalité que je nomme secondaire, qui correspond à l’apparaître proprement dit comme apparaître à… . La question elle-même se dédouble puisqu’il s’agit de savoir à la fois de quelle nature est ce passage et comment il est possible, c’est-à-dire dans quelle mesure il est préfiguré dans la manifestation primaire. Or, Patočka comprend la manifestation secondaire, c’est-à-dire la subjectivation, comme une modalité singulière de l’individuation et donc de la manifestation primaire, consistant en une manière spécifique de se « mettre à part ». Il en vient même à rendre compte de l’humanité de l’homme à partir d’une « expulsion » hors de la totalité et, dès lors, le rapport de l’homme à celle-ci comme un rapport de révolte et de dissension, la vie humaine étant finalement vie « contre la totalité ». Simplement, aux yeux de Patočka, cette détermination est propre à l’homme et joue donc comme critère de distinction avec l’animal qui, quant à lui, est intégré à la totalité, en continuité avec elle. J’ai été conduit à reprendre à mon compte ces suggestions mais en les transformant et en les radicalisant. Telle est la source de mon concept d’exil. D’une part, je comprends cette séparation comme relevant d’un régime d’individuation spécifique, distinct de l’individuation primaire : il y a certes une individuation par délimitation et donc différenciation, qui caractérise la phénoménalité primaire ; mais il y a, en second lieu, une individuation par séparation, qui commande l’existence subjective du vivant. D’autre part, j’ai été conduit à radicaliser cette expulsion en la pensant comme un archi-événement n’ayant pas, à ce titre, de cause ou de raison au sein du monde, alors que Patočka demeure enclin à penser une préfiguration de cette scission dans le monde sur le mode téléologique et c’est pourquoi il affirme que « notre propre individuation appartient à l’univers de l’individuation primordiale ». Enfin, et c’est important, cette « mise à part », qui renvoie pour moi à un pur événement, commande l’existence de tout vivant, animal ou humain et c’est seulement sur fond de cette séparation que, comme je l’ai dit plus haut, une différence pour ainsi dire secondaire pourra être établie.
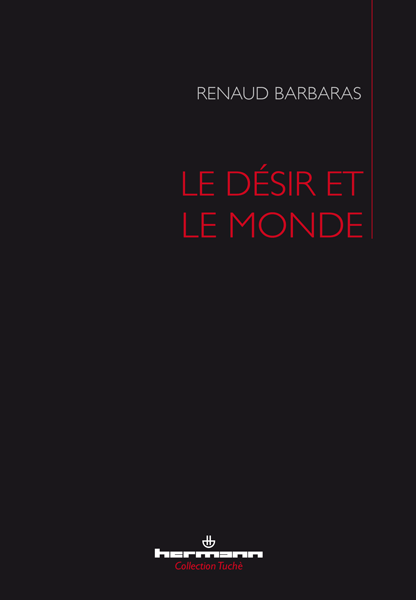
AP : Peut-on dire que le terme d’ « exil » se substitue à celui de « distance » et de quoi cette substitution serait-elle le signe ?
RB : Oui, assurément, ce concept d’exil (ou de scission archi-événementiale) vient en lieu et place du concept de distance, encore insuffisamment déterminé. Mais ce n’est évidemment pas la même chose et le passage de l’un à l’autre correspond à celui d’une phénoménologie de la perception à une phénoménologie se dépassant sous la forme d’une cosmologie et d’une métaphysique. Dans Métaphysique du sentiment, livre qui s’inscrit dans la continuité de Dynamique de la manifestation, je suis conduit à distinguer deux sens de la finitude. D’une part, une finitude qui est celle du monde lui-même et qui caractérise donc le sensible comme ostension de ce monde : elle consiste en ceci que la mondanéité du monde requiert qu’il s’absente de ce qui le présente, à savoir du sensible comme tel, que son infinité exige qu’il se finitise sans cesse dans des apparitions qui en préservent la profondeur constitutive. Cette finitude est insurmontable, elle est inhérente à l’être même du monde : elle est la conséquence du procès de mondification pour autant que celui-ci requiert une auto-production du monde sous la forme d’une différenciation au sein (et donc vis-à-vis) du fond, c’est-à-dire de l’individuation d’étants finis. Si nous existions au niveau de cette finitude, si nous existions au ras même du sensible, nous serions initiés au monde comme tel, nous serions ouverts à sa profondeur, plongerions en elle. Mais tel n’est pas le cas. En effet, nous sommes séparés du monde beaucoup plus radicalement que ne le sont les étants intra-mondains (non-vivants) et c’est aussi pourquoi nous pouvons le rejoindre d’une autre façon, sous la forme de son propre sens.
Autrement dit, il faut reconnaître une finitude qui n’est pas celle du monde mais la nôtre, finitude qui est inhérente à notre existence et renvoie à l’événement d’une scission avec le monde. Alors que le monde se retire seulement derrière ses apparitions sensibles il s’absente de nos existences. Cette seconde finitude, qui est seulement la nôtre, renvoie à un second régime d’individuation, individuation par séparation, ou encore expulsion – expulsion du monde de lui-même et, par voie de conséquence, de nous-mêmes hors du monde. Et bien, dans les livres qui précèdent Dynamique de la manifestation, je n’avais pas encore élaboré cette distinction, qui est celle de l’archi-mouvement et de l’archi-événement, ou encore de la cosmologie et de la métaphysique, de sorte que je faisais comme si notre condition subjective, et donc la phénoménalité qui lui correspond, coïncidait avec l’ostension du monde dans le sensible sous la forme du retrait ou de la profondeur. Je crois que c’est ce que résumait le concept de distance, qui confondait la distance inhérente au monde comme tel et celle qui correspond à notre existence de vivant et qui se solde en réalité par une perte du monde. Or, encore une fois, le mode d’absence du monde au sensible ne se confond pas avec le mode d’absence du monde à nous-mêmes.
AP : Ce qui est très frappant dans votre analyse est le référent de l’exil ; parce que l’exil procède de la subjectivité, il n’y a d’exil que par rapport à cette dernière. « Le sujet ne demeure donc lui-même, comme sujet existant, qu’en se maintenant hors de lui-même, c’est-à-dire exilé de son essence et c’est la raison pour laquelle il est fondamentalement mouvement. »[Ibid., p. 128[/efn_note] Cela est fascinant car la notion d’exil, qu’on retrouve par exemple chez Cioran, a souvent revêtu une teneur gnostique désignant le fait que notre véritable patrie n’est pas le monde mais bien plutôt une sphère spirituelle dont nous aurions été expulsés, expulsion suscitant un sentiment d’étrangeté vis-à-vis du monde sensible. Or, dans vos écrits, tout se passe à l’envers : notre véritable patrie est le monde pris en son cœur sensible et c’est la subjectivité, en tant qu’elle est objectivante, qui nous sépare de cette patrie sensible originelle. Accepteriez-vous le terme de « gnose inversée » que j’avais proposé dans la recension de Métaphysique du sentiment, [consultable ici, pour qualifier vos analyses ?
RB : Oui, comme j’avais eu l’occasion de vous le dire, cette formule de gnose inversée me paraît assez juste. En effet, je pense le sujet vivant à partir d’une forme d’expulsion hors de ce qui constitue au fond le cœur même de l’être, à savoir le monde comme réalité processuelle, comme physis et donc comme surpuissance. Mais cette expulsion renvoie elle-même à une sorte de chute, d’effondrement intérieur du monde, plus précisément à une limitation de sa puissance qui entraîne un détachement, une séparation, pour autant que cette limitation est évidemment incompatible avec sa surpuissance. La différence avec la gnose tient certes à ceci que ce qui pour la gnose est le lieu même de l’exil est pour moi celui de l’origine dont le sujet est exilé. Mais elle tient sans doute aussi à la modalité même et la « cause » de cet exil. Je le pense en effet comme un archi-événement qui affecte le procès du monde mais n’a pas sa cause en lui. Or, je ne suis pas sûr que ce soit ainsi que la gnose pense la perte du principe. En vérité, c’est une question pour moi de définir le statut de cet événement, ce qui exige de le situer par rapport à la création, à la procession néo-platonicienne ainsi qu’à la chute gnostique, étant entendu qu’il ne peut être confondu avec aucune d’entre elles. Il s’agit, plus précisément, de comprendre comment et en quel sens le monde, qui n’est pas la cause de sa propre limitation (la surpuissance ne peut se limiter elle-même) peut être affecté par elle et, d’une certaine façon, y consentir. C’est à ces questions, qui concernent le cœur même de mon entreprise, que je dois m’atteler.

AP : Cette réflexion sur l’exil et la subjectivité amène fort logiquement à faire de la subjectivité tout à la fois ce qui fait qu’il y a désir et tout en même temps ce qui doit se dissoudre. Il n’y aurait en effet pas d’exil sans le sujet, mais le fait même de désirer amène à désirer la fin de l’exil, donc la fin du sujet : d’un côté le sujet désire s’accomplir en coïncidant avec le monde, mais cet accomplissement est dissolution de soi, « ce qui signifie qu’il n’y a de véritable satisfaction du désir que comme disparition du sujet du désir. »1 Cela veut dire que « la réalisation de l’essence du sujet est la disparition de son existence »2 En somme, le prix du désir n’est autre que la mort du sujet ou, pour le dire autrement, le désir est désir de mort, désir de dissolution du sujet. En somme, toute votre réflexion s’organise autour d’une dissolution impossible, celle du sujet responsable de la mise à distance, de l’exil, vis-à-vis de la patrie réelle qu’est le monde pris en sa sensibilité. N’est-ce pas là une reprise une fois de plus inversée d’un élément classique chez les mystiques, à savoir la dissolution du moi en vue de retrouver l’union avec l’origine, que nous empêche de percevoir l’illusion individualisante du sujet ? Métaphysique du sentiment n’hésite en effet pas à tirer des conséquences radicales qui me semblent très proches d’une certaine mystique :
« A nos yeux, l’existence du sujet ne va pas sans impliquer une aliénation fondamentale, un exil radical auxquels seule la fin de l’existence subjective, autrement dit une désindividuation radicale, mettrait fin. » (page 210)
RB : Je voudrais d’abord souligner le fait que, dans ma perspective, ce n’est pas le sujet qui est responsable de l’exil mais plutôt l’exil qui est responsable de l’existence du sujet, de sorte que s’il est vrai de dire qu’il n’y a pas d’exil sans sujet, il est tout aussi vrai d’affirmer qu’il n’y a pas de sujet sans exil. C’est pourquoi le concept d’exil désigne notre condition alors que la scission archi-événementiale renvoie plutôt à la raison de notre existence et donc de l’exil. En d’autres termes, ma démarche consiste à penser la finitude comme un événement qui vient séparer le monde de lui-même et s’ajoute donc à sa finitude propre. Ce n’est pas la finitude qui est un trait du sujet mais le sujet qui est un trait et, pour ainsi dire, un produit de la finitude. Cela étant dit, il est vrai que le désir étant l’envers de notre individuation comme séparation, l’accomplissement du désir correspondrait à la disparition du sujet du désir, à une désindividuation. C’est en ce sens que la pulsion de vie (désir) et la pulsion de mort (désindividuation) coïncident. Cependant, à y regarder de plus près, il n’est pas sûr que cette dissolution puisse être caractérisée comme accomplissement du désir et c’est en ce point sans doute que ma perspective diverge de celle des mystiques que vous évoquez. En effet, si le désir est bien distinct du manque et donc caractérisé par le fait que ce qui le satisfait l’exacerbe, il faut en conclure que l’accomplissement du désir ne peut signifier que son intensification, qui suppose elle-même que la séparation ne soit jamais surmontée.
Autrement dit, je pense le désir comme l’essence même du sujet et non comme une détermination qui renverrait à la simple condition du sujet, exilé de son véritable site ou de sa véritable origine. C’est ici, me semble-t-il, que je m’éloigne des mystiques ; pour eux la dissolution peut en effet être un accomplissement, tout simplement parce que le sujet a son être véritable en Dieu et c’est en cela que, comme vous le dites, l’individuation peut être une illusion. Pour moi, la dissolution n’accomplit rien puisqu’il n’y a de sujet que séparé, puisque la raison même de l’existence subjective est la séparation. La différence fondamentale tient donc à ceci que, pour moi, la séparation ne renvoie pas seulement à une modalité d’existence du sujet mais bien à son essence. Autrement dit, s’il est vrai que le sujet procède de la finitude, celle-ci est par principe indépassable et exclut donc tout accomplissement : nous sommes définitivement assignés au désir.
AP : Je souhaiterais peut-être mettre en perspective la thèse que vous défendez quant à l’exil. Si l’exil se joue par rapport au monde, et non par rapport à une réalité transcendante, alors apparaît un mystère : toutes les pensées qui ont fait de l’exil un exil métaphysique, voire une déchéance par rapport à une réalité supérieure, apparaissent comme de redoutables contresens quant à notre réalité propre et quant à notre origine. Comment rendre compte, dans votre optique, d’un désir métaphysique qui serait formellement identique au vôtre – retrouver l’origine – mais matériellement différent, en ceci que l’origine serait assimilée à une réalité intelligible ou spirituelle dont nous serions déchus ? Ne faudrait-il pas au fond produire en même temps qu’une phénoménologie du désir une sorte de phénoménologie du refus du monde comme lieu d’appartenance ontologique, afin de rendre compte d’un fait, celui de l’existence de nombreuses pensées – néoplatonisme, gnose, etc. – situant l’origine dans une transcendance hors du monde sensible ?
RB : En effet, il faudrait faire la genèse phénoménologique de ce qui, dans ma perspective, relève d’une méconnaissance fondamentale. Il faut cependant souligner que, en raison de la séparation dont nous procédons, cela qui commande le désir et constitue son véritable « objet » (le désiré par différence avec le visé) est ignoré par le désir. Au fond, le désir méconnaît ce qu’il désire véritablement, ce qui le comblerait. Cela ne signifie pas qu’il ne désire rien mais qu’il a tendance à se porter sur des objets (il ne peut pas faire autrement) dont il croit qu’ils peuvent le satisfaire et dont il découvre que ce n’est pas le cas puisqu’ils relancent le désir. Tel est le leurre fondamental et constitutif du désir : rechercher au plan de l’objet, c’est-à-dire de ce qui se donne comme accessible, une satisfaction qui renvoie en réalité à ce qui transcende l’objectalité et qui ne peut être que le monde. Dès lors, il devient compréhensible que le désir en vienne à penser qu’il pourra trouver son apaisement dans une réalité spirituelle.
En effet, puisque l’objet du désir ne peut manifestement pas être cela que je trouve dans le monde, qui s’avère toujours décevant, il faudra le chercher du côté d’une négation des objets du monde, d’une sphère transcendant les réalités mondaines, c’est-à-dire dans une réalité spirituelle ou intelligible. Mais c’est là croire que ce qui est en question est le mode de réalité de l’objet, spirituel et non matériel, intelligible plutôt que sensible, alors que c’est son objectité même qui est question. S’arracher à la réalité matérielle, ce n’est pas encore transcender le plan ontique : c’est seulement la transposer dans un autre champ. Tel serait le leurre fondamental des conceptions intellectualiste ou spiritualiste du désir comme désir métaphysique. Pour moi, le désir est bien désir métaphysique mais cela signifie qu’il est la tentative réitérée de surmonter la scission événementiale, objet véritable de la métaphysique, qu’il est par conséquent désir du monde.
AP : Votre thèse repose également sur une identité entre le monde et le sujet car, si le sujet est en quête de son essence propre à travers le mouvement de désir vers le monde, c’est que celui-ci contient l’essence dont le sujet est lui-même en quête. Il en découle que si le sujet est mouvement, alors le monde lui-même doit être également mouvement, mouvement de mondification par lequel l’indifférenciation originaire produit la différenciation des étants. Cela implique que la sortie différenciée du monde procède d’une puissance que vous thématisez ainsi : « La transcendance du monde vis-à-vis des étants renvoie en dernière analyse à la réserve de la puissance vis-à-vis de ce qui en procède. »3 Vous allez peut-être trouver un peu obsessionnel ce type de questions mais il est difficile ici de ne pas penser à Plotin et à la puissance de l’Un. On trouve par exemple dans le traité 32 ce type d’analyses consacré à l’Un-Bien comme puissance [energheia] de toutes choses : la réalité de l’Un est décrite comme « la puissance d’où viennent la vie, l’intellect et ce qui peut exister de réalité et d’être »4 Et Plotin d’ajouter quelques lignes plus bas que « c’est en tant que puissance qu’elle possède l’illimité, car jamais elle ne sera autre chose que puissance et elle ne fera défaut, puisque c’est à travers elle qu’existent même les réalités qui ne font pas défaut. »5. N’y a-t-il pas dans votre œuvre quelque chose comme qui constituerait une reprise de la notion néoplatonicienne de puissance infinie sous une forme purgée de sa dimension métaphysique ?
RB : Vous avez raison et, en vérité, j’ai choisi le concept de surpuissance, de préférence à celui de toute-puissance, par référence à Plotin. Cependant, la différence est que cette puissance mondifiante ne donne pas lieu à une procession au sens plotinien. La seule hypostase identifiable, si l’on peut s’exprimer ainsi, surgit au sein même du procès mondain, pour autant que la surpuissance ne s’accomplit que sous la forme d’un procès de différenciation du fond, c’est-à-dire d’individuation. C’est pourquoi il faut entendre le monde en trois sens, le procès de mondification produisant l’unité de ces trois dimensions, le monde n’étant autre que les trois en un. Il y a le monde comme surpuissance du fond ; il y a le monde comme multiplicité inhérente à la mise en œuvre de cette puissance comme puissance de différenciation ; il y a enfin le monde comme totalité, c’est-à-dire comme trace de l’indivisibilité de la surpuissance du fond au sein du multiple qu’elle produit. Ainsi, la surpuissance produit les étants en elle-même et elle n’est surpuissance que moyennant cette incessante production. De sorte que, si une dimension était à rapprocher de la procession plotinienne, ce serait plutôt celle du sujet, qui naît du monde par scission, étant entendu que la procession ne peut être assimilée simplement à une limitation. Il s’ensuit que ce qui, chez Plotin, est au plus près de l’Un en est pour moi au plus loin, et inversement.
AP : C’est peut-être à partir de la notion de puissance que le monde se distingue par ailleurs du sujet. Le monde, dites-vous, possède une puissance ontogénétique qui fait défaut au sujet : chez le sujet, le désir est désir de puissance qui lui fait défaut. Mais je me pose une question concernant les rapports entre la puissance du monde et le sujet : le sujet est-il un effet de la puissance du monde ? Si oui, alors comment se fait-il que le monde ait produit une structure de scission vis-à-vis de lui-même, et si non n’y aurait-il pas quelque chose qui échapperait à la toute-puissance qui ne serait donc plus toute-puissance ?
RB : En effet, le mode d’être du sujet est celui de l’impuissance. Comme le dit Valéry, « mon impuissance est mon origine ». Il faut entendre par là qu’il est privé de la puissance ontogénétique qui caractérise la surpuissance du monde, qu’il aspire à.., faut de pouvoir produire. Mais il faut ajouter qu’il y a une puissance propre à cette impuissance : celle de phénoménaliser, de faire paraître, voire de comprendre. Le sujet est donc privé de puissance, ou plutôt, il naît d’une privation de la surpuissance du monde : sa réalité n’est que privative. Il n’en reste pas moins que le sujet n’est pas radicalement séparé du monde, que l’exil n’est pas total (sinon, il s’ignorerait comme exilé, l’exil absolu consistant au fond dans l’oubli de l’exil), sans quoi le sujet ne serait rien et ne ferait rien, bref serait privé de tout dynamisme. Il faut en effet préciser que ma théorie de l’archi-événement s’inscrit dans le cadre d’une phénoménologie de l’appartenance, ce qui revient à reconnaître que le sujet demeure inscrit dans le monde, en prise sur lui, même s’il en est séparé, même s’il ne relève plus du régime cosmologique d’individuation. Autant dire que ce mouvement qu’est le désir est comme la trace ou la présence de la puissance du monde au sein de ce qui en est séparé et donc privé. Le mouvement du sujet n’est donc pas un effet de la puissance du monde mais un effet de sa limitation : il est, plus précisément, cette puissance même privée de sa surpuissance, c’est-à-dire de son infinité.
Or, d’autre part, cette limitation ne peut être l’œuvre de la surpuissance, qui fait tout ce qu’elle peut faire et n’a donc pas la puissance de s’auto-limiter. C’est la raison pour laquelle il faut penser la limitation comme procédant d’un archi-événement, c’est-à-dire de quelque chose qui est foncièrement étranger à la puissance. Dès lors, vous ne pouvez pas dire qu’il y a quelque chose qui échappe à la surpuissance et la nie donc comme surpuissance puisque cette limitation n’est justement pas quelque chose mais rien. Comme le montre Descartes notamment, la puissance se porte sur l’être et ne peut donc être puissance de non-être. Cependant, il n’en reste pas moins que ce non-être qu’est la limitation – non-être qui, comme tel, ne peut procéder que d’un événement (étant sans cause, l’événement ne peut être que l’avènement d’un rien) – ne fait pas rien : il produit cette scission à la faveur de laquelle de l’impuissance, c’est-à-dire du désir, c’est-à-dire encore de la subjectivité peuvent advenir. Il y a moins et non pas plus dans le sujet que dans le monde et c’est à la faveur du surgissement événemential de ce rien sous la forme d’une limitation que le sujet advient.
AP : Un autre élément m’a frappé dans vos analyses, à savoir le rapport entre désir et désir sexuel. La description phénoménologique amène à comprendre que ce n’est pas le désir sexuel qui est la matrice générale du désir mais que c’est inversement « le champ de la sexualité [qui] est subordonné à celui du désir et non l’inverse. »6 Tout l’enjeu devient de comprendre comment ce désir venant de plus loin que de la sexualité « se limite en se cristallisant sous la forme du désir sexuel. »7 Mais cette analyse n’est menée que dans le cadre phénoménologique et la question sexuelle disparaît de l’aspect ontologique comme si la cristallisation particulière du désir sous une forme sexuelle ne pouvait plus être menée dans une optique ontologique. Je comprends que la description phénoménologique, en déniant à la sexualité le caractère fondamental, neutralise celle-ci dans la recherche du fondement. Pourtant, ne pourrait-on pas considérer, ontologiquement parlant, qu’il serait possible de reprendre la question sexuelle comme désir concret de répondre à l’exil par une tentative effective de fusion avec le sensible, un peu à la manière dont Tournier décrit la sexualité élémentaire de Vendredi avec l’île comme telle, conduisant systématiquement à un sentiment de dissolution et d’enveloppement ?
RB : J’ai voulu dire que l’essence du désir sexuel, qui est au fond le désir même, n’est pas sexuelle, que la sexualité est donc la modalité empirique d’un désir que je nomme transcendantal et dont le véritable corrélat est le monde. Cela nous ramène au commencement, à propos de Merleau-Ponty ; ce qui est en jeu dans la sexualité, en tant qu’elle est tournée vers l’autre, c’est une dimension qui transcende l’autre. Pour le dire autrement, je suis frappé par le fait qu’il y va de la même chose dans la désir sexuel et dans ce qui en semble le plus éloigné, à savoir par exemple le désir théorique ; c’est cela qui m’a conduit à reprendre, en le transformant, le concept de sublimation. La relation théorique est un relation érotique et, inversement, il y a dans la relation érotique comme une ouverture à une plénitude qui annonce le monde. J’en conclus que ces deux dimensions apparemment opposées puisent à la même source, sont des modalités d’un seul désir dont le terme véritable ne peut évidemment pas être le sexe de l’autre ou la sexualité avec l’autre. Il est dès lors possible d’imaginer, comme vous le faites, que le désir court-circuite l’autre pour aller droit au monde sous la forme d’une fusion avec la nature, d’un eros cosmologique. Mais, on peut se demander si une médiation (je ne sais pas si c’est le bon terme) n’est pas nécessaire, si une relation érotique avec le monde est pensable et si, en tout cas, elle n’est pas nécessairement vouée à l’échec. Tout se passe comme si le monde ne pouvait être saisi qu’à distance, entrevu à travers l’autre ou le monde de l’autre. En allant doit à la nature et en abolissant la distance du monde, on court le risque de retomber sur de l’étant, aussi élémentaire soit-il, et de manquer alors complètement le monde.
D : Sublimation et désublimation
AP : Restons alors avec Eros ; Freud et Lacan occupent un rôle central dans Le désir et le monde, comme si était venu le moment de vous expliquer avec eux. Outre la question des pulsions, vous abordez également celle de la sublimation que vous réinvestissez pour en faire « l’excès interne du désir »8 Cela vous amène à mener une critique de la notion de sublimation chez Freud. Quel est le nerf de votre critique à son endroit ?
RB : Le nerf de ma critique à l’endroit de la conception freudienne de la sublimation concerne sa condition de possibilité, c’est-à-dire ce que doit être la pulsion pour être capable de se détourner d’un objet « sexuel » au profit d’un autre objet « plus élevé ». Freud fait comme si la pulsion, originairement portée sur tel objet sexuel, pouvait se tourner vers un objet théorique, c’est-à-dire se muer en connaissance. Mais on voit bien que cette conversion ne serait pas possible s’il n’y avait pas déjà dans la pulsion une dimension qui est de l’ordre de la connaissance. Ainsi, jamais la pulsion sexuelle ne pourrait se sublimer en curiosité si elle ne comportait pas déjà par elle-même une dimension de curiosité, c’est-à-dire n’était pas déjà plus que pulsion au sens où Freud l’entend. Bref, il n’y a pas de sublimation possible, de substitution radicale de l’objet si elle n’est pas accompagnée d’une modification correspondante concernant le mode de relation requis par cet objet. Comme vous le voyez, cette critique vise à dessiner un espace pour une dimension qui n’est ni simple poussée, ni pure connaissance, dimension qui est à la fois et indistinctement dynamique et phénoménalisante et qui n’est autre que ce que je nomme désir. Si la sublimation doit être possible, c’est dans la mesure où la pulsion est déjà désir, où le mouvement d’appropriation est identiquement un mouvement de phénoménalisation.
AP : Votre analyse conduit à penser le désir comme désir de monde impliquant sa propre occultation, et c’est cela qui vous permet de résoudre l’impasse freudienne.
« En vérité, si le désir peut se dépasser en tant que désir sexuel c’est parce qu’il est, par essence, toujours déjà plus que le désir sexuel, à savoir désir de la totalité, parce que tel ou tel objet visé est le seul mode de manifestation possible d’un désiré qui l’excède du tout au tout. »9
Et cela vous amène à évoquer une « désublimation du désir »10 Qu’entendez-vous par ce terme de « désublimation » ?
RB : Le terme de désublimation décrit un processus qui est inverse de la sublimation freudienne et c’est pourquoi je le retiens, mais le terme de cristallisation pourrait également convenir. J’ai tenté de montrer que le désir n’est pas par essence sexuel mais qu’il est en son fond désir du monde, autrement dit le seul rapport possible au monde comme tel, la modalité en et par laquelle un monde peut s’ouvrir, bref qu’il est le transcendantal même. Cela étant établi, il reste alors à rendre compte du désir tel que nous l’entendons, du désir empirique, qui se vit comme désir d’un autre, comme désir sexuel. J’ai alors été conduit à montrer que ce désir procède d’un mouvement de reflux et d’occultation par lequel le monde fait place à une réalité intramondaine, qui devient alors l’objet du désir. Mais ce ne peut être n’importe laquelle : autrui a le privilège, sans doute avec l’œuvre d’art, d’initier au monde plutôt que de l’occulter, de constituer une sorte de brèche ouvrant sur le monde au sein du monde. Avec autrui, tout se passe comme si le monde se redoublait ou se repliait en un point de lui-même pour transparaître à même une réalité intramondaine. Ainsi, le désir de l’autre, en tant qu’il est désir, est bien désir du monde, désir transcendantal mais qui reflue vers l’intérieur du monde et se cristallise sur un étant intramondain privilégié, pour autant que celui-ci est une sorte de fenêtre sur le monde. C’est ce mouvement que je nomme désublimation dans la mesure où il inverse le sens de la sublimation freudienne. Ce n’est plus la sexualité qui se dépasse en connaissance mais la connaissance, au sens de la phénoménalisation, qui se ramasse ou se concentre en sexualité ; c’est le désir même, désir qui est en lui-même sans objet, qui se fixe sur un objet et se mue ainsi en désir sexuel, l’insatiabilité de celui-ci manifestant bien que ce dont il y va en lui transcende le plan de l’objet. Évidemment, la limite du terme tient à ceci que cette désublimation ne marche pas sur les traces d’une sublimation préalable et est donc, contrairement à ce que le mot semble indiquer, un phénomène premier. En effet, le rapport du désir au monde est originaire et constitutif et ne relève donc d’aucune sublimation faute d’avoir jamais eu d’autre corrélat que le monde lui-même. Le désir sexuel ne fait que cristalliser et voiler ce désir transcendantal, et c’est pourquoi la désublimation ne nie pas une sublimation préalable, est un phénomène originaire.
AP : Cette désublimation permet également de rendre compte du fait que le désir transcendantal est occulté par le désir empirique, donc du fait que le désir de monde est occulté par le désir des étants particuliers et notamment par le désir d’autrui. N’y a-t-il pas alors un paradoxe voulant qu’autrui constitue peut-être un obstacle à l’accomplissement du désir en tant qu’il n’est qu’un étant mondain, en même temps qu’il une révélation du monde en tant qu’il me donne accès à son propre monde ?
RB : Je vous ai déjà en grande partie répondu à l’occasion de la question précédente.
AP : Oui, c’est tout à fait vrai mais je me demandais s’il n’y avait pas une tension dans le rôle d’autrui vis-à-vis du désir.
RB : Il faudrait dire qu’il n’y a pas à choisir, qu’autrui est indistinctement recouvrement et révélation du monde. C’est même cette unité, entre l’occultation du monde qu’il entraîne et le glissement vers le monde qu’il permet, qui caractérise son mode d’être propre, sa marque de fabrique phénoménale, comme je le montre au début de la dernière partie de mon livre. Autrui est cet étant du monde qui m’initie au monde, cette présence qui, occultant le monde en tant qu’elle est intramondaine, m’ouvre en même temps à lui. C’est pourquoi je ne saisis pas autrui là où est son corps mais plutôt entre ce corps et le monde, sur la ligne de son regard et de ses gestes pour autant qu’ils dévoilent et désignent un monde. Dès lors, on ne peut pas parler d’obstacle car cela serait supposer qu’il y a un rapport direct possible au monde, un désir pur, bref une manière d’exister au plan même du transcendantal. Or, en vérité, même si on peut mettre en évidence un rapport dévoilant au monde au cœur du désir, il va de soi que, puisque c’est précisément du monde qu’il s’agit, ce rapport ne peut que se cristalliser sous la forme d’un rapport à un étant intramondain en lequel le monde s’occulte et se préserve donc comme monde : le désir transcendantal ne peut que se désublimer sous la forme d’un désir empirique. Si le monde est bien cela qui s’absente de toute présence ontique, il n’y a de rapport au monde qu’à travers ce qui le recouvre et le préserve, bref sous la forme d’un désir empirique qui, en tant qu’il désublime un rapport au monde lui-même, ne peut susciter que de l’insatisfaction et du mouvement. Même si, à la faveur d’une épochè, on peut mettre en évidence le noyau véritable du désir, il n’en demeure pas moins que nous ne vivons que des désirs empiriques qui, par l’insatisfaction qu’ils suscitent au cœur même de la satisfaction, laissent transparaître leur véritable essence et leur véritable objet. Il n’y a de désir que désublimé.
Conclusion : une œuvre en discussion
AP : Pour conclure, j’aimerais vous interroger sur le rapport de vos analyses à l’histoire de la philosophie et d’abord à la pensée de Spinoza. Faire du désir l’essence même du sujet peut évoquer une position spinoziste, position que pourtant vous contestez en raison de l’exil, donc de la subjectivité. Le désirant est « sur le mode de l’être exilé de lui-même, en quoi il n’a rien à voir avec le conatus. »11 Vous soulignez par-là la distance d’avec la thèse spinoziste mais cela soulève une question à mes yeux cruciale : l’ontologie spinoziste est moniste. Mais la vôtre, malgré l’exil, ne me semble pas pouvoir être qualifiée de dualiste puisqu’il ne peut y avoir d’exil que s’il y a précisément communauté ontologique originaire. Dans cette optique, au sein de cette ontologie moniste au sein de laquelle la subjectivité ne peut introduire un écart que de l’intérieur, sur quel terrain précis vous distinguez-vous de Spinoza ?
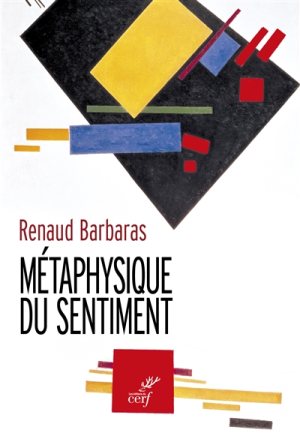
RB : Vous avez raison, ma perspective ne peut être qualifiée de dualiste et, en vérité, je me sens profondément moniste. Simplement, je serais enclin à parler de monisme phénoménologique dans la mesure où il doit intégrer la corrélation et donc la distance constitutive de la phénoménalité. Dès lors, on pourrait dire, en reprenant une formule que Grimaldi, je crois, utilisait à propos de Bergson, qu’il s’agit d’un monisme scissionaire. L’idée est que l’on ne peut rendre compte de l’unité de l’Être comme phénoménalité sans faire intervenir une scission originaire, sans laquelle la distance phénoménale demeurerait incompréhensible. Comme vous le dites très bien, la subjectivité introduit un écart de l’intérieur, une distance dans l’appartenance. C’est évidemment ce qui m’éloigne radicalement de Spinoza : c’est dans la mesure exacte où je suis phénoménologue que je ne peux être spinoziste. J’évoque Spinoza dans mon livre, pour souligner que, comme lui, il faut penser le désir indépendamment du manque. Mais défaut de manque ne signifie pas pure affirmation, conatus : il y a d’autres modes de négativité que celui du manque, notamment ce que j’ai nommé la séparation. Ceci nous ramène donc au point de départ.
AP : Un auteur a récemment fait son apparition parmi vos références, à savoir Mikel Dufrenne ; qu’a-t-il apporté à l’affinement de votre réflexion sur le désir ?
RB : J’ai lu d’abord Dufrenne dans la perspective d’une réflexion sur la poésie, qui motivait la recherche qui a abouti à Métaphysique du sentiment. J’ai été impressionné par Le poétique et, notamment, par ce texte ajouté à l’une des éditions de l’ouvrage intitulé « Pour une philosophie non-théologique ». Puis j’ai lu ou relu le reste de son œuvre et ai trouvé une théorie du désir qui consonnait largement avec mes propres résultats. Comme vous le savez, on lit toujours les auteurs à point nommé, pour y trouver ce que l’on a déjà pressenti, sinon découvert. En outre, sa théorie du sentiment, développée précisément dans Le poétique ainsi que dans sa Phénoménologie de l’expérience esthétique a été décisive pour moi et a impulsé la seconde partie de Métaphysique du sentiment. Cependant, comme je l’ai signalé notamment au début de Dynamique de la manifestation, je demeure en désaccord avec sa phénoménologie, avec les fondements phénoménologiques de sa pensée.
AP : Si vous convoquez de nombreux phénoménologues – Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, Sartre, Patočka, Levinas –, l’absence de Jean-Luc Marion et des analyses menées dans le Phénomène érotique – alors même que Le désir et le monde se clôt par une érotique et une analyse de l’amour – est remarquable. Cela s’explique-t-il par le fait que vous conduisiez deux phénoménologies trop différentes pour qu’une discussion ait un sens ?
RB : C’est exactement cela. Comme j’ai eu l’occasion de le dire dans un entretien récent, j’avoue que l’idée de réduction érotique développée au début de Le phénomène érotique, correspondant à la question « M’aime-t-on ? » me paraît hautement, c’est-à-dire phénoménologiquement, arbitraire parce que doublement surdéterminée : par le point de départ cartésien et par l’horizon de la foi.
AP : D’accord ; merci infiniment de toutes ces précisions et de vos réponses très éclairantes !








