Renaud Barbaras est professeur de Philosophie contemporaine à l’université de Paris I Sorbonne. Il a très gentiment accepté de nous rencontrer pour un entretien consacré à son dernier ouvrage, Introduction à une phénoménologie de la vie ; atu-philosophia tient à remercier vivement M. Barbaras pour sa disponibilité et son amabilité. Les propos ont été recueillis par Thibaut Gress
Actu Philosophia : Cet ouvrage 1 que vous avez publié en 2008 me semble être un double aboutissement, d’une part en tant que synthèse de deux de vos précédents ouvrages, le désir et la distance 2 et Vie et intentionnalité 3. Et c’est également un aboutissement au sens où ce qui était programmatique ou simplement hypothétique dans ces deux ouvrages me semble trouver là des réponses qui n’étaient pas formulées auparavant. C’est un livre qui se veut pleinement phénoménologique, orienté vers une saisie phénoménologique de la vie et ma première question portera sur la nature de votre introduction. Vous essayez de montrer l’insuffisance de la thématisation husserlienne de la vie et le point nodal du reproche que vous adressez à Husserl, ce serait d’avoir extirpé la conscience hors du monde et donc d’avoir généré une équivocité ontologique, entre d’une part l’être mondain et d’autre part l’être de la conscience qui, lui, serait hors du monde. Or, la conséquence de l’équivocité que vous développez est ruineuse, dites-vous et ma question porte précisément sur la nature de l’hypothèse ruineuse de Husserl.
Est-ce que vous critiquez les conséquences du point de départ de Husserl, auquel cas ce ne serait ruineux que du point de vue conséquentialiste, ou est-ce que vous critiquez d’un point de vue plus principiel, cette différenciation et donc cet arrachement de la conscience hors du champ mondain.
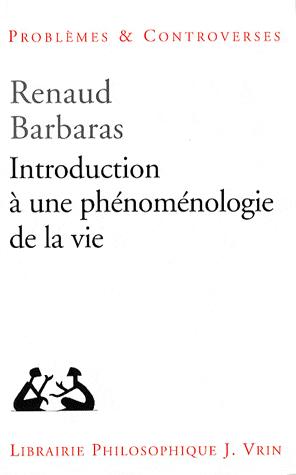
Renaud Barbaras : La réponse est assez simple : c’est le principe même qui est contesté.
Mais je voudrais revenir d’abord sur l’esprit même de ce livre et la manière dont je me rapporte aux auteurs. Ma démarche n’est pas historique : je fais des choix et je durcis le trait à l’occasion. Concernant Husserl, je sais bien que dans d’autres textes, il se confronte à la question de l’articulation entre ego transcendantal et ego empirique, et il n’ignore pas la question de l’insertion de la conscience dans le monde. Cependant, mon idée est que sa pensée de la conscience ne prend pas en considération de manière suffisamment radicale l’insertion mondaine puisque, comme vous le savez, dans Ideen I, il distingue l’entrelacement avec le monde par perception de l’entrelacement avec le monde par incarnation et subordonne l’entrelacement par incarnation à l’entrelacement par perception, ce qui signifie que la conscience est d’abord conscience d’un monde avant d’être conscience dans le monde.
Cela étant dit, la critique est principielle au sens où ce qui est en question, c’est la dénivellation ontologique entre la conscience transcendantale comme absolu et le monde : c’est donc le partage entre deux sens d’être qui pose problème, sens d’être auquel il ne s’agit pas du tout d’opposer une position cartésienne défendant une univocité de la res cogitans et de la res extensa comme substances. Mon propos est de faire apparaître un sens d’être original : celui de la vie en tant qu’elle implique à la fois une certaine appartenance au monde et une différence avec celui-ci. Autrement dit, ici, et ici seulement, je lis Husserl dans une perspective plutôt heideggérienne, qui souligne à la fois la différence de mode d’être du Dasein par rapport à celui des autres étants et, en même temps, son intramondanéité. L’idée est donc de voir dans cette double situation ontologique, appartenance au monde et sens d’être différent de celui des autres étants, l’indice d’un sens d’être original, que j’appelle vie.
AP : Donc c’est parce que le principe en tant que tel est problématique que vous en déduisez que les conséquences elles-mêmes vont être ruineuses.
RB : Absolument. Mais ce qui m’importe, au moment où vous vous situez dans ce livre, c’est plus le principe que les conséquences, c’est-à-dire les distinctions initiales.
AP : D’accord. Donc pour revenir au sens général de l’ouvrage, il me semble que le présupposé fondamental qui est le vôtre est celui de penser le vivre en son indistinction originaire, ou, pour le dire avec vos mots, « c’est penser l’identité originaire de la conscience et de la vie. »4 Vivre c’est être engagé dans le monde, sans que cela ne signifie être engagé exclusivement dans le monde ; il faut ménager une place pour la distance à l’égard du monde, et c’est l’articulation de cette univocité et de cette équivocité au monde qui constituera l’essentiel de l’ouvrage. Dans ces conditions, en vertu de l’articulation de l’univocité et de l’équivocité que vous déployez, pourriez-vous qualifier votre projet d’une phénoménologie dialectique ?
RB : Non, pas du tout. C’est une perspective a-dialectique, voire même anti-dialectique. D’ailleurs, en vous écoutant, je me rends compte qu’il n’est pas sûr que le vocabulaire que j’ai utilisé soit le plus adéquat. Par équivocité et univocité, je voulais dire qu’il y a, du point de vue du mode d’être du sujet, à la fois une différence vis-à-vis du monde et une appartenance, ce qui correspond à deux sens de la vie : la vie transitive, qui correspond au sujet en tant que se rapportant au monde et donc en tant que distinct du monde, et la vie intransitive (être vivant), à laquelle correspond un sujet appartenant pleinement au monde. Et ce n’est pas dialectique parce que le vivre, dans son équivocité linguistique en français, est l’attestation d’un sens d’être plus profond, qui est neutre par rapport au partage de l’être-en-vie et l’expérience de quelque chose, entre une vie intransitive et intramondaine, et une vie extramondaine (si j’ose dire) et transitive.
AP : Entre le leben et le erleben.
RB : Voilà. Entre le vivre au sens de être-vivant et le vivre au sens de vivre quelque chose. Et j’ai voulu entendre le terme vivre comme le signe d’un sens d’être véritable. Tout mon travail consiste à définir un vivre qui soit plus profond que ces distinctions et qui permette de rendre compte à la fois des déterminations du vivant et de l’expérience d’un monde. Mais ce n’est pas dialectique car si la distinction doit bien être dépassée, ce n’est pas du tout sur le mode d’une relève (Aufhebung). Il s’agit plutôt de revenir en-deçà, à une modalité plus originaire vis-à-vis de laquelle la distinction apparaît comme abstraite. C’est donc une médiation purement introductive pour accéder à un sens d’être originaire.
AP : D’accord ; cette question m’était venue à l’esprit parce que la progression méthodologique de votre ouvrage semble pourtant hégélienne: vous proposez une thèse, vous en montrez l’insuffisance mais vous en gardez un résultat par lequel vous opérez un dépassement de la thèse. Il y a quelque chose de l’ordre de l’Aufhebung et j’avais eu l’impression qu’il y avait quelque chose de dialectique dans votre ouvrage aussi en vertu de la méthode retenue.
RB : Oui vous avez raison. Mais à la fin du livre, j’abandonne cela, j’essaie de me débrouiller tout seul, et vous savez bien qu’en philosophie, on pense toujours à partir de et contre. Mais ce que vous évoquez renvoie à Merleau-Ponty plutôt qu’à Hegel : si je suis tributaire de quelque chose, ce serait plutôt de la méthode merleau-pontyenne, qui consiste à écarter deux positions, par exemple l’empirisme et l’intellectualisme, pour frayer une sorte de troisième voie. S’il s’agit d’une dialectique c’est en un sens plus merleau-pontyen qu’hégélien ; il n’y a pas de véritable Aufhebung car je dessine une situation fondamentale et centrale, en écartant deux excès symétriques.
AP : Vous prenez une alternative induite par une pensée, et vous montrez que les deux termes de l’alternative sont aporétiques.
RB : Oui, que les conséquences de l’alternative sont inacceptables, si bien que les deux termes opposés apparaissent comme négativement solidaires. Je suis donc plus proche, de ce point de vue là, de Merleau-Ponty que de Hegel ; j’en prends conscience en vous répondant.
AP : Et pour rester encore un peu dans l’utilisation des auteurs que vous faites, je dirais qu’une chose est assez frappante dans tous vos ouvrages, c’est l’utilisation intense que vous faites des auteurs, pour l’essentiel phénoménologues : rien que dans ce dernier ouvrage, outre Husserl, Heidegger et Merleau-Ponty, sont convoqués Hans Jonas, Raymond Ruyer, Patocka, Michel Henry, Bergson, et Rilke : quel est le statut des auteurs que vous convoquez régulièrement dans vos ouvrages ? Je pose cette question car j’ai l’impression – mais peut-être fausse – que vous savez où vous allez dès le début et on devine dès l’introduction, pour prendre l’exemple de Michel Henry, que la phénoménologie de ce dernier sera incompatible avec la vôtre puisqu’Henry ne parvient pas à penser hors d’un champ d’immanence pure et donc n’ouvre pas la vie à l’ambivalence décrite en introduction ; pourquoi alors convoquer un auteur comme Henry si vous savez par avance qu’il ne permettra pas de répondre aux questions soulevées en introduction ?
RB : Pour Michel Henry je peux vous répondre à deux niveaux.
Il y a d’abord, dans mon livre, un souci sinon d’exhaustivité, en tout cas de prise en considération des phénoménologies de la vie ; il me semblait donc difficile d’esquisser une phénoménologie de la vie sans prendre en compte Michel Henry.
Mais il y a une réponse plus fondamentale : il y a quelque chose pour moi de très important chez Michel Henry, c’est l’idée que l’absolu doit être cherché du côté de la vie et l’affirmation d’une articulation fondamentale entre conscience et vie. Là où je me reconnais dans Michel Henry, bien que je ne sois jamais parti de sa pensée, c’est dans l’idée que, fondamentalement, la conscience est l’attestation d’une vie. Mais alors que, pour Michel Henry, la vie s’apporte tout entière dans la conscience, dans ma perspective – et là il y a une rupture énorme – la conscience est limitation de la vie. Pour moi, dans la conscience, quelque chose de la vie s’est perdu, alors que pour Michel Henry, au contraire, la vie s’apporte tout entière dans la conscience. En somme, dans la mesure où je ne pense pas la vie comme se donnant sous la forme d’une auto-affection, la conscience n’est évidemment pas pour moi le lieu où la vie se donne mais plutôt celui où elle se perd.
Corrélativement, dans la mesure où j’essaie avant tout de rendre compte de la relation à l’extériorité, de l’intentionnalité – dimensions que Michel Henry écarte comme relevant d’une autre sphère d’apparaître – nous différons radicalement.
AP : C’est assez curieux cette exclusion de la transcendance chez Henry…
RB : Oui. C’est une perspective dualiste, ce qui signifie qu’il y a deux régimes d’apparaître et sa démarche consiste toujours à remonter à une dimension plus originaire de l’apparaître : celle de l’immanence. Mais, du même coup, le chemin inverse, qui consisterait à rendre compte de la transcendance à partir de cet apparaître premier, n’est jamais parcouru ; en tout cas, on ne trouve nulle part de tentative en ce sens.
AP : Vous placez Henry parmi les phénoménologues de la vie ; mais considérez-vous que Henry est encore phénoménologue, malgré la réduction radicale qu’il opère de l’intentionnalité et de la transcendance ?
RB : Je pense qu’il est un phénoménologue au sens où il y a des textes remarquables sur la phénoménologie, mais je pense que sa philosophie ne relève pas de la phénoménologie. Dans Incarnation par exemple – qui est un beau livre, un des livres de la fin – il y a toute une première partie qui est d’une rigueur phénoménologique tout à fait étonnante : il y critique Merleau-Ponty et thématise la chair avec une grande clairvoyance phénoménologique ; mais ensuite, on assiste à une espèce d’embardée qui ne relève plus du tout de la phénoménologie. C’est un métaphysicien ce qui pour moi, d’ailleurs, n’est pas un défaut mais le fait est que sa philosophie n’est pas une phénoménologie.
AP : J’aimerais à présent aborder les réponses que vous apportez aux questions soulevées en introduction. Le premier point est l’Ouvert : vous proposez une solution que je trouve très subtile, et qui revient à littéralement renverser la position heideggérienne : l’animal n’est plus pensé de façon privative à partir de l’homme mais c’est inversement la conscience humaine qui constitue une privation à l’égard du monde. « La solution s’impose : la portée de la vie doit excéder celle de la conscience humaine et la différence humaine doit avoir le statut d’une négation ou d’une privation. »5 Il me semble donc que l’Ouvert doit être pensé à partir de Heidegger, fût-ce en l’inversant, même si le terme provient de Rilke. L’homme, c’est la vie moins quelque chose ; et vous êtes amené, à la suite de Rilke, pour penser la condition de possibilité de cette privation, à poser le monde comme l’Ouvert : la question que je me pose réside dans le sens de cet Ouvert qui me paraît un peu énigmatique : l’Ouvert, c’est l’origine déjà perdue, c’est ce que manque par essence la conscience. L’Ouvert, dites-vous, se retire derrière le monde dont il permet l’éclosion si bien que la vie est « visibilisation »6 ; si je comprends bien, l’Ouvert n’apparaît pas, il est ce par quoi il y a de l’étant, mais il n’est lui-même rien d’étant : quelle est la différence avec l’Etre heideggérien ? En quoi l’Ouvert que vous thématisez se distingue-t-il de l’Etre heideggérien, du second Heidegger ?
RB : C’est une très bonne question et un point qui fait problème pour moi. Ce chapitre dans lequel la question de l’Ouvert apparaît, est un chapitre clé car c’est là où la situation se retourne, et où je propose ma propre solution aux problèmes posés. Ma solution réside dans ce que j’appelle une anthropologie privative, fondée sur une idée de la conscience pensée privativement à partir de la vie. J’ai trouvé chez Rilke, et seulement là, au début de la Huitième élégie de Duino, ainsi que dans le magnifique commentaire qu’en fait Roger Munier, un argument : c’était le seul texte que j’avais à ma disposition, donc je l’ai utilisé pour appuyer cette position que je tenais, que j’aurais pourtant pu déduire uniquement des conditions du problème que je posais. C’est donc par fidélité à Roger Munier que j’ai utilisé le concept d’Ouvert ; mais je ne vous cache pas que c’est à mes yeux un concept provisoire et pas tout à fait satisfaisant, parce que par Ouvert j’entends non pas l’Etre mais le monde, en tout cas en un certain sens du monde : non pas le monde tel que l’entendent Munier et Rilke, c’est-à-dire comme procédant déjà d’une objectivation, mais le monde au sens d’une totalité intotalisable, d’un fond qui ne subsiste comme tel qu’en ne se distinguant pas de son propre procès d’individuation. Je l’utilise au sens finkien du terme. Donc ce que j’avais en tête en reprenant ce concept d’Ouvert – qu’encore une fois, j’ai utilisé par fidélité aux auteurs que j’évoquais à ce moment-là – c’était plutôt le monde comme fond intotalisable, mais source de tous les procès d’individuation, cette « immensité inapparente » dont parle Patocka. De ce point de vue là, ma perspective est plus cosmologique qu’ontologique au sens heideggérien.
AP : Ah oui, c’est donc par la cosmologie que vous vous différenciez de Heidegger ?
RB : Oui, c’est aussi par la cosmologie que je me différencie de Heidegger. Pour tout vous dire, je suis en train de travailler à une phénoménologie cosmologique où je reprends ces questions, parce que j’ai conscience que c’est le point de ce livre qui reste à creuser. Ce que j’appelle Ouvert, par souci de fidélité aux auteurs que j’utilise, c’est en fait le monde en un sens originaire. Il y a le monde comme totalité intotalisable, comme fond qui fait advenir l’individuation, et puis il y a le monde comme totalité des étants qui suppose déjà la conscience et donc l’objectivation. Ainsi, j’aurais pu me passer du terme « Ouvert ».
AP : Mais vous l’avez bien déduit de l’anthropologie privative mise en place après avoir renversé Heidegger ? Vous auriez pu le déduire uniquement du renversement de Heidegger, si je comprends bien.
RB : J’aurais pu le faire, et surtout j’aurais pu le déduire des conditions générales du problème, c’est-à-dire : comment penser une différence humaine qui n’implique aucune altérité, aucune positivité ? Une différence souscrivant à ces conditions ne peut être pensée que sur le mode limitatif. A partir des conditions mêmes du problème, j’aurais pu aboutir à une anthropologie privative. Mais comme j’avais trouvé chez Rilke et chez Munier un point d’appui, j’ai voulu l’utiliser.
AP : Ce qui donne un caractère quelque peu heideggérien à votre travail, en vertu de cette référence à Rilke.
RB : Oui, sauf que Heidegger est très anti-rilkéen…
AP : Oui, bien sûr. Mais Heidegger en parle à plusieurs reprises, plus pour le réfuter d’ailleurs, ou plutôt pour le déformer.
RB : Dans Pourquoi des poètes, dans Holzwege, on trouve un long article qui est, d’une certaine façon, consternant, parce qu’il manifeste un aveuglement complet vis-à-vis de Rilke. Il sent bien que Rilke lui échappe mais il veut à tout prix le ramener à sa conception de l’histoire de la métaphysique, et même des heideggériens fidèles, ou en tout cas favorables comme Michel Haar, dans le Chant de la terre, dénoncent l’aveuglement grossier de Heidegger à l’égard de Rilke. Munier est heideggérien aussi, mais son commentaire va dans un sens opposé à celui de Heidegger. Vous aurez compris que ce livre est résolument non heideggérien. A Tokyo au mois de juillet dernier, commentant une conférence que je venais de donner, Françoise Dastur m’a dit : « ce que tu fais, c’est le négatif, au sens photographique, de Heidegger. »
AP : Oui, c’est un renversement assez extraordinaire de la pensée de Heidegger.
J’aimerais à présent parler du manque qui avait déjà été analysé dans le désir et la distance où vous écriviez que si la perception est désir, alors tout étant n’apparaît jamais que sur fond d’un apparaissant ultime qui n’apparaît pas. « Le désir déploie la Distance constitutive du sensible ; en aspirant à la totalité, il ouvre la profondeur de l’apparaître. »7 On comprend la continuité entre vos différents travaux depuis plusieurs années, ce qui est assez remarquable ; en revanche, ce que j’ai un peu de mal à comprendre, c’est que l’Ouvert n’apparaît pas : c’est l’horizon par lequel il y a de l’apparaissant et de l’individuation, mais lui-même n’apparaît pas. Par conséquent, il ne peut être perçu, et comment, dans ces conditions, le sujet peut-il désirer ce dont la visibilité lui est refusée ? Vous dites que « le vivre se dirige bien dans l’Ouvert mais c’est le monde qu’il voit. »8 Comment le sujet sait-il qu’il y a de l’Ouvert, alors que l’Ouvert ne se confond en aucun cas avec ce que rencontre le sujet, c’est-à-dire l’apparaissant, et donc que le sujet ne voit pas l’Ouvert ? On comprend bien qu’il n’y a pas de connaissance de ce qu’est l’Ouvert, mais il faut bien qu’il y ait connaissance du fait qu’il y a de l’Ouvert pour qu’il y ait désir : d’où provient ce savoir du quod de l’Ouvert ?
RB : Vous pourrez laisser tomber le mot « Ouvert ». D’ailleurs vous citez les expressions « apparaissant qui n’apparaît pas » (cela signifie qu’il n’apparaît pas comme tel, mais il n’en reste pas moins qu’il se donne dans les apparitions auxquelles il donne lieu) ; l’Ouvert c’est la totalité inapparaissante. Je serais enclin à contester votre question elle-même. En effet, en posant cette question, vous subordonnez le désir à quelque chose comme un savoir, alors que mon projet est de faire apparaître le Désir au cœur de la perception, à la source même du savoir. On ne peut donc pas rapporter le Désir à un savoir préalable puisque le savoir est en son fond désir, puisque le Désir est le rapport originaire à l’extériorité. J’appelle Désir, dans son excès ou son débordement interne, ce qui nous met en rapport avec un certain monde, avec cet « inapparaissant » d’où se détachent les apparaissants proprement dits. Le Désir, c’est la modalité par laquelle m’est donné un monde comme condition et fond des apparitions perceptives ; c’est en ce sens qu’il est au cœur de la perception. Ma question est la suivante : qu’est-ce qui, dans le sujet, délivre la totalité, le fond ou le monde sur fond duquel, précisément, les apparaissants peuvent se détacher ? Evidemment, je saisis la perception à un niveau qui est plus fondamental : c’est ce niveau que j’appelle Désir et qui me paraît correspondre aux dimensions du problème.
AP : Mais dans ce cas, comment faut-il comprendre la nature du Désir ? Relève-t-il pour le coup d’une cosmologie ? J’ai du mal à comprendre l’articulation du Désir et de l’Ouvert.
RB : Ils sont co-originaires. Mon point de départ, c’est la corrélation entre l’étant transcendant et la subjectivité. Ma question, c’est la seule question que je pose, est la suivante : comment penser la corrélation conformément à ce que Husserl en a dit ? Mon idée est de montrer que, sous la corrélation thématique ou thématisante de la conscience et de ses objets, il y a une corrélation plus originaire, qui est la condition de celle-là : celle de la vie dont l’essence est Désir et du monde. Il s’ensuit qu’il y a une co-originarité entre phénoménologie de la vie et cosmologie. Ce qui est premier, c’est une corrélation : non pas la corrélation conscience-objet, ou sujet-monde au sens additif, mais la corrélation sous-jacente en quelque sorte, qui rapporte originairement l’un à l’autre le Désir et le monde et dont procède par privation la relation de la conscience et de l’objet.
AP : Je comprends mieux.
RB : Mais demeure une question, qui est celle dont traite mon prochain livre : dans la mesure où le Désir est Désir d’un sujet qui, par ailleurs, est intramondain, comment penser le sens d’être du monde de telle sorte qu’en lui quelque chose comme du désir puisse advenir ? C’est là une question d’ordre cosmologique : elle concerne l’enracinement originaire de la vie dans le monde et donc le monde comme possibilité de la vie.
AP : Donc il ne faut pas entendre le Désir comme un Désir thématique ?
RB : Qu’est-ce que vous entendez par thématique ?
AP : Un désir qui serait conscient de ce qu’il désire.
RB : Surtout pas, puisque le désir est le fond de la conscience.
AP : Oui, donc ce serait déjà raisonner de manière dérivée.
RB : Exactement. Le Désir, c’est la condition à laquelle il pourrait y avoir de la conscience, en tant que le Désir est d’une certaine façon toujours frustration : la dimension de conscience naît précisément de cette frustration. Nous retrouvons ici la relation avec Michel Henry. Je pense comme lui que le fond de la conscience réside dans un affect, sauf que, pour moi, l’affect fondamental n’est pas la joie ou la souffrance, qui sont typiquement des affects où le sujet est aux prises avec lui-même dans un rapport d’immanence absolue. Pour moi, l’affect fondamental, c’est le Désir, en tant qu’il comporte une sorte d’excès, de débordement, est originairement en rapport avec l’extériorité. Bref, la conscience est perceptive parce qu’en son cœur elle est Désir. L’être conscient de soi s’enracine dans cette épreuve originaire qu’est le Désir et il n’est épreuve de soi que parce qu’il est exposition à la transcendance.
AP : Mais dans ce cas là, est-ce que le Désir peut encore faire l’objet d’une description phénoménologique ?
RB : C’est une question difficile. Oui, mais à condition de s’accorder le fait que ce que l’on entend par désir, au sens proprement érotique, est une attestation privilégiée de ce que j’appelle Désir, qui est un désir pour ainsi dire transcendantal et non psychologico-érotique. A cette condition oui, mais directement, non. C’est une condition qu’on est obligé de se donner et non quelque chose qui serait accessible comme tel à une description directe. En revanche, on en a un témoin phénoménologique privilégié, qui est le désir érotique tel que nous l’éprouvons : dans le désir érotique s’atteste incontestablement quelque chose de ce Désir fondamental. Je retrouve ici l’idée, développée par Husserl dans certains textes tardifs, selon laquelle la connaissance s’enracine dans une Trieb originaire, dans une pulsion première, selon laquelle il y a dans le désir autre chose que la stricte étroitement érotique, au sens d’une visée de plaisir.
AP : D’ailleurs, vous aviez consacré des textes à cette distinction entre pulsion et désir, dans Vie et intentionnalité, si je me souviens bien.
RB : Absolument.
AP : Cela veut donc dire que votre troisième partie n’est qu’indirectement phénoménologique.
RB : Oui, on peut dire cela ainsi. Vous avez raison de poser la question du statut de cette partie, parce que là, en effet, je ne suis pas à un niveau proprement intuitif au sens husserlien du terme. J’accède à une dimension originaire qui me semble satisfaire aux conditions du problème que je pose et je la nomme Désir dans la mesure où j’en ai une attestation phénoménologique dans notre désir éprouvé.
AP : D’accord ; j’aimerais revenir à la question du manque, en vous citant à nouveau : « Le désir n’est pas recherche manquée de soi mais plutôt accès à soi comme manque, et l’autre est alors autant le lieu d’une révélation (de soi comme manquant) que d’une déception. »9 Le désir permet de se découvrir comme manque, le manque caractérise l’être du sujet. La question est très simple : le manque est-il, pour reprendre un terme heideggérien, un existential ?
RB : Dire cela présupposerait que nous sommes dans une perspective où il y aurait des existentiaux, ce qui implique évidemment que le sujet soit déterminé comme existence, alors que pour moi le sujet n’est pas déterminable comme existence mais comme vie. Tant qu’à faire, je préférerais parler de vital plutôt que d’existential.
AP : Mais est-ce que ce « vital » pourrait éventuellement être l’analogue de l’existential, si on transposait cela dans votre perspective ?
RB : Je dirais plutôt que le Désir, en tant que « vital », serait analogue à un existential. On m’a déjà dit que le Désir occupe chez moi la place qu’occupe la Sorge chez Heidegger. Donc ce Désir peut avoir la même place et la même fonction structurale que le Souci, sauf que ce Désir n’est plus un existential, mais un vital.
AP : Le Désir et non pas le manque ?
RB : Le Désir et non pas le manque. Je voudrais préciser ce qu’il faut entendre par le terme « manque ». J’ai voulu montrer que le manque qu’éprouve le sujet est aussi un manque du sujet, au sens d’un défaut de sujet : ce dont le sujet manque, c’est de lui-même. Mais loin de moi l’idée de me rapprocher d’une pensée comme celle de Lacan, par exemple : je ne veux pas du tout penser le désir comme un défaut ou une lacune qui pourrait être comblé de quelque façon que ce soit. Donc je m’oppose à la fois à une conception qui va dans le sens spinoziste-deleuzien, qui voit dans le désir une pure affirmation, et à une perspective comme celle de Lacan, qui fonde le désir sur le manque. Je recherche une négativité qui ne soit pas une lacune à combler, qui ne soit pas la recherche d’une positivité dont elle serait l’envers. Et que cette positivité soit irréalisable, que le manque ne puisse être comblé ne change rien à l’affaire car ce qui est en jeu c’est la spécificité ontologique de ce qui est ouvert par le désir et qui n’a rien à voir avec l’objet ou l’étant.
AP : C’est anti-sartrien aussi.
RB : Oui, vous avez tout à fait raison d’y faire allusion. Il s’agit de penser une négativité du sujet qui ne soit pas corrélative d’un étant mais du fond mondain de tout étant ; c’est ce que j’appelle, provisoirement, manque. Ce concept a donc un sens très précis.
AP : J’aurais une question subsidiaire : dans Vie et intentionnalité, la perspective que vous faisiez naître du manque était encore d’ordre cognitif : « Parce qu’il est manque inobjectivable, écriviez-vous alors, le désir est la condition pour l’ouverture de toute objectivité. »10 Chez l’homme, « le manque se détache pour lui-même comme horizon indéfini d’objectivation ; c’est alors que la connaissance devient possible. »11 Est-ce que cette introduction à la phénoménologie de la vie ne renonce pas quelque peu à une perspective d’une phénoménologie de la connaissance qui était encore présente en 2003 ?
RB : Je vous remercie pour l’acuité de votre lecture. Ce qui est certain, c’est que cela disparaît totalement de mon dernier livre et cela disparaît de mon dernier livre parce que ce n’est pas mon objet. D’une certaine façon, cela n’a jamais été mon objet, et c’est pourquoi dans Vie et intentionnalité, je l’évoquais seulement comme une perspective possible. Mais c’est un énorme problème pour moi, car, tout simplement, je ne suis pas sûr du tout qu’il soit possible de faire une phénoménologie de la connaissance ; la perspective phénoménologique radicale dans laquelle je m’inscris ne rend pas nécessairement possible une phénoménologie de la connaissance. Merleau-Ponty lui-même, si je peux me permettre de faire ce rapprochement, rencontre ce problème : est-ce que, quand on fait une phénoménologie de la perception, on peut vraiment rendre compte de l’ordre de la connaissance ? C’est un problème très difficile, et pour l’instant, je m’en sens vraiment très loin. Il y a donc deux niveaux de réponse : tout d’abord, ce n’est pas mon objet principal car ma préoccupation est plutôt archéologique ; d’autre part et de plus, je ne suis même pas sûr que cela soit possible, ce qui pose un problème car cela met vraiment en question les limites de la phénoménologie. D’ailleurs, si vous regardez les phénoménologues qui comptent vraiment, vous constatez que la question de la connaissance n’est jamais vraiment affrontée.
AP : A part Husserl, en effet, pas grand monde ne s’est attelé à cette question.
RB : Oui, et ceux qui ont essayé n’ont pas donné de réponse vraiment satisfaisante. Donc il faudrait peut-être renoncer à ce projet, ce qui pose quand même un problème. Dans Vie et intentionnalité, mon but était d’esquisse une piste à partir de l’idée qu’il y a dans la vie une dimension fondamentalement transitive, une dimension proprement phénoménalisante par laquelle la vie échappe à la simple conservation, etc. Mais passer de la phénoménalisation à la connaissance proprement dite, ça engage la question du langage, et je ne suis pas en mesure pour l’instant d’aborder cette question.
AP : Ma dernière question portera sur l’amour. Vous y consacrez un passage, mais un passage étonnamment court quand on songe à l’importance que revêt le désir dans vos analyses. Je vous cite : « L’amour est donc la forme que prend le Désir lorsque ce désir se rapporte à l’autre et accède par lui, au moins fugitivement, à l’Ouvert. »12 L’Amour, c’est une des formes possibles du Désir, donc du rapport entre l’apparaissant et l’Ouvert, de sorte que l’être aimé apparaissant constitue une voie d’accès à l’Ouvert. Autrement dit, dans l’empirique et dans l’apparaissent éclot cela même qui rend accessible le transcendantal. Quelles pourraient être les autres formes du Désir permettant d’établir une relation ? Si on voit bien pourquoi l’amour remplit les conditions, on ne voit pas quel autre exemple pourrait les remplir, en tout cas je ne vois pas quelle serait la possibilité autre que l’Amour pouvant décrire ce que vous appelez Désir.
RB : Je vous remercie, encore une fois, pour vos questions. Pour répondre à votre première remarque, si l’amour n’est pas tellement présent dans ce livre, c’est parce que c’est un livre qui ne s’intéresse pas à l’intersubjectivité mais qui tente de donner les fondements d’une phénoménologie de la vie : le champ de l’intersubjectivité n’y est pas envisagé comme tel. J’annonce dans une note une « érotique phénoménologique » et j’aimerais m’atteler à cela à présent. Mais bien entendu, c’est dans l’Amour par excellence que s’atteste le Désir tel que je l’ai défini. D’ailleurs, je me suis appuyé sur une lettre de Rilke où il dit que, fugitivement, dans l’amour, il y a quelque chose de l’Ouvert qui entre en jeu, qui se dévoile. A dire vrai, il faudrait que je réfléchisse plus avant, mais j’aurais tendance à répondre négativement à votre question : j’aurais tendance à vous répondre que l’amour est la modalité absolument privilégiée, et sans doute unique, livrant accès à ce que j’ai appelé l’Ouvert.
AP : Donc ce n’est pas une forme parmi d’autres du Désir, c’est la forme de celui-ci.
RB : Oui, c’est la forme privilégiée, voire unique, du Désir ; en tout cas, dans mon esprit, Amour et Désir sont synonymes. Cela fait à écho à des points que j’avais étudiés lorsque je travaillais sur Merleau-Ponty il y a bien longtemps. Il y a quelques notes, quelques textes de Merleau-Ponty, très courts, très fugitifs, s’inscrivant au fond dans une ligne très husserlienne, où il est dit que dans l’amour se joue quelque chose qui transcende la simple relation de l’un et de l’autre, comme si l’amour révélait, livrait accès à un plan d’intersubjectivité supérieure où la singularité des consciences et de leurs mondes est comme transcendée. Il y a cela chez Merleau-Ponty et cela m’a toujours beaucoup intéressé.
AP : Ah oui, quand il aborde par exemple « la manière d’être chair donnée », dans un passage…
RB : Oui, exactement ; et il dit, « dans le travail silencieux du désir naît le paradoxe de l’expression » ; je crois que c’est à peu près cela. Il y a chez Merleau-Ponty l’idée que la signification intersubjective renvoie à une expression première dont la source est à chercher dans le désir, dans cet échange avec l’autre, ce « mélange » qui n’est possible que dans le désir, où se transcendent les singularités.
AP : Finalement, j’aurai une question supplémentaire, tournant autour de l’art. Vous concluiez Vie et intentionnalité sur ce thème, et vous en faisiez, à travers l’exemple de la danse, ce qui réconciliait le se mouvoir et le sentir. Or, l’art n’est plus présent dans votre dernier ouvrage : est-ce parce que vous avez évolué sur cette question-là, ou parce qu’il n’entrait d’aucune façon dans votre problématique ?
RB : Je n’ai pas évolué sur cette question. L’idée de Vie et intentionnalité était celle d’une relation originaire du sentir et du se mouvoir. L’art atteste de cette relation en tant qu’il ne fait que prolonger une sorte de dynamique intérieure du sentir, dynamique qui procède de sa dimension constitutive d’insatisfaction. Je m’appuyais sur Valéry et j’en tirais la conclusion selon laquelle l’art archétypal de tous les arts, c’est la danse. Et je continue à le penser, bien évidemment. Mais dans mon dernier livre, je n’aborde pas la phénoménologie du mouvement de la même façon, elle n’a pas la même place.
AP : Peut-être est-ce le sentir qui est moins prégnant aussi.
RB : Peut-être, oui, vous avez raison. Mais je n’ai pas bougé sur ce point et je continue à travailler autour de cette question. La danse me paraît être un art extrêmement privilégié et son étude indispensable à la phénoménologie que je veux élaborer.
AP : Et pour finir sur une boutade, après l’élection de Jean-Luc Marion à l’Académie française, puis-je vous demander si l’Académie vous tente également ?
RB : Non…
- cf. Renaud Barbaras, Introduction à une phénoménologie de la vie, Vrin, 2008
- cf. Renaud Barbaras, Le désir et la distance, Vrin, 1999
- cf. Renaud Barbaras, Vie et intentionnalité, Vrin, 2003
- Barbaras, Introduction…op. cit., p. 21
- Ibid. p. 235
- Ibid. p. 264
- Barbaras, Le désir et la distance, op. cit., p. 152
- Barbaras, Introduction…, op. cit., p. 264
- Ibid. p. 304
- Barbaras, Vie et intentionnalité, op. cit., p. 197
- Ibid. p. 199
- Barbaras, Introduction…, op. cit., p. 286








