L’ivresse des images
Né en 1940, Régis Debray est normalien, agrégé de philosophie, romancier, dramaturge, essayiste et membre de l’académie Goncourt depuis 2011. Auteur d’une soixantaine d’ouvrages, il fait partie des intellectuels français les plus traduits à l’étranger. Il est notamment connu pour être l’inventeur de la « médiologie » : ce néologisme apparaît pour la première fois dans Le Pouvoir intellectuel en France (1979). Il ne faut pas confondre la médiologie avec la sociologie des médias. On pourrait plutôt la définir comme la science les médiations techniques de la culture. Régis Debray a ainsi fondé et dirigé les Cahiers de médiologie (1996-2004) avant de créer la revue Medium qu’il dirige depuis 2004. C’est dans cette perspective médiologique que Régis Debray consacre depuis une vingtaine d’années une réflexion à la question de l’image et à ses enjeux. Dans Le Stupéfiant image1 (expression empruntée à Aragon dans Le Paysan de Paris) paru l’an passé chez Gallimard, il renoue de nouveau avec cette problématique. Je l’ai rencontré pour lui demander quelques précisions autour de sa réflexion sur l’image.
Je remercie chaleureusement Régis Debray de son accueil et de sa disponibilité pour cet entretien.
Propos recueillis par Henri de Monvallier
Actu Philosophia – Le Stupéfiant image se présente comme un recueil de textes aux statuts divers : articles, allocutions, préfaces à des catalogues d’art, etc. Ces textes s’échelonnent de 1992 à aujourd’hui. Or, 1992, c’est précisément la date de parution de Vie et mort de l’image, votre premier grand livre théorique sur la question. Jusqu’à cette date, vous aviez publié surtout des romans, comme par exemple La Neige brûle (prix Femina en 1977), ou bien des essais politiques (Critique de la raison politique, 1981). La question de l’image était donc absente dans votre œuvre jusqu’au début des années 1990. Comment cette question s’est-elle imposée à vous ?
Régis Debray – Il faut, je crois, partir d’abord d’un fait neurophysiologique à la fois contingent et tout à fait décisif : j’ai un œil mais je n’ai pas d’oreille, je suis un visuel et non un auditif. Vous êtes philosophe, vous avez lu Nietzsche et vous savez bien combien une physiologie est à même de déterminer un tempérament : une pensée, un choix de thème, un objet de réflexion procèdent toujours d’un corps. Il est vrai, cependant, qu’on peut avoir les deux : Lévi-Strauss ou Proust, par exemple, avaient tous les deux la chance d’avoir à la fois un œil et une oreille. Pour rester dans les grands noms, Breton n’a pas d’oreille et Hugo non plus… Hugo qui disait, comme vous savez, « Défense de déposer la musique au pied de mes vers ». J’ai, disons, la promptitude du coup d’œil et c’est une grâce qui n’a rien de surnaturel : c’est sans doute physiologiquement déterminé ! Mais je n’ai pas la même finesse d’écoute pour la musique. Premier point. En bon matérialiste, je commence par le corps. Deuxième cause : m’occupant de médiologie, c’est-à-dire de l’efficacité symbolique, de ce qui permet la propagation d’une idée et sa transformation en « force matérielle » (pour reprendre l’expression de Marx), il faut bien constater que l’image est un vecteur extrêmement puissant de diffusion, propagation, propagande et domination. Je dis « l’image », cela inclut aussi bien la statuaire, que l’image peinte ou que l’affiche, voire même le graffiti. Et donc, en tant que médiologue, si j’essaie de voir, par exemple, comment s’est répandu et s’est imposé le christianisme dans l’empire romain d’Orient et d’Occident, je suis bien forcé de réfléchir au rôle de l’image, à la querelle des iconoclastes et à la formidable exception occidentale d’un monothéisme iconophile.
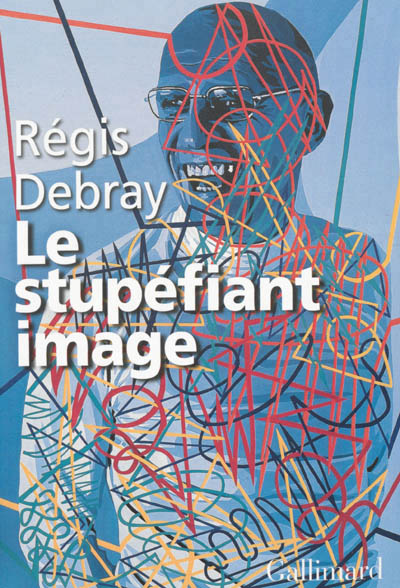
AP – Peut-on dire alors que votre questionnement sur l’image naît à peu près en même temps que votre questionnement sur le religieux en lien avec la problématique médiologique de la transmission?
RD – Oui, ce questionnement est effectivement lié à l’insolite d’un monothéisme pour qui Dieu peut se rendre visible, ce qui, d’un point de vue judaïque ou islamique, est non seulement une aberration ou un non-sens mais même (et surtout) un sacrilège éventuellement puni de mort : malheur au veau d’or et surtout à ceux qui l’adorent, ils sont massacrés… Réfléchissant au christianisme, notamment dans Dieu, un itinéraire (2001), je me suis heurté à ce mariage extraordinaire entre la révélation scripturaire et l’expansion iconique ou plutôt la licéité des images, le fait qu’elles soient permises, autorisées. Cette licéité des images découle directement du dogme de l’incarnation. Pour en venir (troisième raison qui m’a poussé à m’intéresser à la question de l’image) à une situation plus contemporaine, il est évident que nous vivons la civilisation des écrans, il y a certes de l’écrit sur l’écran mais il y a tout de même principalement des images. Je sais que l’image est un mot-valise et un mot fourre-tout mais il est tout de même très symptomatique qu’aujourd’hui les hommes politiques disent avoir des « problèmes d’image », commettre des « erreurs d’image », viser à des « succès d’image ». Et s’ils craignent également les « dérapages » verbaux, c’est uniquement parce que cela nuit à leur image… Cet emploi métaphorique prouve à quel point le champ magnétique de l’image est omniprésent. Il est difficile, à moins de ne pas sortir de chez soi, de ne pas aller dans le métro, de ne pas regarder la télévision ou de ne pas avoir de musée de peinture dans les environs, de ne pas se poser cette question. Et puis il y a, je crois, une dernière raison qui est pour moi celle qui me titille, qui me taquine ou qui m’excite le plus : c’est le mystère de l’indiciel. Comment rendre compte de l’infralinguistique ?
AP – Indiciel et donc indicible en même temps…
RD – L’indiciel est indicible. Comment rendre compte de cette couche émotive « prédiscursive », comme disent les philosophes, qui fait que l’image n’est pas un langage ? Et donc, au fond, comment parler de l’image ? On ne fait que parler autour, sur un mode plus ou moins incantatoire, métaphorique ou lyrique mais, quoi qu’il en soit, pour l’écrivain que je suis, il y a là un sortilège attractif. Comment rendre l’émotion visuelle ? Il s’agit d’un défi radical, sans doute insurmontable, pour le langage. Pour toutes ces raisons, donc, la question de l’image, au sens de picture, image fabriquée de main d’homme, d’image-objet, et pas au sens d’image (de vision mentale, l’image au sens de L’Imaginaire de Sartre), s’est imposée à moi et m’a intéressée. D’autant plus que les philosophes, depuis Platon, n’ont jamais eu grand-chose à dire sur l’image, sinon pour la condamner. Il s’agit donc d’un champ suspect pour un philosophe traditionnel. L’imagination n’est-elle pas « maîtresse d’erreur et de fausseté » ? Dans notre tradition cartésienne, rationaliste, l’image est mal famée et moi j’aime tout ce qui est mal famé !
AP – Vous aimez les marges.
RD – Les bas côtés. Voilà ce qui me vient à l’esprit en faisant une auto-analyse rapide sur la manière dont cette question de l’image s’est imposée à moi.
AP – Et si on passe de l’auto-analyse à l’autobiographie proprement dite, y a –t-il eu des événements déclencheurs qui ont pu préparer le terrain à cette réflexion sur l’image chez vous ?
RD – Oui, il y en a eu beaucoup. Les images pieuses qu’on trouvait dans le missel à la messe, par exemple. Mais il faudrait aussi évoquer le rôle structurant qu’a joué pour moi le cinéma dans ma jeunesse. J’étais cinéphile et, logeant rue d’Ulm à une époque où la cinémathèque était rue d’Ulm, il n’y avait qu’à faire cinquante mètres en sortant de l’ENS sur la droite pour se retrouver avec les jeunes gens des Cahiers du Cinéma.
AP – Dans la longue préface autobiographique du Stupéfiant image, vous dites d’ailleurs : « […] jusqu’à la trentaine passée, j’ai plus fréquenté les cinémas que les bibliothèques. Affaire de tempérament autant que de génération » (13).
RD – Effectivement, j’ai fait mon éducation plutôt par l’écran que par l’écrit, encore que… Les deux vont de pair. On en reparlera sans doute ensuite. Mais en tout cas il me semble vrai que si j’avais eu plus de cohérence, j’aurais sans doute fait l’IDHEC 2. En fait, je suis rentré à l’École Normale par paresse, en me laissant aller, quand suivre ma pente en la remontant m’aurait conduit à l’IDHEC. Et puis… On se laisse aller et on atterrit rue d’Ulm ! Chacun fait comme il peut.
AP – On peut quand même trouver pire comme piste d’atterrissage…
RD – Elle est plus banale.
AP – C’est vrai. Je voudrais revenir sur un point. Vous disiez que l’image n’est pas un langage, que dire n’est pas montrer (voir Wittgenstein). Mais je pense tout de suite à l’article célèbre de Roland Barthes sur la « Rhétorique de l’image » paru en 1964 dans la revue Communications. Analysant une publicité pour les pâtes « Panzani », Barthes montrait que chaque élément de l’image est un signe, comme un mot, et que l’ensemble de l’image serait une sorte de phrase dont le signifié global serait ce qu’il appelle « l’italianité ». Que pensez-vous de cette hypothèse d’une rhétorique de l’image qui, du coup, la rapprocherait du langage ou ferait d’elle un langage ? S’agit-il, pour le coup, d’un abus de langage ?
RD – D’un abus de linguistique, sans aucun doute, comme toute cette époque comiquement logocentrique qui a inventé cette idée que l’image était un langage, ce qui était une façon de plaquer ce qu’on croyait être une science (et qui était la linguistique structurale) sur ce qui ne relève pas de la linguistique. Un langage est un système de signes fonctionnant sur le différentiel, ce n’est pas une représentation, c’est du symbolique, bref… Simplement, à l’époque tout était langage, n’est-ce pas ? La mode, la gastronomie, le droit, la géographie, tout était langage. Cela a donné parfois des choses amusantes, comme les Mythologies de Barthes, mais cela a donné le plus souvent d’immenses conneries sur lesquelles une génération de philosophes ou de pseudo-penseurs a dû plancher. Beaucoup ont d’ailleurs terminé dans la publicité…
AP – Un petit peu avant cet article célèbre de 1964, d’ailleurs, les publicitaires s’intéressent à Barthes par l’entremise de son étudiant Georges Péniniou dont il dirige la thèse sur « La sémiologie de la publicité »: il va ainsi faire une conférence chez Publicis place de l’Étoile et est engagé par Renault pour une étude sur la sémiologie de l’automobile. La position de l’intellectuel critique des Mythologies est bien renversée…
RD – À partir de la fin des années 1950, avec la diffusion massive de Saussure et Jakobson sous la houlette de Lévi-Strauss, qui d’ailleurs n’en pensait pas moins, on s’est mis à considérer que le monde était un texte. Tout cela a débouché sur Lacan, sur le Nouveau Roman et sur le théoricisme dans le domaine marxiste. C’était une époque, j’en ai été indemne, encore une fois par hasard. Je n’ai pas suivi les cours de Lacan, je n’ai pas fréquenté les bons livres et les bons auteurs, tout simplement. Mais je dois reconnaître que cette mode du tout linguistique ne m’a jamais séduit.
AP – Dans les années 1960-1970, vous faisiez autre chose : vous écriviez des romans, des essais politiques en lien avec l’actualité internationale, etc. Vous étiez bien loin de toutes ces préoccupations des « sciences humaines ».
RD – Oui et, d’abord, dès 1961, je sors de France pour les raisons que vous connaissez. J’y reviens en 1971, dix ans plus tard. Tous ces enthousiasmes scolastiques me sont donc restés étrangers. Je n’en suis pas fier : je suis juste passé en travers les gouttes.
AP – Comment votre pensée de l’image a-t-elle évolué depuis vingt ans et depuis la publication de Vie et mort de l’image en 1992 qui traçait le cadre théorique dans lequel les textes brefs et circonstanciels du Stupéfiant image viennent s’inscrire? Souscririez-vous encore actuellement à l’ensemble des thèses que vous défendiez dans ce livre ? Notamment cette idée selon laquelle l’image est un temps révolu, intermédiaire entre celui des idoles lié à la logosphère et à celui du « visuel » lié à la vidéosphère (et, plus récemment encore, à la numérosphère) ? Ou encore cette idée de la fin de la société du spectacle ?

RD – Disons que de Vie et mort de l’image au Stupéfiant image il y a comme une passage du panoramique au gros plan, comme une passage d’une vue, effectivement, théorique à des travaux pratiques, comme une passage d’un registre à un autre : disons du registre encore philosophique et universitaire (Vie et mort de l’image est à l’origine un travail de doctorat sous la direction de François Dagognet) à un registre franchement littéraire, un passage du discursif à l’intuitif, en somme, ou de l’effort intellectuel au coup de cœur ! Disons : du professionnel du concept que je ne suis plus (bien que mes papiers soient en règle) à l’amateur avoué des plaisirs d’images. Voyez-y plutôt une dégradation, de votre point de vue, qu’une promotion !
AP – Que vouliez-vous dire précisément avec cette thèse de la mort de l’image ? Vous disiez juste auparavant avoir survécu aux modes intellectuelles des années 1960 et 1970, mais n’avez-vous pas, pour le coup, cédé à un certain effet de mode ? Après la mort de Dieu, la mort de l’homme, la mort de l’auteur, la mort de l’art, etc., il ne manquait donc plus que la mort de l’image ?
RD – Oui, il y a un effet de mode, c’est certain. Hier tout était mort, aujourd’hui tout est « invention » : invention de Dieu, invention de l’homme, invention de la femme, etc. J’ai peut-être cédé à un snobisme momentané, vous avez raison. Tout de même. J’ai fait des entretiens avec Serge Daney3 (mort d’ailleurs en 1992) et Daney avait une thèse, que j’ai partagée, qui était le remplacement de l’image par le visuel, le visuel étant une représentation du monde qui ne correspond pas à une expérience du monde. Le visuel est de l’ordre du machinique, de l’automatique, du téléguidé, du téléobjectif. En ce sens, le visuel est une mort de l’image au double sens du mot « image », c’est-à-dire à la fois engagement de l’individu dans une représentation et sous-bassement littéraire de l’image, c’est-à-dire précellence et précédence du texte sur l’image (l’image comme sous-texte, comme texte dégradé). Il m’a donc semblé, pour parler vulgairement, que trop d’image tue l’image : quand il y a des milliards d’images qui circulent sur les réseaux sociaux, sur Internet, à la télévision, l’image n’est plus là pour s’installer dans la durée, n’est plus là pour proposer un style d’appréhension du monde, l’image est là pour vendre, faire vendre, distraire, etc. Ce n’est tout de même pas par hasard si la peinture est morte à ce moment-là (j’entends la peinture au sens térébenthine du mot) et a été remplacée par d’autres formes d’art telles que l’installation ou le happening. Bref, il y a eu, me semble-t-il, une sorte de frénésie et de frivolité visuelle qui a relégué dans les marges l’image comme, à la fois, métier, travail, expertise et comme engagement d’un imaginaire personnel. Donc, oui, le titre Vie et mort de l’image était, vous avez raison de le dire, un peu « putain » mais n’était pas complètement infondé. J’aurai, je l’espère, les circonstances atténuantes du tribunal philosophique…
AP – Vous les avez d’avance! Il y avait dans Vie et mort de l’image une autre thèse qui était celle de la sortie de la société du spectacle. Pouvez-vous aussi expliciter un peu ce que vous entendiez par là à l’époque ? En effet, on aurait envie de dire exactement l’inverse, à savoir que jamais nous n’avons été autant dedans avec ce flux d’images permanent et omniprésent que vous évoquiez à l’instant.
RD – La société du spectacle est la plus grande bévue de la pensée contemporaine. Le célèbre livre que Debord publie en 1967 aurait été très bien pour décrire la société de Louis XIV mais, pour décrire la société contemporaine, c’est purement et simplement une antiphrase. En effet, « spectacle » veut dire d’abord mise à distance : mais nous sommes passés de la représentation à la présence. Aujourd’hui, on enjambe la rampe. Comme dit Dubuffet : « Il n’y a plus de regardeur dans ma cité, je ne veux que des acteurs ». Donc, tous en scène ! Mais qu’est-ce qu’est que le spectacle sinon, justement, la séparation entre une scène et une salle ? Or, aujourd’hui cette séparation entre la scène et la salle, entre l’acteur et le spectateur (pas de spectacle sans spectateur) est soustraite, levée. Nous ne sommes pas dans la société du spectacle mais dans la société du contact (voir les écrans tactiles), nous sommes dans la société du direct, du live (voir les chaînes d’information en continu), nous sommes dans la société du self-service sans cérémonie, sans retard et sans protocole. Aujourd’hui, on n’est plus devant, on est dedans. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Dubuffet invente des statues pénétrables. Immédiateté, contigüité, proximité, tels sont les trois piliers de tout ce qui est contemporain. Autrement dit, nous vivons l’âge de la dérégulation. Aujourd’hui la vraie mise en scène, c’est le refus de la mise en scène. C’est le cru, le vif, le sauvage, l’instinctuel, le pulsionnel, etc. 4. Donc, vraiment, je pense que la société du spectacle n’est qu’une traduction malicieuse du jeune Marx et de Feuerbach : vous prenez les textes du jeune Marx de 1843-1844, vous remplacez « aliénation » par « spectacle » et vous avez Guy Debord. Il le dit d’ailleurs clairement dans son livre : « La séparation est l’alpha et l’oméga de la société du spectacle ». Or, pour n’importe quel lecteur du jeune Marx, « séparation » implique « aliénation » (celle-ci pouvant se définir comme la séparation de l’homme d’avec son essence, de l’apparaître et de l’être, les deux devant à terme être réconciliés). Simplement, comme à l’époque, les journalistes, pas plus qu’aujourd’hui d’ailleurs, ne lisaient et n’avaient lu ni les Manuscrits de 1844 ni Feuerbach, ils ont été subjugués par la pensée de Debord et l’ont trouvée absolument géniale et originale. Cela faisait rire des gens comme Baudrillard qui, lui, connaissait son jeune Marx, étant germaniste et traducteur d’allemand, et cela m’a fait rire, moi, parce qu’à l’époque on fréquentait assez le jeune Marx. Donc, cette histoire de la « société du spectacle », c’était, de la part de Guy Debord, qui a sans doute davantage mis son génie dans sa vie, dans sa mort et dans sa manière de construire sa légende que dans son œuvre, un anachronisme. Ce concept serait opérationnel, comme je le disais, pour décrire la cour de Louis XIV, voilà un lieu où il y avait vraiment du spectacle, c’est-à-dire de la séparation entre des regardants et des regardés, des spectateurs et des acteurs, un lieu où il y avait représentation et non présence.
AP – D’où l’importance du théâtre à cette période et les liens de proximité entre Louis XIV et les plus grands dramaturges de l’époque (Molière et Racine).
RD – Tout à fait. Mais, sur le fond, je suis pour le spectacle 5 et je me plains de l’absence de spectacle : c’est ce que j’ai appelé dans un essai de 2007 « l’obscénité démocratique ». Valéry disait fort bien : « La civilisation, c’est un ensemble de “comme si” », c’est-à-dire de mises à distance, de dédoublements, de jeux. Et aujourd’hui, c’est très sensible dans l’art contemporain, l’artiste n’est plus un créateur de spectacles, c’est un créateur d’expériences. L’artiste veut nous immerger. Allez voir les installations de Bill Viola : vous êtes comme immergé dans des grottes préhistoriques. On n’est pas invité à un spectacle mais à un partage. C’est le happening, si vous voulez. Alors, dans ces conditions, parler du happening comme de la société du spectacle, c’est un contresens. Le happening, c’est précisément le contraire du spectacle : dans le happening, il y a des participants mais pas de spectateur. Par ailleurs, le spectacle, c’est ce qui se répète, le happening, lui, ne se répète pas. Autrement dit, Guy Debord : zéro de conduite ! Ou plutôt : 20/20 en termes de conduite (sa grande œuvre reste sa vie) mais zéro en termes philosophiques. Mais il a quand même bien compris que l’absence du médiatique était le comble du médiatique.
La suite de l’entretien se trouve à cette adresse.
- Régis Debray, Le stupéfiant image, Gallimard, 2013
- Institut des Hautes Études Cinématographiques, fondé en 1943 et devenu la FEMIS en 1988.
- Serge Daney : Itinéraire d’un ciné-fils/Entretien avec Régis Debray, Jean-Michel Place, 1999.
- Sur les dérives de ce refus de la mise en scène chez des metteurs en scène comme le Belge Jan Fabre, par exemple, on se référera aux analyses de Régis Debray dans le petit essai Sur le Pont d’Avignon, Flammarion, « Café Voltaire », 2005.
- Voir sur ce point la conférence de 2007 « Éloge du spectacle » : http://www.cerium.ca/Eloge-du-spectacle.








