RE par RE
Propos recueillis par Henri de Monvallier
Né en 1975, Raphaël Enthoven est normalien et agrégé de philosophie. Il anime les émissions « Les Nouveaux chemins de la connaissance » du lundi au vendredi sur France culture (10h-11h) et « Philosophie » chaque dimanche sur Arte à 13h30. Il est, par ailleurs, chroniqueur occasionnel dans l’hebdomadaire L’Express et régulier dans le mensuel Philosophie magazine. Le Philosophe de service et autres textes (Gallimard, « L’Infini », 2011) est son troisième livre après Un Jeu d’enfant – La Philosophie (Fayard, 2007) et L’Endroit du décor (Gallimard, « L’Infini », 2009). Ce livre reprend un certains nombres de chroniques, issues pour la plupart de Philosophie magazine réécrites, remaniées et réagencées pour l’occasion. J’ai voulu rencontrer Raphaël Enthoven pour voir quelle pouvait être la cohérence rétrospective de cet ouvrage, quel était le fond de sa manière de penser et m’entretenir avec lui de son travail d’animateur et de passeur de la philosophie dans les media.
Philosophe de service et philosophe médiatique
Actu Philosophia – Je voudrais d’abord m’attarder sur le texte liminaire qui donne son titre à l’ouvrage : « Le Philosophe de service ». Comment pourrais-tu définir ce personnage conceptuel que tu as inventé en quelques traits ? Qu’est-ce qui le caractérise ?
Raphaël Enthoven – Il faudrait écrire « ceux qui le caractérisent ». Les autres. L’opinion. La loi du marché, dont il est l’élu du moment. Le philosophe de service n’est pas seulement un personnage conceptuel, au sens deleuzien du terme, qui anastomose le désir d’autrui et ses propres traits de caractère, mais aussi, plus simplement, la créature d’une foule sans imagination qui se le représente à la fois comme un pitre et comme un sage, le fond de teint que le consommateur utilise pour maquiller son désarroi. Parce qu’il joue le jeu de l’opinion, l’opinion se joue du philosophe de service ; elle ne lui demande pas de faire de la philosophie, mais de faire le philosophe. Quand elle réclame son « point de vue de philosophe » sur tel ou tel fait d’actualité, l’opinion réclame en vérité l’idée qu’elle se fait de son point de vue de philosophe. Elle lui adresse à mots couverts l’injonction contradictoire d’être accessible et jargonnant, compréhensible et lointain, d’être abstrait tout en parlant du quotidien, bref, d’être à tous égards identique à l’idée reçue que, depuis le Théétète de Platon, Monsieur « On » se fait des philosophes. Plus qu’un discours, PS se doit de produire une petite musique, avec des petites phrases tantôt ombrageuses et jargonnantes, tantôt simplissimes et paternalistes. S’il manque à cette tâche, s’il ne joue pas sur les deux tableaux, si la prestation n’est pas à la hauteur des demandes du client, PS est aussitôt répudié, renvoyé à ses études par l’adjudicataire insatisfait de la marchandise, le client qui, tout en disant ignorer ce qu’elle est, se représente la philosophie comme un mélange de théologie (la philosophie peut-elle donner du sens à ma vie ?) et de psychologie (la philosophie peut-elle m’aider à mieux vivre ma vie ?). La question clef est « mais au fond, à quoi sert la philosophie ? », c’est-à-dire « quel est mon intérêt dans cette histoire ? », « dans quelle mesure est-elle – comme l’argent, l’aspirine ou la sexualité – bonne pour moi ? ». Fausse question, qui demande des réponses comme on demande du jambon, née de l’étroitesse du regard qu’on porte sur le monde quand on prend ses désirs pour des réalités.
AP- L’expression « philosophe de service » évoque immédiatement les philosophes invités sur les plateaux de télévision ou dans les media pour commenter l’actualité ou donner, comme tu dis, le « point de vue du philosophe » sur elle. Peut-on dire que « philosophe de service » et « philosophe médiatique » sont synonymes ?
RE– Pas nécessairement. Les media opèrent à grande échelle l’espèce de captation dont n’importe quel étudiant ou professeur fait l’objet quand, lors d’une discussion en famille ou avec des amis, on se tourne vers lui pour lui demander « Et alors toi, le philosophe, qu’est-ce que tu en penses ? ». En d’autres termes – mi-goguenards mi-admiratifs: «Éclaire-nous de ta lanterne toi qui sais, toi qui es payé pour avoir l’air de savoir… » Pour en revenir aux media, le fait qu’ils soient, à rebours de leur vocation, hantés par l’immédiat les conduit immanquablement à demander que la philosophie, à rebours de sa vocation, donne des réponses en guise de questions. Plus les media relèvent d’un commerce, plus ils sont déformés par le regard de ceux qu’ils devraient informer. Cela dit, aller dans les media n’est pas forcément aller au bordel. On peut également se servir des media comme ils se servent des gens qu’ils exhibent, pour faire passer, en contrebande, le contraire de ce qu’ils attendent, spéculer sur l’audience paradoxale qu’aucune étude de marché ne garantit : l’audience par le haut, qu’on obtient en cessant de flatter, en distillant du doute et du temps long là où le chaland propose ordinairement du réconfort et du zapping… Ce qui n’est jamais que rappeler les media à leur fonction d’intermédiaires. J’ajoute qu’une certaine familiarité avec la célérité désinvolte des media permet de travailler la concision, d’utiliser pleinement l’espace étroit qu’ils allouent pour dire beaucoup de choses en peu de mots, voire de vanter les mérites d’une philosophie de l’immédiat ! La philosophie, telle que je la conçois, est justement une recherche de de la rugosité du réel. C’est ce qu’on essaie de faire passer tous les jours, ou presque, dans « Les Nouveaux Chemins » en parlant de Montaigne ou de Bergson qui, tout en étant les hommes les plus cultivés de leur temps, ne cessent de louer la candeur et la simplicité. Or, la culture (dont les media se méfient) est une condition indispensable de la candeur (à laquelle ils substituent le calcul de l’intérêt).
AP- Mais, justement, pour toi qui es présent dans les media à titre de philosophe, est-ce qu’on ne pourrait pas dire que cette créature ou ce personnage conceptuel fonctionne comme un repoussoir et une occasion d’autoréflexion critique ? Certains pourraient, en effet, avoir tendance à t’identifier au philosophe de service. On peut donc penser qu’en faisant son portrait détaillé, tu te livres à une sorte d’exorcisme par rapport à ce que tu ne voudrais pas être ou devenir, par rapport à l’image que tu ne voudrais pas qu’on ait de toi…
RE– « Nous ne voyons pas les choses mêmes, nous voyons les étiquettes qu’on a collées sur elles », dit Bergson. Or, pourquoi le fait-on ? Parce que vivre consiste à choisir, à prélever dans le monde ce dont on a besoin. Et qu’enseigne la philosophie ? À s’intéresser aux choses qui n’ont pas d’intérêt pour nous. Le philosophe de service est né de l’intérêt provisoire que l’opinion trouve à son existence. L’étiquette de « philosophe de service » est le prix à payer pour avoir le droit de transmettre au plus grand nombre le bonheur de réfléchir et de penser contre soi, voire de se moquer de soi – ce qu’en un sens je fais ici. PS est un malin génie: il est la tentation permanente d’attacher plus d’importance à son image de philosophe qu’au travail sur l’objet qui nous hante, de faire primer l’ego sur le cogito, ce qui jette un doute sur l’existence même de l’ego en question. J’ai joué au philosophe de service. Je suis allé (et je vais encore) dans des émissions « de société » pour faire la promotion d’un livre et pour donner, circonstances obligent, mon point de vue « de philosophe » sur l’actualité. Je le fais sans illusion et en toute connaissance de cause, en me disant, au terme d’une émission, que grâce à elle, certains spectateurs auront peut-être la curiosité d’ouvrir les livres dont j’ai parlé. Il n’est pas exclu que le philosophe de service rende effectivement service. J’ajouterais néanmoins que depuis, contre toute attente, qu’a été lancée l’émission de philosophie sur Arte en octobre 2008, je regarde les media d’un autre œil : il est possible de faire une émission où le sujet l’emporte sur la personne de l’invité, où le commentaire l’emporte sur l’actualité éditoriale, où les gens sont choisis selon leur compétence et non pas leur notoriété et où, enfin, on peut, au risque de devenir soi-même une image, prendre l’image à son propre piège en s’interrogeant sur ce qu’on néglige ordinairement d’y voir. Il n’est donc pas exclu que la télévision réfléchisse avant de renvoyer une image. 1
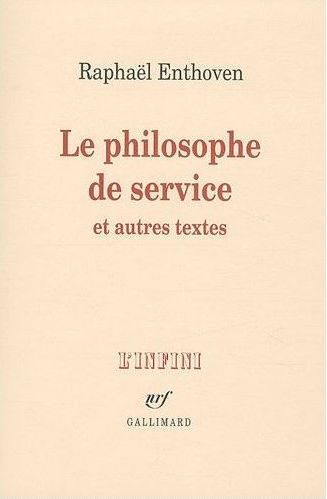
AP- Est-il possible de faire une généalogie de cette figure du philosophe de service ? À partir de quand peut-on la faire remonter ? Peut-on prendre comme date repère le coup d’éclat médiatique des « nouveaux philosophes » sur le plateau de Bernard Pivot en 1977 ? Car, après tout, c’est bien à partir de là que se constitue l’idée, d’une part, que le rôle essentiel du philosophe est de commenter l’actualité et de donner le « point de vue du philosophe » sur celle-ci et, d’autre part, comme tu l’as dit précédemment, qu’il s’agit davantage de « faire le philosophe » que de faire de la philosophie : « […] plus le contenu de pensée est faible, plus le penseur prend d’importance », disait en effet Deleuze à propos des nouveaux philosophes. Qu’en penses-tu ?
RE– Il y a peut-être quelque chose du philosophe de service chez le nouveau philosophe, dans la métamorphose de l’image de l’existence en existence comme image. Mais les nouveaux philosophes défendaient d’abord une thèse et avaient raison de le faire, tandis que le philosophe de service n’est qu’accidentellement le promoteur d’une vision du monde. En fait, tout dépend de ce qu’on entend par « généalogie » : je ne crois pas à un arbre généalogique qui aurait le tort d’identifier des philosophes de service, de mettre des noms sur une réalité plus diffuse, mais si, par « généalogie », on entend l’histoire du besoin qui préside à l’émergence du phénomène « PS », alors c’est un exercice nécessaire qui met au jour les failles, les lacunes, les idées reçues, les certitudes, les « demandes de sens » auxquelles PS doit d’exister.
AP- Oui, on a encore vu cela au moment de la crise financière de l’automne 2008 : tous les philosophes nous ont expliqué sur les plateaux de télévision ou ailleurs que c’était en fait une « crise du sens », comme si cette crise financière et l’effondrement qui s’en est suivi n’étaient pas d’abord la résultante de processus techniques précis qui n’ont rien à voir avec le « sens » (les subprimes, la titrisation, etc.). Ils se sont tous engouffrés dans la brèche…
RE– Tout à fait. La « demande de sens » – qui n’est pas un besoin de sens, mais le besoin de se dire qu’on en cherche un, ce qui n’est pas du tout la même chose – allait de pair, au moment de la crise, avec le onzième commandement de « moraliser le capitalisme ». Deux fausses questions, deux combats perdus d’avance qui, sous l’apparente volonté de comprendre, témoignent à la fois d’une régression par déni des mécanismes et de l’intronisation de la morale elle-même comme valeur d’échange. La crise fut aussi l’occasion, pour les journaux de gauche comme de droite, d’inviter leurs lecteurs à « relire Marx », à se demander si « Marx avait raison », avec l’espèce de frisson canaille qui accompagne les propositions vaguement indécentes… En jouant à leur faire peur, en osant leur parler de Marx, les journaux mettaient leurs lecteurs dans la situation de la Princesse de Parme dont les audaces mondaines de la Duchesse de Guermantes sont autant de « chocs successifs et délicieux » qui lui imposent de « prendre un bain de pieds dans une cabine et de marcher vite pour “faire la réaction” »… Peu importe qu’à la seconde où la crise cessa d’être à l’actu, où tout repartit comme en quarante, où le système homéostatique du marché reprit ses droits sur la crainte de disparaître, le vieux Marx redevînt obsolète. L’essentiel est d’avoir eu juste assez peur pour s’en vanter à table et s’offrir, en cours d’année, un second nouvel an plein de bonnes résolutions.
De l’immanence au singulier
AP- Venons-en maintenant au reste de l’ouvrage dont « Le philosophe de service » ne constitue que le texte éponyme et liminaire. Il s’agit d’un recueil de tes chroniques dans Philosophie magazine depuis deux ans (rubrique « Sens et vie »). Ces textes ont été sélectionnés, retravaillés, remaniés et réagencés pour l’occasion. On peut dérouler la table des matières qui compte dix-huit chapitres : « Dieu », « Jeu », « Courage », « Hasard », « Bonheur », « Mélancolie », « Humour », « Opinion », « Rêverie », « Mensonge », « Folie », « Nostalgie », « Étrangeté », « Égoïsme », « Générosité », « Imagination », « Temps » et « Amour ». Chaque chapitre est consacré à l’exploration d’une de ces notions en quatre ou cinq pages. Y a-t-il un ordre dans ces chapitres ou bien s’agit-il, comme tu le disais toi-même à propos d’une de tes séries d’émission sur France Culture, d’un « désordre savamment ordonné » ?
RE– Non, il n’y a pas d’ordre, le classement des chapitres est totalement arbitraire. Mais il n’y a pas de hasard non plus, dans la mesure où tout arbitraire relève d’une nécessité. De même que « marcher au hasard » revient inévitablement à marcher « d’une certaine manière », ou que, comme dit Clément Rosset, tout anyhow est un somehow, qu’il est éternellement possible de trouver une ligne géométrique dont la notion constante et uniforme lui permette de passer par tous les points qu’une main a pourtant déposés au hasard sur la feuille, le classement aléatoire des chapitres de mon livre donne rétrospectivement le sentiment d’obéir à une intention. En ce qui me concerne, je voulais (comme pour le précédent) écrire un livre qu’on pût commencer par le milieu sans que la lecture en soit affectée, à l’image de ces cartes à jouer qui dessinent un chemin quel que soit l’ordre dans lequel on les aligne. Les seuls chapitres dont la place ne doit rien au « hasard » (ou à la « nécessité ») sont le premier et le dernier : je voulais (si j’ose dire) commencer par « Dieu » et finir par « l’amour », car c’est le chemin de l’Éthique de Spinoza – qui part de l’immanence pour en venir à l’idée que la vertu précède, en réalité, les privations qu’on croit nécessaire de s’infliger pour y parvenir, bref, que s’il faut aimer la vie malgré elle, c’est que la vie précède les raisons qu’on lui trouve. Pas de plan, donc, mais un début et une fin spinoziste. De l’unicité du monde à l’amour de la vie.
AP- En tous cas, le déroulé des titres de chapitre que je viens de faire montre une nette prééminence des thématiques d’ordre existentiel ou moral. Comment choisis-tu les notions que tu traites ? Selon quels critères ?
RE– Je ne les choisis pas. Elles s’imposent. C’est l’œil qui décide, en parcourant la bibliothèque. Lorsque Philosophie magazine m’a proposé d’avoir une chronique mensuelle, ils m’ont donné une liberté d’action totale. À condition de respecter le format, je pouvais traiter n’importe quel sujet.
AP- Mais alors, justement, quand tu as repris ces chroniques pour en faire un livre, est-ce que rétrospectivement quelque chose comme une unité ou une cohérence d’ensemble t’est apparue ?
RE– Oui. Mais toute démarche est toujours susceptible de se découvrir, rétrospectivement, une unité. Une fois que les choses sont ce qu’elles sont, il est aisé de leur trouver un sens. C’est ce qu’on appelle (bien mal) un pré-jugé. Or, j’ai trop lu Bergson pour être dupe d’un tel effet. Le « bergsonisme », comme l’appelle Deleuze, est une philosophie du sang chaud, du mouvement et non de sa décomposition rétrospective en parties, une philosophie de l’avenir, de la nouveauté, et non pas du regard qui justifie rétrospectivement ce qui a été en lui attribuant la pesanteur d’un destin (« c’est écrit, donc il était écrit que ce serait écrit comme ça… »). Bergson est le penseur critique des reconstitutions parasitaires et des modèles explicatifs où l’élan vital s’est enkysté. C’est à lui qu’on doit de comprendre que l’acte libre, l’évolution créatrice, n’admet que rétrospectivement le régime déterministe et ses schèmes fabricateurs… En ce qui me concerne, quand l’idée que les apparences sont moins trompeuses que le sentiment d’être trompé par elles s’est imposée, un jour, comme le point commun (et donc la ligne de conduite) des quinze premiers articles que j’avais envoyés à Philosophie Magazine, j’ai eu envie, alors, de les rassembler dans un livre, au risque d’écrire les suivants avec une idée en tête, ce qui, jusque-là, ne m’avait pas effleuré. Ai-je été prisonnier, dans la rédaction des derniers textes, d’une conviction rétrospectivement découverte ? D’une intuition devenue contrainte par le sentiment nouveau qu’elle était, à mon insu, le fin mot de tous les textes écrits avant sa découverte ? C’est possible. Le fait est que, malgré la mauvaise foi qui accompagne inévitablement la formalisation d’une intuition, je n’ai pas cessé d’éprouver la nécessité d’écrire ainsi et non pas autrement. J’espère que la lumière artificielle et normative d’une vérité stable sur mon propre travail ne m’a pas aveuglé au point de me faire perdre de vue que l’essentiel était dans le mouvement, dans la nécessité organisatrice dont on éprouve la loi quand les notes prises au hasard trouvent d’elles-mêmes leur place et produisent une mélodie. Ai-je écrit comme j’étais, ou ai-je inconsciemment tenté de conformer mes opinions à ce que je croyais savoir de moi-même ? Ai-je donné sa chance à l’intuition que les apparences étaient moins trompeuses que le sentiment d’être trompé, ou n’ai-je fait que décliner les effets d’une vérité ? Ai-je écrit un livre ou une thèse ? Je l’ignore. Mais la qualité de mon livre en dépend. Pour Le Philosophe de service, je me suis attaché, autant que possible, à oublier ce que je croyais savoir, à sonder les textes de mes philosophes pour y trouver d’autres passerelles, d’autres pastels, à colorer d’hypothèses et de signes les arpèges nietzschéens sur le « jeu », « l’égoïsme » ou « l’opinion »… Histoire de retrouver un peu de ma candeur perdue. Dans les textes de ce dernier livre, donc, contrairement au précédent, je n’ai pas l’impression de défendre une « thèse ».
AP- Mais à travers le texte éponyme sur le « philosophe de service » tu dénonces bien quelque chose : en l’occurrence, l’instrumentalisation du philosophe par la doxa…
RE– Non, je ne dénonce rien. Je ne suis pas un contempteur de la société du spectacle. Il m’arrive de rire de ce que je comprends, mais mon rire est d’abord un amour. Les textes qui composent ce livre ont été écrits sous la double lecture des Mythologies de Barthes et d’À la Recherche du temps perdu, alors que le précédent (L’Endroit du décor) devait d’exister à la Sainte Trinité Spinoza-Nietzsche-Bergson, autrement dit immanence, apparence et singularité : l’étonnement n’est pas soluble dans la connaissance, les apparences sont moins trompeuses que le désir d’être trompé par elles, nous savons tout mais nous refusons de le savoir, la dissipation des mystères – c’est-à-dire l’unicité du monde et son caractère intégralement connaissable – ne dissipe ni l’énigme, ni l’émerveillement, on peut être surpris par l’arrivée de ce à quoi on s’attend ; en terme d’histoire des idées, Bergson est, en profondeur, l’héritier de Spinoza. Et ils ont un enfant commun : Clément Rosset. Dans la rédaction du Philosophe de service, Barthes a eu pour effet de me rendre aimable ce que je critiquais, de m’inviter, selon la belle expression qu’il emploie tout le temps, à « donner de la saveur au savoir ». Et Proust m’a donné la tentation de considérer chaque phénomène comme une « énigme de bonheur ». De fait, entre L’Endroit du décor et Le Philosophe de service, je suis passé d’une théorie implicite sur les apparences à la tentative de mieux saisir la singularité qu’elles dissimulent.
AP- Mais c’est une très vieille histoire puisque, dans Un Jeu d’enfant – La Philosophie, tu rappelles que tu avais dû traiter le sujet « La connaissance du singulier » à l’agrégation ! C’est étonnant de voir comme les philosophes peuvent rencontrer, au hasard de l’agrèg’, des sujets qu’ils approfondissent par après à titre personnel. Comme Sartre qui est passé sur « La contingence » en leçon d’oral ou bien Foucault sur « La sexualité »…
RE– Comparaison n’est pas raison, mais c’est vrai ! J’aime l’idée qu’un sujet de concours dicte une vie de recherche. En ce qui me concerne, j’avais eu 4/20, et je ne méritais pas davantage. J’avais fini la dissertation par des considérations oiseuses sur Bachelard qu’à l’époque j’avais à peine lu. Le fait est que le sujet m’a hanté depuis ce jour-là. J’y vois la formule secrète qui m’a conduit à « choisir » ensuite tel sujet plutôt que tel autre. C’est peut-être aussi, bêtement, la raison pour laquelle je passe mon temps à fabriquer des plans de dissertation.
AP- Dans un entretien sur France Culture en 2009, tu avais déclaré, à propos de ton livre précédent L’Endroit du décor : « Je laisse à mon lecteur le soin de compléter les raisonnements ». De fait, lorsqu’on te lit, on est frappé par un style enlevé, elliptique et intuitif qui pose problème sur le plan de l’argumentation. Un philosophe a-t-il le droit de dire qu’il laisse à son lecteur le soin de compléter les raisonnements ? Ne doit-il pas dérouler toutes les étapes de sa réflexion, toutes « les longues chaînes de raison », comme dit Descartes, qui mènent d’une idée à une autre, d’un argument à un autre ?
RE– En fait, il y a deux genres d’ellipses : d’abord, l’ellipse spontanée, péremptoire, l’aphorisme amnésique, dont le souvenir imparfait du savoir qui l’a engendré produit des jugements apparemment hâtifs, des considérations trop rapides, voire de mauvaise foi. Chez moi, ça prend la forme d’expressions comme « Jankélévitch pue la France, mais il est juif », une phrase stupide, mais que j’avais besoin d’écrire sans savoir pourquoi, et dont j’ai découvert, après coup, que, sans se réduire à cela, elle présentait le judaïsme comme une transcendance et la francité comme un particularisme, tout en rappelant le dégoût de Jankélévitch lui-même quand la France l’a révoqué deux fois de l’université au motif qu’il était juif et fils de métèques. De même que l’antimodernité est une façon comme une autre d’aimer son époque, l’abrupt et l’emporte-pièce témoignent parfois, en le recouvrant, d’un travail inconscient. Il m’arrive même de pousser l’ellipse jusqu’aux signaux infimes que je suis seul à voir parce que je sais qu’ils s’y trouvent. Par exemple, on peut faire tenir une infinité de considérations liminaires, de réflexions contradictoires et de savoir acquis dans la simple modification d’un pronom possessif : si vous dites d’une femme aimée que vous avez dans sa bouche le parfum de la vodka, vous reprenez, sans nulle intention de le faire, en un paradoxe imperceptible à l’œil nu, la tentative proustienne d’ouvrir son cœur au point d’y faire tinter la voix d’un autre, l’intuition d’une altérité insoluble dans la connaissance qu’on en a.
Le second registre de l’ellipse est plus concerté que le premier, moins amnésique. Fidèle à l’intuition nietzschéenne (elle-même elliptique) que « ce qui a besoin d’être démontré ne vaut pas grand-chose », l’ellipse naît aussi, tout simplement, d’une démonstration qu’on a raccourcie – comme on coupe en brosse des cheveux longs pour leur rendre de la vigueur… Exemple : dire du « scepticisme » qu’il guérit du « soupçon » semble étrange à première vue, mais relève, en réalité, d’une logique rigoureuse. Etre sceptique, c’est (en ce qui me concerne) considérer qu’établir un lien de causalité entre deux phénomènes concomitants relève le plus souvent de l’abus de langage. Etre suspicieux, c’est au contraire faire peser sur la juxtaposition de deux phénomènes le soupçon d’une intention qui les attache l’un à l’autre. Ainsi Bloch, l’ami du narrateur d’À la recherche du temps perdu, croit que le narrateur ne sort jamais de chez lui parce qu’il vit avec Albertine, alors que ces deux faits n’ont rien à voir : comme écrit Proust, « Ceux qui apprennent sur la vie d’un autre quelque détail exact en tirent aussitôt des conséquences qui ne le sont pas et voient dans le fait nouvellement découvert l’explication de choses qui précisément n’ont aucun rapport avec lui. » Cette phrase, absolument géniale, est un antidote à tous les « journalistes » qui réduisant, au mépris de la présomption d’innocence, leur métier à l’art de combler les trous, opèrent des déductions dont le caractère imaginaire est recouvert par l’apparente cohérence qui les dicte. Mais il appartient au lecteur, si le cœur lui en dit, de reconstituer tout seul le chemin qui relie deux termes brutalement réunis dans une ellipse, de donner la saveur d’une intuition à des rapprochements apparemment inattendus. C’est le principe de la maïeutique, comme de la bonne cuisine qui, au terme d’expérimentations infinies, en vient à mélanger des aliments n’ayant, à première vue, rien à faire dans le même saladier. Quoi de plus improbable qu’un mélange de mâche, de pamplemousse, de crevettes, d’avocats, d’huile d’olive et de moutarde de Meaux ? Le résultat est pourtant délicieux. L’ellipse, c’est la systole d’un texte, la contraction des chambres du cœur. La démonstration en est la diastole. Un texte est vivant – son cœur bat – quand il alterne les deux.
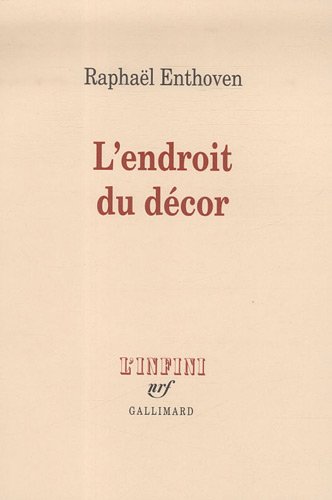
AP- D’accord, mais si on lit certains textes on a quand même l’impression d’être aux frontières de la littérature et de ne plus du tout être dans l’argumentation. Prenons par exemple les premières lignes du texte sur la rêverie (qui se trouve d’ailleurs au centre du livre) : « C’est une drogue douce qui joue avec le feu. Un terrain vague – forêt de ruines ou jungle pavée selon que la veille ou le sommeil fait peser la balance. Une vieille ville dont les ombres gardent la trace des occupants évanouis, dont les édifices minutieux, patiemment reconquis par la nature, demeurent soudain des châteaux de sable. Sous le kaléidoscope du rêveur qui prend son absence de désir pour la réalité, les oiseaux lacèrent le crépuscule, les cyprès plongent dans la piscine, les étoiles scintillent dans la mer, les nuages adoptent une forme, les nymphéas fleurissent en plein ciel, les schémas s’assouplissent, l’étendue se détend, la pensée danse, la lumière est éclairée par l’ombre, les contraires se juxtaposent, se fondent et s’enchaînent en préambule à la beauté : la rêverie, c’est la préhistoire de la contemplation, l’éducation du regard par les yeux de l’âme » (p. 63-64). N’est-on pas dans de l’écriture littéraire pure ?
RE– C’est toi qui le dis. Si on y regarde de plus près, si on dissèque un peu (ce qui n’est pas passionnant), on découvre des mécanismes et des sources vives là où il semble n’y avoir qu’une énumération arbitraire. Les deux phrases sur la ville et le terrain vague sont tirées d’un chapitre de Gracq dans Le Rivage de Syrtes intitulé « Les Ruines de Sagra » dans lequel l’auteur décrit une sorte de gigantomachie entre une ville fantôme et la végétation qui reprend inéluctablement du terrain. C’est là que Gracq écrit : « La ville dévidait une longue rêverie ». Dans la suite de mon texte, le kaléidoscope et les nymphéas sont une référence explicite à Proust ; l’expression « prendre son absence de désir pour la réalité » est une allusion au paradoxe schopenhauerien du désir de ne plus désirer ; les cyprès qui plongent dans la piscine font écho au passage très célèbre de L’Œil et l’esprit de Merleau-Ponty qui réhabilite le monde perçu et les illusions qui l’accompagnent ; les étoiles qui scintillent dans la mer et la lumière éclairée par l’ombre font référence à Hugo, l’expression « la pensée danse » est un hommage à Nietzsche et « les contraires [qui] se juxtaposent, se fondent et s’enchaînent en préambule à la beauté » sont une allusion au point surréaliste où « les contraires cessent d’être perçus contradictoirement ». Toutes ces références sont soit délibérées soit spontanées, ça dépend. Ce qui compte, c’est leur dilution au service d’un objet mobile et très difficile à saisir : la rêverie, le « dormeur éveillé » (Bachelard) dont l’immense talent, la raison d’être (ou la raison de devenir) est de jouer sur les deux tableaux de la clairvoyance et du récit. A la différence du rêve, dont les visions s’estompent au réveil, et de la veille, dont la lucidité recouvre l’énigme de bonheur qui qualifie le moindre phénomène, la rêverie, l’entre-deux fécond, permet d’être et de savoir en même temps, de voir tout en permettant de raconter ce qu’on a vu. C’est en cela que j’en parle comme d’une « drogue douce », dont l’ivresse qu’elle procure ne supprime pas la possibilité d’en faire le récit. L’enjeu est d’avoir un pied dans les deux univers, la narration et la contemplation, qui sont deux attributs d’un monde unique. Comment dépouiller le monde de ses préjugés tout en ménageant la possibilité de le décrire ? Sans dépasser pas le point de non-retour où la rêverie bascule dans la folie ? Comment abuser modérément de la drogue ? Pratiquer, sans y verser, ce que Michaux appelle la « connaissance par les gouffres » ? Bref, comment s’étonner de ce qui nous est familier, convertir le déjà-vu en aptitude à être surpris parce qu’on connaît déjà ? Comment puiser sans s’épuiser ? C’est l’enjeu de la rêverie, comme de la connaissance, me semble-t-il.
AP- Et alors, justement, pour en revenir à la question du style, quels sont tes maîtres en la matière ? As-tu des auteurs de prédilection qui aient influencé ta manière d’écrire?
RE– Ça dépend des jours. Tout le monde m’influence. L’essentiel est de mettre les outils dont je dispose au service de la plus grande précision possible. Rien n’est plus utile et précieux, à cet égard, que l’usage de la métaphore qui, à la différence de la comparaison, ne se contente pas de rendre commensurables des éléments disparates, mais les mélange et les soude, au point de donner à voir des détails inaperçus et des objets singuliers. La métaphore est la fine pointe dont les pieds carrés du concept sont dépourvus. Les écrivains disposent, à cet égard, d’une liberté qui fait défaut aux fabricants de systèmes. Quand Camus décrit une « campagne noire de soleil », il en dit plus long (en quatre mots) sur les cailloux d’Algérie et les ombres du soleil que la description scrupuleuse et exhaustive d’un paysage.
AP- Mais, avec la phrase de Camus que tu viens de citer, on est vraiment dans la littérature. Cela veut-il donc dire qu’il n’y a pas de différence entre littérature et philosophie ?
RE– Camus n’est jamais si philosophe que quand il écrit L’Étranger où se trouve cette phrase… Quand on se donne le singulier pour objet d’étude et d’investigation, on finit inévitablement par sacrifier le concept à l’étal d’une sensation. Mais ça ne revient pas fatalement à remplacer la philosophie par la littérature, car la philosophie n’est pas seulement hypothético-déductive, et la littérature n’est pas uniquement tournée vers le récit. Comme l’idée même de singularité (c’est-à-dire de bizarrerie et d’unicité à la fois) naît du sentiment paradoxal d’appartenir au monde qu’il faut pourtant réussir à rencontrer, l’espèce de sensation qu’on traque en travaillant sur le singulier n’a rien à voir avec la subjectivité fade de celui qui aime ou qui n’aime pas quelque chose, mais avec l’expérience éternelle que l’on peut faire en abritant, sans la dénaturer, une émotion, un réflexe, une altérité, quelque chose qui ne vient pas de soi (peu importe que cet autre soit Dieu, comme c’est le cas chez Pascal, ou plus modestement, le tintement d’une sonnette, comme c’est le cas dans La Recherche). « Les affections de mon corps, dit Spinoza, me renseignent davantage sur l’état de mon corps, que sur la nature du corps qui m’affecte » : savoir cela, paradoxalement, invite à ne pas être dupe des préjugés qu’on interpose entre le monde et soi-même. Car c’est en prenant la mesure de ce qui vient de moi que j’ai une chance de penser loin de moi. C’est en admettant que le monde n’existe, en un sens, qu’au titre des impressions qu’il dépose en moi, que j’ai une chance de regarder le monde en lui-même, sans moi, comme si je le voyais pour la première fois et que son spectacle n’était pas filtré par mes besoins. Personne ne décrit mieux la métamorphose du monde sous l’effet d’un regard soustrait à l’ego que Jean-Paul Sartre, dans La Nausée, qui raconte (ce sont ses mots) « la nature sans les hommes ». Personne ne suggère mieux que Spinoza – dans l’appendice de la Première Partie de l’Éthique – de séparer le réel des besoins qui me hantent, de prendre la réalité pour son désir et non plus l’inverse. La Nausée est, à cet égard, un grand livre de philosophie. L’Éthique est, à cet égard, un poème sublime.
Radio et télévision dans le miroir de l’écriture
AP- Si on continue sur la question du style, pourrais-tu nous parler de l’influence de ton travail à la radio et à la télévision sur ta manière d’écrire des textes philosophiques ? On sait, en effet, que tes émissions sont en partie écrites et que parfois textes et émissions communiquent. Prenons l’exemple du début de ton texte sur l’humour : « Le dandy qui veut bien mourir en duel mais refuse de se lever tôt, le naufragé ravi d’apprendre que son compagnon de radeau est végétarien, le grand distrait qui dit “pardon, monsieur” à un poteau, le gamin qui refuse de faire ses devoirs le jour où il découvre que l’univers en expansion menace à terme l’équilibre de Brooklyn, le petit homme qui – à contre-courant d’une foule pleine de slogans – brandit un panneau avec inscrit dessus “j’ai mal au dos” font tous, à leur manière, de l’humour la forme par excellence de l’insoumission, le pied de nez d’une souris à un éléphant. “Non seulement Dieu n’existe pas, dit Woody Allen, mais encore, essayez de trouver un plombier le week-end.” On ne badine pas avec l’humour qui, d’une pirouette, transforme l’égoïsme en roi de comédie, remise l’immense au magasin des accessoires et fait, en retour, à l’infime une place de choix » (p. 51-52). Si je prends ton émission d’Arte sur le thème de l’humour avec Robert Ziegler (19 mars 2011), je remarque en effet que l’amorce de ton introduction est à peu près similaire dans le choix des exemples et dans ce qu’on appelle scolairement la « problématisation » (avec l’opposition entre infime et infini). L’écriture communique donc ici avec l’image… En quoi radio, télévision et écriture s’entre-influencent-ils ?
RE– Tu as absolument raison. C’est le même texte. Mais ce n’est pas seulement de la paresse de ma part. L’idée de départ du texte (l’humour comme bras d’honneur que l’infime adresse à l’infini) m’est venue pendant une émission que j’enregistrais avec Daniel Sibony et Benoît Peteers sur l’humour chez Tintin. L’idée du texte sur l’humour est donc un effet émergent de la discussion improvisée que j’ai eue à la radio sur le sujet, et elle a donné, à son tour, son début à l’émission de télévision. C’est dire que, pour l’instant, si les démarches se nourrissent les unes des autres, la télévision se trouve en bas de la chaîne alimentaire. Il y a pourtant, je crois, une différence de nature entre le fait d’écrire et celui d’enseigner (dans les media comme en classe). L’enseignement, la transmission d’un savoir ou d’une méthode, repose sur l’utilisation de mots qui ont le même sens pour tous. On ne transmet que du dicible – ou alors du désir, dans le meilleur des cas, par l’exemple de sa propre passion. Écrire est, en revanche, un plaisir solitaire. Avec des mots qui n’appartiennent qu’à soi, dont l’agencement relève d’une intime conviction et non du souci d’un lecteur. On enseigne aux autres, on écrit pour soi. Il y a, à cet égard, entre les deux, l’abîme qui sépare un sacerdoce d’une liberté. Néanmoins, il arrive, quand on fait cours, ou au cours d’une discussion, que les pensées acquièrent une célérité que la plume ne peut pas suivre, une acuité que l’intelligence ne peut pas saisir. C’est l’effet de l’improvisation, qui est une sorte d’effet-cause, l’expérience d’être simultanément dans la nature naturée (le monde et ses effets, son savoir, les feuilles mortes qu’il met à ma disposition) et la nature naturante (le monde comme source vive, dont l’intime connaissance dépend de la suppression du moi). Pour improviser, pour aller au hasard, il faut connaître son sujet au point d’en éprouver la nécessité, de se sentir porté par lui, invité à divaguer sans perdre la tête. L’improvisation est une rêverie, la rêverie la plus active, à côté de laquelle l’écriture est une lettre morte. De là l’envie (ou plutôt la curiosité) de retranscrire et de publier certaines séries des « Nouveaux Chemins ». De là également le souci que nous mettons, nos invités, Adèle Van Reeth et moi, à retravailler le texte des entretiens pour leur maintenir un caractère oral qui, bizarrement, s’estompe quand leur restitution (dans les premières épreuves du manuscrit) est trop fidèle.
AP- Justement, peux-tu expliquer la manière dont tu travailles car certaines personnes pourraient s’imaginer qu’il y a juste à se poser derrière un micro et à parler. C’est un peu plus compliqué que cela…
RE– Ceux qui l’imaginent se trompent sans avoir tort. Chaque émission est une fin en soi, qui demande de connaître suffisamment les livres en question pour se référer dans l’instant à la page que mentionnent les invités, d’enregistrer à l’avance des textes qui seront diffusés au hasard de la discussion, de construire a priori quelques enchaînements textes/musique /archives /question. Mais, en fait, l’émission est une longue phrase qui s’écrit dans l’instant, à l’improvisade, et pour laquelle j’ai sous la main, comme autant de signes de ponctuation, une vingtaine d’éléments susceptibles d’être envoyés à tout instant selon les signes que j’adresse, à travers la vitre, à mes deux réalisateurs bien-aimés, François Caunac et Mydia Portis-Guérin. Quand l’émission commence, je dispose d’un très (mais jamais trop) long conducteur qui est comme un tableau de bord, dont l’utilisation varie selon ce qui se dit. Il est vrai que le travail liminaire, considérable et collectif, que nous abattons en amont s’estompe, d’une certaine manière, au moment de la discussion elle-même dont il faut garder à l’esprit que l’essentiel est d’être à la fois intelligible et précise. Je dis toujours à mes invités, en leur donnant à l’avance la première question que je poserai, que j’ignore, au-delà de cette question, où la conversation est susceptible de nous conduire. A tel point que j’ai parfois un peu l’impression de travailler comme votent les Corses dans Astérix en Corse (« On bourre les urnes, on les jette à la mer et c’est le plus fort qui gagne ») ! Mais c’est une illusion. En réalité, sans le travail énorme que fournit l’équipe des « Nouveaux Chemins », je ne pourrais pas improviser comme je le fais. La part incompressible d’imprévu, de nouveauté, de maïeutique, d’inattendu qu’il m’appartient, dans le temps de l’émission, de faire surgir, repose à la fois sur le sentiment d’être prêt et sur la liberté donnée par les pistes que nous avons explorées avant de prendre le micro. Quand on part du principe qu’aucune prédiction, aucun plan préétabli, n’a l’acuité de l’intuition qui jaillit dans l’instant, tenter de prévoir le maximum de choses n’est pas un handicap au fait d’improviser, au contraire. De même qu’on ne se prépare pas à mourir mais qu’il est indispensable de penser la mort pour ne pas perdre la vie à essayer d’oublier qu’elle s’achève, on ne se prépare pas à improviser, sinon en acquérant suffisamment de connaissances et d’outils pour avancer à tâtons sans craindre de trébucher, ou pire : de sentir à l’antenne que le soufflet retombe. Je suis trois fois aidé dans la démarche de l’improvisateur : par le travail de mon équipe, par le fait que les émissions soient le plus souvent en direct (trois émissions sur cinq sont en direct, et les autres sont enregistrées dans les conditions du direct), et par la nature de la philosophie elle-même. Un problème en philosophie étant insoluble, il est toujours vivant : chaque paradoxe en appelle un autre, toute question est grosse des questions qu’elle résume et porte en elle, la moindre difficulté est, quand on la déplie, quand on la déploie, une matière toujours vive et infinie. L’émission de télévision – où, à la différence de la radio, je sais à l’avance l’ordre des images qui vont se succéder – relève également d’une construction immanente (d’ailleurs, il n’y a qu’une seule prise et une seule caméra, le temps y est irréversible, aucun montage ne peut effacer une ânerie). J’aime à penser que l’édifice d’une émission se construit dans l’instant, comme la forme et la couleur d’une flamme varient selon qu’elle consume du charbon, du papier ou du bois. Les discussions à la radio ou à la télévision auraient été différentes si je les avais eues un autre jour, tout en obéissant toujours à la liberté sans choix de l’improvisateur à qui une bonne maîtrise de son sujet permet d’être fidèle sans être soumis à ce qu’il raconte.
AP- Quelle est l’influence de la radio et de la télévision sur ta pensée et tes textes ?
RE– C’est l’influence du corps sur l’esprit, pour le meilleur ou le pire… Certaines semaines changent ma vie et ma façon de (sa)voir, d’autres m’épuisent sans que j’en retire le moindre plaisir. Ça dépend du sujet comme de mon humeur. Certaines émissions me donnent l’occasion de mettre des phrases et des pages sur des intuitions endormies. D’autres ont pour seul effet d’ajouter, comme des sédiments inutiles, un paquet de savoir sans saveur dont je ne sais que faire ensuite. Bref, les émissions sont tantôt nourricières, tantôt (plus rarement) indigestes.
AP- Oui, c’est un peu comme si tu repassais l’ENS ou l’agrégation chaque semaine avec un nouveau programme à chaque fois !
RE– Oui. Comme si je prenais ma revanche sur les épreuves qui me terrifiaient quand j’étais plus jeune, comme on met la main dans la cage de verre d’un serpent domestique. Je prends toujours des risques avec bonheur. Est-ce le syndrome de l’éternel khâgneux ou agrégatif désœuvré quand il n’est pas en concours ? Il y a en moi, enfoui, un jeune homme qui se représente toujours ces épreuves (tout comme le bac, d’ailleurs) comme une montagne à gravir, et qui se voit, à chaque fois, surpris d’y parvenir, comme s’il y parvenait pour la première fois. La grande différence, tout de même, c’est qu’avec les nouveaux chemins, la méthode que j’emploie repose d’abord sur le goût et le désir de ne pas savoir où l’on va.
AP- Cela voudrait-il donc dire que « Les Nouveaux Chemins de la connaissance » ne mènent… nulle part ?
RE– Pas exactement. L’idée de l’émission de radio m’est venue de son titre, d’abord (les « Chemins de la connaissance » existent sur France Culture depuis 1973, je crois), mais aussi de deux citations de René Char : « Un poète doit laisser des traces et non des preuves » (je cite de mémoire), et « Les routes qui ne promettent pas le chemin de leur destination sont les routes aimées. » Où qu’ils aillent, les chemins se rendent quelque part. Il est impossible d’aller nulle part, comme il est impossible de marcher n’importe comment, puisque toute existence est une détermination. En revanche, les chemins veulent être toujours « nouveaux », même et surtout quand ils arpentent des textes classiques ou bien archi-connus. La « nouveauté » signifie tout simplement que l’émission repose à chaque fois sur une interaction unique avec un interlocuteur unique pour un moment qui, lui-même, n’est pas reproductible, ce que Bergson appelle la « création continue d’imprévisible nouveauté ». Plus j’y réfléchis, plus je me dis que l’expérience du direct est fondamentale à ce titre, car il met l’animateur et l’invité sur un trapèze sans filet. C’est vertigineux. Au début, j’éprouvais à chaque émission la tentation (salutaire quand on la contrarie) de penser à autre chose, d’oublier la discussion, de me mettre soudain à dire n’importe quoi, comme on se met tout nu sur la table (ce qui, même à la radio, pourrait s’entendre). Difficile liberté, dont on devient l’esclave quand on cède à ses charmes… Depuis deux ans, néanmoins, il se passe quelque chose d’intéressant : à la seconde où la lumière s’allume, où la table devenue rouge indique que nous sommes à l’antenne, tout stress disparaît, la peur s’estompe, le calme se fait en moi. Le direct (ou l’immédiat) est paradoxalement devenu mon écosystème.
AP- Je pense aussi à la saison 2006-2007 sur France Culture où, bizarrement, tu n’avais plus d’émissions de philosophie mais où on t’avait mis à animer le « Rendez-vous des politiques ». Ça m’avait paru un peu bizarre à l’époque, moi qui étais un ancien auditeur régulier de « Commentaires » que j’écoutais tous les quinze jours le vendredi matin dans le cadre des « Vendredis de la philosophie » (entre 2003 et 2006). Soudain, je t’ai vu passer de Kant à Bayrou… Ce n’était pas exactement le même registre. Tu n’es pas du tout journaliste politique de formation, non ? Alors, comment t’es-tu retrouvé à animer cette émission ?
RE– C’est une demande de David Kessler, alors directeur de France Culture. J’ai accepté, d’abord, parce que les désirs de David sont des ordres pour tous ceux qui ont la chance de travailler avec lui (les salariés des Inrocks vont bientôt découvrir leur bonne fortune, je suis content pour eux). Ensuite, parce que j’étais heureux, l’année des élections présidentielles, de distiller un peu de philosophie dans le débat public. Enfin, c’était une hebdomadaire (les « Vendredis de la philosophie » que j’animais avant et qui me demandaient un énorme travail de montage n’étaient que bimensuels), ce qui multipliait mon « salaire » par deux. Et puis ce n’était pas absurde, dans la mesure où (David le savait) j’avais moi-même fait beaucoup de politique entre avril 2002 et fin 2004, au PS, où j’étais chargé, par Laurent Fabius, de lui fournir des arguments contre la gauche du parti (Emmanuelli et Mélenchon étaient ses deux bêtes noires à l’époque). J’ai longtemps eu le goût des feuilletons de la politique politicienne, des grands discours, des petites phrases, des stratégies électorales, des croche-pieds et des polémiques en carton-pâte dont la durée de vie n’excède jamais un tour de cadran. De ce point de vue, j’étais comblé avec le Parti Socialiste, qui est une sorte de haras composé d’écuries dont les poulains se disaient tous (à juste titre) qu’avec la catastrophe du 21 avril 2002, le candidat de la gauche bénéficierait en 2007 du vote utile, serait mathématiquement présent au second tour et probablement désigné par les militants eux-mêmes qu’il importait donc de flatter à tout prix, au prix notamment de toute conviction (comme c’était le cas avec Laurent Fabius au moment du référendum de 2005 sur le TCE) 2 Animer « Le Rendez-vous des politiques » pendant un an m’a permis d’expurger ce goût tenace pour les calculs mesquins et la comédie du pouvoir. Enfin, la préparation des émissions de politique me demandait infiniment moins de temps que le travail nécessaire aux « Vendredis de la philosophie » (qui étaient pourtant deux fois moins nombreux) ; ça m’a permis d’écrire mon premier livre. L’inconvénient, c’était le service de presse. Au lieu de recevoir la dernière édition des Essais de Montaigne, je recevais Mon Paris gagnant de Françoise de Panafieu, ou bien la biographie romancée de Christine Boutin…
AP- Mais alors, justement, toi qui as été intervieweur politique pendant un an avant de revenir à des émissions philosophiques, en quoi les deux techniques d’entretien diffèrent-elles ? En quoi est-ce différent d’interviewer un homme politique et un intellectuel ?
RE– C’est très différent, dans la mesure où la qualité d’un entretien avec un homme politique repose sur l’aptitude à le coincer, à le prendre en défaut, à lui faire cracher qu’il s’est contredit, tandis qu’une discussion avec un professeur de philosophie consiste en une construction commune où, si désaccord il y a, nous sommes lui et moi tout à fait d’accord pour ne pas nous entendre et communément soucieux d’aboutir à un terrain d’entente. J’ajoute qu’en politique, où chacun se donne l’air de parler selon la raison, le but est, en premier lieu, d’avoir raison de l’autre. Alors qu’il arrive en philosophie (même si ce n’est pas toujours le cas) que la mauvaise foi et le dialogue de sourds qu’elle implique disparaissent sous l’effet de l’attention loyale et réciproque qu’on porte à un autre discours que le sien. Les politiques sont souvent des sophistes (et pour cause) qui confondent le droit d’avoir une conviction avec le devoir de la défendre coûte que coûte. Le dogmatisme est immanquablement au bout de la route – ce dont il faut se réjouir, paradoxalement, car c’est aussi la preuve qu’on se trouve en démocratie, c’est-à-dire sous l’œil des électeurs. Un politique n’est pas là pour débattre ni pour changer d’avis, mais pour dérouler la vision du monde que les membres de sa corporation électorale attendent de lui. Les rares fois où il a été possible de débattre un peu dans cette émission politique, c’était quand l’invité, s’étant lui-même éloigné des jeux et des enjeux du pouvoir, se permettait, par conséquent, de penser contre lui-même. Ce qui est frappant avec certains hommes politiques, ce n’est ni leur rigidité, ni leur inculture (qui n’est pas si répandue qu’on le dit), mais leur souplesse. Ce sont des contorsionnistes qui préfèrent se mettre un pied derrière la tête plutôt que de revenir sur une certitude. Une fois qu’on renonce à leur faire envisager une autre logique que celle qu’ils défendent, le spectacle est aussi passionnant, sinon divertissant, qu’un numéro de cirque.
AP- Cela veut donc dire que cette expérience d’émission politique ne t’a rien apporté ?
RE– Au contraire. Ça m’a permis de vérifier que je n’étais pas doué pour l’exercice et probablement inapte, le cas échéant, à briguer moi-même les suffrages des électeurs. Ce n’est pas rien ! Et puis, encore une fois, tant de souplesse pour tant de rigidité, tant de compromis pour tant de vœux pieux, c’est vraiment intéressant. Je ne voudrais pas que mes propos soient pris en mauvaise part. Je ne juge personne ici. Je constate seulement que la politique expose, par définition, à la tentation de modeler son discours sur ceux dont on espère qu’ils vous donnent le pouvoir, à être l’esclave de ceux qu’on voudrait gouverner. Je me réjouis tous les jours de vivre en démocratie, ce qui n’empêche pas d’en critiquer les inconvénients, le triomphe de l’opinion publique, le nivellement par le bas, le goût de l’unanimité (qu’on tient à tort pour une expression du consensus), la démagogie, enfin, des tribuns de la plèbe qui font passer leurs mauvaises manières pour un signe de franchise… Enfin, on peut faire de la politique sans militer. En ce qui me concerne, je n’ai jamais signé de pétition sans le regretter aussitôt. « Les Nouveaux chemins de la connaissance » enchaînent parfois les semaines qui se contredisent, comme on l’avait fait avec Marx et le libéralisme. C’est la façon que nous avons trouvée d’être sinon univoques, du moins utiles, et plus en phase avec le présent qu’avec l’actualité.
Métamorphoses du chroniqueur
AP- Pourrais-tu nous parler de l’évolution de ta chronique dans Philosophie magazine ? Depuis le début, elle s’intitulait « Sens et vie » et les textes présentés dans cette chronique sont à l’origine de ton dernier livre et du précédent. Depuis février 2011, l’intitulé est « Le Chant des signes ». Tu te livres à une sorte d’analyse des objets et des mythes contemporains comme le faisait Barthes dans ses Mythologies. Tu as ainsi écrit un texte sur la solution hydroalcoolique pour se laver les mains (février 2011), une autre sur le phénomène du « buzz » (mars 2011) avant de réfléchir sur la « baguette tradition » (avril 2011). Dans quel esprit conçois-tu ce nouvel intitulé « Le chant des signes » ?
RE– À l’origine de ce changement d’intitulé et de ce nouveau chantier se trouve effectivement la découverte de Mythologies de Roland Barthes. Plus je lis ce livre, plus je suis émerveillé par le soin qu’il met à décrire des objets ordinaires, l’attention qu’il porte aux phénomènes de société, le goût de s’interroger non pas sur la chose elle-même, mais sur le besoin qu’on en a, et le sens que lui donne un tel besoin. Le mythologue est aussi un généalogiste, au sens nietzschéen du terme, qui remplace le jugement sur la chose même par l’examen des motifs qui la rendent soudain indispensable ou populaire. Et puis Barthes est drôle, tendre et généreux. Même quand il attaque, il donne à aimer ce qu’il combat. Armé de ces deux règles (d’une part, s’intéresser non pas aux choses, mais au besoin qui les suscite ; d’autre part, ne jamais oublier d’aimer même ce qu’on déteste), j’ai voulu m’inscrire dans le sillage de Barthes, remplacer l’écume par le présent, exhumer de la consistance sous les objets du quotidien, réfléchir enfin aux problèmes implicites qu’ils posent : en quoi les savons sans eau dont on se lave les mains à tout bout de champ témoignent-ils de la main mise de l’hygiénisme sur nos comportements ? Comment se fait-il que les boulangers répandent de la farine sur la baguette de tradition française après sa cuisson ? Comment comprendre le fait qu’avec le GPS, l’acquisition de l’autonomie passe par l’allégeance à la voix d’un robot ? Comment France Info s’y prend-elle pour donner à son auditeur l’illusion d’écouter les infos quand il veut (« C’est toujours l’heure des infos »), tout en lui montrant, par un rythme haletant, qu’il est pris par le temps ?
AP- Oui, France Info, c’est « une édition incomplète toutes les sept minutes », comme le dit un sketch célèbre des Inconnus sur les radios… !
RE– Eh oui, avec France Info, on n’a jamais le temps ! À cet égard, la naissance d’Info en 1987 a été la première étape vers la constitution du village global qui, après que le temps nous a fait défaut, nous expose à n’avoir plus nulle part où aller.
AP- En tous cas, il ne s’agit pas de jouer « le philosophe de service » et de donner le « point de vue du philosophe » sur France Info.
RE– J’espère que non. Le « point de vue du philosophe » est indifférent à ce dont il parle. En ce qui me concerne, j’adore les objets que je décris. Mes émissions reposent sur le goût de ne pas savoir où l’on va ; ces textes-là reposent sur le goût d’être surpris par tout ce dont l’utilité dispense ordinairement de questionner la forme, la nature et les processus de fabrication. La question de la dignité ou de l’indignité des objets que la philosophie se donne est, je crois, une fausse question. La philosophie ne s’occupe que du réel, qu’il prenne la forme d’un concept, d’une chose, d’une rumeur ou d’un dogme. Il n’y a pas d’objets intrinsèquement philosophiques (sinon le réel ne serait pas axiologiquement neutre, mais porterait en lui, comme une signature intime, les valeurs de Bien, de Mal, d’inintéressant, de philosophique, etc.), il n’y a que des manières philosophiques d’appréhender un objet. Ce n’est pas parce qu’un objet est pensable qu’on s’interroge à son sujet. C’est parce qu’on s’interroge à son sujet qu’un objet devient pensable.
AP- Tu est également chroniqueur à titre occasionnel pour l’hebdomadaire L’Express dans sa nouvelle formule. La première chronique porte sur l’indignation, s’intitule « L’indignation est le prolongement naturel de l’égoïsme » et constitue une sorte de réponse à Stéphane Hessel 3; Comment conçois-tu cette chronique ? Comme une occasion de faire de la philosophie à partir de l’actualité ?
RE– Le texte que tu cites n’est pas une réponse à Stéphane Hessel, dont je n’ai pas lu le livre (en fait, j’ai commencé, mais je ne suis pas allé jusqu’au bout), mais un hommage implicite aux « Cinq petites pièces morales » qui terminent le Démon de la tautologie de Clément Rosset. Dans ces pages (qui ont vingt ans), Rosset montre que l’indignation est inextinguible, puisqu’elle s’appuie sur la possibilité permanente d’être déçu par le monde qui, par définition, ne répond pas à nos attentes. Il désigne également l’indignation comme une stratégie d’esquive, une façon de camoufler l’objet qui nous indigne en s’interdisant de le penser. « La disqualification pour raisons d’ordre moral, écrit-il, permet ainsi d’éviter tout effort d’intelligence de l’objet disqualifié, en sorte qu’un jugement moral traduit toujours un refus de penser – ce qui fait du moralisme en général moins l’effet d’un sentiment exalté du bien et du mal de celui d’une simple paresse intellectuelle. » C’est quand même plus intéressant que les chiffres de vente de Stéphane Hessel. Bref, ne le dites pas à Christophe Barbier, mais si j’ai l’air, dans L’Express, de m’occuper de l’actualité, en réalité, c’est une couverture.
L’enfant est le père de l’homme
AP- Dernière question : retournons au livre Le Philosophe de service et, plus précisément à sa dédicace. Tu dédies, en effet, ton ouvrage à tes deux fils Aurélien et Sacha. Peux-tu nous dire ce que permet de penser philosophiquement l’expérience de la paternité ?
RE– L’expérience de la paternité m’a appris que si transmission il y a, elle s’opère du fils au père, plus encore que du père au fils ; je dois à mes enfants de vérifier les vertus d’une « façon virginale de voir, d’entendre et de penser ». L’expression est de Bergson qui, partant de cette intuition, en vient à inverser les termes de la liberté : au lieu que, comme on le croit ordinairement, la délibération précède la décision qui précède l’action, Bergson montre qu’en réalité, l’action est première, la décision vient ensuite et la délibération ratifie, ultimement, une décision qui, feignant d’organiser ce qui lui échappe, courait après le geste premier. C’est particulièrement frappant quand on songe au Cid, par exemple, dont Clément Rosset (qui veut ici illustrer la thèse de Spinoza selon laquelle le libre-arbitre est une illusion) montre qu’il n’hésite pas une seconde entre l’amour et l’honneur. Le problème de Rodrigue n’est pas de savoir s’il va « choisir » l’amour ou l’honneur. Le problème de Rodrigue est de se rendre digeste à lui-même le fait qu’il a, par définition, d’emblée choisi l’honneur, et qu’il va donc perdre l’amour de Chimène. Les stances du Cid ne sont qu’une comédie inconsciente que Rodrigue se joue à lui-même pour donner à sa décision l’alibi rétrospectif d’avoir pesé le « pour » et le « contre », mais personne n’est dupe. Pour ma part, j’ajouterais que l’action précède la décision comme l’enfance précède l’âge adulte. Mais si la transmission s’opère dans ce sens-là, si l’enfant est le père de l’homme, alors je suis à la fois le fils de mon fils et le père de mon père, ce qui fait de moi-même mon propre arrière-arrière-grand-père !
AP- L’enfance, c’est donc une manière, en un sens, de remettre le monde à l’endroit ?
RE– Exactement. Il suffit, pour cela, de regarder le monde avant de le préjuger, de prendre non pas ses désirs pour des réalités mais la réalité pour son désir. L’enfance est la source vive de la pensée. Pratiquer la philosophie, c’est faire durer l’enfance, malgré les conventions, les bonnes manières et la nécessité du quotidien.
AP- L’enfant ou l’enfance dont tu parles au sens philosophique, ce serait donc plutôt l’enfance de la troisième métamorphose de l’esprit au début du Zarathoustra de Nietzsche : « L’enfant est innocence et oubli, un recommencement, un jeu, une roue roulant d’elle-même, un premier mouvement, un “oui” sacré 4. »
RE– C’est exactement ça. A chaque fois que je lis ce texte, j’en ai le sourire aux yeux.
Bibliographie sélective de Raphaël Enthoven
Œuvres
Un jeu d’enfant – La Philosophie, Fayard, 2007. Rééd. Pocket, 2009.
L’Endroit du décor, Gallimard, « L’Infini », 2009.
Le Philosophe de service et autres textes, Gallimard, « L’Infini », 2011.
Ouvrages d’entretiens
Les éditions Fayard éditent depuis 2009, en partenariat avec France Culture, des ouvrages d’entretiens issus de l’émission « Les Nouveaux Chemins de la connaissance ». Ont été publiés à ce jour L’Absurde, La Création, Le Visage, Barthes, Kant, Pascal et, dernier volume paru, Lectures de Proust.
- Voir à ce sujet ici-même l’article de François-Xavier Ajavon du 18 mars 2009: « Comment Raphaël Enthoven a réinventé l’émission de philosophie » https://www.actu-philosophia.com/spip.php?article101.
- Voir sur ce point Un Jeu d’enfant – La Philosophie (2007), Pocket, 2009, p. 134-136.
- L’Express , n°3116, Semaine du 23 au 29 mars 2011, p. 112.
- Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, trad. Goldschmidt, LGF, « Le Livre de Poche », 1983, p. 41.








