AP : Après l’architecture et le droit, place désormais au travail ! Et autant les deux premiers axes font partie de vos préoccupations depuis plusieurs années voire décennies, autant le dernier fait son apparition (à moins que je ne me trompe…) dans votre dernier ouvrage. Et c’est bien logique si l’on s’avise que le sous-titre de Durer n’est autre que : Éléments pour la transformation du système productif. Vous abordez plus particulièrement le travail sous le prisme inattendu de la « maintenance » : là où l’on tend à associer le travail à l’optimisation, à la création de valeur et à la performance, c’est-à-dire à l’univers de la production, vous faites de la maintenance sa vocation, vocation qui devient d’autant plus nécessaire d’assumer à mesure que les technologies déployées se complexifient. Qu’est-ce que la maintenance ? À cette question, vous répondez :
« La maintenance représente la part néguentropique du travail » (Durer, page 164).
Pourriez-vous expliciter le contenu de cette formule ramassée ? Et quelles conséquences tirez-vous de cette définition quant à votre analyse des différents secteurs de l’économie (primaire, secondaire, tertiaire) ?
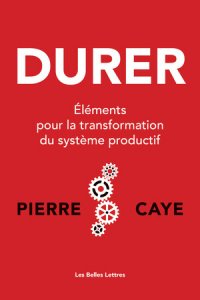
PC : Le monde est fragile : il a besoin d’être maintenu. La maintenance, autrement dit entretenir, réparer, recycler, restaurer, prendre soin, est le fondement de tout système productif aujourd’hui comme hier. Il n’est aucun secteur qui puisse en faire l’économie. Il concerne au premier chef, les infrastructures industrielles, les réseaux viaires, mais aussi les réseaux énergétiques, en particulier les centrales nucléaires qui posent des problèmes d’entretien redoutables de même que toutes les activités de l’industrie chimique classées Seveso. La presse nous alerte à maintes reprises sur les difficultés que notre organisation économique et technologique a à assumer ce genre de responsabilité qui se traduit souvent par des pannes géantes ou par des accidents industriels causes de nombreux morts et de pollution aggravée. Même les activités les plus innovantes, celles qui semblent reposer sur un renouvellement incessant de leurs produits ou de leurs services, comme les nouvelles technologies de l’information et de la communication, réclament un effort important de maintenance. 60% des dépenses dans ce secteur d’activité y sont en réalité consacrées. Car l’utilisation des systèmes informatiques contemporains est, à bien des égards, le résultat d’une réparation et d’un entretien continus. Le logiciel est une industrie de l’éphémère à laquelle la maintenance donne sa consistance et sa durée. Ce seul exemple, tiré des industries les plus récentes et surtout les plus immatérielles, exemple assurément paradoxal et contre-intuitif, manifeste assez le caractère idéologique des discours sur la puissance de la destruction créatrice ou sur la nécessité de la disruption, qui au demeurant ont de moins en moins prise sur la société à la recherche, comme l’épidémie le montre assez, d’une protection et de certitudes de moins en moins assurées. La transformation du système productif vers un développement plus durable est une affaire de maintenance bien plus que d’innovation, ou plus exactement d’innovation au service de la maintenance. La conversion agricole que je considère prioritaire, tout simplement parce que nous avons en main aujourd’hui tous les instruments à la fois financiers, scientifiques et techniques pour l’accomplir dans les meilleures conditions, est essentiellement une affaire de maintenance, en l’occurrence de protection des paysages ainsi que de restauration des sols et de leur force végétative.
La maintenance est étroitement liée au patrimoine comme le montre l’exemple de la terre qu’il importe de transmettre aux générations futures en évitant son épuisement. A partir du moment où il s’agit de transmettre les biens plutôt que de les échanger, il faut veiller à les ménager pour mieux les inscrire dans le long terme.
Hier, il fallait maintenir pour pallier la pénurie, le manque de produits par rapport aux besoins de la société ; aujourd’hui, nous devons maintenir, pour surmonter l’entropie qu’engendre au sein de notre système productif sa complexité. Cette situation a un impact considérable sur le statut du travail, et nous conduit à sortir de la fausse opposition où l’enferment les débats actuels à son sujet. Les uns considèrent que la robotisation des activités permettra plus de temps libre pour le travailleur, les autres qu’elle favorisera l’émergence de nouveaux besoins et partant de nouvelles activités productives propices au plein emploi. A mes yeux, la robotisation va rendre le système productif à la fois plus complexe et plus fragile ce qui conduit à multiplier les tâches de maintenance de sorte que chaque acte productif soit redoublé par un acte d’entretien, de réparation, voire de prévention pour limiter l’évolution entropique de la production. Reste la question, fondamentale pour la justice sociale, de rémunérer justement ces activités de maintenance, de protection et de conservation jusqu’à présent méprisées et invisibilisées. C’est toute l’histoire de la condition féminine qui ressort ici en filigrane. Le travail est devenu une question plus de responsabilité que de liberté au contraire du discours idéaliste. Il est plus important de prendre soin des choses que de se représenter soi-même dans les objets de sa production comme dans un miroir. Mais sans doute ce narcissisme explique pourquoi ce qui n’est pas de l’ordre de l’auto-représentation de l’homme reste invisible. La notion de maintenance dépasse la seule dimension de la régulation productive, pour concerner l’ensemble du système reproductif : santé, éducation, justice ; il s’agit de conserver la vie, de transmettre le savoir, de maintenir l’ordre social. La destruction créatrice repose sur une grossière illusion, à savoir que la production assure, par sa dynamique même, les conditions de sa reproduction, comme si l’augmentation du trafic routier consolidait et renforçait par elle-même les ponts, où comme si l’industrialisation des exploitations agricole enrichissait les sols et les rendait plus fertiles, bref comme si la production était par elle-même néguentropique. Il n’en est rien comme en témoignent les problèmes écologiques de plus en plus aigus que rencontre notre système productif. Il y a une logique parfaitement autonome de la reproduction que la production contemporaine a tendance à négliger et à affaiblir. Or, les conditions de la production ne sont pas les mêmes que ceux de la reproduction. Il n’y a pas de cercle vertueux entre les deux dimensions nécessaires et dialectiques de tout système productif qui se veut durable. Au contraire de la Théorie de la croissance endogène, la recherche scientifique par exemple dépend moins des lois du marché que de celles de l’esprit. Le développement ne pourra se perpétuer que s’il prend toute la mesure de la maintenance et de ses techniques de préservation, c’est-à-dire s’il se transforme dans son rapport même à la production et à ses conditions.
AP : Durer s’attaque à la problématique du développement durable. L’enjeu est en fin de compte de savoir lequel des deux mots qui constituent cette expression se voit accorder le primat sur l’autre. Dans les conditions actuelles, celles de la mobilisation totale, la durée se trouve mis au service du développement, de la destruction créatrice, de telle sorte que la durabilité en question n’est pas celle du monde mais vise bien plutôt la reproduction continuelle du système productif actuel. De votre côté, vous vous attachez à déterminer les conditions d’un modèle de développement qui serve la durée, et dont l’architecture, le droit et le travail, comme formes fondamentales de la tenue, constituent les piliers. Reste alors à interroger, et c’est l’objet du dernier chapitre de votre ouvrage intitulé « Gouvernance et souveraineté », la dimension politique de ce projet. Pourquoi la gouvernance, terme que l’on utilise pour désigner la direction de n’importe quelle organisation, ne serait-elle pas en mesure d’accoucher d’un développement réellement durable ? Et quelle alternative proposer face à ce modèle dominant mais défaillant ? La souveraineté moderne, celle liée à l’avènement puis à l’hégémonie des États-nations, semble irrémédiablement appartenir à un passé révolu, mais peut-elle faire son retour sous d’autres formes, peut-elle, en quelque sorte, se réincarner ?
Pierre Caye : Je ne crois pas que les vieux modèles de la souveraineté étatique appartiennent à un passé révolu. Nous assistons au contraire à leur grand retour depuis la crise financière de 2008 : en Chine, en Inde, au Brésil, aux Etats-Unis, et peu importe leur récent changement de président, ou dans la Grande-Bretagne du Brexit, désormais s’affirme une très forte revendication de souveraineté étatique et nationale. Cela ne signifie certes pas la fin de la mondialisation, malgré les fortes tensions sur le régime de libre-échange qu’engendre ce retour, mais celle-ci change de nature. La crise de 2008 a marqué la fin de la « mondialisation heureuse », pour une mondialisation beaucoup plus dure, reposant non plus sur le multilatéralisme mais sur une diplomatie bilatérale plus conflictuelle. Ce retour du souverainisme politique s’accompagne en même temps d’un affaiblissement du souci écologique comme en témoigne la présidence Bolsonaro au Brésil ou Trump aux États-Unis. La puissance des nations dépend plus que jamais de leur croissance économique, au prix le plus souvent de l’abandon de toute ambition environnementale.
Il est vrai que l’Europe, ou plus exactement la Communauté européenne, représente une exception, puisque les grandes souverainetés historiques qui se sont affrontées au cours des deux guerres mondiales ont disparu, discréditées par leur combat. L’Europe vit désormais dans un régime de post-souveraineté : les Etats nationaux ont confié une grande part de leurs prérogatives à une sorte d’autorité administrative internationale indépendante, la CE, mais celle-ci reste une simple autorité administrative dénuée de toute prérogative de souveraineté. A la souveraineté se substitue la gouvernance. La gouvernance se présente de prime abord comme une évolution heureuse de la démocratie, reposant sur la participation, le partage et la négociation plutôt que sur l’action unilatérale et autoritaire de la puissance publique, selon une approche contractuelle plutôt que réglementaire de l’action administrative : une démocratie fondée sur la communication et la transparence, où l’instance souveraine s’effacerait au profit des interactions entre les hommes que la gouvernance prétend favoriser. Les sociétés occidentales seraient trop complexes pour être commandées ; on ne peut que les réguler, et c’est à quoi s’attachent les nouvelles modalités de l’action politique propres à la gouvernance. En même temps que la CE promeut la gouvernance, elle prétend être aussi à l’avant-garde mondiale de la transformation du système productif vers un développement plus durable comme en témoigne le récent Green New Deal act de 2019. La CE laisse ainsi entendre qu’il existe une complémentarité et une convergence entre le développement durable et la gouvernance : le développement durable formant le but de la gouvernance, la gouvernance la condition du développement durable. Le développement durable serait à l’économie ce que la gouvernance est à la politique : une réappropriation par l’être humain de sa praxis, productive dans un cas, institutionnelle dans l’autre ; ou encore, un désarmement de la volonté de puissance, ici de la croissance pour la croissance, là du pouvoir pour le pouvoir. Voilà en gros quel est le storytelling dominant de la Communauté européenne depuis une génération, son récit de légitimation. Ce récit est trop flatteur. Il me semble de mon côté que la gouvernance est insusceptible de favoriser la transformation dus système productif, parce qu’elle est trop soumise au pouvoir des lobbys en raison même de sa nature transactionnelle, et trop polarisée sur le court terme pour développer le sens du temps nécessaire à la durabilité du développement. Il est en ainsi parce que la gouvernance n’est en réalité que la modalité d’un pouvoir dont la tâche essentielle consiste à réguler quasiment au jour le jour la machine ou dispositif complexe que sont devenues les sociétés contemporaines, machine où les êtres humains sont enrôlés au service de la production, en vue de la mobilisation totale des forces productives. Il faut relire le traité de Lisbonne qui à cet égard est un texte particulièrement éclairant.
Il importe de sortir de cette fausse opposition entre souveraineté et gouvernance qui toutes deux, sous des formes diverses, en fonction de situations politiques différentes, sont au service de la mobilisation totale et du déchaînement des forces productives.
Mais sans doute avons-nous une conception insuffisante de la mondialisation. Nous la concevons de façon essentiellement géographique sous la forme de l’ouverture des frontières et de la contraction spatiale que les moyens de transport et de communication modernes ont favorisée. En tant que telle, fermer les frontières est comme dresser un barrage contre le Pacifique ; mieux encore, la mondialisation apparaît comme la seule échelle adaptée aux défis écologiques qu’on ne peut mesurer et surmonter qu’aux dimensions de la planète. Ici le cosmopolitisme est une ardente obligation. Mais en réalité ce n’est pas cela que nous appelons « mondialisation ». La mondialisation porte mal son nom. Elle ne cherche pas à se mettre au service de la constitution d’un monde commun, ni même à faire monde. Le terme qu’utilisent les Anglo-saxons me semble plus juste : ceux-ci parlent de globalization. Et j’entends par « globalisation » la marchandisation générale des sociétés, c’est-à-dire le fait que chacun de nos actes se trouve soumis aux lois d’un marché global autrement dit un marché qui détermine l’ensemble de nos actions. C’est cela le seul facteur commun de la mondialisation, et en tant que telle la mondialisation est une soumission. Il est essentiel de pouvoir dissocier mondialisation et globalization, pour rendre possible un cosmopolitisme qui ne soit pas tributaire des outils d’indifférenciation généralisée que sont la monnaie et le marché. Cette dissociation que j’appelle de mes vœux renvoie à une nouvelle conception de la souveraineté, étrangère au retour des souverainetés nationales que je viens d’évoquer au début de ma réponse.
Mais qu’est-ce que la souveraineté ? On a l’habitude d’associer souveraineté et domination, la souveraineté étant l’organisation juridique et politique de la domination des hommes sur les hommes. Pourtant, en Europe, si les souverainetés ont disparu, la domination est plus présente que jamais, sous des formes certes renouvelées. La souveraineté en réalité est d’abord de la différence : la différence du politique par rapport au social et à l’économique. De la modalité de la différence dépend la nature de la souveraineté, la façon même d’exercer le pouvoir. Il est vrai que cette différence pendant longtemps a pris la forme des sociétés disciplinaires qui ont imposé leur domination au nom du nécessaire travail d’hominisation et de civilisation des hommes par le pouvoir. C’est la vieille souveraineté, celle que symbolise l’humanisme de la Renaissance aux Lumières, et qui s’est accompagnée en Europe de la naissance des Etats-nations. Je n’y reviens pas.
Mais aujourd’hui la différence politique par rapport à la vie économique et sociale a changé de nature. Elle apparaît non pas comme un facteur de domination, de surplomb du pouvoir sur ses sujets, mais au contraire comme un facteur d’affranchissement des êtres humains par rapport à la mobilisation totale et aux dominations immanentes au marché. Etre souverain c’est être capable de débrayer la mobilisation, de sortir de la machine, de différer avec la gestion court-termiste du politique pour créer le temps long nécessaire au développement durable ; c’est être capable de rentrer en différence avec l’instantanéisme et l’ubiquisme de la mondialisation contemporaine sans en passer par la fermeture des frontières ni par l’appel à quelque identité fantasmée. Ce type de souveraineté est sans domination, c’est-à-dire, selon les termes mêmes qu’utilise Plotin au Traité 39 des Ennéades pour définir la force de l’Un, une souveraineté sans commandement ni commandé, autrement dit une souveraineté sans transcendance au service de la lutte comme les nouvelles formes de domination que le monde contemporain produit sans cesse pour soutenir sa marche.
AP : Pierre Caye, ce long entretien prend hélas fin. Je vous remercie pour votre disponibilité et la clarté de vos réponses qui constituent, je le crois, une excellente introduction à vos travaux. Bien sûr, j’aurais voulu évoquer votre rapport à Heidegger, votre dialogue avec Nietzsche, votre attachement au stoïcisme, vos analyses du pouvoir et de la transmission, le volet éthique de votre pensée, etc., mais la place manque cruellement ! Souhaiteriez-vous néanmoins profiter de ce dernier échange pour préciser tel ou tel point ou alors apporter un éclairage complémentaire ?
PC : A travers Durer, je poursuis ma réflexion, depuis longtemps engagée, sur ce que le temps fait au réel. J’entends le temps comme temporalisation, c’est-dire comme condition de notre être au monde, et je vois le réel à travers la profonde transformation que l’omniprésence de la technique lui impose. A travers cette question, se croise et s’articule une approche à la fois pragmatique (autour du développement durable) et métaphysique (sur le statut de la différence), articulation qui me semble indispensable pour élaborer des instruments à la fois, je l’espère, utiles à la compréhension de notre temps, et susceptibles de nous aider à en surmonter les défis.








