Propos recueillis par Henri de Monvallier
« La littérature pense plus que la philosophie. La revue Tel quel, la revue L’Infini, tout ce que je fais, c’est pour essayer de montrer cela, qui est peu recevable, peu acceptable, à savoir que la littérature pense davantage que la philosophie. »
Philippe Sollers, Entretien avec Anne Deneys-Tunney (2010).
Philippe Sollers est né en 1936. Auteur de très nombreux romans et essais, il fonde en 1960 la revue et la collection Tel Quel aux éditions du Seuil puis, en 1983 la revue et la collection L’Infini chez Gallimard. J’ai souhaité le rencontrer pour l’interroger sur son rapport ambigu, à la fois lointain et proche, à la philosophie. Qu’il soit remercié ici pour la rapidité de sa réponse et la courtoisie avec laquelle il m’a reçu dans son petit bureau de Gallimard où l’on ne peut guère être plus de deux au milieu de tous les livres qui s’y trouvent…
Première partie : Sollers lecteur des philosophes
Actu Philosophia : Une remarque, disons purement poétique pour commencer : je crois que personne n’a jamais remarqué, à ma connaissance que « Philippe Sollers » est l’anagramme (au moins approximative) de « philosophie »…
Philippe Sollers : Et qu’un personnage de l’un de ses romans s’appelle…Sophie !
AP : Une première question d’ordre biographique. Comment avez-vous découvert la philosophie ? Avez-vous des souvenirs de votre professeur de philosophie et de votre classe de philosophie au lycée ?
Ph. S. : J’ai fait ma classe de philosophie au lycée à Bordeaux, j’ai d’abord été au lycée Montesquieu, ensuite au lycée Montaigne. Le rapport à la philosophie est d’abord passé par les cours de français. Je suis très redevable à mes professeurs de français de m’avoir ouvert à la lecture de Montaigne que j’ai pratiquée très vite et très tôt, mon souvenir le plus vibrant étant la visite traditionnelle, à l’âge de douze ans, à la tour de Montaigne avec les fameuses poutres ornées de citations grecques et latines. Montesquieu, c’était la visite d’après, à la Brède. Donc, mon rapport à la philosophie vient d’abord par la littérature, Montaigne et Montesquieu étant tous les deux des auteurs à cheval (si j’ose dire) entre littérature et philosophie. Ce côté entre-deux, ç’a été assez décisif pour moi, je crois. C’est resté d’ailleurs parce que l’une des critiques qui m’est le plus souvent adressée est qu’il y a trop de pensée dans mes romans et trop de littérature dans mes essais…Je suis toujours un peu entre les deux, c’est un tropisme bordelais ! Toujours est-il qu’à cette époque (15-16 ans, un peu avant la classe de philo) je me rappelle très bien que j’ai eu envie de lire les philosophes.
AP- Vous avez commencé par quoi ou par qui ?
Ph. S. : Bizarrement, par Leibniz qui est quelqu’un avec lequel on m’associe rarement. Je me souviens très bien, plus tard, à l’époque de Tel Quel, d’avoir lu avec beaucoup d’intérêt les deux volumes de Michel Serres Le Système de Leibniz et ses modèles mathématiques (1968) au point de vouloir en faire un compte-rendu pour la revue Critique. Leibniz me parlait : cette question des monades, des singularités, ça m’a toujours beaucoup intéressé. J’ai l’impression que beaucoup de mes personnages de roman sont des monades. Toute la philosophie de Leibniz, c’est un peu une théorie des exceptions, au fond… Et puis il y a eu Proust (le plus philosophe des romanciers) et Bataille qui m’a mis en contact avec Nietzsche (le Sur Nietzsche et le Memorandum, recueil de citations de Nietzsche). Je me suis également intéressé ensuite, après le bac, à la phénoménologie et à Husserl : les Recherches logiques et les Méditations cartésiennes, que j’ai lues avec beaucoup d’attention. Tout ça m’intriguait beaucoup.
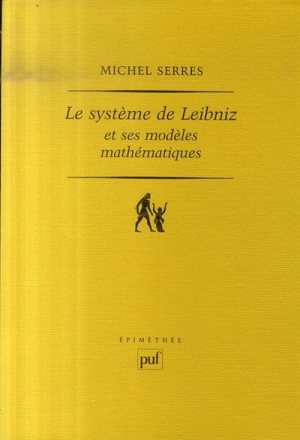
Et puis évidemment le choc considérable de Marx et Engels (vers 25 ans). Quelque chose que j’ai mis beaucoup de temps à comprendre, c’est pourquoi Marx et Engels se sont trompés à propos de quelqu’un qui, pour moi, est de la plus haute importance : Hegel. Hegel est trop méconnu et c’était une erreur de vouloir « le remettre sur ses pieds ». C’était eux qui marchaient sur la tête ! Je découvre La Phénoménologie de l’esprit en exergue, figurez-vous, de Madame Edwarda de Georges Bataille : encore une fois, la philosophie passait par la littérature… Bataille, comme on le sait, a suivi les cours de Kojève qui est, à mon avis à côté de la plaque sur pas mal de points, mais bon, ça, c’est un autre problème. Quelqu’un qui, par contre, avait certainement lu Hegel au point de se plaindre en privé que les psychanalystes ne l’avaient pas lu, c’était Lacan. Il faut bien entendu aussi parler de Heidegger et des contemporains que j’ai lus et connus personnellement (notamment Derrida et Foucault qui a accepté de venir à la première décade de Cerisy organisée par Tel Quel). Tous ces textes, les textes de pensée m’habitent depuis longtemps. Je me suis d’ailleurs remis tout récemment à travailler sur La Phénoménologie de l’esprit pour mon prochain livre.
AP-Hegel sera dans votre prochain roman ?
Ph.S.-Oui, je vous donne un scoop en avant-première : Hegel sera un personnage central de mon prochain roman !
AP-Ah bon ? C’est bien la première fois, à ma connaissance, qu’un romancier fait de Hegel l’un de ses personnages (centraux, qui plus est). Donc, au fond, vous n’êtes pas d’accord avec la phrase de Valéry, que je vous citais dans la lettre qui sollicitait cet entretien, lorsqu’il dit : « Je lis mal et avec ennui les philosophes, qui sont trop longs et dont la langue m’est antipathique » (Cahiers, I, 197) ?
Ph.S.- Trop léger. C’est de la coquetterie intellectuelle. Comme souvent, Valéry est emporté par son ironie et son talent aphoristique… S’il lit avec ennui les philosophes, pourquoi, alors, se donner la peine de faire une conférence en 1937 au IXe Congrès International de Philosophie (dit Congrès Descartes) pour le tricentenaire du Discours de la méthode? Certes, il représentait l’Académie Française mais personne ne l’y obligeait… C’est d’ailleurs amusant de penser que Bergson, « le » philosophe de l’époque qui avait été sollicité, n’a pas pu être là, lui : trop vieux et malade…
AP- D’accord mais quand même, quand on aime le beau style et la littérature, Hegel et Heidegger, ce n’est quand même pas Baudelaire ou Proust…
Ph.S.-Mais quand je lis ces philosophes, ce n’est pas le style que je cherche, c’est la pensée. Je me méfie d’ailleurs de Français qui ne sont pas toujours capables de penser comme il faudrait penser, y compris leur propre histoire. Les Allemands sont souvent plus forts de ce point de vue-là. Qui a pensé la Révolution Française ? Hegel et ses amis du séminaire de Tübingen (Hölderlin et Schelling, Hölderlin qui est venu à Bordeaux, je vous le rappelle…). Sur ce point, les livres sur Hegel du regretté Jacques d’Hondt, disparu il y a trois ans, m’ont passionné. Ces jeunes Allemands étaient enthousiastes de la Révolution Française sous sa forme girondine (et non jacobine). Ce qui me touche, car les Girondins sont un peu mon parti politique. Je me sens donc tout à fait en affinité avec eux sur ce point-là. Donc, vous voyez, à un moment Marx dit : « Je vais faire un nœud à trois, la philosophie allemande, l’économie politique anglaise et le socialisme français. » Disons : Hegel, Smith et Proudhon. Le temps que perd Marx (de façon éblouissante, d’ailleurs) à dézinguer Hegel en nageant en plein contresens… Contresens, pourquoi ? Parce que la mort n’est pas traitée. Ce nœud à trois demande à présent à être minutieusement desserré pour voir ce qui tient le coup. Parce que, bon, le messianisme du prolétariat, hélas, les dégâts ont été considérables…
AP-Mais, reprenons deux minutes sur Hegel : pourquoi ce retour à La Phénoménologie de l’esprit ?
Ph.S.-Parce que je voulais comprendre pourquoi Hegel à Iéna en 1806 se met à sa fenêtre et voit passer l’âme du monde (Napoléon). Ce n’est pas tous les jours que vous vous mettez à votre fenêtre et que vous voyez passer l’âme du monde, quand même ! Ça m’intéresse toujours.
AP-Mais sur la question du style des philosophes, et en particulier de certains philosophes contemporains, ne pensez-vous pas qu’il y a eu des effets délétères du jargon de la philosophie allemande à partir de la seconde moitié du XXe siècle (disons à partir des premiers écrits philosophiques de Sartre dans les années 1930) alors que, de Montaigne à Bachelard, la philosophie en langue française s’est toujours exprimée dans une langue limpide et élégante ? Bergson a tout de même été prix Nobel de littérature…
Ph.S. –Ce qui compte, c’est la pensée. Certains philosophes ont un style mais pas de pensée : ce sont des essayistes (cela dit sans mépris en passant, j’en suis un moi-même…). D’autres ont une pensée mais l’expriment dans une langue un peu sévère, c’est effectivement le cas des allemands (ne sous-estimons pas cependant les effets de traduction : Hegel ou Heidegger sont plus directement compréhensibles dans le texte). Maintenant, si vous me demandez si je prends le même plaisir à lire Hegel et Stendhal, ma réponse est non ! Je prends du plaisir dans les deux cas mais je ne cherche pas la même chose, c’est tout… Par ailleurs, c’est vrai qu’il y a dans la pensée française classique (XVIIe et XVIIIe siècle) la tradition des moralistes qui essaient de conjoindre le souci philosophique (moral ici, en l’occurrence) et la recherche du style. C’est très bien et je crois que, de même que les moralistes sont les enfants de Montaigne, de même, la plupart des grands philosophes de langue française sont, en un sens, des moralistes, d’une manière ou d’une autre. Regardez Sartre dans L’Être et le néant : il est imprégné de philosophie allemande, de phénoménologie, les fameux trois « H » (Hegel, Husserl, Heidegger) mais de temps en temps il y a des passages où il analyse des cas concrets : le garçon de café, la coquette, le type qui attend son ami dans un café, etc. À ce moment-là, il analyse les questions d’authenticité, d’hypocrisie, de mauvaise foi, toutes les illusions que les hommes se font sur eux-mêmes, les mensonges qu’ils se racontent à eux-mêmes, etc. Il s’inscrit bien dans la grande tradition des moralistes français. Disons qu’il fait tout un détour par la philosophie allemande pour retrouver La Rochefoucauld et Vauvenargues…
AP-Si l’on reprend la question de vos lectures philosophiques, il y a un penseur que vous n’avez pas évoqué, c’est Spinoza. Vous en parlez dans un chapitre de votre dernier roman L’École du mystère où vous notez : « Personne ne voudrait d’une existence aussi terne, aussi renfermée, même en échange d’une conviction métaphysique absolue et d’une gloire mondiale »1. Comment avez-vous découvert Spinoza ?
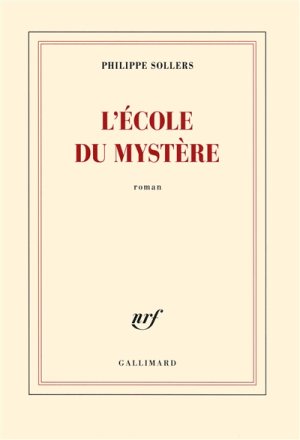
Ph.S.- Je l’ai lu assez tôt. Et le fait, on revient à lui, que Hegel ait trouvé Spinoza absolument crucial m’a beaucoup impressionné. Vous connaissez la formule : « Le spinozisme est un point capital de la philosophie moderne : ou bien le spinozisme ou bien pas de philosophie ». Mais il trouve que la substance de Spinoza est trop figée, qu’il méconnaît la dialectique, le processus et le mouvement. Omnis determinatio est negatio, d’accord, formule essentielle, mais il oublie la négation de la négation.
AP-Et les philosophes que vous avez connus personnellement ?
Ph.S. –Alors, là, comme vous devez vous en douter, il y en a un certain nombre. J’ai déjà évoqué Derrida et Foucault. Il y a eu Althusser avec qui j’ai eu de longues discussions : le procès sans sujet, tout ça, je n’étais pas vraiment d’accord mais, au fur et à mesure de nos discussions, je me suis rendu compte qu’il était dans une sorte de courses aux extrêmes dialectique et que sa vraie ambition, c’était de supprimer la négation de la négation. Remettre Marx sur ses pieds, quoi ! C’était des conversations étranges et passionnantes. Et puis, bon, le moins qu’on puisse dire c’est qu’il a eu une fin de vie qui n’était pas banale : ce n’est pas tous les jours qu’un philosophe assassine sa femme sans être jugé pour cause de démence ! Vous savez ce qu’on a dit à ce moment-là : du procès sans sujet au sujet sans procès… !
AP-Vous déclariez en 2010 dans un entretien avec Anne Deneys-Tunney : « Interrogez les philosophes sur les femmes, c’est un délice, ils n’y connaissent strictement rien. Et si vous voulez, je peux vous le prouver en faisant un tableau des différents philosophes »[Philippe Sollers, l’impatience de la pensée, Paris, PUF, p. 178. Livre recensé à cette [adresse [/efn_note]. Pourriez-vous préciser et brosser rapidement ce « tableau » que vous évoquez ?

Ph.S.- C’est un sujet immense, un sujet pour un livre… Peut-être faudrait-il que je l’écrive si j’ai le temps. Mais, disons que dans l’histoire de la métaphysique, l’élément féminin est, rejeté et passe au second plan…
AP-Et les femmes philosophes ? Arendt, Beauvoir, Weil ? Font-elles différemment de la philosophie ?
Ph.S.-Arendt a l’immense avantage de s’être rendu compte que personne ne lisait comme Heidegger (c’est ce qu’elle dit). Son amour s’en déduit. Simone Weil est un cas tout fait passionnant mais c’est du Platon version masochiste et anorexique, donc là, je l’ai lu avec intérêt mais j’ai moins accroché. Elle apparaît dans Le Bleu du ciel de Georges Bataille sous la forme du personnage de Lazare, beau texte, hommage indirect de Bataille à Weil dont on pouvait penser a priori qu’ils n’avaient pas grand-chose en commun. Beauvoir : les lettres à Sartre sont tout à fait intéressantes. « Mon petit philosophe, vous allez me construire un beau système », etc. Et puis quand ils vont à Venise, Sartre ne voit rien, Beauvoir, elle, voit beaucoup… C’est amusant ! Comme Heidegger, d’ailleurs : quand il vient à Venise, il ne voit rien.
AP- Pourquoi ? Les philosophes hommes sont-ils sont trop cérébraux ?
Ph.S.- Oui, en fait, je crois qu’ils sont souvent dans l’idéal de la maîtrise intellectuelle et morale (le savoir et la sagesse). Donc Venise les met en danger car ça les met en danger d’expérimenter une sensualité trop forte, ça supposerait de passer de la maîtrise à la déprise… De la philosophie à la littérature, peut-être ?
Seconde partie Sollers philosophe ?
AP- Vous êtes écrivain : c’est votre identité sur le plan artistique et social. Vous n’êtes donc ni un philosophe…
Ph. S. – Ni un « intellectuel » ! À la limite un essayiste, comme je disais avant.
AP- Mais Montaigne disait aussi « Je ne suis pas philosophe » (Essais, III, 9). Pourtant, il l’est. De même, Épictète disait « Ne te dis jamais philosophe » (Manuel). C’est donc l’inverse de la cour de récréation : c’est celui qui le dit qui n’y est pas ! Mais, justement, est-ce que dire qu’on n’est pas philosophe, qu’on ne revendique pas ce titre, ce n’est pas signe qu’on l’est ? Seriez-vous donc une sorte de philosophe…masqué ?
Ph.S.- À la longue, quand vous l’êtes (même un peu), ça finit par se voir, c’est vrai… Pourquoi ? Parce que dans la tradition philosophique occidentale, le relais politique a été très amalgamant : regardez Marx ou Hegel dont on a déjà parlé (beaucoup d’étudiants à l’enterrement de Hegel). Disons : l’université et la politique mettent la philosophie dans une position de clergé laïque. C’est une cléricature qui s’obtient par des travaux universitaires et débouche automatiquement sur la politique. C’est pourquoi il importe de toujours interroger les philosophes sur leur credo ou leurs affinités politiques. Si je vous dis « Badiou », c’est clair : il y avait encore hier ou avant-hier2 un texte de lui dans Le Monde, un texte extravagant sur le communisme, avec une rage étrange d’ailleurs contre Voltaire. Ne l’oubliez pas celui-là : c’est comme Montaigne. Est-il philosophe ? Par son influence politique, oui. Donc ma thèse, si vous voulez, c’est : le critère pour dire qui est philosophe et qui ne l’est pas (puisqu’il en faut bien un), c’est l’influence politique, qu’elle ait été voulue ou non dans le « projet originaire » du philosophe en question. Regardez pour Montaigne : c’est quand même lui que Mitterrand lit dans sa photographie officielle de président de la république (Gisèle Freund) et pas Machiavel, comme on l’a dit parfois… On tabassait dans les commissariats sous la photo de Mitterrand lisant Montaigne !
AP- Un écrivain pense-t-il ? Dans un entretien avec Serge Moati en 2008, vous aviez déclaré « Penser, c’est écrire sans accessoire ». Vous pouvez préciser un peu ?
Ph. S. – Ce n’est pas de moi, c’est une citation de Mallarmé. Est-ce que Mallarmé a lu Hegel ? On ne sait pas mais certains le disent. Est-ce qu’un écrivain pense ? Bien sûr ! Proust m’évite de perdre du temps avec Bergson, Céline m’introduit dans les convulsions des deux guerres mondiales avec les délires qui s’ensuivent aussi. Céline pense d’ailleurs de façon beaucoup plus forte que ce qu’il dit est erroné. Le cas Heidegger, c’est la même chose. La pensée est totalement contrôlée par l’idéologie mais celle-ci n’a aucune prise sur l’effervescence et l’imprévisible de l’œuvre littéraire… Je pense même que l’idéologie a fini son œuvre et qu’on est passé à la marketologie : le marketing envahit progressivement tous les secteurs de la vie humaine. Tout était politique, tout est devenu économique. Même les déclarations de nature intellectuelle sont soumises aux règles du marketing.
AP- Dans Fugues, vous déclarez : « J’écris des romans métaphysiques »3.
Ph. S. – Ça veut dire que la question philosophique (si on entend par philosophie, l’histoire de la métaphysique, de la « philosophie première », comme on dit) est toujours là. On parlait de Husserl en commençant : la réduction phénoménologique et l’ego transcendantal ont été des chocs très profonds pour moi. Qu’est-ce que serait un « je » qui ne serait pas moi ? Un « je » impersonnel (on retrouve Mallarmé) ou transpersonnel qui serait en moi mais qui ne serait pas moi ?
AP – Dans ses Carnets (1936), Camus note : « On ne pense que par images. Si tu veux être philosophe, écris des romans ». Que pensez-vous de cette déclaration ? Vous reconnaissez-vous dedans ?
Ph. S. – Le « par images » me gêne : ça veut dire qu’on est déjà dans la littérature considérée comme cinéma (n’oubliez pas l’influence considérable du cinéma sur les romanciers de la génération de Camus : chez Malraux, par exemple, c’est très clair). Pour ma part, je combats le roman-cinéma et je suis davantage sensible à la littérature comme rythme et comme musique. C’est aussi, du reste, une ligne de partage parmi les philosophes : ceux qui sont sensibles à la musique et ceux qui ne le sont pas. On pense à Nietzsche, bien sûr, à Jankélévitch mais on pourrait aussi mentionner Hegel qui adorait l’opéra… Je dirais plutôt (en paraphrasant le Heidegger de Acheminements vers la parole) : « Écoute et tu penseras ». Lorsque j’écris un roman, je me mets en état d’écoute, d’une sensation, d’une œuvre d’art, d’un concept philosophique (l’ego transcendantal ou ce que vous voulez) et je laisse résonner librement en moi. Heidegger, qui parle rarement de musique, était quand même capable de suivre du Bach avec le doigt sur la partition, donc quand il parle de l’écoute dans Acheminements vers la parole, il sait de quoi il retourne. C’est amusant de savoir, d’ ailleurs, qu’il allait chez son voisin pour écouter les matchs de football à la radio, je ne sais plus qui raconte cette anecdote, ça doit être Rüdiger Safranski dans sa biographie, je crois. Pour ma part, je crois aux anecdotes : elles entrent souvent en cohérence avec l’œuvre. Je crois aussi à la biographie des philosophes. Vous ne pouvez pas comprendre l’œuvre d’un philosophe si vous ne connaissez pas sa vie. C’est pour ça que j’ai écrit une biographie romancée de Nietzsche (Une Vie divine).
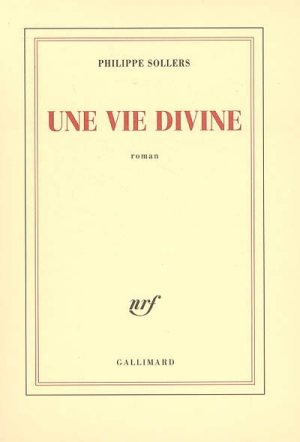
AP- Reprenons sur le rapport philosophie-littérature. Comment définir le rapport des philosophes avec la littérature ?
Ph. S. – Vous aurez remarqué sûrement que beaucoup de philosophes ont un « moment » important avec la littérature, une sorte d’explication. Voir le culte que rend Heidegger à Hölderlin, Foucault sous l’emprise de Blanchot, Deleuze avec Proust au début, Tournier et Kafka ensuite. Et puis Sartre : les livres sur Baudelaire, Genet, Mallarmé et le grand ouvrage inachevé sur Flaubert. En 1972, j’allais voir Sartre chez lui, il écrivait L’Idiot de la famille pendant que les émeutes éclataient dehors. Et quand je le quittais, il me disait « Rendez-vous dans la rue ! ». Un type extrêmement sympathique. Pourquoi s’intéresser autant à la littérature ? Le cas de Hegel est très intéressant. À la fin de l’Encyclopédie, il cite Rûmi, un poète mystique persan du XIIIe siècle. La Phénoménologie de l’esprit se clôt par un vers de Schiller. Donc, à un moment, même les plus grands philosophes laissent la place à la littérature : ce qu’on ne peut penser (car au fond, c’est ça qu’il y a d’intéressant en philosophie : l’impensable, se confronter aux limites de la pensée), on peut l’approcher, l’exprimer dans et par la littérature.
AP- Dans l’entretien de 2010 avec Anne Deneys-Tunney, vous déclarez : « La littérature pense plus que la philosophie. La revue Tel quel, la revue L’Infini, tout ce que je fais, c’est pour essayer de montrer cela, qui est peu recevable, peu acceptable, à savoir que la littérature pense davantage que la philosophie »( p. 190). Mais comment la littérature pense-t-elle ? Comment penser sans faire de raisonnement et sans argumenter ?
Ph. S.- Comme réponse, qui vous paraîtra sans doute pauvre mais à laquelle je tiens, vous avez le savoir-vivre. C’est essentiel. Comme dit Montaigne, « Revenons à nos bouteilles ». Autrement dit, ne pas perdre le contact avec la vie, avec ce qui se trouve là sous nos yeux, de façon immédiate. La littérature nous plonge dans la vie et, en tant même qu’elle nous y plonge et nous y immerge avec toute une gamme de sensations et d’émotions, elle nous fait prendre du recul sur elle et nous permet de mieux la comprendre. « La vie réellement vécue », dit Proust. D’ailleurs, certains mouvements comme la phénoménologie ont bien senti ça : au Collège de France, Merleau-Ponty a fait des leçons sur Claude Simon. Aujourd’hui, quelqu’un comme Claude Romano à la Sorbonne a, il y a une dizaine d’années, écrit un livre sur Faulkner. Les phénoménologues sentent bien que le roman permet de capter de façon plus directe tout ce qu’ils essaient de problématiser sur le plan conceptuel : le corps, la vie, le vécu, l’intuition, la sensation, l’apparition, la vibration ténue de l’instant, etc. La littérature pense davantage que la philosophie car elle la précède souvent en tâtonnant dans la délimitation du pensable (ou de l’impensable, d’ailleurs) qu’elle pressent et fait pressentir au lecteur sans arriver pour autant à le conceptualiser (ce n’est pas son rôle). Les écrivains sont des aventuriers, des « expérimentateurs », comme dit Nietzsche, les philosophes devraient l’être aussi.








