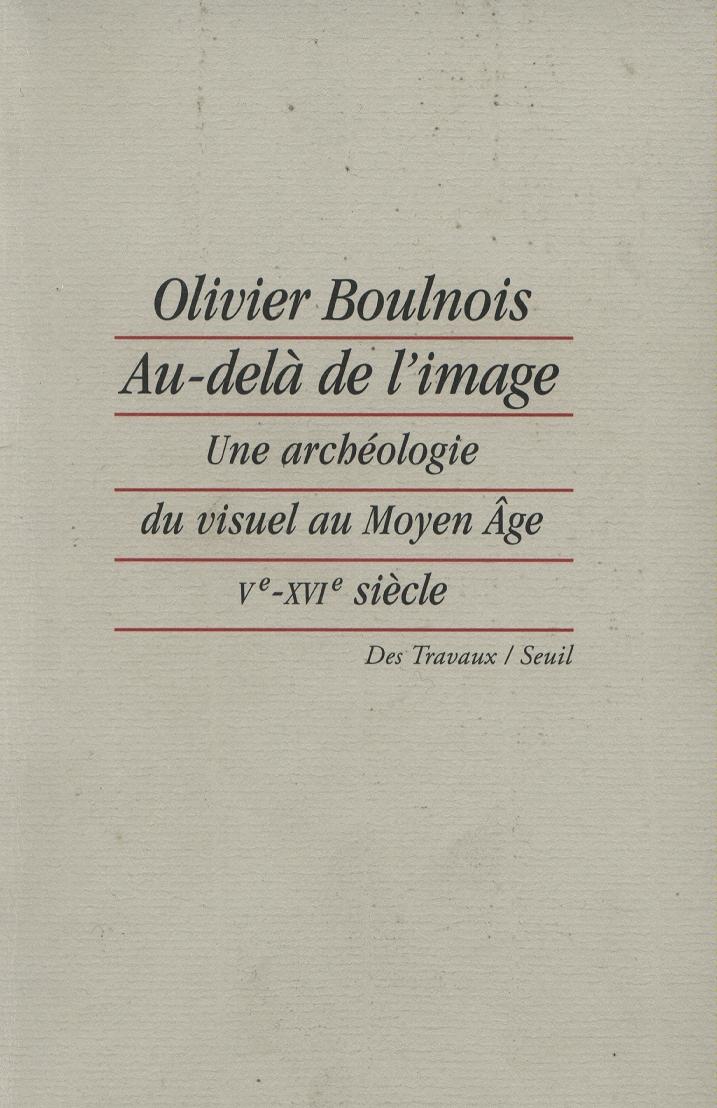Olivier Boulnois vient de publier un ouvrage qui fera date 1, ouvrage consacré à l’élaboration conceptuelle de l’image et de sa visualité au Moyen Age. Certes, quelques entreprises avaient déjà vu le jour 2, mais le texte de Boulnois, à la fois par l’étendue historique qu’il embrasse et la maîtrise des auteurs qu’on lui connaît, se pose d’emblée comme un document exceptionnel. A l’occasion de la parution de ce beau travail, l’auteur a fort aimablement reçu Actu-Philosophia pour évoquer quelques aspects de son dernier ouvrage. L’entretien s’est passé chez l’auteur, et les propos ont été recueillis par Thibaut Gress.
Actu-Philosophia : J’aimerais d’abord vous interroger sur le titre : vous venez de diriger un recueil intitulé Généalogie du sujet de Saint Anselme à Malebranche et le sous-titre de Au-delà de l’image est Une archéologie du visuel au Moyen-Age : Vè-XVIè siècle. On ne peut pas ne pas penser avec ces deux mots – généalogie et archéologie – à une méthode foucaldienne, Foucault définissant d’ailleurs le travail de Les mots et les choses comme « une histoire de la ressemblance » ; et la ressemblance, dans votre ouvrage, constitue un thème bien évidemment majeur, pour ne pas dire structurant. Mais au-delà, nous retrouvons toute une étude de l’a priori historique rendant possible la pensée, et nous pouvons citer par exemple les évocations de la lecture muette, la crise iconoclaste, et surtout les longues analyses autour des Libri carolini.
Pouvez-vous d’abord nous confirmer la dimension foucaldienne de la démarche de cet ouvrage et nous dire pourquoi elle vous a semblé utile dans le cadre de l’étude de l’image au Moyen-Age.
Olivier Boulnois : Vous me faites découvrir que je suis plus foucaldien que je ne le pensais… Déjà, pour Etre et représentation, le sous-titre n’était autre qu’ « Une généalogie de la métaphysique moderne à l’époque de Duns Scot. » Je m’aperçois a posteriori que j’ai suivi la méthode de Foucault dans mes principaux livres. Mais pour celui-ci, j’en étais conscient : dans ce travail sur l’image, il s’agissait essentiellement de dépasser une approche d’histoire générale. Ce livre n’est pas une simple histoire générale de l’image. C’est d’abord une histoire des théories de l’image, même si elle croise parfois l’histoire des pratiques. C’est ensuite une histoire philosophique, l’histoire d’une problématique : celle de l’image vraie, de l’image parfaite, d’Augustin à la Renaissance. Et c’est aussi, en même temps, une analyse philosophique, l’analyse de la préhistoire de la situation moderne, c’est-à-dire la recherche d’une paternité, et en même temps, comme dans la généalogie nietzschéenne, la recherche d’un sens ou d’une valeur. La question directrice pourrait se résumer ainsi : qu’est-ce qui donne sens à l’image ? D’où viennent les mutations du ou des sens de l’image ? – J’ai été sensible surtout à un certain exotisme : aux statuts différents qu’a pu avoir l’image avant l’époque moderne. Comment a-t-il pu en aller autrement ? Comment est-elle devenue ce qu’elle est ?
Pourtant, même si le lien avec Foucault est étroit sur le plan méthodique, mon enquête aboutit aussi à désaccord sur le résultat : celui du rôle du Moi (ce que Foucault appelait le sujet). Au XVIè siècle se met en place l’homme au centre d’une galerie d’images et c’est la fameuse « place du roi ». Le moi devient le centre de toutes les images, qu’elles soient matérielles, conceptuelles, imaginaires, etc. Mais je montre surtout comment il n’en a pas été toujours ainsi. Je suis tombé sur un texte de Pierre-Jean Olivi décrivant la place qu’un tableau doit réserver au roi : dans ce cas, le principe de la représentation n’est pas centré sur l’œil et l’observateur ; plus on est proche de l’essentiel, plus l’essentiel est caché. Le principe est en réalité celui de la théologie symbolique de Denys : plus quelque chose est essentiel, plus il faut le montrer par la dissemblance. Il faut dissimuler l’essentiel pour mieux le faire pressentir. Il fallait donc faire une histoire des rapports entre dissemblance et ressemblance, de l’iconologie négative et non seulement de l’iconologie moderne, positive.
En somme, je recherche bien le sens des images mais il s’agit d’une autre généalogie que celle de Foucault.
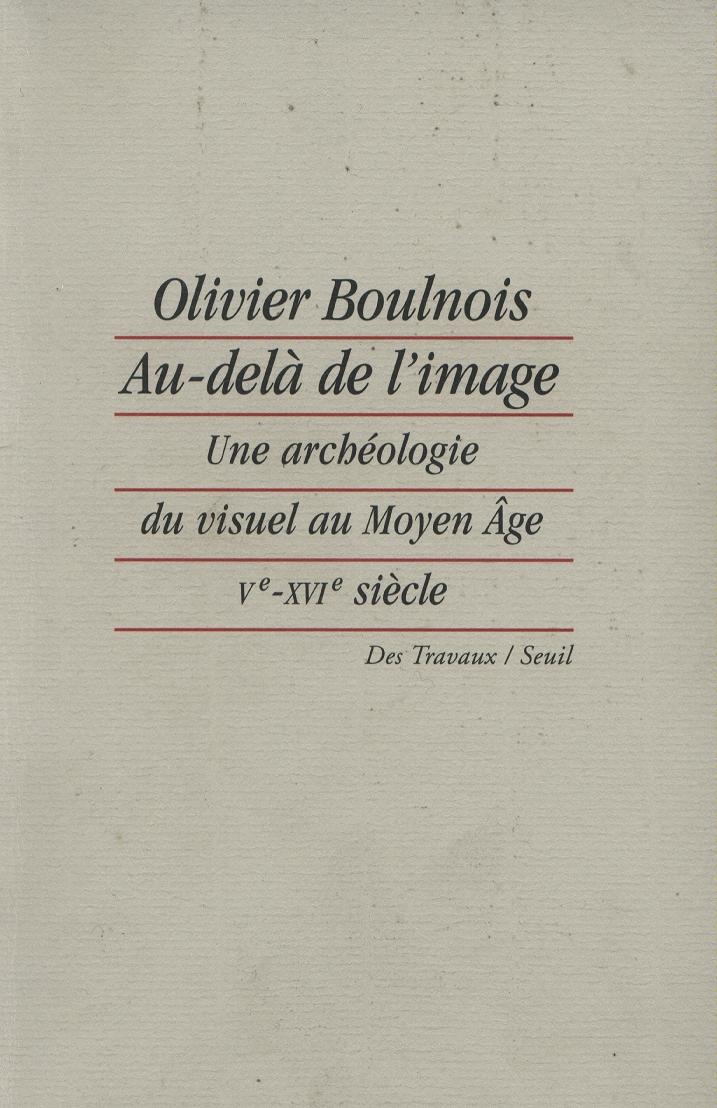
AP : Il y a un très grand nombre d’auteurs abordés, avec des développements très profonds sur Augustin qui ouvre votre travail, mais ce travail ne se présente pas comme une anthologie des textes consacrés à l’image ; toutefois, le lecteur de Didi-Huberman que je suis s’étonne de l’absence d’un auteur, à savoir Tertullien ; le De idolatria aurait pu, me semble-t-il, constituer l’occasion d’une illustration assez féconde autour des thèmes de la ressemblance, de l’image, de la dualité du visible et du visuel, etc. Son absence est-elle une absence contingente liée au fait qu’on ne peut pas parler de tout le monde ou est-ce une exclusion délibérée répondant à une raison précise ?
OB : Il n’y a aucune exclusion voulue de Tertullien. Simplement, il n’entrait pas dans le cadre de ma problématique. Je suis parti d’une question directrice : quels concepts les médiévaux avaient-ils de l’image ? Pour identifier ces concepts, je m’appuyais sur un texte fondateur, le traité « De l’image », dans les 83 questions d’Augustin. Dans ce traité, Augustin réussit à dépasser l’aporie platonicienne, à savoir le caractère de la dissemblance de l’image qui la menait nécessairement à l’imperfection. Platon disait dans le Cratyle que si l’image de Cratyle était parfaitement ressemblante, ce ne serait plus une image mais un second Cratyle ; il n’y avait donc d’image qu’imparfaite, ce qui allait de pair avec un discrédit ontologique jeté sur l’image. C’est cela que surmonte Augustin : pour Augustin, il y a image lorsqu’un objet ressemble à un autre et qu’il en dépend. Du coup, l’image n’implique en soi ni perfection ni imperfection. Et du coup encore, on peut imaginer une propriété supplémentaire, que l’image soit égale à l’original. Mais alors, il existe une image par excellence, une image parfaite, l’image de Dieu en Dieu, le Fils, image du Père. Vous le voyez, sous cet angle, Tertullien ne trouve pas sa place dans l’économie de la problématique. Et il n’est sans doute pas le seul…
AP : Il y a de très belles analyses sur Maître Eckhart, sur le paradoxe de l’image chez Eckhart, où l’on devient image en recevant la forme divine alors même que l’on ne rejoint Dieu véritablement que par le processus de l’Entbildung.
En revanche, j’ai un peu plus de mal à comprendre votre analyse de Nicolas de Cues, où vous faites de celui-ci le théoricien d’une image dont le devenir historique est tel que l’interdit de représentation du Père vient de s’éclipser ; vous en déduisez ce que vous appelez l’anthropomorphisme de l’image chez Nicolas. « L’image de Dieu constitue en réalité une image humaine. » écrivez-vous page 388. Il y a pourtant ce § 15 du De Visione Dei où Nicolas de Cues affirme que celui qui croit voir sa propre forme en regardant Dieu, a tort. Et Nicolas a cette formule extraordinaire : « Mais ici c’est l’inverse qui est vrai, car ce qu’il voit dans le miroir de l’éternité n’est pas une figure mais la vérité dont lui n’est que la figure. La figure, en toi, mon Dieu, est donc la vérité et le modèle de chacun et de tous les êtres qui sont ou qui peuvent être. » J’ai du mal à voir en quoi il y a ici un anthropomorphisme ; il me semble au contraire qu’il y a plutôt un théomorphisme où la vérité de l’image provient justement du fait qu’elle est image de Dieu.
OB : Ce passage de Nicolas de Cues est très important. Il prend acte d’une mutation de la pratique pour introduire cette mutation dans la théorie. Depuis les origines bibliques, la représentation de Dieu était considérée comme interdite ; depuis Augustin, elle était de surcroît considérée comme impossible ; de ce fait, seule était licite (et possible) une représentation indirecte, médiate, du Christ : puisque le Christ est Dieu fait homme, en représentant l’humanité du Christ, on représente à travers lui la divinité. Autrement dit, Dieu ne pouvait être représenté qu’à travers son image, en tant qu’homme, par le visage du Christ. Pourtant une pratique nouvelle apparaît à partir du XIIe siècle, la représentation de Dieu le Père sous les traits d’un vieillard. Il s’est ainsi produit un événement surprenant : la représentation du divin sans la médiation du Christ, jadis interdite ou impossible, se trouve pratiquée de plus en plus. Nous avons là une pure mutation de fait. Or le point remarquable est que Nicolas de Cues prend acte de cette mutation de fait et propose de penser directement une « icône de Dieu » (ce qui est une contradiction dans les termes : les orthodoxes parlent uniquement d’une icône du Christ). Dès lors, au lieu que l’image ou l’icône de Dieu soit justifiée par la médiation christique, elle est ce qu’y projette l’homme. Dieu est ainsi un miroir de l’état de l’âme : l’homme indigné voit un Dieu indigné, l’homme joyeux voit un Dieu joyeux, etc. A travers l’image, Dieu n’est plus une altérité avec laquelle on dialogue, mais un reflet. Cela va si loin que Nicolas reprend à compte le fragment de Xénophane, où il est dit le bœuf voit Dieu comme étant un bœuf !
Lors du concile de Nicée II, la limite était claire : l’origine de la visibilité de Dieu était son humanisation ; mais si Dieu devient une projection par l’homme, il n’y a plus de limites, et Nicolas incarne ce moment extraordinaire où il n’y a plus de limites à la représentation de Dieu. Clairement, Dieu n’est plus qu’une projection par l’homme de sa propre représentation.
AP : Il y a donc anthropomorphisme selon vous parce que l’image divine se conforme à la forme humaine – ou autre – qui la perçoit ; or il me semble pourtant que c’est inversement l’humain qui a affaire à un regard qui le crée à son image ainsi que me semble l’expliciter la conclusion du § 16 : « La ressemblance que j’ai l’air de créer est, en fait, la vérité qui me crée. » Le phénomène de ressemblance qui semble dans un premier temps anthropomorphique relève, en un second temps, du théomorphisme ; sommes-nous d’accord sur ce point ?
OB : L’homme reste l’image de Dieu, en effet. Pourtant, il y a chez Nicolas de Cues l’idée d’une coïncidence entre l’image de Dieu et nous et l’image de nous en Dieu, ce qui veut dire qu’on peut se représenter l’absolu et surtout, qu’on peut s’y unir en court-circuitant la médiation de l’humanité du Christ. C’est cela qui m’a intéressé chez Nicolas, cette idée d’un contact, d’une infinité de l’âme et de Dieu, court-circuitant la médiation christique et nécessitant donc que Dieu soit à l’image du regard qui le perçoit.
AP : Dans votre conclusion, vous dites sans détours qu’un certain nombre de canons esthétiques qui sont encore les nôtres, y compris celui du plaisir esthétique, ne sont que des séquences historiques, presque contingentes. Ne considérez-vous pas pourtant qu’il y a eu un progrès objectif avec la Renaissance dans l’histoire de l’art ?
OB : Non. Je pense aux Remarques sur le Rameau d’or de Frazer, de Wittgenstein. Ce dernier disait à peu près qu’entre Frazer et les primitifs, le plus primitif des deux n’est pas celui qu’on croit : c’est l’idée même de l’explication historique dans le sens d’un progrès qui est primitive. Mieux vaut laisser chaque pratique à sa place, et les observer dans leurs différences et leurs relations mutuelles, plutôt que de vouloir les enrôler comme des moments dans une évolution irréversible. En d’autres termes, je ne crois pas au progrès de l’art dans son histoire. – Même si beaucoup d’histoires de l’art ont été écrites comme le récit d’un progrès, ou d’une évolution irréversible, par exemple vers la perspective, je crois qu’on n’ose plus faire cela. Nous sommes libres de choisir qui est notre contemporain : Fra Angelico ou Rothko…
Néanmoins, techniquement, la question est plus délicate. Panofsky a d’une certaine manière rompu avec le schéma hégélien d’une évolution irréversible. Mais il y a un point sur lequel je ne puis suivre Panofsky : l’idée que la perspective est arbitraire. Pour Panofsky, chaque choix d’une perspective demeure soumis à l’arbitraire. Non ! Perspective signifie d’abord optique, et il existe des règles optiques précises. Mais cela ne signifie pas que soumettre toute la peinture aux règles optiques soit la marque d’une supériorité artistique. Parler de supériorité, c’est simplement prendre l’utilisation de la technique de la perspective – que je ne crois pas arbitraire – comme critère pour disqualifier toutes les autres techniques. Par exemple, je ne crois pas que l’on puisse juger Giotto à l’aune de Brunelleschi. Rappelons que ce que l’on appelle « perspective », c’est essentiellement la perspective artificielle, centrée sur l’observateur à partir de l’expérience de Brunelleschi, c’est-à-dire conçue de telle sorte que l’observateur prenne la place du roi – précisément celle que lui assignera Velasquez, comme l’a montré Foucault. Finalement, d’une certaine manière, Velasquez répond ironiquement à Brunelleschi avec les Ménines…
AP : Oui, cette idée d’ironie me semble très forte, et très juste dans le cas de Velasquez. En définitive, pouvons-nous lire votre ouvrage non pas comme la quête d’une image belle, mais comme une réhabilitation de l’image vraie ? Et si oui, est-ce Augustin qui fournit le paradigme de cette image vraie ?
OB : Oui. La doctrine du beau et celle des images n’ont commencé à se rejoindre qu’au XIIIe et au XIVe siècle, deux siècles où se trouve progressivement valorisé le plaisir esthétique.
La strate augustinienne est celle du paradigme de l’image vraie. Avec Augustin, l’image nous fait accéder à la vérité, puisque l’aporie platonicienne de la dissemblance est surmontée, et que la ressemblance est assumée. Il ne faut toutefois pas oublier le titre, « au-delà de l’image », qui nous rappelle que l’image reste une limite, qu’elle n’est pas toute la vérité. Ce titre indique aussi la tentation permanente de rejoindre la vérité sans images ; c’est le mouvement que vous rappeliez tout à l’heure chez Maître Eckhart, c’était déjà celui d’Augustin, qui ne cesse de nous dire que Dieu est intelligible, et que l’intelligible est sans images.