Je remercie Christelle Di Pietro pour ses conseils et pour sa relecture.
Michel Melot a mené une double carrière de conservateur et d’historien de l’art. Rédacteur en chef des Nouvelles de l’estampe 1971-1982), directeur du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque nationale de France (1981-1983), directeur de la Bibliothèque publique d’information (1983-1990), vice-président puis président du Conseil supérieur des bibliothèques (1990-1996), chargé de la sous-direction de l’Inventaire général puis de la sous-direction de l’Architecture et du patrimoine au ministère de la Culture (1997-2003). D’abord historien de l’estampe, spécialiste de la caricature du XIXe siècle, il élargit son interrogation à l’image en général, au livre et à l’écriture, à la question des bibliothèques et au statut du patrimoine. Parmi ses précédents ouvrages, citons L’estampe, Genève, Skira, 1981, L’illustration, Genève, Skira, 1984, L’estampe impressionniste, Paris, Flammarion, 1994, La sagesse du bibliothécaire, Paris, l’Œil neuf éd., 2004, Livre, Paris, l’Œil neuf éd., 2006, Une brève histoire de l’image, Paris, l’Œil neuf éd., 2007, Mirabilia. Essai sur l’inventaire général du patrimoine culturel, Paris, Gallimard, 2012.
Mirabilia pose la problématique du statut du patrimoine au regard du projet de l’Inventaire général institué par André Malraux en 1964 dont la mission est de « recenser et décrire l’ensemble des constructions présentant un intérêt culturel ou artistique ainsi que l’ensemble des œuvres et objets d’art créés ou conservés en France depuis les origines ». La question du patrimoine entend d’une certaine façon relayer et englober celle de l’art qu’elle repose autrement : à partir, d’une part, des négociations concrètes entre la multitude d’acteurs qui interviennent au sein du processus de patrimonialisation, d’autre part, dans une perspective anthropologique analysant la racine des comportements qui sous-tendent ce processus et les concepts qui l’instituent.
La question du patrimoine est d’autant plus actuelle avec les multiples controverses et polémiques liées à « l’identité nationale », au sens, et au statut de « l’héritage ». Pour Michel Melot, le patrimoine est moins ce qui me possède que ce qui me définit. Il est certes ce dont j’hérite, mais cet héritage est plutôt à mettre en relation avec le patrimoine génétique : comme ce qui à la fois me singularise et inscrit la collectivité en moi.
Il s’agit également selon nous, à travers la question du patrimoine, de questionner le mode contemporain du « faire monde ». Le patrimoine peut en effet être envisagé comme concrétion de la question heideggérienne de l’être-avec envisagée sous l’aspect de son historicité et de celle des points de jonction du symbolique et de l’esthétique, autrement dit, de ce que Rancière appelle le « partage du sensible ».
Les avatars contemporains du patrimoine nous permettent ainsi d’envisager de façon concrète la constatation faite par Franck Fischbach dans un entretien publié sur Actu-philosophia « (…) mon propos ne s’appuie pas sur le constat de la non-existence d’un monde, mais sur le fait que les individus attendent un monde, escomptent leur propre inscription dans un monde, et font l’expérience de ce que cette attente, dans les circonstances actuelles, n’est pas satisfaite ou bien est très souvent déçue . » Pour Fischbach, « Il ne s’agit pas (…) d’opposer un autre monde à notre monde d’aujourd’hui, mais de savoir si notre réalité d’aujourd’hui peut ou non devenir un monde.1 »
Par les modes contemporains d’institutiondu patrimoine, par la façon dont ceux-ci échappent à la seule prérogative des États, où le patrimoine devient à la fois mondial et local, ce sont certains processus primaires des tentatives de « mises en monde » du réel qui se découvrent – la question (qui restera en suspend) étant bien sûr de savoir si le patrimoine tel qu’il se fait aujourd’hui traduit un effort de « faire monde » ou en valide l’impossibilité.
Je tiens à remercier Michel Melot pour sa disponibilité, pour le temps et la générosité consacrés à ses réponses et pour sa bienveillance.
AP : Je commencerais en évoquant l’importance de la pensée de Malraux pour votre livre. Vous considérez en quelque sorte dans la continuité l’un de l’autre le musée imaginaire et la mise en place de l’Inventaire général qui en quelque sorte le réalise – mais aussi le déplace. Comme l’écrivait Malraux dans Le musée imaginaire « pour la première fois, la recherche, devenue son objet propre, fait de l’art une valeur à découvrir, l’objet d’une question fondamentale » Il s’agit bien pour Malraux d’ouvrir à une histoire de l’art après la fin de l’art, alors que les étalons de valeur ne sont plus donnés a priori, que l’art se cherche. Ainsi, le sens de la recherche change : on ne cherche plus ce qui correspond à un étalon de valeur donné, on interroge en quelque sorte la question de la valeur à même les œuvres d’art – en ce qu’elles déploient elles-mêmes. De cette façon aussi, Malraux, comme d’autres avant lui, abandonne la dimension classificatoire, objectiviste de l’histoire de l’art, et considère la subjectivité du rapport à l’art.
MM : C’est tout à fait ça. Ce qui m’apparaît, c’est que Malraux a besoin de se rassurer. D’une part, il se place du côté des relativistes et des subjectivistes, dans la mesure où il ne croit pas aux archétypes jungiens, où il considère que l’art est un produit de l’histoire. À son époque, il était un des rares, même si cette idée est devenue très courante depuis. Malraux appartient à une génération charnière, sans doute plus active en Allemagne qu’en France, amenée à défendre des positions relativistes tout en appartenant à un monde encore structuré autour de l’idée de grand art. En quelque sorte, Malraux essaie de se convaincre lui-même que l’axiologie en art est relative à une historicité, mais il reste encore très marqué par l’idée d’une supériorité des chefs-d’œuvre qui restent pour lui le cœur de l’art. Il n’ose pas abandonner l’idée que l’art ait ne valeur absolue, mais se plie à l’idée qu’il y ait bien une relativité de l’art. Il définit lui-même sa génération comme la génération de la mort de Dieu – et de cette génération, il est un de ceux qui ont le mieux compris que la mort de Dieu impliquait aussi une certaine mort de l’art. Tant que la pensée de Malraux évolue au milieu des objets d’art, des chefs-d’œuvre, il peut concilier l’absolutisme et le relativisme. Le relativisme pour lui reste si l’on veut dans la sphère du grand art. L’Inventaire est d’emblée lié à cette question, en tant qu’il a affaire à des objets qui ne sont pas des objets d’art mais le deviennent. En cela, il y a dans l’Inventaire une ouverture que Malraux a eu le courage de faire, mais en restant lui-même dans le domaine bien délimité de l’art, alors que la problématique même de l’Inventaire, en se situant à ses bords, rend la pensée de Malraux plus pertinente. Cela s’étend bien au-delà de ce qui a été voulu comme art. L’Inventaire a été créé sans que l’on sache ce qu’il allait y avoir dedans.
AP : Dans Le musée imaginaire, il s’agit en effet encore des grandes œuvres et des grands noms. De son côté, l’Inventaire général « ne fait pas que modifier le périmètre de l’art. Il le creuse autant qu’il l’élargit. Il en montre la trame.2 ». L’esprit de l’Inventaire montre deux tendances : de façon classique d’une part, trouver les chefs-d’œuvre, ou au contraire, « donner à voir », constituer les conditions de mise en lumière de ce qui peut entrer dans le champ de l’art. Ce faisant se pose également cette question difficile mais pourtant indispensable du dénominateur commun, de ce par quoi un objet entre d’une façon ou d’une autre dans le champ de l’art – du processus et de la rencontre à l’issue desquels il se trouve investi d’une valeur symbolique spécifique. Ainsi écrivez-vous : « L’inventaire ne s’intéresse pas à l’art, mais à l’artistité d’un objet, je veux dire ce qui fait qu’un objet peut-être ou non porteur de sens. »
MM : Je suis arrivé à l’Inventaire avec l’idée très profondément ancrée qu’il ne s’agissait pas d’imposer une nouvelle liste de chefs-d’œuvre. Je me suis toujours pour ma part intéressé aux objets marginaux, comme les caricatures, la mode, l’architecture des bibliothèques, etc., j’ai toujours été intimidé par le grand art. Je n’aurais pas voulu être conservateur de musée, être conservateur au Louvre où tout est déjà validé et consacré. Ce qui m’intéresse, c’est comment une œuvre entre dans les musées.
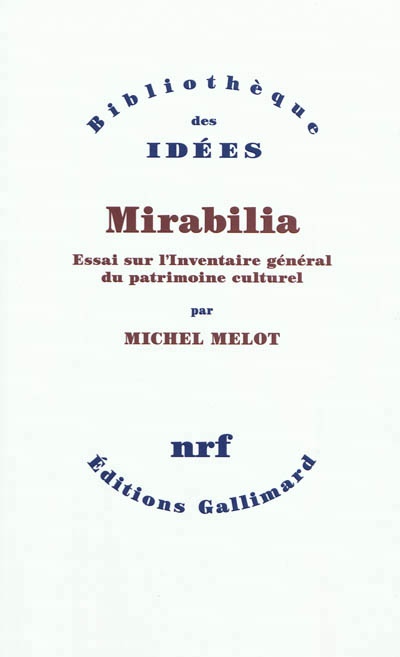
Quand je suis arrivé, mes collègues étaient formés à la tradition française de l’histoire de l’art. Ils minimisaient le rôle et la pensée de Malraux dans la création de l’Inventaire, et exaltaient André Chastel. Or, Chastel avait lui-même une pensée très ambiguë. À la fois, il était très bon connaisseur de Malraux (j’ai suivi ses cours dans les années 60), mais dans ses activités à l’Inventaire, il a clairement aligné celui-ci sur les musées. Son analyse était très platonicienne : il y avait de fait des chefs-d’œuvre, et le rôle de l’Inventaire était de retrouver ceux que les musées avaient oubliés. Dès mon arrivée, j’ai eu des discussions animées avec mes collègues. Pour moi, notre rôle n’était pas seulement de trouver ce qu’on avait oublié de mettre dans les musées, mais d’interroger le processus de reconnaissance investissant l’objet d’une valeur symbolique et esthétique.
Je me suis tout de suite heurté à un certain empirisme méthodologique que je ne trouvais pas approprié à notre tâche. Par exemple, le travail des conservateurs de l’Inventaire était basé sur des fiches comportant des critères. La fiche commençait par l’auteur. Or, ce n’est pas l’auteur qui nous expliquera maintenant pourquoi l’objet a du sens, surtout étant donné le type d’objets auxquels nous avions affaire.
Je suis totalement d’accord avec Malraux sur ce point : l’objet de la recherche est à découvrir. Il s’agit aussi de découvrir ce que l’on cherche. A mon arrivée à la tête de l’Inventaire, j’ai relu Malraux, j’ai retrouvé mes enthousiasmes et mes réserves d’adolescent. J’ai retrouvé un prodigieux écrivain et un piètre historien, j’ai été ébloui par son style, agacé par son manque de sérieux, par son manque de tout ce qui définit normalement le travail de l’historien. Mais malgré cela, Malraux a vraiment eu une analyse très fine de ce que devenait l’objet d’art. Dans sa préface à son Musée imaginaire de la sculpture mondiale, il écrit que les photos ne reproduisent pas les objets anciens, mais sont un nouvel objet. C’est aussi comme ça qu’il faut prendre ses écrits : comme de la littérature faisant quelque chose de nouveau avec l’histoire de l’art, et pas comme des écrits d’historien. Les évaluer à cette aune, cela n’a pas de sens.
AP : J’ai une remarque et une objection sur la question du relativisme. D’abord, j’ai l’impression qu’il faudrait davantage distinguer relativisme et subjectivisme.
MM : La question du relativisme m’a longtemps posé problème. J’ai trouvé une formulation satisfaisante sous la plume de Gérard Genette. Le relativisme, dit-il, ce n’est pas tout vaut tout. C’est tout vaut tout, mais pas pour le sujet. Le sujet est nécessairement impliqué dans un système de valeur. Le relativisme caractérise la position du chercheur. Le chercheur est nécessairement méthodologiquement relativiste. L’esthète, nécessairement absolutiste. En quelque sorte, le subjectivisme est la limite du relativisme.
AP : Je voudrais reprendre. La question du relativisme me gêne toujours. J’évoquerais bien sûr Kant ici, pour qui l’expérience de la beauté manifeste la possibilité de l’objectivité là où celle-ci n’est pas donnée. Là où Kant a dit quelque chose de fondamental, c’est sur le fait que précisément on peut discuter des goûts et des couleurs. Mieux : que c’est là où s’ouvre le champ de l’intersubjectivité, là qu’il y a l’idée qu’un échange est possible à partir du sein même de nos expériences. On peut s’entendre, on peut se comprendre. L’universalisation virtuelle évoquée par Kant n’a pas nécessairement, selon moi, visée comminatoire ici (c’est comme ça que Bourdieu la lit, pour la lier à un habitus socialement marqué, mais j’ai l’impression que rien de nous force à assimiler universalisation potentielle et universalisation voulue). Il me semble que dans la logique de Kant, c’est quelque chose de potentiel, qui appartient à la structure du jugement esthétique. En quelque sorte, dans l’art, il y a un approfondissement collectif de ce qui me dépasse. On pourrait dire ici : le partage des goûts c’est aussi ce qui me permet d’approfondir les nervures de mon propre goût, de mieux comprendre ce que j’aime dans ce que j’aime, et ce que je pourrais aimer d’autre et autrement. Il y a quelque chose qui s’échange : même si l’on ne partage pas tout. Il y a pour moi quelque chose qui « nous dépasse » à la fois dans notre perception et dans la tradition. Les symboles excèdent toujours d’une certaine façon leurs cadres ; ils ouvrent à une transcendance potentielle dans leur réinterprétation – un mouvement de tension entre les objets que l’on questionne à travers eux et ce que ces objets révèlent en retour de virtuellement présent en eux.
J’aimerais ajouter quelque chose, lié à Malraux, pour qui la dimension d’une pulsion vers la transcendance est essentielle à la compréhension de l’art, peut-être plus que jamais quand ses valeurs se fragilisent. L’art n’est certes plus lié à un étalon absolu, mais il manifeste une pulsion de l’homme vers ce qui le dépasse. J’aurais presque envie de dire qu’il y a aussi l’idée qu’on va aimer ce qui mérite de l’être : que dans l’art, on dépasse le caprice ou on l’approfondit, qu’on travaille son impression, qu’on l’affine, qu’on se laisse déborder par elle.
On pourrait dire que d’une certaine façon, ce qui a été partagé, ce sur quoi on s’est mis à peu près d’accord, ce qui a été stabilisé, incarnent bien en tout cas ce qu’on a pu chercher dans la pratique de l’art. Ce n’est pas pour rien qu’on l’a choisi. C’est un résultat, un état : ce dont une tradition a été capable à un moment donné. Cela ne dit pas tout, mais c’est une réponse à la question qu’est l’art. C’est pourquoi je me méfie du relativisme qui coupe la parole a priori, qui, en court-circuitant l’échange, empêche ce processus, et permet du coup à d’autres processus de peser encore plus lourdement dans la question esthétique. La pensée de Bernard Stiegler (on pourrait évoquer Rancière et l’idée de « partage du sensible », aussi) à ce sujet me paraît très importante. Pour lui, l’esthétique est bien un partage du sensible, un mécanisme de transindividuation que l’usage accéléré de la technique court-circuite en substituant un impératif d’adaptation au processus traditionnel d’adoption.
MM : Je suis plutôt d’accord avec vous. Je veux juste ajouter quelque chose par rapport à la technique. Il faut bien insister sur le fait que c’est elle qui permet ce mouvement de partage, de décentrement, d’appropriation différenciée. Qu’il y a un lien originel de la technique à l’esthétique sur ce point de la collectivité, que la question du patrimoine révèle, justement. Ce qui est aliénant, c’est un usage de la technique enrégimentée par le marketing.
AP : C’est précisément la position de Stiegler
MM : Sinon, je suis tout à fait d’accord avec ce que vous dites, et je trouve intéressant que vous fassiez cette objection. Quand je parle du relativisme, je ne parle jamais du relativisme a priori. Ce que je vise, c’est vraiment l’idée que le champ de l’art doit rester ouvert, qu’on ne peut pas déterminer par avance le jugement porté sur un objet à partir de critères fixes. Ma génération a dû se battre contre un fixisme extrêmement lourd dans l’école française de l’histoire de l’art – beaucoup moins dans l’école allemande plus profondément marquée par la philosophie. Votre génération a peut-être plutôt à affronter un relativisme sauvage qui est aussi aliénant que le fixisme l’a été pour nous. Peut-être qu’en fait, je mène un combat d’arrière-garde en continuant à militer pour une approche élargie du patrimoine ?
AP : Je ne trouve pas, parce que parler du patrimoine, c’est bien parler du processus de reconnaissance et de partage des valeurs, c’est revenir à la racine des choses. Il y a une inflation, mais c’est peut-être aussi un brassage nécessaire pour se réapproprier collectivement quelque chose…
MM : En tout cas, sur cette idée de « communication à même l’objet », de cette intersubjectivité, je suis tout à fait d’accord. C’est la question même du patrimoine, et dont le patrimoine montre les mécanismes, la mise en œuvre.
AP : J’aurais envie de dire que le relativisme exacerbé est la contrepartie d’une conception trop absolutiste du sacré : du sacré comme absolu, justement. C’est précisément la problématique de Heidegger : la pensée occidentale est depuis son origine habitée par une disposition qui conduit à hypostasier un absolu : en quelque sorte, le divin occidental porte originairement en lui l’amorce du Dieu Unique et du Dieu Principe de Raison de la Métaphysique, mais ces figures accomplissent et consument le divin dans l’absolu. Ce qui est intéressant, c’est que pour Hegel, l’accomplissement de la philosophie signifie la mort de l’art dans ce que l’art a d’actif, de positif dans le processus d’appropriation de l’histoire. Pour Heidegger au contraire, l’art sur-existe à la religion et à la philosophie : l’art manifeste que quelque chose du divin n’est pas épuisé par la dissolution de sa figure occidentale. Mais cette autre façon de « se tenir » dans cette dimension du divine est dissimulée par notre tradition (il faut préciser que le divin chez Heidegger, c’est, en simplifiant beaucoup, la dimension de ce qui nous dépasse – de ce qui nous donne à penser dans la pensée.) D’où, d’ailleurs, l’intérêt de Heidegger pour la pensée orientale, pour le taoïsme en particulier3.
MM : Natalie Heinich a étudié, dans un article très intéressant4, la contamination du champ de l’art par le vocabulaire religieux, surtout dans le vedettariat . Elle y défend l’idée que le culte des vedettes ne doit rien au surnaturel, tout d’abord parce que le culte des vedettes n’est pas institutionnalisé, ce qui est le propre de la religion. Mais alors qu’est-ce qui les rapproche ? Pourquoi les confondre ? C’est aussi que ce culte exprime quelque chose qui s’exprime aussi dans la religiosité, et qu’il faut interroger ailleurs, par l’anthropologie.
AP : C’est vrai que ce qui change avec l’idée de patrimoine, c’est l’élargissement ; l’art classique était au centre d’un cône plus évasé que l’on considère maintenant dans toute son extension. Avec le patrimoine, on va aux limites de ce cône, aux points quasi-invisibles, ce qui « frange » – le représentatif dans son ambiguïté (pourquoi cette usine, pourquoi cette maison ?) – on est dans la mécanique même de la symbolisation, de son jeu, de ses motivations. D’où le passage à l’ethnologie et à l’anthropologie pour interroger les fonctions de symbolisation – dans cette perspective, moins les cultures en question sont articulées sur l’idée d’une histoire progressive, plus elles dévoilent ces mécanismes (vous citez Warburg écrivant : « sur les hauts plateaux du Mexique, j’ai acquis la conviction que l’homme primitif, partout dans le monde, fournit l’étalon intérieur de ce qui, dans la haute culture, est habituellement présenté comme un processus en apparence esthétique »). On y reviendra.
MM : Par rapport à la religion maintenant. Vous avez tout à fait raison. C’est vrai que seul un Dieu unique peut mourir. Je vais souvent en Inde, je suis fasciné par l’Inde, mais il y a quelque chose d’incompréhensible dans le fonctionnement indien. Là-bas, vraiment, le divin se pose où il veut, pour reprendre la formule de Durkheim. Il prolifère. N’importe quel personnage peut être déifié. Pour évoquer une autre tradition encore, à Taiwan, on trouve même un temple dédié à Victor Hugo. C’est vrai que ces divinités-là sont trop flottantes pour mourir : le divin se renouvelle sans cesse.
AP : Aucun dieu ne peut s’isoler suffisamment pour accaparer le divin et l’emporter avec lui. J’aimerais proposer un petit développement. Vous écrivez vous-même que le grand art est en quelque sorte lui-même une œuvre de l’Occident. Mais en quelque sorte une œuvre achevée… En ce sens, il semble bien y avoir quelque chose de singulier dans cet art-là : qui ne relève pas des processus anthropologiques liés au patrimoine, mais à quelque chose d’autre, induit par une culture spécifique, un rapport au divin spécifique.
AP : Le rôle de l’Inventaire, écrivez-vous, est d’« offrir le plus vaste champ possible à la conscience et à la maîtrise d’un patrimoine5 ». Il y a quelque chose de très post-moderne dans l’Inventaire : il s’agit de ménager les conditions de possibilité de rencontrer ce qui sera considéré comme art. Les questions essentielles en deviennent d’une part la visibilité (possibilité de rencontrer quelque chose sous un angle inédit, remarquable, signifiant, comme le prônait Baudelaire, dès l’apparition de la photographie), et d’autre part des limites, des frontières qui permettent à quelque chose de se dessiner. L’histoire de l’art au sens classique était l’histoire d’un régime de visibilisation, qui s’achève. Une autre forme de visibilisation doit le relayer. En quelque sorte, il s’agit ici d’une métamorphose de la question de l’aura de Walter Benjamin.
MM : L’idée d’aura me gêne. On a l’impression que l’œuvre a en elle-même ce qui lui permet d’être vue. J’ai l’impression que l’aura n’insiste pas assez sur la relation esthétique.
AP : J’ai toujours compris l’aura comme le dégagement au sein de la relation esthétique. Une sorte de cadre ou d’écrin qui rend l’œuvre énigmatique. Une sorte d’espace ménagé par la façon dont je la regarde : qui lui permet d’apparaître autrement.
MM : C’est intéressant. Je ne lis pas le texte de Benjamin comme ça. Pour en revenir à l’Inventaire, vous dites donner une chance d’être vu, d’être vu comme une œuvre, de lui donner une chance d’avoir une aura. Mais en effet il y a un tri, qui parfois se heurte à de vraies perplexités. La plaque d’égout par exemple. A partir de quand l’objet mérite-t-il qu’on lui accorde crédit ? Comment pressentir qu’un objet mérite qu’on le prenne en compte ? Nathalie Heinich6 a très bien montré comment procédaient concrètement les chercheurs de l’Inventaire . Le chercheur s’arrête. Il y a des codes ; le chercheur s’interdit de raisonner en son nom propre (on est dans un relativisme méthodologique, mais pas aveugle, qui s’agit de comprendre le sens potentiel de l’objet, donc cela implique une sorte de familiarité avec l’objet. Il y a une interdiction implicite du jugement en première personne, mais il faut comprendre aussi qu’on (que quelqu’un) puisse porter un jugement esthétique, symbolique, éventuellement éprouver quelque chose. C’est en effet une forme d’expertise.
Plus généralement, je dirais qu’il y a eu un réel basculement dans les années soixante-dix, avec la remise en cause de la hiérarchie dans les arts. L’envolée du goût pour le patrimoine vient aussi peut-être d’une réaction contre les corpus intangibles, d’une volonté d’affirmer que la liste de l’histoire de l’art n’est pas close, et de la volonté de nouveaux acteurs de participer au processus de décision. 1980, qui a été l’année du patrimoine, marque un véritable changement de registre à ce sujet : beaucoup de nouveaux acteurs, issus de la société civile, des collectivités locales, ont fait irruption sur cette scène. Un tel changement de rapport de force est aussi très visible dans les listes mêmes de ce que l’UNESCO accueille au patrimoine mondial. Le tiers monde y est de plus en plus présent, il y a de plus en plus de paysages, de cérémonies, etc., avec bien sûr toutes les récupérations politiques, et tous les problèmes de définition que cela pose.
AP : Plus loin, vous proposez ce qui n’est pas une définition mais un critère (car si peu interventionniste soit-on, il s’agit tout de même de faire des choix). « Toute œuvre susceptible de faire sens ». Du coup, l’interrogation se déplace : que veut dire être porteur de sens ? Qu’est-ce que cette dimension du sens ? Quels paramètres examine-t-on pour déterminer si une chose entre ou non dans la sphère du sens ? Vous évoquez votre fascination pour les codes (codes d’Hammourabi, code d’Ur-Nammu) qui sont à la fois des documents et des monuments – qui, à la fois, sont très anciens et renvoient aux sources de l’histoire humaine, ont une dimension documentaire, une dimension artistique…
MM : Je partage, je l’ai écrit, cette fascination pour les tables d’Hammourabi avec M. Loyrette, le directeur du Louvre. Plus généralement, je suis fasciné, je ne sais pas pourquoi, par l’écriture en tant qu’objet. Un autre objet qui me fascine est le mur de Gortyne, en Crète : sur lequel est gravée la loi. C’est un mur de dix à douze mètres de long, de trois mètres de haut, les caractères font une quinzaine de centimètres. Ce mur est formellement travaillé, il exerce une vraie séduction esthétique. A l’opposé, en Crète également, au musée d’Héraklion, l’objet qui me fascine le plus, ce sont les minuscules écritures qu’on appelle le linéaire A. Le linéaire A est considéré comme à l’origine de l’écriture linéaire, mais n’est pas déchiffré pour le moment. Ces deux objets, totalement différents par leurs dimensions et leurs fonctions, m’émeuvent tout autant. Mais il est difficile d’aller au-delà du témoignage personnel à ce sujet. J’emploie le mot ‘sens’ dans une acception très vulgaire et générale. Ce mot me paraît très difficile à définir ou à approfondir sans une référence à lui-même. En référence à Derrida : ce qui marque ou inscrit l’absence originelle de sens ? Cela reste très autotélique.

AP : Il y a cependant une tendance, dans l’art contemporain, à sortir du sens, à se vouloir en rupture avec le sens, d’aller chercher en amont, dans l’affect, dans ce qui ne relève pas des cadres de la compréhension, mais des comportements. Ou alors, il faut produire un concept de sens étendu : assumant le sans-sens, comme le fait Jean-Luc Nancy.
Je me permets une digression. J’ai travaillé, d’un point de vue philosophique et phénoménologique, sur la question du sens. Cette question, on le sait, a été contestée par le structuralisme, déconstruite, rendue extrêmement difficile par le post-modernisme. Elle a été envisagée sous un double horizon : celui du symbolique, d’une part, celui du sens perceptif, thématisé par exemple par Merleau-Ponty, d’autre part. Elle est reposée sous des angles différents, par des auteurs comme Jean-Luc Nancy ou Marc Richir, que j’ai interrogés pour Actu-philosophia).
Or, j’ai l’impression que le sens est aussi le fil conducteur de vos travaux. Alors que des travaux comme ceux d’Henri-Jean Martin7, ou de Roger Chartier8, ancrés dans l’école des Annales, se sont intéressés à ce qui touche à la matière même (l’évolution technique, la dimension économique), vous insistez davantage sur ce qui fait du livre une forme symbolique (une forme sens)9. Le livre a fait quelque chose – que d’autres objets ont fait et que de nouveaux objets assumeront peut-être. Plus encore que l’aspect mnémotechnique, il y a en lui cette fonction de « faire espace » et de « faire temps ». Dans cette perspective, on notera également votre intérêt pour l’architecture des bibliothèques10 : pour la bibliothèque en tant qu’édifice, pour ce qui, en apparence paradoxalement, demeure un lieu, une incarnation, dans une époque que l’on dit souvent marquée par la dématérialisation.
MM : Je serais assez d’accord avec vous, mais encore une fois, le mot sens traduit plutôt une perplexité. Si vous avez des références contemporaines lisibles pour un non-philosophe, je serai ravi d’en prendre connaissance.
AP : Vous citez beaucoup Malraux mais je suis intéressé par votre rapport à d’autres intellectuels, et à ce qu’ils apportent – et pour un historien de l’art, et pour un directeur de grande institution culturelle. Je pense en particulier à Derrida dont vous avez souvent revendiqué l’influence, de la façon dont son concept d’écriture et de trace (et de ce qui peut empiriquement jouer le rôle de la trace, de la danse, du rythme, etc.) peut motiver votre travail.
MM : Il est difficile de répondre à cette question. Je n’ai aucune formation philosophique, mais j’ai eu à plusieurs reprises l’occasion de travailler avec des philosophes. En particulier, j’ai travaillé avec Lyotard et Stiegler pour Les Immatériaux quand je dirigeais la BPI. J’adorais les discussions avec Lyotard, ses paroles toujours limpides, mais j’ai toujours été incapable de le lire. A force de relectures, je commence à comprendre quelque chose à De la Grammatologie de Derrida. Je suis nettement plus à l’aise avec les historiens de l’art allemands, dont les travaux ont une dimension réflexive forte. Wöllflin, Riegl, ou surtout Worringer, qui est pour moi l’équivalent de Saussure en histoire de l’art.
AP : L’Inventaire, écrivez-vous, accomplit et prolonge, déforme, le musée imaginaire de Malraux. Mais dès lors, réfléchir sur l’Inventaire devient aussi réfléchir sur l’idée de musée et son ambiguïté. Le musée, c’est bien en effet à la fois une mise en majesté de l’œuvre, et comme le pointait Valéry, un entassement. La muséographie, c’est à la fois la disposition raisonnée, cohérente des œuvres et la scénographie qui permet à l’œuvre de se manifester – ou mieux peut-être, qui permet la rencontre de l’œuvre. En ce qui me concerne, je suis par exemple plus sensible aux Musées du Vatican, pour le lien plus organique des œuvres à l’espace lui-même sinueux, tortueux, qui ne les expose pas mais les propose, qu’au Louvre. Avec l’Inventaire, il ne s’agit pas d’élargir le musée. Le risque de la muséification accompagne celui de la patrimonialisation, et a souvent été pointé. Or, ce n’est pas la finalité de l’Inventaire. Ici se pose donc toute la question de ce qu’implique vraiment l’inscription à l’inventaire, au patrimoine, aux monuments historiques, etc. Que signifie protéger ? Qu’inscrit-on exactement ? Qu’est-ce que cela implique ?
MM : En ce qui me concerne, j’apprécie la sculpture dans l’atelier du sculpteur. J’avais aussi beaucoup aimé les Musées du Vatican, pour les raisons que vous dites. Pour revenir à Malraux, malgré sa fascination pour les musées, il était bien conscient de tout ce que l’œuvre d’art perd en y entrant. L’avantage de l’Inventaire est de laisser l’œuvre in situ. Cela dit, pour en parler on l’isole au moins techniquement, en faisant une fiche, on la délimite. J’ai évoqué dans le livre les discussions interminables liées aux ensembles. Qu’est-ce qui relève du patrimoine ? La maison, l’îlot, le quartier ? Un fragment de la maison ? Ce n’est pas seulement une question méthodologique, c’est le problème essentiel du patrimoine. Quel sens y a-t-il à restaurer le balcon sans restaurer le reste de l’immeuble ?
Pour l’UNESCO aussi, la tendance est de plus en plus de prendre de grands ensembles, de globaliser. Il y a une propension inévitable de la patrimonialisation à englober de vastes espaces. Du coup, quel est le sens de cette patrimonialisation ? Juridiquement, les conséquences sont considérables, mais au-delà… c’est très flou. En quelque sorte, c’est bien le mouvement contraire de celui du musée : un refus de la fragmentation, de la classification. En même temps, la tendance à la classification, à la fragmentation est très occidentale. Le principe même du musée, qui est de fragmenter pour donner du sens, est très occidental. Pour d’autres cultures, il n’y aurait sans doute pas de sens à isoler et prélever un élément pour l’exposer. Comment le sens s’arrêterait-il « au bout du pinceau » ? Comment prélever quelque chose sans le briser ? La culture orientale est beaucoup moins sensible à cette nécessité de fragmenter et de distinguer.
J’avancerais, à titre d’hypothèse, qu’il y a un lien entre l’idée de fragmenter pour rendre intelligible avec l’écriture alphabétique, et que le musée tel que nous le connaissons est héritier de la civilisation alphabétique. C’est très spéculatif, mais tout le monde sait que c’est l’édit de Millet, en 403 avant JC, qui impose à toutes les cités grecques une écriture purement abstraite. Or, c’est au cours de cette même décennie qu’apparaît une sculpture à vocation réaliste. Avant le Ve siècle, l’image est toujours stylisée, hiératique et codifiée. Elle conserve une certaine indépendance avec le réel. L’idée d’imitation fidèle de la réalité pourrait être la contrepartie du passage de l’écriture symbolique à l’abstraction : celle-ci libérant en quelque sorte l’image de son rôle d’écriture symbolique. D’ailleurs, réciproquement, c’est à partir du moment où, avec la lithographie, l’écriture réintègre l’image, qu’un art abstrait se développe. Anne-Marie Christin a écrit une passionnante histoire couplée de l’écriture et de la représentation figurée : L’invention de la figure11.
AP : Selon vous, l’écrit est lui-même d’une certaine façon une image, et gagne à être considéré aussi comme ça. D’ailleurs, les symboles et pictogrammes ont fait depuis longtemps leur entrée dans le champ de la pensée. Le texte mathématique au début du XIXe était bien plus rédigé qu’il ne l’est maintenant. Les manuels de géographie à présent sont peuplés de schémas qui font sens par eux-mêmes, qui sont eux-mêmes de la pensée – où l’image a acquis le statut d’une écriture, l’écriture une spatialité d’image.
MM : Je m’intéresse énormément à l’histoire de l’écriture. Pas l’histoire de l’écriture dans sa dimension linguistique, mais à l’écriture comme objet matériel, et comme objet matériel de forte signification. Il me paraît de plus en plus évident qu’il y a une relation étroite, originelle, entre l’écriture et la figuration. Je renvoie encore à Anne-Marie Christin, L’invention de la figure, qui demande jusqu’où remonte l’image, au sens large. On peut faire des développements fascinants sur ce qu’il y a déjà d’image au sein des premières émotions, olfactives, tactiles, ou autres, et à la façon dont on peut anthropologiquement lier cette fonction physiologique originelle de l’image avec la figuration et son rôle.
AP : La phantasia
MM : Oui, le mot grec phantasia est tout à fait adéquat. Il désigne bien ce qui n’est pas encore stabilisé par la langue. Mais pour ma part, je n’ai pas trouvé de développements qui abordaient vraiment cette question. Chez Freud, la fonction imageante est toujours déjà capturée par la langue et stabilisée par elle. Comment penser des images non informées par la langue et leur fonctionnement dans la genèse des représentations ?
AP : C’est une question assez prégnante en philosophie contemporaine également. La phénoménologie contemporaine accorde un rôle capital à la phantasia. Marc Richir par exemple reprend et approfondit la distinction que faisait déjà Husserl entre phantasia et imagination (informée par la langue) pour se concentrer sur la dimension de la phantasia. Mais cette question de l’imagination « proto-formante », cette Einbildgkraft, irrigue en quelque sorte toute la pensée contemporaine depuis Kant, sinon depuis la renaissance, avec Ficin. Le concept de schématisme de l’imagination est crucial dans la philosophie kantienne – ce qui rend la sensibilité homogène aux catégories, qui inscrit dans la sensibilité quelque chose de passible à la reprise catégoriale. Cette fonction de l’imagination a été très étudiée par la philosophie contemporaine : comme passage de l’indéterminé au déterminé, comme constitution de la forme au creux de l’informe.
MM : C’est sur ce point qu’il faut examiner ensemble la question de l’écriture et celle de l’imagination, étudier l’écriture dans l’optique de la figure primitive. Les préhistoriens comme Leroi-Gourhan montrent bien que les premiers graphistes sont abstraits, que les premières figures ont quelque chose d’une écriture. D’ailleurs, c’est bien aussi la question que pose aussi le patrimoine : les investissements originaires de la fonction imageante et leur lien au symbolique et à l’esthétique. Comment passe-t-on de la phantasia à la figure ? De mon côté, je lie ça à l’évolution des techniques de l’écriture. Là encore, c’est très intuitif, mais comme je le disais plus haut, il y a vraiment des concomitances intrigantes. La dernière d’ailleurs est que la déconstruction est contemporaine du fait que sons et images puissent se retrouver sur un même support, le magnétoscope (1951). Au moment où Derrida propose de considérer la langue, et même la parole, comme une écriture, se développe une technologique qui permet de traiter en même temps le son et l’image comme des signaux d’information. Ces coïncidences sont très troublantes.
AP : En histoire du livre, vous vous intéressez à la matérialité du livre comme mise en scène du sens, au livre édifice, ainsi qu’à la matérialité de l’écrit : la présence de l’écrit dans l’espace urbain, public, de Rome à nos jours. On sent dans toute votre réflexion l’influence du travail d’historien de l’image12. Comme vous le rappelez d’ailleurs, la photographie interroge l’idée d’objet d’art à sa racine, et renvoie à des processus complexes qui sont aussi institutionnels. Une photographie ne peut être considérée comme œuvre d’art que si son tirage est limité, etc. Malraux voyait bien que la reproduction allait faire changer l’œuvre de statut, mais l’idée même de reproduction est du même coup contestée. « A la conception de l’image comme dégradation d’un original, il faut substituer celle d’une image dont chaque version enrichit l’original, devient l’original.13 »
MM : Oui. Ce que Didi-Huberman étudie avec la question des sceaux. C’est patent avec la question du moule, dont chaque exemplaire hérite en quelque sorte de son unicité, comme si le moule se sacrifiait dans ses enfants que sont les exemplaires que l’on produit grâce à lui. Il faut vraiment penser ça au sens génétique ; la relation parentale en est la meilleure métaphore.
Cette question est intimement liée à celle du patrimoine. Je la lie à ce dont vous parliez plus haut, avec l’idée de socialisation de l’objet, qui pour avoir une valeur, doit coaguler. Cette socialisation est totalement liée à l’idée du marché et de la reproduction. La copie électronique en change complètement la donne. L’histoire de l’estampe est extrêmement instructive sur tout ça. Comment arrive-t-on à dupliquer quelque chose en individualisant ?
Ce qui me frappe à ce sujet, c’est que l’histoire de l’écriture tient peu compte des procédés de reproduction de l’écriture. On étudie l’écriture dans son rapport à la langue, à sa forme graphique, sa fonction énonciative, mais on laisse souvent de côté la question de la duplication des exemplaires. Or, dans l’idée d’écriture, il y a bien cela aussi : l’écriture est faite pour se multiplier. La langue ne se multiplie pas. Ma parole ne peut être tenue que par moi. L’écriture en revanche prolifère. L’électronique met cette question de la prolifération de l’écriture en relief. Ses répercussions sur l’appréhension de l’objet sont importantes. C’est le même phénomène qu’avec le passage du musée au patrimoine. Une sorte de prolifération, et un effritement du régime de l’objet.
AP : Est-ce qu’on peut dire que l’habitude du rapport à l’image – et surtout ces images spécifiques que sont les estampes et les photographies – aide à se sentir moins dérouté par la fragmentation de l’art et de l’œuvre à présent, donc à la question du patrimoine ?
MM : Mes collègues de l’Inventaire attachaient peu d’intérêt à la photographie, et restaient convaincus de l’importance de la fiche. Un détail révélateur : les photographes étaient engagés en catégorie C, et considérés comme de simples exécutants qu’on envoyait ramener des clichés selon une liste arrêtée extrêmement stricte de spécifications. Toutes les consignes données allaient à l’encontre de la photographie comme création. Or, je me souviens de discussions vraiment enrichissantes avec les photographes, qui allaient bien au-delà des détails techniques. Je me suis fait une réputation de défenseur de la photographie et du travail des photographes, même si je n’avais bien sûr aucun moyen de faire passer d’un coup cinquante personnes de la catégorie C à la catégorie A. Le rôle de la photographie dans la révélation du patrimoine est central : ce qui restera d’abord de l’Inventaire, c’est la banque de photographies, bien plus que les fiches.
AP : Une dernière question. L’Inventaire, écrivez-vous, matérialise les nouvelles valeurs dont les communautés se dotent pour exister14. Une autre question intéressante se pose ici. Qui est en charge de l’Inventaire ? Celui-ci atteste certes d’un déplacement de la sphère privée – dimension publique, mais comme vous le faites remarquer, finalement, l’État en tant que tel n’a pas vraiment besoin de l’inventaire, ne sait pas quoi en faire. L’État se définit par lui-même – par les conséquences immédiates que ça a d’être français plutôt qu’allemand, etc. Ce sont les Régions qui sont en charge de l’Inventaire depuis 2004 – elles aussi, qui en ont le plus besoin.
MM : Tout à fait. La décentralisation a eu du mal à passer, mais pour moi il y avait vraiment du sens à donner le patrimoine à la Région. La Région se cherche, elle n’a pas d’identité définie. Le Département est formel, défini selon des raisons électorales (on devait pouvoir aller voter à cheval à son chef-lieu en une journée), sans réalité géographique. Personne ne dit « je suis loir-et-chérien, on dit je suis de Touraine… Mais c’est un sens très flou, qui reste à trouver. L’État français au contraire n’a pas besoin de se trouver. Il a ses frontières, ses lois : comme vous dites, il se définit par lui-même, comme le roi autrefois. Il n’a pas besoin de son patrimoine, sinon pour l’inventorier comme ensemble des richesses qu’il possède. La Région, elle, a besoin de son patrimoine. Tout ce qui a une réalité géographique, humaine, mais n’est pas définissable a priori a besoin de telles médiations.
- https://www.actu-philosophia.com/spip.php?article411
- Mirabilia. Essai sur l’inventaire général du patrimoine culturel, p. 61
- Par exemple, « Entretien avec un Japonais », dans Acheminement vers la parole.
- N. Heinich, « Des limites de l’analogie religieuse. L’exemple de la célébrité », Archives des sciences sociales des religions, n°158, avril-juin 2012, p. 157-177.
- Mirabilia, p. 44
- N. Heinich, La fabrique du patrimoine, Paris, éd. de la Maison des sciences de l’homme, 2009.
- L’Apparition du livre, avec Lucien Febvre, Albin Michel, Paris, 1958, Histoire et pouvoirs de l’écrit, préface de Pierre Chaunu, Perrin, Paris, 1988.
- L’Ordre des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe siècle, Alinea, coll. « De la pensée / Domaine historique », Aix-en-Provence, 1992
- Livre, Paris, l’Œil neuf éd., 2006.
- Nouvelles Alexandries les grands chantiers de bibliothèques dans le monde, sous la dir. de Michel Melot. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1996.
- L’invention de la figure, Paris, Flammarion, coll.« Champs- arts ».
- Une brève histoire de l’image, Paris, l’Œil neuf éd., 2007.
- Mirabilia, p. 132.
- Mirabilia, p. 26.








