L’œuvre de Marc Richir1 constitue une contribution majeure à la philosophie comme telle, d’abord, à la phénoménologie dans son ensemble pour l’explicitation de ses méthodes et a priori ensuite, à certaines questions phénoménologiques enfin – le sens, l’imagination, l’affectivité, la temporalité et la spatialité – dont elle propose une élaboration novatrice et profonde2.
Cette œuvre ample – plus de 10000 pages publiées à ce jour – complexe et diversifiée trouve peu à peu l’audience qu’elle mérite et suscite de plus en plus de travaux philosophiques – citons en particulier Le sens se faisant3 d’Alexander Schnell, ou l’excellente thèse de Robert Alexander, La refondation richirienne de la phénoménologie : les multiples enjeux de la refonte et de la refondation de la phénoménologie transcendantale chez Marc Richir à partir du traitement de la question de l’espace/temps phénoménologique archaïque4 – et d’intérêt venant d’autres champs du savoir, en particulier, de la psychopathologie. Par son ampleur, elle entre en résonance non seulement avec les autres projets de refondation phénoménologiques mis en œuvre par Maldiney, Michel Henry, Jacques Garelli, Jean-Toussaint Desanti ou Jean-Luc Marion, mais aussi avec les mises en question et déconstructions qui, via Heidegger et surtout Derrida, semblent ébranler les conditions de possibilité même de l’exercice de la philosophie.
La phénoménologie génétique de Marc Richir se présente comme une refondation globale et systématique de la phénoménologie qui en interroge les conditions de possibilités théoriques et méthodologiques et tente d’expliciter le statut du phénoménologique comme tel. Elle cherche à la fois à préciser et ré-effectuer le détail des analyses husserliennes, à en interroger les décisions et les orientations fondatrices, et à en transposer la méthodologie sur des plans que Husserl laisserait en friche.
Ses derniers ouvrages publiés, Variations sur le sublime et le soi 15 et 2 6, prolongeant des recherches antérieures consacrées à la genèse et la structuration du sens 7 mettent en chantier une refonte ambitieuse de la pensée des processus par lesquels l’expérience devient expérience sensé, expérience humaine, donc. Cette problématique de l’origine de la pensée – de la pensée humaine – est liée par Richir à la thématique classique du sublime. Pour Richir, c’est en effet un « événement sublime » (événement qui n’est d’aucun lieu et d’aucun temps mais qui par sa survenance ouvre l’expérience à sa temporalisation/spatialisation) qui suscite l’écart d’avec soi de l’expérience qui est la forme transcendantale du sens se faisant. L’expérience sublime demeure cependant toujours latente, à l’état de trace, au sein de la pensée : il y est sublime en fonction.
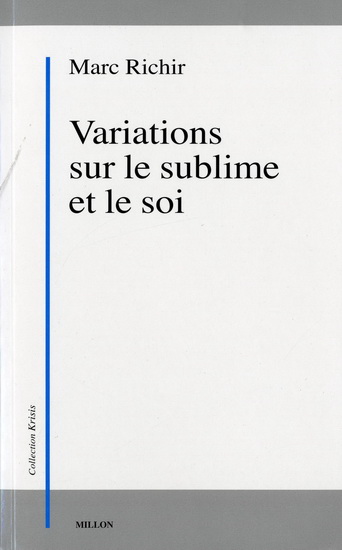
Notre entretien n’est pas limité aux derniers ouvrages d‘autant que Richir a actuellement en chantier un nouveau traité de grande dimension consacré à la question de la politique, en dialogue étroit avec Schelling. Notre but est aussi ici d’aider ceux qui ne sont pas familiers avec la terminologie richirienne à s’orienter parmi les concepts principaux de son œuvre.
Il y a sans doute en effet deux choses qui en rendent l’accès difficile. D’abord, une terminologie très riche (qui a des motivations dans la signification historique des concepts repris, déplacés) qui peut désorienter, occulter la matière phénoménologique qui la motive. Ensuite, une façon de procéder devenue rare. Richir publie en effet des recherches – la pensée n’étant pas un résultat mais un processus se faisant, inséparable de sa temporalité, de ses accélérations, de ses hésitations, de ses court-circuits, de ses retours en arrière, de ses accidents. Les livres de Richir ne livrent pas des conclusions toutes faites, ni une déduction pré-orientée : d’où les nombreux va et vient, les renvois, l’ébranlement des concepts par la pensée qu’ils soutiennent…
La phénoménologie transcendantale
Actu-Philosophia : Vous êtes avant tout un phénoménologue. Vous proposez une refonte et une refondation de la méthode phénoménologique et de ses outils. Celle-ci passe d’abord par une reconsidération du phénomène, que vous comprenez comme rien-que-phénomène. Ce concept de rien-que-phénomène est sans doute ce qu’on connait le mieux de votre œuvre, et c’est sur cela que vous avez-vous-même insisté, par exemple dans le numéro du Magazine Littéraire de 2001 consacré à la Phénoménologie, ou encore dans l’entretien que vous avez accordé à la revue Philosophie en 2010. Ce qu’on sait peut-être moins, c’est qu’il y a dans ce concept une reprise et une radicalisation de la façon dont Husserl lui-même conçoit le phénomène – dans l’Appendice de la Recherche Logique VI par exemple. Husserl explique en particulier que le vécu n’est pas le phénomène mais un moment abstrait (dépendant) du phénomène qui n’y accessible qu’au prix d’une réflexion interne. Plusieurs de vos textes reprennent cette, disons, déduction transcendantale du phénomène : par exemple « Qu’est-ce qu’un phénomène ? » , Les études philosophiques n°4/1998, Le phénoménal et sa tradition Paris : Presses Universitaires de France, 1998, ou bien « Le sens de la phénoménologie » dans La phénoménologie comme philosophie première en 2011. Pourriez-vous en dire quelques mots.
Marc Richir : Je dirais justement essayer de considérer le phénomène comme rien que lui, comme rien d’autre que lui-même. Pas comme phénomène d’autre chose que de lui-même. Le phénomène n’est presque rien tout en n’étant pas néant. Il n’est pas non plus phénomène d’être. Il peut aussi y avoir phénomène illusoire, illusion, simulacre. Il faut le voir aussi, pour reprendre la formule de Pablo Posada Varela, dans son article du dernier numéro des Annales, comme un tout concret de concrétudes par-là même phénoménologique8. A priori, le phénomène n’a pas grand-chose à voir avec la perception. Par exemple, on peut parler de phénomène de pensée, ou de phénomènes qui sont pensées. Ces tout concrets sont articulés les uns aux autres en schématismes, et en schématismes phénoménologiques. On y reviendra sans doute plus tard.
AP : Mais ne peut-on pas dire au moins que sinon la perception, du moins une sorte de sensibilité donne le prototype du phénomène ?
MR : Le phénomène n’est pas a priori perceptuel, ni à proprement parler sensible. Il faut dire qu’en régime phénoménologique, le phénomène est converti en concrétudes phénoménologiques. Mais précisément, ce n’est rien a priori de sensible au sens courant. C’est là tout le cœur de l’énigme, mais c’est très difficile à expliquer en style direct. Les phénomènes, en tout cas, sont des non-positivités. Il y a une part d’indétermination constitutive en eux.
AP : J’aimerais dans la même perspective insister sur le caractère transcendantal de la phénoménologie que vous revendiquez, qui se manifeste d’abord par la forme que prend votre radicalisation du concept de phénomène. Vous invitez par votre travail à une réévaluation de l’intérêt du transcendantalisme. Alors qu’il s’agit d’aller en deçà de toute « pré-compréhension », de tout idéalisme linguistique, d’éviter de prendre le mot pour la chose, vous montrez que la perspective transcendantale est très puissante pour cela – bien plus forte que toutes les tentatives de « détranscendantalisation ». Vous montrez au contraire, avec votre conception des registres architectoniques, qu’il y a des motivations transcendantales à différentes problématiques (l’altérité et l’extériorité, la hyle9, le Leib10, le Körper11 et le Leibkörper12 ; on reviendra sans doute plus loin sur ces concepts) qui n’ont de sens qu’à partir du moment où elles sont envisagées « au bon endroit ».
MR : Vous le dites très bien : les notions phénoménologiques n’ont de sens qu’envisagées au bon endroit. C’est toute la question de l’architectonique. Vous prenez des problématiques comme la hylé – et bien précisément, la hylé des concrétudes n’est pas matérielle. Chez Husserl non plus d’ailleurs. De la même façon, le Leib n’est pas déterminé et limité. Il a nécessairement quelque chose d’indéterminé. Ce qui est déterminé, c’est le Leibkörper – parce que là il y a Körper, c’est la dimension du Körper qui limite. Mais comprendre cela, cela implique d’abord de ne pas confondre Leib et Leibkörper.
Ce qui permet la voie d’accès aux phénomènes, à leur juste place, c’est l’épochè phénoménologique qui démantèle les touts concrets pour en faire voir les ingrédients, les dimensions. Le Leib est une dimension de la problématique de la spatialité, le Körper en est une autre, le Leibkörper encore une autre. A chaque fois, ce ne sont pas les mêmes problèmes et il ne faut pas leur apporter les mêmes réponses.
Influences
AP : Votre transcendantalisme est nourri d’abord par Kant, mais est également fortement marqué de de thèmes fichtéens. Autant Alexander Schnell dans Le sens ce faisant que Robert Alexander dans sa thèse ont insisté sur l’importance de la référence fichtéenne chez vous – alors que vous mettez davantage l’accent sur Kant. Pourriez-vous, en quelques mots, résumer ce que vous retenez d’essentiel chez Kant et chez Fichte.
MR : Chez Kant, essentiellement la distinction entre a priori et a posteriori.
Et l’ébauche, l’esquisse de phénoménologie qu’il y a dans « l’Analytique transcendantale » et dans la « Dialectique transcendantale ». La dialectique transcendantale est une problématique de l’illusion transcendantale. Illusion qui pour moi est phénomène. Mais cette illusion dont, comme le montre Kant, on ne peut pas se débarrasser. Une illusion nécessaire.
Et bien sûr, ce qui m’a retenu chez Kant, c’est le schématisme et surtout, dans la troisième critique, le schématisme esthétique, le schématisme réfléchissant.
Chez Fichte, mais je vous parle ici a posteriori, c’est, bien qu’il ne le dise pas clairement, la mise en jeu, en œuvre de l’hyperbole. Le premier principe de la 1ere Wissenschafstlehre13 de 1794, c’est clairement la mise en œuvre d’une hyperbole.
Ce qui distingue cependant le transcendantalisme de Kant et Fichte de celui de Husserl, et de celui que je mets en œuvre, c’est qu’il ne s’agit plus pour Husserl de légitimer. Alors que chez Kant, il s’agit de légitimer – en particulier dans la Critique de la Raison Pure – et chez Fichte, de fonder la science. Ce privilège de la science me paraît particulièrement limitatif.
Chez Husserl, le transcendantal n’a pas vraiment de fonction légitimante. L’attitude naturelle est là, elle précède ce qu’on peut en dire, il ne s’agit pas de la légitimer, mais de comprendre ce qui se passe en elle. Même quand Husserl fait explicitement des mathématiques et de l’épistémologie des mathématiques, il le fait pour comprendre ce qui se passe dans l’effectuation des opérations logiques, des actes d’abstractions, etc. Quand on regarde bien, Husserl cherche toujours à rendre compte de ce qui se passe, et se garde d’introduire des procédures épistémologiques de légitimation a priori.
La logique transcendantale chez Husserl est très différente de la logique kantienne. Elle n’est pas normative, même si finalement, Kant lui-même fait des mathématiques quelque chose de légitimant et pas de légitimé. Les mathématiques pour Kant sont la preuve que les jugements synthétiques a priori sont possibles parce qu’ils sont mis en œuvre dans les mathématiques. Toute la question, pour Kant, c’est la physique. Le rôle de la déduction transcendantale des catégories, c’est surtout la déduction des conditions de possibilité de la physique. Pour moi, la table des catégories kantienne tombe un peu du ciel – ou plutôt de l’institution symbolique. Pourquoi ces catégories-là précisément ? C’est ce qu’il y a de plus daté dans sa philosophie.
AP : Vous reconnaissez également le questionnement de Merleau-Ponty sur le dégagement d’une eidétique sauvage, d’une phénoménalisation pré-articulée par des Wesen sauvages14, comme une source d’inspiration – vous reprenez d’ailleurs un certain nombre de termes merleau-pontyens. Vous êtes aussi influencé par la problématique de la parole opérante et du sens se faisant – Laszlo Tengelyi, dans L’histoire d’une vie et sa région sauvage a fait de cette thématique le principal point d’entrée dans votre œuvre, et Alexander Schnell a intitulé son bel ouvrage qui vous est consacré Le sens se faisant. Dans ses cours, Tengelyi vous présente comme le philosophe qui a permis d’entrer le plus loin dans l’épaisseur (le terme est de moi) de l’existence humaine, dans tous les méandres et les sinuosités du vivre Comment définiriez-vous votre rapport à ces questions merleau-pontyennes ?

MR : Mon rapport à Merleau-Ponty est compliqué. J’ai été très influencé dans ma jeunesse par Merleau-Ponty, et particulièrement, vous le dites bien, par la problématique très énigmatique des Wesen sauvages. Derrière l’attitude naturelle, et même derrière l’expérience phénoménologiquement réduite au sens husserlien, Merleau-Ponty cherche une dimension plus fondamentale. Pour Merleau-Ponty, cette dimension vient de la Leiblichkeit15. Or, il y a une chose que je n’admets plus du tout, c’est la problématique de la chair. Pour moi, il y a un lieu architectonique bien précis pour cette question. La réversibilité a un sens phénoménologique, mais elle n’est pas universelle. Elle est valable à un certain registre uniquement.
Cela dit, il est toujours difficile de parler de Merleau-Ponty, car on parle d’une œuvre inachevée. Le Visible et l’Invisible est une ébauche. Il est très difficile de savoir fixer précisément les axes problématiques de ce texte, de savoir ce que Merleau-Ponty voulait vraiment dire. En résumé, je garde un certain attachement à Merleau-Ponty, mais je me sens dégagé par rapport à lui. En fait, il y aurait beaucoup trop à dire. Je suis encore assez satisfait de mon texte à ce sujet, dans un Appendice de Phénoménologie en esquisses.
AP : Je vais maintenant dire un mot de deux auteurs avec lesquels votre rapport est plus distant : Heidegger et Derrida. Pour vous, il s’agit explicitement d’aller au-delà. Mais d’un autre côté, vous êtes occupé par ce qu’ils ont posé : je vous avoue d’ailleurs que c’est en cherchant des forces théoriques et spéculatives pour aller au-delà de ce qu’ils ont mis en question que je suis arrivé à votre œuvre pour ma part. Le thème de l’Ereignis est ainsi longuement discuté dans votre premier ouvrage publié, Au-delà du renversement copernicien. La thématique de archi-écriture chez Derrida, en particulier telle qu’elle est introduite dans « Linguistique et grammatologie » dans De la grammatologie, est très présente dans vos premières œuvres, jusqu’à Phénomènes, Temps et Etres. Dans sa thèse qui vous est consacrée, Robert Alexander a tenté de montrer quelle « circulation » articule Heidegger, Derrida, Fichte dans le premier moment de votre œuvre. Pour schématiser (c’est le cas de le dire) : vous radicalisez Heidegger par la pensée de la différence, qui vous accompagne sur le chemin du « rien » : du phénomène pur. Mais aussitôt, selon un schéma très fichtéen, vous montrez comment ce phénomène vide s’auto-réfléchissant se mondanise, comment l’auto-réflexion du rien que phénomène le pluralise en monde – en mondes. Pouvez-vous, en quelques phrases, expliciter votre rapport à Heidegger et Derrida ?
MR : Mon rapport à Heidegger est évidement complexe. Je ne parlerai pas du premier Heidegger, et du statut très équivoque de ce qu’il appelle la problématique phénoménologique du sens de l’être. La question m’a été posée par Alexander Schnell rue d’Ulm16, je vais en profiter pour préciser ma réponse. Je disais que la problématique de l’être est trop massive. Il y a chez Heidegger une sorte d’éléatisme qui ne me satisfait pas du tout. Et il y a une pièce fondamentale qui manque chez Heidegger : la dimension du simulacre.
Chez Heidegger, il y a éventuellement de l’erreur, éventuellement confusion d’un étant avec un autre étant, comme Platon l’explique dans le Théétète. Mais il n’y a pas, ce que Platon montre très bien, lui, dans le Sophiste, de simulacre, de simulacre qui donne au néant l’apparence de l’être. Pour moi, c’est un défaut fondamental, qui me fait me séparer radicalement de Heidegger. Il n’y a jamais par exemple de réflexion chez Heidegger sur l’illusion.
Par exemple, l’illusion de Lichtung17. Heidegger ne se demande pas ce qui distingue une mauvaise œuvre d’art d’une bonne. Une mauvaise œuvre, c’est-à-dire qui a l’air d’une œuvre, qui a une illusion d’aura, mais dans laquelle il n’y a que de la rhétorique. Une œuvre qui, en fait, n’illumine rien. Cette question fondamentale totalement absente fait tomber Heidegger dans un éléatisme radical, l’éléatisme de Parménide plutôt que de Zénon.
Quand à Derrida…. Autant effectivement j’ai été très intrigué par la notion d’archi-écriture, qui est un peu l’ancêtre de ce que j’appelle le schématisme… Autant je trouve que par la suite, après la Grammatologie, la pensée de Derrida a tourné à la sophistication, voire, à la sophistique. Même dans la Grammatologie, on ne peut pas se retenir de penser que Derrida construit de bout en bout la figure de Rousseau qu’il veut déconstruire. Alors oui, Derrida lui, pense la notion de simulacre. Mais chez lui en quelque sorte, il n’y a plus que des simulacres, ce qui n’est pas satisfaisant non plus.
Evolution
AP : Vous êtes originairement un physicien. Vous avez travaillé en relativité générale, il me semble. Je voudrais naïvement vous demander comment d’abord s’est fait le passage à la philosophie. Et comment avez-vous choisi la phénoménologie ? Par quel chemin intellectuel, d’abord, mais aussi académique. Qui ont été vos professeurs ? Sur quoi portait votre thèse ?
MR : Qu’est-ce qui m’a séduit dans la physique, d’abord ? Une intuition de jeunesse, qui me rendait à mon insu pythagoricien. J’avais l’intuition que le fond des choses était mathématique. Mais j’étais travaillé par la philosophie. C’est par Kant que j’ai compris qu’on ne pouvait pas aller au fond des choses avec la physique. Ensuite, qu’est-ce qui m’a amené à la phénoménologie ? Je ne saurais exactement le dire. Je sentais sans doute qu’il y avait chez Husserl une forme de rigueur qui se rapprochait le plus de la rigueur scientifique que je connaissais.
Après un an à l’Institut d’Astrophysique de Liège, je me suis donc inscrit en philosophique. Mes professeurs ont été Jean Paumen (un homme très cultivé, au bon sens du terme), et évidement, Max Loreau. C’est lui qui m’a amené à l’esthétique, et en particulier à la peinture. J’ai commencé grâce à lui à comprendre ce qu’était la peinture.
Ma thèse portait sur le jeune idéalisme allemand et s’intitulait Au-delà du renversement copernicien : la question de la cosmologie philosophique dans le jeune idéalisme allemand. Au-delà du renversement copernicien en était l’introduction. Le rien et son apparence était la partie sur Fichte. Il y avait aussi une partie sur Kant et une partie sur Schelling que je n’ai pas publiées et que je ne publierai jamais.
AP : J’en profite pour vous interroger immédiatement sur votre rapport aux sciences. Il semble que des, disons des dispositions de physicien, des expériences de pensée de physiciens, ont pu orienter certaines modalités de votre phénoménologie. Il y a un bon article d’Albino Lanciani à ce sujet : « Phénoménologie et réalité du physicien », dans L’œuvre du phénomène, Mélanges de philosophie offerts à Marc Richir, Bruxelles : Éditions Ousia, 2009. Les mathématiques ont également été un objet de questionnement pour vous, par exemple dans la Recherche Phénoménologique IV.
MR : Ce que j’ai appris dans la physique c’est comment, avec un formalisme mathématique, on arrive à établir de façon très locale, ponctuelle, un rapport au réel. Une équation physique n’est pas une équation mathématique : tout doit avoir des raisons physiques, tirées d’une manière ou d’une autre de l’expérience.
Donc, c’est un certain rapport au réel qui m’a intéressé dans la physique. Justement, un rapport problématique. Un dispositif expérimental, c’est un artefact. Ce qui est caractéristique du physicien, c’est qu’il doit savoir poser les bonnes questions à partir d’une base théorique.
Les mathématiques elles ne s’intéressent pas au rapport au réel. Elles s’élaborent sans impliquer la recherche de correspondants quelconques dans le réel. Il m’est arrivé par ailleurs de caractériser les mathématiques comme la seule institution symbolique capable de s’autoréguler, parce qu’on ne peut bien sûr pas faire n’importe quoi en mathématiques.
Ce qui est intéressant dans la physique, c’est de décrire comment une telle institution symbolique peut construire de manière autorégulée des artefacts par lesquels on pose de bonnes questions à la nature.
Au premier degré par exemple, les concepts fondamentaux de la mécanique quantique ne correspondent plus à rien. Ils rendent compte d’un système indéterminé dont les états sont mélangés. Si vous voulez effectuer une mesure, il faut modifier le système, c’est-à-dire réaliser une préparation, passer par un artefact compliqué. Par exemple faire passer un flux d’électron dans un tube cathodique et le soumettre à un champ magnétique…
Pour un physicien, l’important est qu’une expérience soit répétable dans les mêmes conditions. C’est le critère de l’objectivité. Regardez l’affaire des mésons qu’on a crus plus rapides que la lumière. La sagesse des physiciens a été exemplaire. Au lieu de chercher à remettre en cause tout l’édifice de la relativité restreinte et de la relativité générale, ils se sont dit tout de suite qu’il y avait certainement une erreur quelque part dans le protocole. Et en effet : il y avait une erreur de calibrage des horloges, de l’ordre du milliardième, mais suffisante pour donner des résultats aberrants. Tout ça pour dire que la physique a affaire à un type d’objectivité qui n’a plus rien à voir avec le concept classique d’objectivité. Et que ce que je trouve admirable chez le physicien, c’est leur façon d’assumer que quelque chose n’est vrai que jusque à preuve du contraire. Les philosophes en sont loin.
AP : Pour continuer encore sur ce thème : une des dimensions les plus puissantes de votre œuvre, est, il me semble, qu’elle ne renie pas l’interrogation épistémologique de Husserl, ni la question de l’eidétique. Elle entend seulement en déplacer le champ, montrant ce qui est sous-jacent à l’eidetique que découvre Husserl – dévoiler, en deçà, un champ antéprédicatif plus sauvage, plus riche, finalement plus générateur que ce que Husserl en dit dans Logique formelle et logique transcendantale ou Expérience et jugement.
MR : Je suis tout à fait d’accord. Ce que je dirais, c’est que l’explicitation phénoménologique, y compris épistémologique, doit éviter la circularité, ce que Husserl ne fait pas dans les textes que vous citez : l’antéprédicatif y est un peu le petit frère du prédicatif. Or il faut surtout éviter de se donner « ce qu’il faut » pour que ça marche. Les concrétudes phénoménologiques sont libres, anarchiques, a-téléologiques. Rien ne les oblige à être structurées de façon homogène aux lois logiques.
AP : Pour revenir à la période de vos débuts en philosophie. Vous avez été membre fondateur de la revue Texture, avec Lefort, Castoriadis, Gauchet et Abensour. Quelle était le projet ou l’interrogation commune à la base de cette revue. Quels souvenirs gardez-vous de cette période ?
MR : Peu de choses à dire, sur Textures. Ça a été une belle entreprise : faire une revue philosophique et politique, parcourant tout le champ des sciences humaines. Une revue politique non-militante. Lefort et Castoriadis ont fait par ailleurs une revue militante, Socialisme et Barbarie. Mais Textures, ils l’ont répété, n’était pas Socialisme et barbarie 2. Il s’agissait de traiter du contemporain, mais en philosophes. Lefort venait de publier son Machiavel, Castoriadis allait publier Le monde morcelé. Gauchet était l’assistant de Lefort, Abensour était assistant à la Sorbonne, et j’étais depuis peu au FNRS. J’en ai gardé d’excellents souvenirs. Il y avait une vraie communauté de pensée, et on s’amusait bien. Je suis toujours resté très proche de Miguel Abensour.
AP : Entre la fin des années 70 et le début des années 90, votre pensée a peu à peu évolué vers une plus grande fidélité à la méthode et aux outils husserliens. J’aimerais vous demander les motivations de cette évolution. Celle-ci passe par un réinvestissement de la question des synthèses passives, dans Méditations phénoménologiques, puis par un réexamen approfondi des réflexions husserliennes consacrée à l’imagination et la phantasia (réexamen qui s’est accompagné d’un travail éditorial soutenu).
MR : Ma grande découverte, on peut parler de rupture dans ma vie intellectuelle, a véritablement été celle du volume XXIII des Husserliana. J’y y trouvé quelque chose de vraiment nouveau, qui m’a fait comprendre beaucoup de choses que j’ai tenté de prolonger ensuite. Ça a été un moment capital pour moi. J’y ai trouvé de quoi reprendre la question du simulacre qui est, je vous l’ai déjà dit, une question absolument capitale pour moi.
AP : La politique, enfin occupe une place non négligeable dans votre œuvre. Pour être plus précis, il y a tout un nœud de questionnement entre le symbolique (présent partout, mais auquel est en particulier consacré le deuxième tome de Phénomènes, Temps et Etres), le mythe (La naissance des dieux, L’expérience du penser), l’histoire et la politique enfin (Du sublime en politique). Vous avouez avoir personnellement une fascination pour l’histoire, mais il semble que votre vision de l’histoire soit assez, disons, tragique, que ce qui vous intéresse le plus dans ce nœud, c’est bien une certaine teneur tragique. Puis-je vous demander ce qui vous retient particulièrement dans la question politique.
MR : Question complexe ! Disons, pour parler vite et sans entrer dans mes motivations personnelles : la polis comme Sache. C’est-à-dire : qu’est-ce qui tient les hommes ensemble dans une société, dans une cité. Par exemple, qu’est-ce qui fait que nous sommes ici à nous sentir (en tout cas c’est mon cas) européens. Pas américains ou asiatiques, européens, alors même que l’Europe est morcelée, a été traversée par des guerres intestines, divisées par des langues différentes.
C’est vraiment une question complexe. Qu’est-ce qui fait que les hommes se sentent appartenir à la même société ? Je dis bien société, pas ethnie ou catégorie sociale ou agrégat ! Qu’est-ce qui justement distingue une société d’un agrégat !
Je me suis d’ailleurs posé la question pendant que Sarkozy était au pouvoir : la France est-elle encore une société ? N’est-elle pas juste un agrégat tenu ensemble par une administration ? Cette question doit bien être distinguée de celle de l’identité. Elle est beaucoup plus subtile : se sentir concerné par les affaires d’un pays, qu’est-ce que ça veut dire ?
- Le portrait dessiné de Marc Richir est issue d’une série de Pierre Vermersch. Nous remercions celui-ci de nous avoir autorisé à l’utiliser.
- Ces quelques phrases de présentations sont une version légèrement modifiée du début de l’introduction de notre ouvrage La phénoménologie de Marc Richir, non encore paru
- Bruxelles : Ousia, 2011
- Soutenue à l’Université de Toulouse en 2011
- Grenoble : Jérôme Millon, 2010
- Amiens : Mémoires des Annales de Phénoménologie, 2011
- Méditations phénoménologiques sur le langage
- Pablo Posada Varela, « Concrétudes en concrescences », pp. 7-56, iin Annales de Phénoménologie nº11, Association pour la Promotion de la Phénoménologie, Beauvais, 2012
- Le concept de hyle est un concept fonctionnel issu de la décomposition du phénomène comme structure : à la noèse correspond le noème, et au noème appartient une hyle qui s’y anime (ou y est animée). Le terme de hyle est introduit comme un moment qu’il faut nécessairement dégager pour la cohérence de l’élucidation noématique de la visée ; la hyle n’a de sens descriptif que dans son partage avec le noème (auquel il « appartient » métaphysiquement, mais sur un mode qui, précisément, l’en détache, comme ce qui est mis en forme en lui, et qui d’une certaine façon, le transcende, ou plus exactement, est ce en quoi se manifeste l’effectivité de la transcendance visée)
- Qu’on traduit généralement par chair, qui désigne le corps pris en tant que dimension phénoménologique
- Qu’on peut traduire par corps objet, qui occupe lui-même une place dans l’espace physique et y est lui-même perceptible
- littéralement, le corps de chair, la dimension phénoménologique du corps en tant qu’elle est ancrée dans un corps-objet qui occupe lui-même une place dans l’espace physique et y est lui-même perceptible
- Doctrine de la science
- Richir utilise, avec Merleau-Ponty, le terme de Wesen sauvages – littéralement êtres au sens verbal, êtres phénoménologique dont l’essence est d »ester » pour désigner les concrétudes originaires qui pré-dessinent le champ phénoménologique, y laissent pointer des lignes de forces, des lignes de relâchement
- Corporéité au sens phénoménologique…
- NB : lors du colloque Nouvelle phénoménologie en France, http://www.ens.fr/spip.php?article1306, tenu à la suite de la parution de l’ouvrage de Hans-Dieter Gondek et László Tengelyi, Neue Phänomenologie in Frankreich, Berlin : Suhrkamp, 2011
- Clairière, ouverture : mouvement par lequel l’être se donne à entendre








