Spécialiste de la première philosophie de Husserl, Jocelyn Benoist conduit depuis plusieurs années une confrontation féconde entre philosophie analytique et phénoménologie. Professeur à Paris I, il a déjà donné un entretien en deux parties au site Actu-Philosophia en 2012 que l’on peut consulter ici et là. Nous le remercions de sa gentillesse et de la bienveillance indéfectible qu’il témoigne à l’égard du site.
Propos recueillis par Raoul Moati qui a par ailleurs recensé l’ouvrage ici et là.
Raoul Moati : Partant d’Anaxagore, c’est-à-dire au moment fondateur où la notion de phénomène fait son entrée en philosophie, jusqu’à la phénoménologie actuelle, Logique du phénomène 1 retrace, dans ses grandes lignes, l’histoire de la notion de phénomène qui n’est autre, à te lire, que celle de sa lente et progressive dégrammaticalisation – ou absolutisation. Tu expliques que la phénoménologie consiste en un platonisme qui en aurait oublié la leçon. Peut-on revenir sur ce point et expliquer d’abord en quoi consiste la leçon de Platon, son rapport à la grammaire puis expliquer en quoi consiste la progressive dégrammaticalisation – ou absolutisation – de la notion de phénomène que tu diagnostiques dans ton livre? Autrement dit, en quoi consiste la grammaire du phénomène d’une part et sa violation d’autre part?
Jocelyn Benoist : Le livre répond à une perplexité ayant trait à l’évidence apparente, et la quasi-naturalité, de la notion de « phénomène » telle qu’une part importante de la philosophie contemporaine l’utilise. A ce titre, bien sûr, c’est en premier lieu la phénoménologie qui est en discussion. Celle-ci fait fond sur la notion de phénomène, mais finalement, au moins dans les versions que nous en connaissons aujourd’hui, l’interroge rarement. Or, ce que j’ai voulu montrer, c’est que cette notion a un coût, des présupposés, dans lesquels il est important d’entrer philosophiquement si on veut en faire quelque chose. On ne peut pas la traiter comme un inconditionné ou un point de départ qui irait de soi.
Une telle démarche de refondation et de critique (« à quelles conditions peut-on parler de phénomènes ? », c’est-à-dire : quelles conditions sont toujours déjà comprises dans le fait qu’on en parle ?), si elle conduit à poser la question de la légitimité de la « phénoménologie » au sens étroit du terme, c’est-à-dire en tant que courant historique particulier, s’applique en fait plus généralement à tout discours philosophique qui se veut « discours des phénomènes » ou fait place à un tel discours en tant que partie autonome de la philosophie. On pourrait dire, en ce sens, qu’il y a un concept étroit et un concept large de « phénoménologie ». C’est le concept large qui est discuté dans le livre.
Au-delà de la phénoménologie, la critique s’adresse donc à tout ce courant, pendant longtemps porteur, de la pensée moderne, qui a absolutisé la notion de « phénomène ». Dans l’orbe du kantisme, ce discours a été dominant, il a traversé tout le XIXe siècle, avec le positivisme, puis « la phénoménologie ». Encore aujourd’hui, il est loin d’être évident que la philosophie contemporaine, après la phénoménologie et parfois encore en rencontre avec elle, l’ait surmonté. Je n’en prendrai à témoin que le débat, florissant aujourd’hui, autour de la « conscience phénoménale ». Les protagonistes de ce genre de discussion se demandent s’il y en a ou non, et, s’il y en a une, alors quelles sont ses modalités concrètes. Cependant, il est très rare qu’ils s’interrogent vraiment sur les implications qu’il y a à l’appeler « phénoménale ». Pourquoi un aspect particulier de la conscience devrait-il s’énoncer en termes d’« apparaître » ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Quel type de représentation de la subjectivité et de ce que c’est qu’avoir une « conscience » est présupposée par une telle idée ?
Car en effet, c’est là le problème sous-jacent à la notion de « phénomène » : celui de la généralisation d’un certain modèle, qui est celui de « l’apparaître ». A une soutenance récemment, Kevin Mulligan, jouant son rôle habituel de philosophe analytique pour phénoménologues, énonçait avec une généreuse démagogie vis-à-vis du public (phénoménologique), non sans susciter le frémissement partagé de ceux qui croient communément enfoncer une porte ouverte, que là où il y a perception, il doit bien y avoir « apparaître ». Eh bien, précisément, il n’y a rien là qui aille de soi : pourquoi Diable faudrait-il que la perception se dise en termes d’« apparaître » ? Je veux dire : en général en termes d’apparaître – qu’il puisse y avoir des raisons de dire de certains perçus sous certaines conditions qu’ils « apparaissent » est une autre question. En toute rigueur, il n’y a que sur le terrain du perçu que la notion d’apparaître puisse avoir un sens, mais cela ne veut pas dire qu’il soit légitime d’entendre le perçu comme tel, intrinsèquement, en termes d’apparaître. En fait, cela veut dire exactement l’inverse. L’apparaître est une modalité du perçu, non le perçu de l’apparaître. Identifier purement et simplement la perception en général, intrinsèquement, à l’apparaître, c’est tout simplement ne pas s’être posé une question. La philosophie consiste à se poser de telles questions. Non pas d’ailleurs pour forcément récuser cette identification, mais pour voir qu’elle a un coût, quelle métaphore, en l’occurrence, elle met en jeu, et quelles sont les conditions sous lesquelles celle-ci peut avoir un sens et dire quelque chose. C’est donc ce genre d’« évidence » qu’essaie de discuter Logique du Phénomène, dans le prolongement de mon livre précédent Le Bruit du Sensible.
Selon cette perspective systématique, l’exposé, dans Logique du Phénomène, prend en effet un tour plus « historique » que dans mes ouvrages précédents. La raison en est que la notion de « phénomène » est un pur produit du discours philosophique, qu’on ne peut retirer à son histoire, qui se confond assez largement avec celle de la philosophie, depuis son instauration platonicienne. Les concepts philosophiques, comme les concepts en général, ne poussent pas sur les arbres. Il faut donc les interroger dans leur provenance. Celui de « phénomène » a constitutivement partie liée avec l’institution grecque de la philosophie. J’ai donc éprouvé le besoin de revenir aux Grecs pour poser correctement le problème. Pourquoi la philosophie grecque s’est-elle mise à parler de « phénomènes » ? C’est la question qui traverse toute la première partie du livre.
Or, ce qu’on trouve de ce côté, c’est que la qualification de quoi que ce soit comme « phénomène » (c’est-à-dire : « ce qui apparaît ») est toujours liée, pour les Grecs, à un dispositif qui rend l’apparaître possible et en vertu duquel seulement il y a un sens à raisonner en termes d’« apparaître ». D’abord, pour qu’il y ait apparaître, il faut qu’il y ait quelque chose qui puisse apparaître, quelque chose qui, en son sens, doit être déterminé dans des termes autres que l’apparaître, puisqu’il lui servira de norme. Ensuite, pour paraphraser Aristote, ce qui apparaît apparaît à quelqu’un d’une certaine façon, en un certain temps et un certain lieu. Ainsi les Anciens ont-ils très précisément cartographié les conditions sous lesquelles nous disons de quelque chose que « cela apparaît », les conditions sous lesquelles nous faisons de quoi que ce soit un « phénomène ».
De ce point de vue, l’usage moderne de la notion de « phénomène » – dont, très classiquement, j’ai fait porter le tournant à Kant parce que la popularité du terme, dans les philosophies du XIXe et du XXe siècle, lui est indubitablement due, mais évidemment il faudrait d’abord revenir à Leibniz : c’est à lui que remonte la réactivation moderne de cette notion – est caractérisé par une forme d’oubli progressif et de refoulement des conditions ordinaires de ce jeu de langage de l’apparaître. Comme si l’apparaître pouvait tenir par lui-même – ce dont la sphère phénoménologique absolue envisagée par Husserl dans les Ideen I constituerait la figure ultime – et tout pouvait impunément être qualifié de « phénomène ». Un des buts du livre est d’interroger la consistance d’un tel point de vue et le prix à payer pour l’usage d’un terme à la syntaxe originairement constitutivement relative (phénomène pour quelqu’un à une certaine occasion dans un certain contexte ou un certain genre de contexte) dans un emploi voulu absolu (« le phénomène » ou « les phénomènes », sans qu’on sache trop d’où ils viennent et ce qu’ils sont : sans qu’ils aient d’abord été situés dans la réalité).
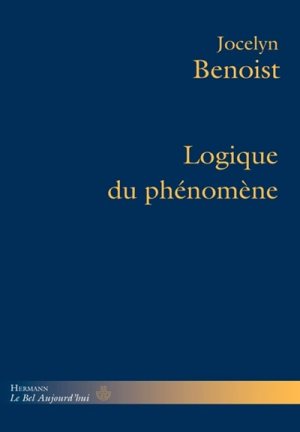
Le problème, comme toujours, n’est pas qu’on ait introduit un nouvel emploi. Si c’en était réellement un, il n’y aurait rien à dire. C’est plutôt qu’il n’est pas sûr que cela en soit un – je veux dire : réellement un emploi. Le philosophe moderne qui parle la langue des phénomènes louche sur l’ancien emploi – qui les qualifie en tant que « phénomènes », permet de comprendre pourquoi on traite alors une certaine chose comme « apparaissante » – mais en même temps il en met hors-jeu (sous « réduction ») toutes les conditions, se place en situation d’exception par rapport à elles. De ce point de vue, on ne voit pas de quoi il parle, et il ne reste plus qu’à lui demander de mieux définir son emploi.
RM : Il y a un argument, plus sophistique qu’autre chose m’inspirant beaucoup d’antipathie, qui circule dans tout un pan de la philosophie post-heideggerienne consistant à dire en substance: « Oui il est parfaitement vrai que nous violons l’usage des termes, que nous ne nous en tenons pas rigoureusement à leurs implications, ainsi qu’à leur grammaire, mais non par défaut de lucidité, ainsi qu’il serait loisible de nous en accuser, mais délibérément: nous nous réclamons d’une telle violence faite au langage, parce que les mots et leur système d’implications, leur grammaire, restent en deçà de ce qui est notre affaire, et que des termes comme « être » « apparaître » « phénomène » ne peuvent qu’approcher de manière asymptotique et inexacte, de sorte que dans notre propos, il ne s’agit jamais pour nous de ce dont nous parlons« . A l’instar de Protagoras, ils réclament l’édification d’un autre discours, lequel n’existant pas et ne pouvant exister (comme tu le montres très bien dans Logique du Phénomène, il ne s’agirait tout simplement plus d’un langage), seule la violation systématique de la grammaire leur donne l’illusion d’approcher, par la voie négative, de la chose qu’ils disent ne pas pouvoir décrire. Il me semble que tout un pan de la post-phénoménologie actuelle est compromise dans cette tentative de débouter le langage, que ce soit à travers l’idée d’un discours alternatif, poétique, ou dans l’idée qu’ils vont chercher chez Levinas (voire Lacan) d’un nécessaire et constant « dédire du Dit ». Ma question n’est pas tant de savoir quoi leur répondre mais plutôt de te demander ce qui dans le langage, en tant qu’il est le nôtre, peut faire naître en nous la tentation de croire que nous devrions – à défaut de pouvoir le faire – nous en exempter et le répudier?
JB : Une formule suivant laquelle le langage pourrait nous empêcher de dire quoi que ce soit ne peut que laisser perplexe. Il y a là comme un parfum de contradiction, non ? Si la question est de le dire, alors, elle n’a de sens que sous l’horizon du langage.
Evidemment, dira-t-on, on n’a pas forcément disponibles tous les outils qu’il faudrait pour dire ce qu’on a à dire. Il est possible que, pour énoncer certaines choses, on ait besoin d’un système plus riche, pourvu de plus grandes ressources expressives. Cependant, les outils, cela se crée. Le tout est de définir pour eux un usage précis. Par après, ces usages eux-mêmes évoluent, se calent sur de nouveaux usages, qui consistent à parler de ce que, précédemment, on n’aurait même pas pu concevoir. La créativité linguistique, en ce sens, n’a pas de limite.
Mais ce n’est pas ce qu’ont en vue, je pense, ceux dont tu parles. Pour eux, je suppose, il y aurait des choses qui, structurellement, essentiellement, « ne pourraient être dites ». Il ne suffirait pas d’ajuster le langage, comme nous pouvons le faire, pour les dire, car elles seraient au-delà des capacités d’expression du langage – et pourtant « à dire » tout de même. Ne nous resterait plus dès lors qu’à les mi-dire : à les suggérer en adoptant un mode de discours qui refuserait de s’identifier complètement comme discours et de jouer le jeu d’un usage.
Cette posture est illusoire, me semble-t-il : un usage déviant est tout juste un autre usage ; et, en deçà de l’usage, il n’y a que du bruit.
En revanche, il faut en effet se demander quel peut être son ressort : pourquoi le mirage d’un usage possible du langage qui nous ramènerait en-deçà du langage, ou qui nous emmènerait « au-delà » du langage, revient si souvent en philosophie. Je ne pense pas qu’une telle tentation résulte en quoi que ce soit d’une limitation qui affecterait nos mots, au contraire. En fait, ce qu’elle exprime, c’est, tout à l’opposé, notre désir impuissant de limiter ceux-ci d’une façon dont ils ne peuvent l’être, en quelque sorte de les retenir sur la voie sur laquelle ils nous emportent car tel est leur rôle. Comme toujours dans notre rapport aux mots, nous sommes responsables du problème, qui est un problème de responsabilité, précisément. En fait, je pense que le propos selon lequel : « je veux dire quelque chose, mais qui est autre chose que ce que veulent dire mes mots (et pour quoi, tendanciellement, il n’y a pas de mot) », a une signification bien précise. Il ne s’agit de rien d’autre que d’une tentative de privatiser le langage. Cela veut dire, au fond : « Je parle, mais je ne vous parle pas », car « mes mots ne sont pas à vous. » En fait, il ne s’agit de rien d’autre que d’une figure du fantasme du langage privé. C’est évidemment structurellement impossible : je ne peux parler sans, par destination, parler à… – et donc sans que le sens de mes mots soit un sens dans lequel un autre pourrait effectivement entrer, même s’il y a un coût pour cela. Le langage, par construction, c’est le langage à l’Autre. Au contraire, la mystique de l’ineffable essaie de retirer sa dimension d’adresse au langage, et de le faire se replier sur un sens qui ne serait pas exposé – et qui se retrouverait donc placé dans une forme d’immunité fictive par rapport à l’Autre. Vouloir dire, « mais sans (tout à fait) dire », c’est, fondamentalement, ne pas vouloir te dire quelque chose (à toi ou à un autre, mais la parole est toujours, par définition, adressée à quelqu’un, même dans l’anonymat du monologue). Un certain ineffabilisme philosophique, qui parle beaucoup (il faut avoir du respect pour l’ineffabilisme silencieux, mais c’est une autre affaire), n’exprime rien d’autre que notre désir d’échapper à cette responsabilité qui, structurellement, va avec tout énoncé. Que le langage puisse nous faire cet effet-là est un fait intéressant (à notre propos) ; mais ce n’est en rien « sa faute ». C’est à nous de savoir si nous avons quelque chose à dire, c’est-à-dire quelque chose que nous soyons prêt à assumer comme dit – qui, dès lors, par définition, a un sens public, et n’est pas « à nous ». Tes ineffabilistes, apparemment, disent (et ce n’est pas incident qu’ils l’aient dit) : « Il ne s’agit jamais pour nous de ce dont nous parlons. » Seulement, quand vous parlez, c’est, par définition, pour les autres (et non « pour vous ») que vous parlez.
RM : Tu dis que « l’apparaître est une modalité du perçu, non le perçu de l’apparaître ». Peut-être qu’une telle formulation pourrait nous donner l’occasion d’établir une jonction avec ton précédent ouvrage Le Bruit du sensible où la notion de sensible était clairement distinguée de celle de « manifestation ». Comme tu le formulais dans Le Bruit du sensible : « le sensible ne manifeste pas un être, il est un être » 2. Il me semble à te lire, que la philosophie moderne procède à une insonorisation de l’être sensible en l’assimilant indûment et systématiquement à de l’apparaître, de la phénoménalité, de la manifestation de, là où tu prends soin de rappeler que le sensible ne s’y réduit jamais – en lui-même il n’a rien d’intentionnel. Toute manifestation de est, par principe, adossée au sensible, car elle a enregimenté le sensible sous une certaine norme, c’est-à-dire fait quelque chose de ses contrastes, de ses différences, ressemblances et autres surprises qui lui sont intrinsèques et qui constituent le tissu sensible de notre vie perceptive, sans pour autant, en lui-même, manifester quoi que ce soit. Il me semble que Logique du phénomène reprend cette distinction mais l’élucide en repartant de l’autre bout de la chaîne, depuis la « manifestation ». Il s’agirait pour toi d’éclaircir les conditions logiques à partir desquelles cela peut se mettre à avoir un sens de raisonner sur le sensible en termes de manifestation. Tu dis par exemple, p. 180 : « La notion d’apparaître, cependant, ne s’applique pas à la simple perception de la maison. En elle-même, cette expérience n’est jamais que ce qu’elle est, et elle n’a pas la puissance logique du « donné », mais celle de la réalité » 3. Peut-on dire que le « phénomène » n’est rien d’autre qu’un sensible évaluable – c’est-à-dire placé sous une norme – alors que le sensible en tant que tel demeure tout simplement indifférent (et non pas réfractaire) à l’évaluation ? en somme que le phénomène est un sensible auquel la question de l’évaluation est posée – celle de manifester correctement ou incorrectement quelque chose ?
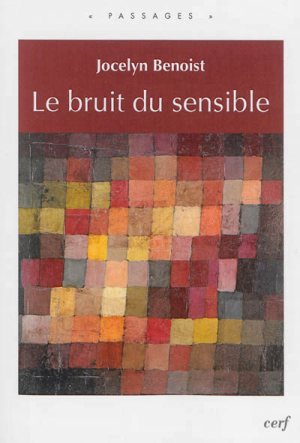
JB : Tu résumes mon propos mieux que je ne pourrais le faire. Bien sûr, le rapport entre les deux livres est étroit. A bien des égards, Logique du Phénomène se présente comme une sorte d’appendice au Bruit du Sensible, même si, je pense, il peut être lu de façon autonome, puisque j’ai introduit les rappels qui me semblaient nécessaires au fur et à mesure. En même temps, tu cernes bien la spécificité du nouveau livre : celui-ci, outre qu’il replace le débat dans une histoire de la philosophie au beaucoup plus long cours, analyse plus spécifiquement le concept d’apparaître.
Sur ce plan comme sur le reste, je suis tout à fait d’accord avec les formules par lesquelles tu caractérises ma perspective. Je préciserai simplement qu’il faudrait, pour que l’analyse soit complète, pluraliser les dimensions d’évaluation du sensible, et d’autre part les types de normes en fonction desquelles quelque chose de sensible se voit déterminé comme « phénoménal ». Je veux dire : je ne crois pas que toute norme qui s’applique à du sensible qualifie celui-ci comme « phénoménal », c’est-à-dire « apparaissant ». Tout jeu de langage, y compris s’il s’applique constitutivement au sensible, c’est-à-dire s’il est essentiellement fait pour cela, n’ouvre pas nécessairement, logiquement, une place pour « l’apparaître » – c’est-à-dire pour que cela ait un sens de parler dans ces termes-là. En revanche, la réciproque est vraie : il n’y a de sens à faire d’un sensible un « apparaissant » que sous une certaine norme, et du point de vue de cette norme. D’autre part, il faut faire droit à la pluralité de telles normes : si toute norme n’ouvre pas un horizon sous lequel il y a un sens à parler d’« apparaître », plusieurs le font et sur des modes divers. Ainsi, si la norme ontologique joue certainement un rôle privilégié dans cette affaire, suivant l’axe canonique de l’opposition ou alternativement de l’équation entre l’être et le paraître, il est clair que ce n’est pas la seule dimension du jeu de langage de l’apparaître, qui est fondamentalement diversifié : il y a celle du remplissement d’une attente, ou, au contraire de l’inattendu, ou bien tout simplement, de la meilleure visibilité, indépendamment de toute intention de connaissance. Ces déterminations ne sont pas directement ontologiques, même si elles supposent, et ce n’est bien sûr pas incident, qu’à un certain niveau, de l’être soit en jeu. L’important, cependant, est que, dans tous ces cas, on retrouve bien, en des sens variés, à l’œuvre une certaine norme, et, de façon correspondante, une structure de remplissement. Là pourrait résider le chiffre de la notion de phénomène : pas de « phénomène » sans qu’il y ait un sens, d’une façon ou d’une autre, et suivant une modalité positive ou négative, pour la notion de remplissement. Telle serait l’équation générale de l’indexation fondamentale du phénomène à une « norme » – qui, comme toute équation mathématique intéressante, se spécifie en cas particuliers qu’il faut calculer à la main.
RM : A ce titre, tu montres de manière très impressionnante de quelle façon Platon assimile le sensible au phénoménal en étant parfaitement conscient de son geste, autrement dit de façon parfaitement délibérée. Comme tu le formules « Platon construit ici de part en part “le phénomène”, c’est-à-dire les conditions sous lesquelles cela a un sens de traiter les choses sensibles, ces choses qui, dit-on, nous entourent, comme des “phénomènes” » 4.
Ton propos est-il dès lors de dire qu’à aucun moment, contrairement aux modernes, Platon ne prend pour argent comptant la notion de phénomène, mais, pour reprendre ton terme, qu’il la construit ? Manquerait-il à la phénoménologie, en somme, outre la transcendance des normes platoniciennes (sur lesquelles nous reviendrons plus tard), ce que j’aimerais appeler avec toi une construction du phénomène ?
JB : Ta question a deux faces. Quant à Platon, bien sûr, il n’est guère possible de lui imputer quelque naïveté que ce soit par rapport à la notion de « phénomène ». Il n’a guère de mérite à cela, puisqu’il l’invente ! En tout cas il n’a, en la matière, aucun autre que celui-là même de son absolu génie créatif, qui le conduit à inventer la philosophie et une certaine prise sur le sensible (la philosophie comme prise sur le sensible) simultanément : ce faisant, il invente la notion de phénomène comme façon de problématiser (c’est-à-dire de rendre problématique) le sensible en général. La notion a été utilisée avant lui (Anaxagore), mais pas ainsi, en général, comme chiffre du sensible. Qu’elle le devienne suppose toute une construction, dont la mise en scène du mythe de la caverne est la part la plus spectaculaire, qui fonde une généralisation de la problématique de l’apparaître au-delà de ses limites usuelles. Il y a là un geste tout à fait artificiel, mais parfaitement résolu et conscient. Un geste souverain d’institution philosophique, qui se confond essentiellement avec l’institution de la philosophie même.
Pour ce qui est de la phénoménologie, oui, à première vue, on pourrait trouver cela surprenant. Ce qui caractérise cette méthode philosophique à son meilleur – ou en tout cas ce qui devrait la caractériser – c’est la mise en scène, la capacité à faire apparaître ce qui correspond aux concepts, précisément – ce qui suppose déjà qu’on le constitue en « apparaître ». Or s’il y a bien une chose que la phénoménologie ne met pas en scène, c’est les conditions de « l’apparaître » lui-même, ce qui le qualifie en « apparaître », dont elle ne nous dit rien. A l’origine, chez Husserl et Heidegger, on trouve une certaine sensibilité à la question de ce qu’on pourrait appeler les « conditions initiales » de la phénoménologie, parce que celle-ci a à s’établir, mais dans ses versions plus récentes, elle tient assez largement pour acquis que l’on puisse, de façon non problématique, universellement raisonner en termes d’apparaître. Comme je te le disais plus haut, par exemple, pour un tel point de vue, il va de soi que la perception est de l’ordre de l’apparaître. Cela ne fait même pas question, et il n’y a pas à le construire. En fait, la phénoménologie s’installe dans les conséquences de la construction platonicienne (y compris lorsqu’elle prétend la renverser en quelque dérisoire « anti-Platon » qui tire ses présupposés et ses couples d’oppositions opératoires du platonisme), mais, pour ainsi dire, sans se poser la question de son prix, des gestes à accomplir pour effectuer cette construction, et de ce que ces gestes supposent déjà de la réalité. Cet oubli des actes nécessaires pour qu’il soit possible de généraliser le discours de « l’apparaître » est sans doute la condition pour l’institution du concept moderne, absolu, de phénomène. Le problème, c’est que, contrairement à l’institution platonicienne, dont elle dépend, mais dont elle refoule l’idée aussi, c’est une institution silencieuse. Cette absolutisation du phénomène est passée en quelque sorte en passager clandestin, dans les wagons de la subjectivité moderne. C’est bien sûr un sous-produit du tournant subjectif caractéristique de la modernité. De ce point de vue, le motto d’une « phénoménologie asubjective », qu’on entend parfois, ne peut que prêter à sourire – à moins bien sûr qu’il ne s’agisse, en revenant à l’institution originaire, platonicienne, de la phénoménalité, de rapporter de nouveau ce qu’on appelle « phénomènes » à leurs conditions réelles, et de les faire donc tourner autour de la réalité, et non autour du sujet. Mais alors, probablement, il ne s’agit plus d’une « phénoménologie » – qui, au sens moderne du mot, ne se soutient que d’une autonomie supposée des phénomènes par rapport à la réalité.
RM : Dans le cours houleux de cette histoire, j’ai l’impression que la dégrammaticalisation de la notion de phénomène – ou encore la transgression de la logique du phénomène – atteint son point paroxystique à deux moments: le positivisme, qui, contre Kant, s’en prend à ce qui restait de grammatical dans l’approche kantienne – à savoir la mesure de l’apparaître par une norme – au nom d’une philosophie qui prétendrait s’en tenir aux seuls phénomènes. A ce titre, tu montres de manière très intéressante, en quoi la phénoménologie hérite à la fois du positivisme tout en récusant, cependant, l’espèce d’agrammaticalité à laquelle aboutirait l’idée d’un phénomène exempt de tout normation, et en quoi, en ce sens, la phénoménologie constitue une sorte de réhabilitation du kantisme à rebours du positivisme. Le second moment serait la phénoménologie actuelle, qui, à l’instar du positivisme, exonère à nouveau le phénomène de toute normation et prétend établir sur les décombres de la norme une métaphysique du phénomène. Peut-on revenir sur ces deux moments et expliquer au lecteur en quoi ils reposent sur une approche du phénomène qui rend ce dernier inintelligible du point de vue de sa logique constitutive?
JB : Mon propos n’est évidemment pas de distribuer les bons ou mauvais points à travers l’histoire de la philosophie. Ce n’aurait pas de sens du point de vue historique et pas plus du point de vue philosophique.
Il serait évidemment vain de nier que s’exprime, dans mes travaux, depuis une dizaine d’années, une certaine défiance vis-à-vis de la philosophie moderne. Ce n’est pas lié à un tournant réactionnaire de ma part, mais tout simplement au fait que je suis devenu de plus en plus sceptique par rapport à l’épistémologie et l’ontologie caractéristique de cette époque, qui dépend complètement du concept de subjectivité. Il ne s’agit pas pour moi de « nier le sujet » ou de le « dépasser », comme le voudraient les post-modernes. Accorder une importance excessive au fait qu’il « n’y ait pas de sujet », comme on le voit encore parfois (de moins en moins et, au fond, ce n’est peut-être pas très bon signe), c’est encore participer au psychodrame du sujet. Mon problème est plutôt que ce que les modernes ont introduit sous le nom de « sujet », encore une fois, est une instance inconditionnée. Là aussi, il faudrait rendre au sujet sa grammaire : sous quelles conditions syntaxiques peut-il y avoir quelque chose qui joue le rôle de sujet ? dans quel emploi ?
Or c’est au fond exactement la difficulté qui grève l’épistémologie positiviste, dans son incapacité à formuler et assumer sa propre condition métaphysique (qui, évidemment, lui fait constitutivement enfreindre les limites mêmes qu’elle prétend fixer). Le positivisme est fondé sur la notion de « phénomène » et, encore aujourd’hui, le savant positiviste réclame toujours une « phénoménologie » préalable à laquelle son analyse puisse s’adosser : il faut d’abord, dit-on, « décrire les phénomènes ». Mais qu’est-ce qui les qualifie donc comme « phénomènes » ? Comment pourrait-il y avoir « phénomène » si ce n’est pour quelqu’un ? De ce point de vue, l’attaque de Nietzsche contre le positivisme est proprement imparable. C’est amusant parce qu’on en trouve l’une des versions les plus explicites dans un fragment souvent cité mais, en règle générale, très mal compris. On isole cette phrase bien connue de son contexte : « il n’y a pas de faits, seulement des interprétations ». La post-modernité a fait de ce motto son étendard, la réaction réaliste aujourd’hui en fait sa cible et en un sens avec raison. Il faut cependant replacer l’énoncé dans son contexte. Contextuellement son sens est parfaitement clair : il s’agit d’une critique du positivisme qui, dit le même texte, veut « n’en rester qu’au phénomène ». Ce que Nietzsche dit est que cette « modestie » est en réalité impossible. Elle est purement et simplement inconsistante. La notion de « phénomène » telle que l’emploie le positivisme est en effet porteuse d’un présupposé majeur, dont on ne peut la séparer, celui de la subjectivité, qui n’a rien de « phénoménal ». Il est donc impossible de « s’en tenir aux phénomènes » comme le voudrait le positiviste. Encore une fois, il y a un coût à parler de « phénomènes ». La grammaire de cette notion suppose toujours que nous ayons un pied au-delà de sa seule sphère, d’un côté (celui du sujet) ou de l’autre (celui de l’objet), et, j’aimerais dire, quant à moi, si possible des deux côtés (il vaudrait mieux, pour que la notion puisse réellement fonctionner). C’est ce que Nietzsche, avec sa lucidité critique habituelle, a vu. On n’est pas forcé d’en tirer les conséquences philosophiques qu’il en tire – le perspectivisme en abyme à l’infini – mais il a de toute évidence levé un vrai problème.
Quant à ce que tu appelles « la phénoménologie actuelle », il faut probablement distinguer les réflexions qu’elle m’inspire plus spécifiquement (la critique de Jean-Luc Marion, notamment, joue un rôle important dans ce livre), dans la mesure où elle témoigne d’une importante évolution par rapport au projet originaire de ce genre de philosophie tel qu’il avait été défini par Husserl, et les doutes que suscite déjà pour moi ce projet lui-même.
La phénoménologie, dans sa définition husserlienne, canoniquement formulée dans les Ideen I, a représenté la tentative la plus aboutie d’autonomisation philosophique de l’apparaître. Elle en a fait une sphère absolue, objet d’un savoir systématique : celui, précisément, d’une « phénoménologie ». Cette absolutisation suppose un geste philosophique bien particulier : l’époché. J’ai, dans le livre comme dans un article contemporain dans l’Archivio di Filosofia 5, contesté qu’un tel geste puisse avoir un sens, précisément dans la mesure où, grammaticalement, il n’y a d’apparaître que référé à un être, et cela non pas au sens d’une référence qui resterait interne à cet apparaître, mais en celui de la référence à un être qui lui est logiquement externe (qui n’est pas un pur « effet d’apparaître ») et sur lequel la norme qui mesure cet apparaître est calée. Tout cela, encore une fois, est assez platonicien, mais je pense qu’on y reviendra. On ne peut logiquement pas mettre l’être entre parenthèses ni non plus le réduire à sa visée – fût-ce à une « visée réussie », car la question qui se pose alors est de ce qui est effectivement atteint dans une telle visée : il faut que l’objectif, en un certain sens, soit déjà là, et soit tout court, pour que celle-ci ait un sens. Au contraire, une fois que vous avez sauté à pieds joints dans la supposée « sphère de l’apparaître », comme la phénoménologie nous y invite – c’est l’époché – vous ne retrouverez pas l’être, mais tout au plus son idéal à l’infini, qui demeure un indéfini puisqu’il n’a rien sur quoi se caler. Mais c’est qu’en fait ladite « sphère de l’apparaître » n’a pas de sens en tant que « sphère » close sur elle-même. S’il y a « apparaître » c’est que, en un sens ou en un autre, vous avez déjà « l’être ». Il n’y a donc pas de « phénoménologie » au sens absolu du terme. Seulement, le hic, c’est que le sens et la vocation d’une phénoménologie, c’est précisément d’être absolue (« tout l’apparaître, mais rien que l’apparaître »). Comme si l’apparaître pouvait se normer – et donc se qualifier en tant qu’apparaître – par ses propres moyens.
A un autre niveau, on rencontre les développements contemporains de la phénoménologie, que je préférerais appeler « post-phénoménologie ». Par rapport à la question de l’apparaître et du phénomène, dans le champ actuel, on trouve principalement deux positions qui, me semble-t-il, appellent de ce point de vue une réflexion plus spécifique.
Il y a, d’un côté, celle de mon ami Renaud Barbaras. En un certain sens, assumant la prétention patočkienne à effectuer une époché qui ne s’identifierait pas à une réduction, la démarche de Renaud semble exactement tomber sous le coup de ma critique de la phénoménologie comme métaphysique du phénomène, c’est-à-dire institution de la phénoménalité en sphère absolue, en soi et pour soi. De ce point de vue, le fait qu’une telle phénoménologie se voit dite « asubjective » est plutôt un facteur aggravant. On pourrait dire que cette exigence porte la phénoménologie à son point d’agrammaticalité extrême. Que serait en effet un apparaître qui ne serait pas apparaître pour un sujet ? Il y a là, typiquement, ce que j’appelle un problème de grammaire. En même temps, ce qui change tout, c’est que, précisément, la « métaphysique du phénomène » que propose Renaud en est une en un sens assumé, c’est-à-dire qu’en réalité elle outrepasse positivement les limites de la phénoménologie. Avec ce qu’il appelle « archi-événement », si je le comprends bien, Renaud donne une forme de fondement à l’apparaître, qui ne peut être que non-phénoménologique. La phénoménologie, chez lui, se prolonge ainsi positivement en métaphysique, au lieu d’être adossée à une métaphysique non sue (et donc non élaborée comme telle). Il s’emploie à échafauder une véritable métaphysique du phénomène. Inutile de souligner ce que ce geste, dans sa dimension spéculative, peut conserver d’étrange pour moi – je ne cherche pas, quant à moi, une métaphysique en un sens spéculatif, et le regain du spéculatif caractéristique de la pensée française contemporaine me laisse, dans l’ensemble, perplexe. Il suscite cependant toute ma sympathie, en tant qu’appliqué à la phénoménologie. Renaud est un philosophe qui, à sa manière propre, pose la question des limites de la phénoménologie et en fait positivement quelque chose, y injectant la dose de métaphysique nécessaire et inévitable. Bien sûr, il le fait d’une façon qui l’inscrit en partie dans le prolongement d’un certain spiritualisme – la conjugaison de la tradition phénoménologique et du spiritualisme français en tant que spiritualisme métaphysique est essentielle pour comprendre son travail – dont tu sais qu’il ne constitue pas mon langage de référence. En même temps, il y a une forme de grandeur dans ce spiritualisme en tant que métaphysique, précisément. De ce point de vue, je dois dire que j’aime ce qui, dans la pensée de Renaud, vient d’auteurs comme Ruyer, qu’il m’a fait découvrir : un spiritualisme de l’étendue qui a d’abord pris la forme d’un hyper-mécanisme (un mécanisme pour ainsi dire grammatical, dans Esquisse d’une philosophie de la structure), tout de même, il faut oser ! On trouve des intuitions philosophiques très fortes, sans doute, de ce côté, qui peuvent contribuer à relancer une recherche métaphysique (je n’ai pas dit « recherche d’une métaphysique ») aujourd’hui.
De l’autre côté, on trouve Jean-Luc Marion. Je voudrais clarifier mon rapport à son œuvre. Il y a une chose qui m’a toujours intéressé chez lui – depuis les années d’Ecole Normale – à savoir sa théologie. Non pas que je la partage, au contraire (je ne suis pas théologien, et si je l’étais, je pense que je ne la partagerais pas non plus), mais elle a, à une certaine époque, défini pour moi les termes d’une question qui me tenait à cœur : celle de savoir quel sens philosophique donner au fait d’être athée – ainsi que je me suis toujours identifié. Récemment un lecteur hors du commun, Matthieu Contou, m’a montré un manuscrit où il défend avec un certain nombre d’arguments impressionnants l’idée que c’est la question qui m’a toujours mû et qui explique tout mon cheminement philosophique. Je ne sais pas s’il a raison et ce n’est pas à moi d’en décider. Ce qui est certain, en tout cas, c’est que cette question a pu être importante pour moi à une certaine époque. De ce point de vue, L’Idole et la Distance, de Jean-Luc Marion, est un livre qui a compté pour moi et qui, certainement, compte encore. Un certain nombre des choses que j’ai faites peuvent probablement se comprendre comme des tentatives, directes ou indirectes, de le réfuter.
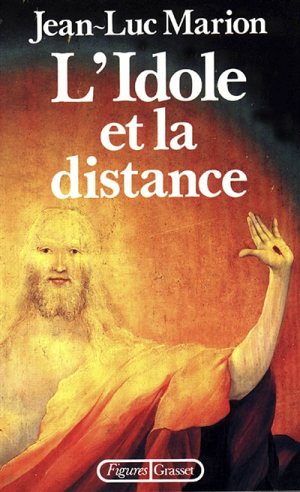
Je dois dire que je suis beaucoup plus sceptique sur l’aspect voulu « phénoménologique » – central apparemment, mais je me demande s’il n’y a pas là un effet de surface, ou disons un effet rhétorique – du discours de Jean-Luc Marion. Je suis toujours frappé, dans ce qu’il fait en général, depuis la fin des années 80, par l’effort déployé pour réécrire systématiquement dans des termes qu’il voudrait phénoménologiques toute thèse qu’il soutient, y compris quand elle ne s’y prête pas, et même son énonciation en termes phénoménologiques en réalité annule son sens. Comme si le langage de la phénoménologie devait donner une forme de caution à un propos qui en fait souvent a été conçu tout à fait indépendamment de cet idiome et n’y trouve qu’un revêtement artificiel.
Il en résulte un usage très abstrait de la phénoménologie. Jean-Luc Marion traite tout ce dont il parle, uniformément, comme « phénomène », sans jamais se demander s’il y a des choses que cela a un sens de traiter ainsi et, de façon solidaire, d’autres choses qu’il n’y a surtout pas de sens à traiter dans ces termes. C’est son concept de « donation », ici, bien sûr, qui est en cause, dont je ne suis pas sûr qu’il en soit vraiment un, car on ne voit pas bien ce qu’il discrimine de quoi et pas exactement ce que, dans sa généralité, il permet de thématiser positivement. Marion circule, apparemment, complètement dans le présupposé de l’apparaître. Le problème est qu’il l’applique à tout, les seules différences envisageables pour lui étant celles de modes de « donation ». Sa phénoménologie se présente, en ce sens, essentiellement comme ce qu’on pourrait appeler une phénoménologie généralisée. Cependant, la généralisation qu’il opère, suivant de prétendues « réductions » successives, paraît fondamentalement fictive. D’abord, cela n’a pas de sens de mettre l’ontologie comme telle sous réduction, si l’on veut parler de « phénomènes » et on veut faire de la phénoménologie. La constitution du phénomène – la condition sous laquelle on peut parler d’« apparaître » – est essentiellement ontologique : quelque chose n’est dit « apparaître » qu’en référence à un être ou en tout cas à une question sur l’être (comme peut l’être par exemple l’attente, ou l’exploration visuelle), en bon français. Cela, Husserl – même s’il ne s’est pas donné les moyens de fonder correctement cette ontologie – et Heidegger l’ont bien vu, dont les phénoménologies respectives sont, chacune à leur manière, orientées ontologiquement. Cette constitution onto-logique du phénomène, chez eux, ne doit rien au hasard. Par rapport à cela, le geste levinasien de remise en question de l’ontologie dont Jean-Luc Marion prétend s’inspirer (voire dépasser dans une « réduction » supplémentaire), quant à lui, n’a rien d’une « réduction ». Il représente plutôt quelque chose comme une forme de « contextualisation » radicale : de remontée en direction du fondement de l’ontologie et (donc) de la phénoménologie à la fois (l’une est l’envers de l’autre, et elles relèvent de la même conditionnalité). Lire ce geste comme une extension du sens du « phénomène » (de ce qu’on appellerait, de façon indifférenciée, « donation ») est un contresens majeur, qui empêche d’apercevoir la dimension non phénoménologique de la pensée de Levinas et de comprendre ce dont il s’agit dans sa démarche de remise en question et de refondation à la fois.
En réalité, ce que manque toujours Jean-Luc Marion, de mon point de vue – et que n’a pas manqué Levinas : c’est son objet propre, en un sens – c’est l’écart fondamental, fondateur, entre « phénoméno- » et « logie ». Le dire n’est pas un phénomène. Le traiter ainsi, c’est perdre son sens, qui est de nous rapporter directement à l’être des choses – référence première à leur être sur le fond de laquelle seulement la notion d’« apparaître » se met à avoir un sens. La « signification » n’est pas à proprement parler un mode de donnée, mais la fixation de norme en vertu de laquelle peut avoir un sens de qualifier quoi que ce soit comme « donné ».
Sur l’interprétation de Levinas, bien sûr, on peut discuter. Levinas, tu es bien placé pour le savoir, est un auteur ambigu, et en un sens clivé dans sa radicalité même et son absence de compromis, ton livre Evénements Nocturnes 6 le montre bien. Ce qui m’intéresse, cependant, c’est la vérité que sa lecture, d’un certain point de vue, peut nous aider à voir : la priorité sur toute phénoménalité du langage en tant qu’adresse de l’un à l’autre, qui définit la norme de l’être même. Il est intéressant, de ce point de vue, de remarquer que, lorsque Jean-Luc Marion prétend emprunter à Levinas le concept de « donation », ou en tout cas le trouver chez Levinas, il en inverse la valence par rapport à sa source. Dans la construction de Jean-Luc Marion, la « donation » devient une extension – une généralisation – de la Gegebenheit phénoménologique. Elle est donc toujours, en dernière instance, vue du point de vue de celui qui reçoit, comme le prouve le privilège accordé, dans la phénoménologie marionienne de l’appel, assez paradoxale comme je le montre dans le final de mon livre, à la réponse. Or ce n’est nullement ce que signifie le terme « donation » chez Levinas, qui a une fonction bien précise et délimitée : il renvoie au fait que, par le simple fait de parler, nous qualifions les choses comme « êtres » et les donnons donc aux autres, y compris à notre corps défendant, leur conférons le statut « public » de choses qu’elles sont. La « donation », en ce sens-là, chez Levinas, c’est ce qui nous fait définitivement sortir de la sphère du « phénomène », sans espoir de retour, et une telle sortie ne passe pas par une phénoménalisation de plus : elle repose sur un rapport primordial de l’un à l’autre, qui est adresse, révélation et non, en aucun cas, manifestation. La parole n’est pas ce qui est reçu de l’extérieur et ce dans quoi l’Autre se « manifeste ». Elle est ce dans quoi, dans mes propres mots, l’Autre est déjà, parce que mes mots sont essentiellement adressés. L’important, en ce sens-là, ce n’est pas la « donation » au sens marionien – qui en dernière instance n’est jamais qualifiable que du point de vue de celui qui reçoit – mais le don, le fait que nous donnions. Or celui-ci a des conditions réelles, métaphysiques : le rapport de l’un à l’Autre, dont il faut partir au lieu d’essayer de le déceler dans la phénoménalité – où il ne peut que demeurer intrinsèquement introuvable. Le problème n’est pas de « saturer » le phénomène. C’est d’en sortir – où plutôt de prendre en compte que nous en sommes toujours déjà sortis, que c’est du dehors que nous en parlons et que nous lui donnons la valeur de « phénomène » et que c’est là la condition de la notion de « phénomène » – et de le replacer dans cette intrigue métaphysique que décrit Levinas.
En fait, je pense que l’impossibilité structurelle de l’opération effectuée par Marion tient à la confusion et à l’écrasement de deux modèles qui renvoient à des dimensions fondamentalement différentes : à savoir celui de la « donation phénoménologique » (si on veut appeler ainsi la Gegebenheit de Husserl, je n’y ai pas d’objection), d’un côté ; et celui de « l’appel » de l’autre. Marion traite l’appel comme une des formes de ladite « donation » parce qu’il le rapporte primordialement à celui qui le reçoit : ce faisant, il « réduit » l’appel à son expérience. Cependant, c’est s’installer dans une pure et simple confusion des grammaires. L’appel n’a pas à se « manifester ». Il se révèle, ce qui relève d’une tout autre grammaire : la « révélation » suppose quelqu’un qui révèle, là où la manifestation ne réclame que « quelque chose », et là-même où « je me manifeste » (sans rien révéler), c’est encore en me faisant chose. On dit que maintenant Jean-Luc Marion essaierait d’élaborer une philosophie de la révélation. Je ne peux que m’en réjouir, car il s’agit d’une notion fondamentale, y compris pour une approche parfaitement laïque du langage. Comment comprendre celui-ci sans faire un sort à sa fonction de révélation, de parole adressée ? J’espère toutefois que, pour aborder ce problème, Jean-Luc Marion laisse de côté ce mot-valise de « donation », qui gomme la différence phénoméno-logique (celle entre l’apparu et le dit), et qui place a priori, par principe, de la phénoménalité là où, logiquement (en vertu de ce statut logique même qui est celui du discours), il ne peut pas y en avoir. Sinon, c’est mal parti.
En fait c’est très simple : ce n’est pas que l’autre ait à « m’apparaître » en tant qu’il me parle, comme se le représente l’idéalisme moderne, pour lequel le langage (le fait que « ça parle ») est un « phénomène » comme les autres ; c’est que l’autre est de toute façon déjà là en tant que simplement je parle et que, que je le veuille ou non, parler, c’est toujours lui parler.
En ce sens-là, en tant que nous nous parlons, nous ne sommes pas, les uns pour les autres, des phénomènes. « La relation métaphysique […] relie au noumène » Emmanuel Levinas, 7, non au phénomène. Or, en ce sens, la parole est intrinsèquement « métaphysique ».
Entretien avec Jocelyn Benoist : autour de Logique du phénomène (partie II)
- Jocelyn Benoist, Logique du Phénomène, Paris, Hermann, « Le Bel Aujourd’hui », 2016.
- Jocelyn Benoist, Le Bruit du sensible, Paris, Cerf, « Passages », 2013, p. 219
- Logique du phénomène, p. 180
- Logique du phénomène, p. 56
- Voir Jocelyn Benoist, « L’objet et ses échos », Archivio di Filosofia, LXXXIII, 2015, p. 109-124
- Voir Raoul Moati, Evénements Nocturnes. Essai sur Totalité et Infini, Paris, Hermann, 2012
- Totalité et Infini, Le Livre de Poche, 1990, p. 75








