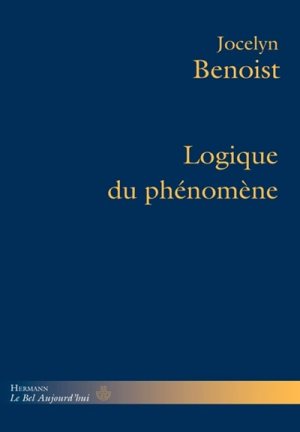Entretien avec Jocelyn Benoist : autour de Logique du phénomène (partie 1)
RM : J’ai présenté Logique du phénomène comme exposant l’histoire de la progressive dégrammaticalisation – ou absolutisation – de la notion d’apparaître ou de phénomène. Cependant, ce qui me frappe à te lire, c’est que l’on retrouve chez les modernes, aussi bien Kant que Husserl, des échos très puissants à la logique du phénomène de Platon – qu’aucun n’abandonne en réalité tout à fait. Que ce soit chez Kant où comme tu le rappelles : « pour que le discours de l’apparaître ait pleinement sens, il faut, que, d’une façon ou d’une autre, soit déterminé ce qui est censé apparaître. Il faut, en d’autres termes, que l’apparaître ait une norme. Or la Critique a une réponse quant à la question de savoir ce que peut être cette norme : elle a pour nom “objet” » 1.
Ou chez Husserl : la phénoménologie ne saurait être réductible à un discours de l’apparaître qui, à l’instar du discours désiré par Protagoras, aurait congédié l’être, puisque, ainsi que tu le soulignes fortement, « il y a une vocation fondamentalement ontologique de la phénoménologie (…) le discours de l’apparaître est inintelligible sans référence à un être. Les deux termes font système. Et dans leur systématique, c’est l’être qui fait norme » 2.
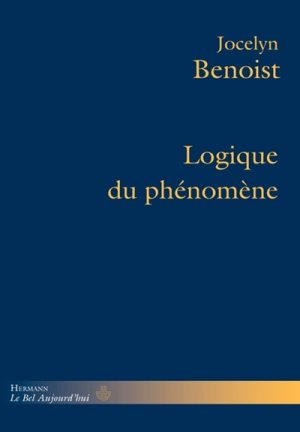
S’agirait-il dans ces deux cas d’une déformation de la logique du phénomène plutôt que de son abandon pur et simple ? Ne peut-on pas dire que les penseurs qui ont succédé à Platon ont tous systématiquement refusé de suivre la voie tracée par Protagoras (d’une phénoménalité libre de l’être – y compris Nietzsche puisque comme tu le rappelles magnifiquement chez Nietzsche l’extinction du monde vrai aboutit à celle du monde des phénomènes tout autant), en quoi sans doute restent-ils tous, à leur manière, platoniciens, donc tout simplement philosophes ? Peut-on vraiment dire donc que la leçon de Platon a été oubliée comme tu sembles le suggérer dans certains passages de Logique du phénomène ? Si elle l’a été, il me semble, mais nous reviendrons là-dessus, que c’est sans doute, comme tu le montres, dans l’idée d’une possible internalisation des normes au phénomène – comme le proposera Husserl, mais jamais dans l’abandon de la logique du phénomène. Cependant, si certes, cette logique n’a pas été abandonnée, elle a subi de Platon à Husserl des altérations extrêmement fortes et il me semble que le résultat de ton livre est bien de nous dire que la logique du phénomène n’est plus de mise dans un platonisme altéré ou sorti de ses gonds. Mais peut-être est-ce une lecture délibérément réactionnaire de ton livre à laquelle je me livre là ! Est-ce que cela ne discrédite pas totalement la possibilité d’un « platonisme du sensible » dont se réclame la phénoménologie – lequel, en somme, à te lire, ne serait plus un platonisme du tout ?
JB : Oui tu as raison, il ne s’agit pas pour moi d’opposer purement et simplement Platon et les conceptions modernes du phénomène. Dans la mesure où il s’agit de pensées du phénomène, elles supposent le dispositif platonicien et en héritent chacune à leur façon. En un sens, ce que j’ai fait dans ce livre, ce n’est rien d’autre que tirer le fil du platonisme comme fil qui traverse toute l’histoire de la philosophie : en un sens, le fil de la philosophie même.
C’est pourquoi la référence à Nietzsche est capitale, car il s’agit d’un des très rares auteurs qui (contrairement à la phénoménologie) se tienne en dehors de ce dispositif – donc il permet de l’interroger de l’extérieur et, en quelque sorte, le révèle. De ce point de vue, je ne suis pas sûr qu’il soit réellement correct de dire, comme on le fait parfois, que Nietzsche revient à la sophistique, mais ce qui est certain, c’est qu’il refuse de jouer le jeu de Platon. Evidemment, l’ironie, c’est que seul un philosophe peut faire cela de la façon dont il le fait, que ce retournement contre la « vérité » platonicienne est elle-même le fait de ce qu’il appelle « volonté de vérité ». Nietzsche n’est pas le héraut de l’abdication d’une telle volonté : il est au contraire celui qui la radicalise et pour ainsi dire la porte à incandescence, au point de retourner la puissance critique de cette volonté contre la « vérité » même. En ce sens, il est un des rares philosophes qui aient eu la probité – une de ses grandes valeurs – de remettre en question la philosophie, c’est-à-dire de poser la question de sa légitimité, elle qui pose les questions de légitimité. Avec Platon – mais en un sens bien opposé –, qui, de son côté, a lutté pour instaurer le type de norme de discours et de vie (norme sur la vie) qu’est la philosophie, il s’agit évidemment d’un des sommets de la pensée philosophique.
La phénoménologie au sens restreint (moderne) du terme n’est pas l’objet ultime de Logique du phénomène, qui traite plutôt des conditions générales sous lesquelles il peut être question de « phénomène » – et, dans le dernier temps de l’analyse, en dialogue avec Wittgenstein, de « donné ». En ce qui concerne la phénoménologie au sens historique du terme plus particulièrement, il me semble simplement que, telle qu’elle a été définie par Husserl, elle porte l’aporie constitutive d’avoir voulu internaliser au phénomène la norme qui lui permet d’être un phénomène. Husserl a nommé cela « intentionalité ». Le concept est bon. Cependant, il ne peut fonctionner, avoir son efficacité normative, que là où cette « intentionalité » est rapportée à une réalité – et donc là où on est déjà sorti du plan des « phénomènes ».
RM : J’aimerais aborder avec toi la place qu’occupe la dimension métaphysique abordée dans ton livre. Dans un entretien de 20113, tu affirmais « Pas de phénoménologie qui n’ait sa propre charge métaphysique ». A l’heure de la réhabilitation tous azimuts de la métaphysique j’aimerais que nous revenions sur ce point afin de lui apporter toutes les précisions nécessaires. Je me souviens lors d’une discussion que nous avions eue, tu m’avais dit: « je ne parle pas tant de la métaphysique que du métaphysique ». Pourrais-tu préciser le sens de cette distinction ? Je retrouve cette leçon dans une phrase de Logique du phénomène qui m’a ébranlé. Tu parles de ce « ce qu’il peut y avoir d’irréductiblement et positivement métaphysique dans la logique même »4. En ce sens, la phénoménologie retrouve la dimension de normativité constitutive de celle d’apparaître (l’une ne va pas sans l’autre) mais par une internalisation – ou immanentisation de la norme et en ce sens appauvrit considérablement cette part métaphysique dont tu parles. Ma question est de savoir si on la retrouve nulle part ailleurs aussi scrupuleusement et rigoureusement déployée que chez Platon? Et si ce n’est pas le cas, ne faudrait-il pas reprocher à la phénoménologie de rétablir, contre le positivisme, la dimension de normation, de laquelle on ne peut affranchir le phénomène, tout en refusant d’en assumer le coût? Autrement dit, d’accepter la norme tout en refusant la transcendance qui lui est essentiellement constitutive.
JB : Oui, il est vrai que, dans ce livre plus explicitement que dans les précédents, vient au jour le motif d’une forme de « réhabilitation » de la notion de métaphysique, suivant un mouvement caractéristique de la dernière phase de ma réflexion – évolution dans laquelle, du reste, le dialogue avec toi a joué un rôle important.
Il y a, à ce niveau, plusieurs remarques à faire.
D’abord, sans doute, un de mes premiers pas dans le sens d’une prise de distance par rapport à la phénoménologie française, alors massivement post-heideggerienne, il y a plus de vingt ans, a été de cesser de croire à la formule toute faite de « la fin de la métaphysique ». Cette formule hypostasie « la métaphysique », elle en fait un principe actif, comme si elle était, à la limite, le sujet de l’Histoire (avec un grand H, comme il se doit). Elle relève de toute évidence d’une philosophie idéaliste, à laquelle je ne puis souscrire. Voici longtemps que j’ai cessé de croire que les idées mènent le monde, et je ne sais pas ce que c’est que cette « Métaphysique »-là.
Une fois qu’on a dit cela, cela ne règle évidemment en rien la question de ce qu’on appelle ordinairement « métaphysique ». Reste l’évidence historique de l’existence de toute une série de recherches et questionnements philosophiques qui s’auto-intitulent, ou qu’on appelle de l’extérieur, « métaphysiques ».
A ce niveau, j’ai évolué. Je dois dire que je conserve, en règle générale, une certaine méfiance par rapport à de tels questionnements. En même temps, je pense qu’il faut démêler le bon grain de l’ivraie, et que, si ce que la philosophie appelle « métaphysique » est, en général, assez catastrophique, il est nécessaire, d’un autre côté, de faire droit à quelque chose comme une dimension métaphysique qui serait intrinsèque au concept de « réalité ».
En fait, je pense qu’il faut distinguer deux choses. D’un côté, on trouve la prétention de la philosophie à s’instituer en science – une science d’au-delà des sciences en quelque sorte – et, à ce titre, à nous délivrer une connaissance de surplomb de ce qui est. Ce motif aristotélicien de la science de l’étant en tant qu’étant, devenu, au prisme de la refondation moderne de l’idée de science dans celle de sujet, « ontologie », a toujours suscité ma méfiance. Ce qui a à charge de dire ce qu’il y a, ce sont les différents discours faits pour parler de tel ou tel genre de choses de tel ou tel point de vue, qu’ils soient scientifiques ou non. Je ne vois pas pourquoi il faudrait une philosophie pour ça. Quant à « l’étant » simplement en tant qu’« étant », je ne crois pas qu’il y en ait une science. Il n’y a pas de description de l’étant qui ne le prenne comme un certain étant, suivant un certain registre et dans une certaine dimension.
En revanche, bien sûr, il y a quelque chose à dire philosophiquement de ce qu’implique le fait qu’il y aille dans nos vies de choses qui sont (et non de simples « phénomènes »). En ce sens-là, il y a une réflexion philosophique à mener sur les conditions de cet engagement ontologique qui est toujours le nôtre.
C’est à ce niveau que se situe la dimension que je nomme métaphysique. Celle-ci est de part en part logique au sens où il y va en elle primairement de notre condition d’êtres parlants – et donc se parlant. Ce qui est métaphysique, c’est que nous soyons adressés à l’être – et donc qu’il y ait toujours pour nous, en un certain sens, une adresse de l’être. Or ce fait est absolument indissociable de ce que nous nous adressions les uns aux autres.
Le lieu du métaphysique n’est donc pas la monologie de l’être – l’ontologie – mais le logos lui-même en tant que logos adressé – qui donc porte en lui la différence, mais une différence logique – celle qui structure la logique même, d’être un espace de questions et de réponses, et de justifications possibles. C’est ce que j’appelle « métaphysique ». Le logos est métaphysique dans la mesure exacte où il est ce que, constitutivement, nous ne pouvons nous « donner » à nous-mêmes, et donc ce qui ne peut en aucun sens, pour nous, être un « donné ». Il est bien plutôt ce qui nous échoie toujours avant – au sens d’une priorité logique, celle de la logique même – qu’il y ait du « donné » et ce par quoi ce que nous qualifions pour nous comme « donné » est, par là-même, toujours déjà donné aux autres – ce qui est, grammaticalement, la seule façon d’être donné.
Sur le chemin de cette redéfinition, ton travail a joué pour moi un rôle important : il m’a, pour ainsi dire, libéré d’une restriction. A la fin de ma scolarité à l’ENS, dans les années de préparation de la thèse, Levinas fut une lecture déterminante, qui, déjà, au départ, m’a aidé à sortir d’un certain sens monologique – j’aurais tendance à penser maintenant : inévitablement monologique – de la « phénoménologie ». Je le lisais cependant alors encore excessivement dans le prolongement de la phénoménologie. Aussi, en prenant mes distances avec elle et en me rapprochant de certains motifs venant de la tradition dite analytique, je me suis aussi éloigné de cette lecture, qui a disparu de mon horizon un certain temps. Ton travail de thèse 5, mobilisant dans un même mouvement la référence cavellienne et le concept levinassien de « métaphysique » dans une critique de la phénoménologie négative, ou inversée, de Derrida, a rendu cette référence pour ainsi dire de nouveau acceptable pour moi, et a levé ce qu’on pourrait appeler mon inhibition à cet égard. J’ai enfin aperçu le rapport entre ce genre de philosophie et les considérations qui m’intéressaient depuis une dizaine d’années. Alors j’ai réintégré une réflexion de ce côté-là à ma problématique, évidemment dans des termes assez nouveaux par rapport à il y a vingt ou vingt-cinq ans, puisque j’y revenais avec à l’arrière-plan un agenda qui venait de la philosophie contemporaine du langage, dont j’ignorais à peu près tout à l’époque de mes études. Je suis revenu à Levinas par et depuis Wittgenstein en quelque sorte, et sans abandonner Wittgenstein. Le style d’analyse de Logique du Phénomène (sur l’apparaître, le donné, etc.) demeure fondamentalement wittgensteinien. Cependant, la compréhension qui y est formulée du rôle (métaphysique) du langage dans nos vies incorpore évidemment un élément levinasien. Dans mon esprit, ce n’est pas incompatible, du point de vue de l’analyse philosophique – même si les deux pensées mettent en jeu des styles d’écriture philosophique profondément incompatibles, mais c’est un autre problème. Dire que le langage, c’est toujours le langage de l’Autre, c’est au fond une réécriture possible de l’argument du langage privé. Reste à mesurer que ce fait grammatical a une dimension intrinsèquement métaphysique : qu’il nous installe en tant qu’êtres parlants constitutivement dans le métaphysique, au sens de ce qui dépasse ce qu’un peut dire. Mais cela, au fond, je pense que, en un certain sens, c’est aussi chez Wittgenstein. En tout cas, ça y est indubitablement si on le lit comme Cavell, dont je ne partage pas toute la lecture mais qui, c’est certain, nous a donné Wittgenstein à entendre comme on ne l’avait jamais entendu. Je pense que, en un sens, il a saisi ce qu’il y avait d’irréductiblement métaphysique, au sens positif du terme, chez le philosophe autrichien.
Au fond, « le métaphysique », c’est très simple : c’est que, pour parler, il faut, au départ, qu’il y ait de l’Autre. Evidemment, restaurer « la métaphysique » en tant que science, c’est une tout autre affaire.
En ce qui concerne Platon, sur lequel tu ramènes justement l’attention, c’est un amour de jeunesse aussi – logiquement, mon premier amour philosophique qui, en un sens, se confond avec celui de la philosophie même. Quand j’étais étudiant, je rêvais de lui consacrer un livre et je le ferai peut-être un jour.
C’est plus récemment, cependant, au vu d’un diagnostic sur l’état de la philosophie contemporaine muri au fil de mes expériences des vingt dernières années de part et d’autre des fractures qui caractérisent le paysage philosophique contemporain, que s’est imposé à moi le motif de ce que j’appellerais une nécessaire contre-réforme platonicienne en philosophie. Comme tu le sais, c’est en 2012, dans mon cours d’agrégation sur « la forme », que j’ai pour la première fois osé me formuler l’idée de cette façon, en la formulant aux autres – comme beaucoup de mes idées, elle n’a pris ses contours précis que dans l’enseignement, suivant les exigences de l’adresse.
Bien sûr, il y a quelque ironie dans cette formule. Je suis toujours amusé de la candeur avec laquelle l’étudiant en philosophie moyen – j’entends : statistiquement moyen – nourri au deleuzo-foucaldisme (c’est délibérément que j’associe ici la carpe et le lapin, car il est bien entendu que cette vulgate passe-partout a peu à voir avec Deleuze et Foucault eux-mêmes, que j’admire chacun à des titres différents), se croit passionnément « anti-platonicien ». Je suis aussi plus sérieusement consterné par l’anti-« platonisme » de principe de certains collègues qui, à mes yeux, repose sur un défaut d’examen. L’anti-« platonisme » est une posture relativement commune – même si non universelle – dans le milieu analytique, notamment. Evidemment il est lié à une caricature et à une mécompréhension de l’intention de Platon, quand celle-ci est même considérée.
Je pense qu’il faut mettre en avant deux points. Premièrement, il n’est pas du tout si facile de se débarrasser de l’idée de « norme » que ne tend souvent à le croire « l’étudiant en philosophie ». Aussi Foucault ne l’a-t-il jamais envisagé et peut-être, en un sens, Deleuze non plus – en tout cas son nietzschéisme, si on admet qu’il est véritable, devrait rendre les choses plus complexes de ce point de vue. Or, le défi que lance Platon, à l’origine de la philosophie, est celui de l’intelligence desdites normes : qu’est-ce qu’elles signifient ? et que signifie-t-il qu’il y en ait ? Il n’est pas dit qu’on doive répondre à ces questions de la façon dont le fait Platon, mais, pour autant, ce sont des questions auxquelles on ne peut échapper et qui sont définitionnelles de l’interrogation philosophique. Pour faire de mon bon plaisir la mesure de l’être – ce qui pourrait bien être constitutivement une énormité, non pas parce que ce n’est pas bien, mais tout simplement parce que c’est absurde – il faut déjà avoir un sens pour ce qui « est », et celui-ci n’est pas compris dans la simple notion de « bon plaisir ». Tel est le dilemme devant lequel nous met Platon, et notre narcissisme de post-modernes doit bien faire avec, « que cela nous plaise ou non ».
De l’autre côté, je pense que, du côté des critiques plus sérieux du « platonisme », selon une tradition endurante dans l’histoire de la philosophie, règne souvent une confusion entre Platon et ledit « platonisme ». En fait, ce qu’on reproche en général à Platon, ce sont les entités idéales, les Idées, ou bien, de façon corrélative, le motif d’un accès intuitif auxdites Idées. Bref, ce qui est mis en question, c’est soit l’ontologie, soit l’épistémologie platonicienne. La dernière est souvent lue comme une forme d’intuitionnisme naïf, comme si on recevait purement et simplement les Idées – les structures intelligibles – devant les yeux de l’esprit. C’est assez surprenant : cela revient à séparer l’expérience de l’intelligible, chez Platon, de la dialectique dans laquelle elle prend corps, et qui la rend seulement possible. Pour moi, Platon, évidemment, est le penseur du discours par excellence : pas d’Idées sans dialectique ascendante. D’autre part et surtout, de façon corrélée, à mes yeux, ce qui ne va pas, c’est la lecture de la philosophie platonicienne comme ontologie, ou comme culminant dans une ontologie. Très souvent on la réduit à cela, et, à vrai dire, dans le débat contemporain, le terme « platonisme » est devenu synonyme d’une certaine position ontologique. C’est à ce titre qu’il est généralement rejeté ou, rarement, défendu. Je lisais récemment un bon article de Frédéric Nef dans lequel il essayait de réévaluer l’apport possible de Platon à la métaphysique actuelle6. Le seul problème est qu’ici « métaphysique », comme presque toujours en philosophie analytique, voulait dire « ontologie » et que la contribution de Platon était entendue exclusivement en termes de catalogage du mobilier de notre monde. A mon sens, ce n’est pas le problème de Platon. Son propos est plutôt de nous conduire à nous interroger sur l’importance des items du catalogue, sur ce qu’ils signifient dans notre vie (dans notre condition terrestre) et, pour appeler un chat un chat, leur valeur. Il n’y a pas d’ontologie chez Platon. Ou alors celle-ci, fondamentalement, est ordonnée à la primauté de l’Idée du Bien, qui n’est pas une Idée comme une autre, mais si l’on peut dire méta-Idée (c’est là que tu trouves le principe du « métaphysique », suivant l’étymologie pseudo-platonisante du terme), Idée de la normativité même, et qui éclaire, du point de vue logique, la normativité fondamentale des autres Idées, qui, avant d’être des entités, sont des normes. Il n’y a pas de « monde des Idées » chez Platon, il faut toujours se le rappeler, mais tout au plus un « lieu intelligible » où, mythiquement (il est fondamental que ce soit présenté comme un mythe), nous pourrons « voir » les Idées.
Après, bien sûr, tout est question d’accentuation. Si on appelle « platonisme », comme on le fait souvent, sans toujours je crois comprendre exactement ce que l’on fait alors, toute posture qui traite primairement les normes comme des entités, qui les « ontologise », alors cela pourrait être une définition de « la métaphysique » comme ce qu’il faut éviter, parce qu’elle nous fait perdre à la fois le sens du réel et du normatif, fondée qu’elle est sur leur confusion. De ce point de vue, je suis pour l’anti-platonisme le plus déterminé.
Si, en revanche, on prend au sérieux le fait que, chez Platon, « les Idées » ne constituent pas un terminus ad quem, et se déterminent fondamentalement par leur subordination à l’Idée du Bien, qui leur est transcendante, comme un vrai soleil de la pensée (la pensée est donc de part en part affrontée à la question de la norme), alors on est assez loin, me semble-t-il, du platonisme comme ontologie, et c’est là que surgit, inévitablement, pour moi, la question du métaphysique, comme question qui a toujours à être reposée.
Bien sûr, il y a une part de choix stratégique à lire Platon ainsi – plutôt qu’à essayer désespérément de déchiffrer dans les textes « la doctrine de Platon » (entendez par là, bien sûr, sa doctrine ontologique, celle qu’il n’expose nulle part en toutes lettres mais qui, disent les interprètes, serait partout présupposée). Cependant, je pense que c’est aussi une façon de faire droit à la spécificité unique de son régime de discours, celui de la « philosophie », qui le place à l’avance dans un porte-à-faux de principe par rapport à ce qu’on appelle « histoire de la métaphysique » (qui est, en fait, histoire de l’ontologie, ou du désir de la philosophie de nier son propre désir (du Bien), et de se travestir sous les couleurs de la science ontologique).
Dans une belle formule, à mon avis très juste, Elisabeth Rigal parlait, dans un texte 7, à propos de Wittgenstein, d’un « Platon sans platonisme ». Eh bien, je crois que la formule est si juste qu’elle nous permet, à travers Wittgenstein, de voir ce qu’est Platon, une fois débarrassé lui-même de la charge scolaire du « platonisme ». En la matière, comme souvent, tout est question d’« aspects ». « Que veux-tu donc dire quand tu dis que… ? », demande le Socrate platonicien.
RM : Si ton livre est résolument platonicien, pour autant, et tu l’as précisé, tu ne partages pas avec Platon la sorte de réification des normes à laquelle il procède. Tu as une théorie extrêmement intéressante des « normes », présentée au chapitre VI et VII du livre. En effet, pour toi, il n’y a pas quoi que ce soit comme des normes déjà là, nous faisons les normes, en les calant comme tu le dis, sur des êtres. Et pour cela, le langage joue un rôle fondamental : celui de fixer des standards à partir desquels l’évaluation de l’apparaître – et l’apparaître tout court – devient possible : « Le cas où une maison est vraiment “donnée” se confond avec celui où, tout simplement, nous disons que nous voyons une maison, en employant le mot “maison” comme nous savons l’employer par rapport à certaines réalités sensibles de notre environnement. Or, dans ce cas, normalement, nous ne parlerions pas de “donné”. Nous en parlons précisément dans la seule mesure où nous faisons de ce cas un cas paradigmatique pour des expériences dans lesquelles la question se pose de savoir si la chose en question est bien “donnée” » 8. Peut-on revenir à cette genèse des normes que tu décris et au rôle du langage dans l’établissement de ces dernières, c’est-à-dire à l’élucidation de ce que tu appelles « le lien métaphysique dans lequel le langage nous met immédiatement avec les choses » ? Par là même occasion pourrais-tu commencer par expliciter cette idée de calage des normes sur l’être ? Et la distinction logique qu’il faut établir entre les normes et la réalité ?
JB : L’analyse menée dans le dernier temps du livre trouve ses racines chez Frege (qui n’est pas cité, mais qui pourrait faire office d’un Platon contemporain) et Wittgenstein (dont j’utilise les Remarques Philosophiques). Le génie indépassable de Frege est d’avoir réactivé, à l’orée de la philosophie contemporaine, un thème authentiquement platonicien : celui de l’irréductibilité de la norme à toute forme de processus naturel, contre tout « sophisme naturaliste » (suivant la formule de Moore). En même temps, Frege s’est cru obligé, pour assoir cette idée, de sacrifier également à une forme de réification platonisante – exactement ce qui est recouvert par ce qu’on appelle habituellement : platonisme. C’est le « troisième règne » des entités idéales venant suppléer celui des objets physiques et celui des représentations mentales. L’idéalité de ces entités est censée garantir leur fonction normative, mais il paraît essentiel, en quelque sorte, que cette fonction soit incarnée par une entité. Tout se passe comme s’il fallait réaliser la norme, en faire une chose, ou une quasi-chose, afin d’en assurer l’effectivité. C’est ce que j’appellerais la tentation de l’hyper-physique : construire la norme, dans son opposition à la nature, comme une autre nature, une nature au-delà de la nature, en quelque sorte. Or le redoublement d’une entité donnée par une autre (pas plus qu’une entité en elle-même, d’ailleurs : une pierre au jardin de la métaphysique analytique, et de la métaphysique tout court) n’a jamais en lui-même expliqué quoi que ce soit. Une entité – en d’autres termes : quelque chose qui est, ou est supposé être – ne constitue pas par elle-même une norme. En revanche, mais ce n’est pas la même chose, il est toujours possible de construire des normes avec de l’être, et c’est ce que nous passons notre temps à faire. Il suffit d’ériger une chose qui est en modèle. Mais pour cela nous n’avons pas besoin de choses particulièrement idéales. Le réel suffit. En lui-même il n’a pas valeur de norme. Cependant, lorsque nous usons d’un réel pour en mesurer un autre, par exemple pour définir de quoi ce second réel devrait avoir l’air sous certaines conditions, alors cet usage d’un réel est en lui-même producteur de norme. On n’a pas besoin d’entité idéale pour penser cela. C’est dans ces termes – suivant les lignes d’un Frege moins l’hyperphysique, ce qui pourrait être une assez bonne définition de Wittgenstein – que, à la fin du livre, le problème des normes est posé, en particulier de façon à cerner comment certaines normes peuvent, en référence à certains aspects de la réalité, fixer un cadre pour la notion d’« apparaître ».
Le rôle du langage, ou d’ailleurs de tout ce qui est assimilable à un langage – en fait, en la matière, tout symbolisme fait l’affaire – est de fixer la norme. Une chose, en elle-même, ne fait pas norme. En revanche, les mots ont le pouvoir de nous engager normativement avec les choses – rien de « magique » là-dedans : ils sont faits pour ça.
Une idée importante que j’ai voulu mettre en avant dans la discussion wittgensteinienne du dernier chapitre, et qui était déjà mentionnée dans mes Eléments de philosophie réaliste9, mais dont, alors, je n’avais pas encore mesuré toute la portée, est que, dans le langage, il y va de la réalité même autant que dans la perception, même si en un sens logiquement bien différent. En un sens, maintenant, je serais tenté de dire que c’est le seul langage qui nous relie avec la réalité des choses, au sens où il n’est rien d’autre qu’une machine à créer des prises sur celle-ci – à produire des identités et autres normes en tout genre qui rendent le réel intellectuellement et pratiquement maniable. La perception, elle, ne nous « relie » pas avec le réel, parce qu’elle n’est rien d’autre qu’un aspect, ou disons qu’une dimension, de ce réel même. Ou, peut-être plus exactement, elle est une dimension du concept de « réel ».
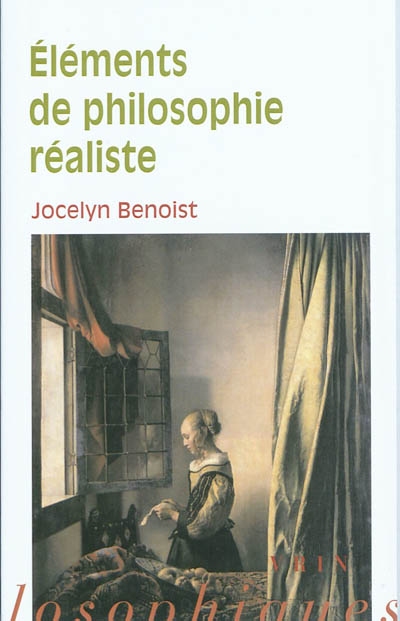
Seul quelque chose comme les mots est capable de nous engager par rapport aux choses – de nous mettre en position d’assumer qu’elles sont comme ceci ou comme cela – sans doute parce que seul quelque chose comme eux peut nous engager tout court, faire de cette relation que nous nouons avec les choses le bien d’autrui autant que et parce que le nôtre. Je parle de « quelque chose comme un langage », mais en fait, ce que je viens de donner là, c’est une définition du mot « langage » dans la plus grande extension du terme.
RM : Certains de tes lecteurs lisent ton œuvre comme retrouvant le chemin Biblique et/ou psychanalytique de la Loi. Je peux concevoir qu’à la lisière des normes se trouve inévitablement impliquée l’idée de Loi, sans jamais confondre celle-ci avec celles-là, bien entendu, mais il me semble néanmoins que c’est un point que tu n’affrontes pas explicitement dans ce livre bien que de nombreux éléments nous y reconduisent. Peut-on profiter de cet entretien pour clarifier cette articulation?
JB : Je pense que tu fais référence à la lecture, aussi forte qu’originale, proposée par Bruno Karsenti de mon livre précédent, Le Bruit du Sensible. Face à cette lecture, je ne sais pas trop que dire, et je suppose que ce n’est pas, pour moi, ici le lieu d’y répondre. Ce qui est certain, c’est que Bruno, sans doute mieux que tout autre, a vu ou, pour filer la métaphore, qui, dans le livre, n’en est pas exactement une, « entendu » quelque chose dans Le Bruit du Sensible. Il me l’a exprimé à sa façon, en me disant : enfin un livre qui nous débarrasse du paganisme chrétien de l’Esprit qui a à se faire chair, autre chose qu’une pensée de l’Incarnation ! Ca m’a surpris – je ne me voyais pas vraiment en penseur juif – mais il y a du juste là-dedans, certainement. Un aspect caractéristique de mes recherches sur le sensible, dans mes deux derniers livres, c’est en effet sa dé-spiritualisation radicale. Qu’on le respecte pour ce qu’il est, si on peut dire ! C’est une fois séparés le corps et l’esprit que le premier peut valoir quelque chose en lui-même, en tant que plan d’application des normes dans leur irréductibilité précisément à tout corps. D’une pensée du Verbe qui se fait chair on passe à celle d’une parole qui donne leur loi aux corps, sans jamais s’identifier à eux, fût-ce sous la forme de ce que « la métaphysique », fondamentalement spiritualiste, traite habituellement comme le « corps spirituel du mot ». Une telle identification (essayer de retrouver l’esprit dans le corps, ou le corps dans l’esprit), en effet essentielle pour comprendre ce qui s’est appelé « la métaphysique », relève, à mes yeux, de la pure et simple erreur de catégories. Il ne s’agit pas, contre la tendance constitutivement phénoméno-logique de la pensée occidentale, imprégnée d’une logique de la manifestation (la révélation (més-)interpréée comme dévoilement, « apocalypse »), de poser le corps et l’esprit comme deux substances « ontologiquement » distinctes, mais tout simplement de comprendre la différence grammaticale qu’il y a de l’un à l’autre. Fondamentalement, ils ne relèvent pas de la même grammaire. Pour le dire en deux mots, le corps ressortit grammaticalement à l’être ; l’esprit, à la norme (dont il est essentiel qu’elle ait à se dire) : il n’est rien d’autre que l’espace des normes. De là à trouver chez moi une pensée de la Loi, il y a un pas que je ne franchirai pas (en tout cas, pas tout seul).
Pour la psychanalyse, tu sais qu’elle m’a toujours intéressé et a toujours joué un rôle dans mon élaboration philosophique des problèmes. C’est vrai que le primat de l’Autre, pour moi, a quelque chose à voir avec cette préséance du Nebenmensch à la première étape de la vie que Monique Schneider mettait si bien en évidence dans un bel article sur l’Esquisse de 1895 qui mériterait d’être classique 10.
Dès le départ, avant même la parole en quelque sorte – dans le cri premier – la parole est demande. Elle est donc adressée de part en part. Il y a là un fait anthropologique très simple, qui est aussi un fait logique (au sens de : définitionnel du langage), dont je suis toujours stupéfait que la philosophie du langage, et la philosophie tout court, ne le prenne pas plus en compte. En fait, sur un mode différent, c’est aussi le genre de faits qui intéressent Wittgenstein.
RM : Pour conclure cet entretien, je voudrais t’interroger sur la question du réalisme. On assiste aujourd’hui à un retour en force du réalisme en philosophie. Toi-même, à de nombreuses reprises dans tes dernières œuvres, tu te réclames d’une démarche réaliste. Voici la définition que tu donnes de la philosophie dans Logique du phénomène : « sur la façon d’employer les mots, il y a toujours moyen de disputer, et c’est un aspect essentiel de ce que le Socrate de Platon entend par “philosophie” de le faire. Si l’emploi des mots était toujours évident à ceux qui les emploient, il n’y aurait pas de philosophie » (p. 40). J’ai l’impression que cette leçon est loin d’être partagée par ledit « nouveau réalisme » et qu’en ce sens, il y aurait comme un malentendu à qualifier ta démarche de réaliste si l’on prétend par là assimiler celle-ci à une variante de celui-là.
JB : Le retour vers le réalisme – dont j’étais parti lorsque j’étais étudiant : ma maîtrise se terminait déjà par une remise en question « réaliste » de Husserl – est un mouvement amorcé depuis plus de vingt ans dans mon cas. En vérité, la question était revenue en force pour moi dès la fin de ma thèse après ce qu’on peut considérer comme un détour par la phénoménologie française. Cette préoccupation explique assez largement le rapprochement esquissé avec une certaine philosophie analytique à ce moment-là, qui a marqué la phase ultérieure de mon travail. J’ai en un sens trouvé chez Frege, Wittgenstein et Austin les ressources d’un réalisme me conduisant à corriger, limiter, puis abandonner purement et simplement la phénoménologie et son engagement idéaliste de principe.
Aujourd’hui, je pense qu’on ne peut que se réjouir du fait qu’un certain nombre de philosophes importants d’éducation continentale placent leurs recherches sous l’étendard du « réalisme ». C’est assez nouveau, et évidemment il y a là un symptôme, le signe peut-être que la philosophie continentale est allée jusqu’au bout de ses excès idéalistes – de son idéalisme de principe – et en a la gueule de bois. En tout cas, si c’était vrai, cela donnerait l’espoir qu’on va enfin pouvoir refaire de la philosophie, au-delà du néo-classicisme académique d’une bonne partie de la philosophie analytique, trop occupée à parodier la science qu’elle n’a pas à être, et du baratin continental.
Evidemment on ne peut sous-estimer l’effet d’annonce – qui, lui, est bien continental. J’aurais pour ma part, tendance à me méfier – tu vas encore soupçonner un tournant réactionnaire – de ce qui se présente définitionnellement sous l’espèce du « nouveau ». A Turin, où Maurizio Ferraris m’a fait l’amitié de m’inviter à son séminaire, j’ai présenté un exposé à ce propos sous le titre interrogatif : « Vino vecchio in otri nuovi ? ». La parole évangélique nous met en garde contre les vieilles outres qui résistent mal au vin nouveau. Seulement, dans de nombreux cas, le vin vieux l’emporte sur le vin nouveau. J’aurais donc tendance, pour ma part, à faire confiance aux vieilles amphores – plus solides, et donc préférables aux outres.
Avec humour, Maurizio Ferraris observe qu’il est possible que, dans un siècle, il reste aussi peu du « Nouveau Réalisme » de notre temps qu’il ne reste aujourd’hui du New Realism proclamé dans la philosophie américaine d’avant la guerre de 14 – dont le point de vue antireprésentationaliste avait pourtant des aspects sympathiques. Par définition on n’en sait rien, et cela n’a aucune importance. Ce qui est sûr c’est que Maurizio Ferraris et mon ami Markus Gabriel, qui sont les protagonistes centraux de cette affaire, sont de bons philosophes, créatifs et intéressants, et que leurs œuvres respectives – en réalité de teneur assez différente et développant également des positions contrastées en ce qui concerne le contenu à donner à la notion de « réalisme » – sont sans doute de nature à faire bouger les présupposés de la philosophie dite « continentale » dans le bon sens. Pour moi, ce sont des interlocuteurs, même si je me classerais plutôt dans les « anciens réalistes ». Ce n’est pas par goût des antiques, mais, si le réalisme est en effet, probablement, en un sens, chose assez nouvelle pour la philosophie continentale, sur le fond, il vaudrait mieux, sans doute, pour être réellement digne de son nom, qu’il ne soit pas trop « nouveau ». C’est sans doute la dette indélébile que je paie aux philosophies de l’ordinaire : où serait la réalité si ce n’est là où nous la rencontrons et dans ce que, en un certain sens, nous savons « déjà » indépendamment de la philosophie ? Ma conviction profonde est que nous n’avons pas besoin de la philosophie pour découvrir quelque réalité que ce soit. Pour nous aider à y revenir, si, sans doute, et telle est la fonction essentiellement critique du thème réaliste à mes yeux. J’ai bien conscience que ce que je dis là peut sonner comme un paradoxe, tant la philosophie, souvent, a servi au contraire à ne pas voir la réalité. Cependant il ne s’agit alors que nominalement de philosophie : plutôt de « métaphysique » au sens péjoratif (qui, on l’a dit, n’est pas le seul) du terme.
Cher Raoul, permets-moi de te remercier pour cet échange, qui a rendu les choses beaucoup plus claires pour moi sur de nombreux points. Tes questions, qui vont au droit au but, m’ont sans doute forcé à être beaucoup plus clair que je ne le voulais, et m’ont par là-même aussi permis d’aller plus loin que je ne le pouvais. Tu me permettras de voir là l’adresse de la « métaphysique » dans son versant positif et de t’en dire ma gratitude, comme pour le reste. Le livre, tu le sais, doit déjà beaucoup à nos entretiens.
RM : Merci à toi, c’est un grand honneur pour moi d’avoir une place parmi ceux que tu considères comme tes interlocuteurs !
- Logique du phénomène, p. 107
- Logique du phénomène, p. 44
- « Context, Realism, and the Limits of Intentionality », in Tarek Dika & W. Chris Hackett (eds.), Quiet Powers of the Possible. Interviews in Contemporary French Phenomenology, New York, Fordham University Press, 2016, p. 103
- Logique du Phénomène, p. 62
- Qui a, depuis, donné lieu à publication : Raoul Moati, Derrida et le langage ordinaire, Paris, Hermann, 2014
- Frédéric Nef, « Platon et la métaphysique actuelle », Études platoniciennes, 2012, p. 13-46
- Elisabeth Rigal, « Ludwig Wittgenstein, un Platon sans platonisme », in Monique Dixsaut (éd.), Contre Platon, t. 2 : Renverser le platonisme, Paris, Vrin, 1995, p. 101-126
- Logique du phénomène, p. 181
- Jocelyn Benoist, Eléments de philosophie réaliste. Réflexions sur ce que l’on a, Paris, Vrin, 2011
- Voir Monique Schneider, « En-deçà de l’objet : la proximité et l’éthique originaire », in Jean-François Courtine (éd.), Figures de la subjectivité, Paris, Ed. du CNRS, 1992, p. 193-206