Né en 1968, professeur à l’Université Paris I, membre de l’Institut Universitaire de France, directeur des Archives Husserl de Paris, Jocelyn Benoist est l’auteur de douze ouvrages, l’éditeur scientifique de quatorze autres ouvrages, et l’auteur de cent quatre vingt articles à ce jour. Il a longtemps œuvré à l’interface de la phénoménologie et de la philosophie analytique, de la philosophie du langage et de la philosophie de l’esprit, et s’est en particulier imposé comme un des principaux spécialistes de la philosophie autrichienne et des origines de la phénoménologie.
Depuis la publication de son ouvrage Les limites de l’intentionalité1, il s’attache à définir les contours d’une philosophie réalisme dont les résultats les plus récents sont exposés dans Concepts2 et surtout dans les Eléments de Philosophie Réaliste3.
L’ensemble de son parcours a été brillamment exposé par Raoul Moati4.
L’entretien ici présenté a été réalisé par courriers électroniques au cours des quinze premiers jours de juillet 2012. Je tiens à remercier particulièrement Jocelyn Benoist pour sa disponibilité, pour le temps et la générosité consacrés à ses réponses et pour sa bienveillance.
Sensibilité
Actu-Philosophia – Tu as commencé par chercher à établir quelque chose qu’on peu qualifier de philosophie de la présence – marquée, tu l’écris toi-même, par Jean-Luc Marion5, en particulier par son article « La percée et l’élargissement », et peut-être encore plus par Didier Franck.
Tes premiers textes publiés portaient sur les structures facticielles de l’ego transcendantal – sur ce que Husserl, dans les manuscrits C, théorise comme flux archi-hylétique, à la fois porteur de l’extension temporelle et de l’extension spatiale. Il y a là, d’une autre façon que chez le second Heidegger, une interrogation sur l’espace et la spatialité : l’idée qu’il y a quelque chose d’irréductible dans la spatialité – quelque chose, même, dont il faut rendre compte si on veut rendre compte de la temporalité. Husserl, de son côté, prolonge cette interrogation en cherchant à thématiser une intentionnalité pulsionnelle ou de poussée (qui pousse de présent à présent) – à la fois porteuse du mouvement d’auto-transcendance du sujet vers le monde et du mouvement de sa temporalisation.
Cette réflexion sur l’espace s’est concrétisée en ce qui te concerne à travers une série d’ouvrages co-dirigés avec Fabio Merlini, en particulier : Après la fin de l’histoire. Temps, monde, historicité, et Historicité et spatialité. Recherches sur le problème de l’espace dans la pensée contemporaine. Tu introduis d’ailleurs ce second ouvrage avec un article intitulé « spatialiser ; historiciser». Dans lequel tu écris que : « Ce qui est en jeu alors [avec la question de l’espace], c’est une nouvelle expérience de la positivité du réel qui a toujours à voir avec son extensivité ».

Jocelyn Benoist : Que serait une « philosophie de la présence » ? S’il s’agit de mettre en avant le fait que les choses nous sont présentes, ce geste est toujours un peu suspect : il suggère ce qu’il entend conjurer. Si les choses doivent être caractérisés comme « présentes », c’est donc qu’elles pourraient être absentes. Plus : ce n’est que depuis un fond d’absence auxquelles elles s’arracheraient qu’il y a un sens à les qualifier ainsi.
En ce sens, la crise de la présence dont la phénoménologie, après Husserl, a été saisie – ce pourrait être là le trait distinctif de ce qu’on appellera « post-phénoménologie » – ne constitue probablement que la contrepartie du projet même d’une philosophie de la présence. Ce n’est que pour une conception suivant laquelle les choses auraient à se manifester, à se phénoménaliser, que celles-ci peuvent échouer à le faire, ou que l’on peut s’étonner que certaines ne le fassent pas.
Il est vrai qu’au départ je me suis inscrit en faux contre une certaine critique, alors prévalente dans le milieu philosophique continental où j’ai été éduqué, de la « métaphysique de la présence ». Dans une telle formule, si je la comprends si peu que ce soit – ce qui n’est pas dit – probablement le mot important est-ce : « métaphysique ». Ce qui serait en question alors, ce serait un sens normé de la présence suivant lequel celle-ci est censée apporter une forme de réponse à une demande – ce qu’on appelait jadis un « remplissement ». Mais après tout, dans les Recherches Logiques, toute intentionalité n’est pas une « Intention » au sens restreint qu’isole alors Husserl c’est-à-dire une intentionalité qui appelle un remplissement. Il n’est même pas sûr que la perception elle-même soit une « Intention » : certainement, la vie de la conscience perceptuelle produit localement des phénomènes de remplissements intra-perceptuels, d’une intentionalité perceptuelle à une autre, mais il n’est pas dit que de telles intentionalités perceptuelles appellent par elles-mêmes, définitionnellement, en tant que perceptions, de « remplissement ». D’autre part, contre Husserl, il faut peut-être de toute façon libérer plus clairement la phénoménalité de tout engagement a priori dans une intentionalité. Certaines phénoménologies ont essayé de prendre cette voie. A partir de là, il paraît tentant de vouloir libérer le phénomène de toute entente téléologico-normative. Alors, on peut penser que l’on puisse ainsi dégager un autre sens de la présence, qui ne serait plus celle d’un remplissement, mais de « ce qui est donné », purement et simplement. Quelque chose comme une présence déchargée métaphysiquement. Sans doute est-ce ce que je croyais avoir en vue dans ces énoncés où, dans mes premiers travaux (Autour de Husserl, 1994), je pouvais revendiquer un concept positif de présence.
Maintenant, j’aurais tendance à penser qu’un tel concept neutre de « présence » est une illusion, que « la simple présence des choses » est un mythe et qu’on ne parle jamais de « présence » que sous l’horizon d’une norme, qui la mesure. Aussi, si l’on veut lâcher les grands mots, il n’y a pas de présence qui ne soit pas « métaphysique », au sens où c’est raisonner en termes de présence qui est intrinsèquement métaphysique. Mais ne pas raisonner en termes de présence, ce n’est certainement pas adopter le discours de la non-présence, de l’absence ou de la trace : c’est au contraire reconnaître que, dans l’ensemble, les choses n’ont pas à se présenter à nous parce qu’elles sont déjà là. Ce n’est que sur le fond de cet être premier – ce que j’appelle leur « réalité » – que cela a localement un sens de les dire « présentes » ou « absentes ». Bien sûr, un tel changement de perspective suppose qu’on renonce également à la notion de « phénomène » dans son emploi absolu.
En ce qui concerne ma formation, c’est en effet avant tout l’enseignement de Didier Franck qui a compté pour moi. Il m’a appris la phénoménologie husserlienne, en m’habituant aussi à jeter sur elle un regard critique. Sa construction de la question du corps et de la spatialité dans son irréductibilité à toute déduction phénoménologique, que ce soit par la voie husserlienne ou par la voie heideggerienne, a été très importante pour moi. J’ai placé beaucoup d’espoir, pendant longtemps, dans la mise en avant de l’espace comme une forme de principe d’extériorité métaphysique, le privilège du temps entendu comme temps de la conscience ayant constitué le vecteur de l’engagement de la pensée moderne dans la voie de l’idéalisme. C’est resté un axe important de mon travail tant que j’ai cru que la solution aux questions que je me posais était ontologique.
Ensuite, à la fin de ma scolarité à l’ENS (1990-1991), je me suis intéressé à l’œuvre de Jean-Luc Marion. Du point de vue strictement phénoménologique, l’opération de réouverture de la variété des modalités de l’intentionalité husserlienne qu’il effectuait dans son texte « La percée et l’élargissement » m’intéressait, mais sans doute pour des raisons bien éloignées de son agenda réel : j’y voyais, quant à moi, la possibilité de mobiliser la phénoménologie husserlienne pour développer un questionnement ayant trait à la signification. Ce que j’ai fait par après, jusqu’à ce que je me rende compte qu’il s’agissait d’une voie sans issue.
AP : Tu poursuis ta recherche sur la dimension irréductible du sensible dans ton livre Kant et les limites de la synthèse en prenant plus à la racine la question du rapport de cette « présence » au langage qui l’exprime. Passer à Kant, c’est déjà sortir du donné phénoménologique tel qu’il est thématisé, le prendre dans ce qu’il a de plus impalpable et de plus évident – comme structure de ce qui va de soi. Dans L’idée de phénoménologie, tu synthétises cette perspective en écrivant : « La contingence du donné alléguée ici n’est pas la possibilité du non-donné, à côté du donné, mais la fragilité fondamentale du donné qui le fait immaîtrisable, d’être ce pur surgissement sans raison aucune qui est le fond même d’expérience par rapport à laquelle peut se déployer notre raison (…).» (p. 68) ou encore « De la passivité fondamentale associée à l’événement, le moi naît et d’un événement à l’autre il ne répète rien d’autre que sa passivité, qui est l’épreuve pure de l’événement lui-même (…) », (p. 73).
JB : Le retour à Kant constituait certainement déjà un pas de côté par rapport à la phénoménologie. En mettant en avant, contre les lectures néo-kantienne et heideggérienne, l’irréductibilité de l’Esthétique transcendantale, j’ai recherché, paradoxalement, dans la Critique la figure d’un « donné » qui résisterait à la synthèse et comme un résidu d’empiricité. Mon Kant louche vers l’empirisme. Il est en tout cas celui du transcendantal confronté à ses propres limites, alors que la phénoménologie, via les synthèses passives, a essayé d’absolutiser le transcendantal et de le faire sans reste. Ce qui m’a intéressé, au contraire, c’est le reste comme tel, ce reste qu’au fond, dans mes premières recherches, est le sujet, entendu comme subjectivité : sensibilité et pâtir.
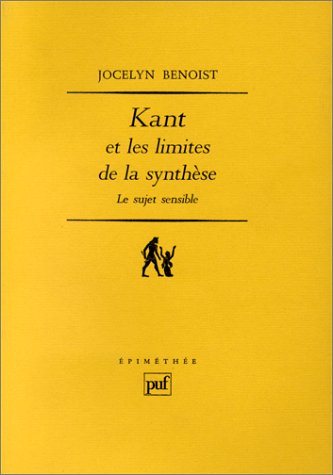
Il s’agissait, dans Kant et les Limites de la Synthèse (1996, à partir de ma thèse de doctorat soutenue en 1994), de redéterminer le sujet, entendu comme subjectivité, à partir de l’événement de la sensibilité, selon une dimension essentielle de passivité. Ce que j’ai essayé de faire, dans le contexte post-phénoménologique d’alors, était dans l’air du temps, même s’il était certainement un peu inattendu, compte tenu de l’image de ce philosophe habituellement nourrie par la phénoménologie, d’essayer de le faire à partir de Kant. Au fond, ressaisir la subjectivité comme être-affecté depuis une épreuve sensible conçue comme une forme d’événementialité était comme le problème commun posé à une post-phénoménologie qui, depuis cinquante ans, se débattait désespérément pour sortir de l’idéalisme transcendantal présent même chez Heidegger (dans Sein und Zeit au moins). Je pense que ce qui distingue mon essai dans ce contexte général, c’est la conscience du fait qu’inscrire l’événement du sensible comme une forme de « limite » (« les limites de la synthèse ») au cœur même du transcendantal, ce n’est pas introduire une instance transcendantale de rechange ou inversée, fût-elle passive, négative, ou ce qu’on voudra. L’événement est précisément ce qui ne peut plus être un transcendantal. Donc caractériser la sensibilité comme événementialité, c’est avant tout et surtout marquer la limite d’un certain mode d’analyse. Il n’y aurait aucun sens à transcendantaliser les limites du transcendantal et à produire une forme d’analytique a priori de l’événementialité reproduisant parodiquement les formes de l’analyse transcendantale.
Après restait encore à franchir un pas décisif – le dernier pas – , et à se rendre compte que, pas plus qu’il n’y a de sens à absolutiser la notion de « phénomène », il n’y en a à absolutiser celle d’événement, à mettre de l’événement partout, et à traiter l’expérience sensible elle-même comme un événement. Il y a des événements, certainement, et des événements sensibles, mais de telles notions supposent l’indépendance première de ce qu’il y a, et de ce qu’il y a de façon sensible, par rapport à la notion d’événement : cette dernière n’est pertinente, une fois encore, qu’au sein d’une réalité, pour opposer certains aspects de cette réalité à d’autres. Mais c’est tout juste un non-sens de dire, comme j’ai pu être tenté de le faire, que la réalité elle-même soit un événement. Ou alors, il faut redéfinir complètement la notion d’événement, ce qu’on est toujours en droit de faire. Mais il faut le faire. Comme les mathématiciens le savent bien, ce n’est pas rien d’introduire un nouvel usage : il faut être capable de le rendre effectif.
AP : Je me permets juste une petite remarque à ce sujet. Je suis totalement d’accord en ce qui concerne les difficultés d’une analytique événementiale qui procéderait par une déduction crypto-transcendantale des modalités de l’événementialité. Dans ce type d’élaboration, qui plus est, la structure de la métaphysique classique est juste renversée et reproduite à l’envers: l’événement devient la catégorie matricielle, comme l’être avait pu l’être jusqu’alors.
Mais dire qu’il fait partie du cahier des charges d’une phénoménologie de faire place à l’événementialité qu’il peut y avoir dans l’expérience – de prendre en compte qu’il puisse y avoir des événements, n’est-ce pas déjà quelque chose comme un raisonnement transcendantal ? J’aurais tendance à employer justement le qualificatif de transcendantalisme en ce sens-là. Pour dire qu’il y a des dimensions dont on ne peut pas s’affranchir, qui font partie des conditions d’articulabilité d’une théorie de l’expérience.
JB : Bien sûr, c’est bien pourquoi à partir de ce moment-là il ne pouvait plus s’agir d’une phénoménologie. Ce qui avait en effet voulu commencer comme une phénoménologie de l’événement s’achevait comme un simple constat d’empiricité et la prise de conscience qu’il y avait autre chose à faire : élucider la grammaire de ces déterminations, et non fonder leur possibilité.
AP : Ensuite, il me semble déceler deux tendances. D’une part, un accroissement de cette dimension d’impalpabilité – on passe d’une certaine façon au fur et à mesure d’un caractère phénoménologique du sensible à sa grammaire en excluant toute forme de redoublement – il n’y a pas de sens à parler d’une phénoménalité du sensible, nous y sommes toujours déjà, cet « y être » n’est pas un mode d’être mais une structure de description. L’existence, au fur et à mesure, se dévêt alors de tout caractère descriptible – en tout cas descriptible en tant que tel – se dépouille de tout ce qui pourrait être interprété en terme de phénoménalité. Exister, cela va de soi – il n’y a aucune profondeur phénoménologique dans la tautologie de l’existence. Au contraire, les structures phénoménologiques sont des transpositions d’une grammaire de la description.
JB : Tu énonces le diagnostic auquel je suis parvenu mieux que je ne saurais le faire. Selon la formule de Wittgenstein, il y a des problèmes phénoménologiques, mais il n’y a pas de phénoménologie. Il y a des problèmes phénoménologiques dans la mesure exacte où il peut être pertinent de dire de quelque chose que cela « apparaît », et ce genre de caractérisation soulève des problèmes spécifiques, mais il n’y a pas de phénoménologie au sens où il n’y a pas une doctrine d’un fait universel qui s’appellerait l’apparaître. Il n’y a rien d’évident ni de naturel à dire des choses, a priori, qu’elles apparaissent. Sous certaines conditions, de certaines choses et dans certaines circonstances, cela a un sens. En revanche il est beaucoup plus difficile de voir ce que cela pourrait signifier des choses en général, ou comme condition générale sur les choses.
En d’autres termes, il n’y a pas de « donation ». Sous certaines conditions, cela peut avoir un sens de dire de certaines choses qu’elles sont « données » – elles le sont alors toujours à quelqu’un et, en un certain sens, par quelqu’un. Mais, en elles-mêmes et par elles-mêmes, les choses ne sont pas « données ». Ou alors, encore une fois, il faut définir un sens pour un tel emploi, et cela a un coût : par opposition à quoi ? pour distinguer quoi ?
Il y a une façon de la phénoménologie d’abstraire les déterminations venant de ce qu’on appelait au bon vieux temps la « métaphysique de la subjectivité » et de les hypostasier en les proclamant asubjectives, ou plus radicales que le sujet. « Apparaître », dit-on – mais apparaître à qui ? « Apparaître » tout seul ne marche pas. « Donné » – mais à qui ? Une fois engagée cette interrogation se pose inévitablement la question du statut ontologique de ce « Qui ? », comme aurait dit Heidegger. Et alors on découvre une chose très simple que seul un rapport philosophique au langage fondé sur l’oubli constant de ses conditions d’effectivité avait pu nous faire oublier, à savoir qu’il n’y a d’ « apparaître » et de « donné » que dans une réalité, et comme structures de cette réalité.
Une fois rétabli ce scénario du don ou de l’apparaître, qui fait partie de la grammaire de ces notions, il devient patent qu’elles ne s’appliquent qu’à des cas particuliers et ne peuvent nullement caractériser ni le statut des choses en général, ni le rapport que nous aurions à celles-ci.
Ce que la phénoménologie essaie de cerner sous le nom d’« apparaître » ou de « donation », c’est en réalité tout autre chose : le fait que, là où nous décrivons une certaine chose, selon la situation, nous la décrirons d’une façon ou d’une autre. Par exemple, dans certains cas il sera pertinent de parler de « présence » de la chose, dans d’autres non ; dans certains cas, de qualifier cette présence en termes d’apparaître, dans d’autres non. Cependant l’illusion phénoménologique consiste, comme tu l’as bien relevé, à prendre ce qui définit un format de description pour un trait substantiel : comme si être telle que cela ait un sens de la qualifier comme « apparaissant » ou non (par exemple) était quelque chose que la chose elle-même faisait, et il y avait une science autonome (la phénoménologie) à déployer de cette activité de la chose – apparaître ou pas. Alors qu’être telle par exemple que cela ait un sens de la décrire en termes d’apparaître – et donc inversement de dire d’une façon sensée qu’elle n’apparaît pas – n’est pas un fait à propos de la chose, mais plutôt une condition pour énoncer certains faits à son propos : un format de description.
Pour la phénoménologie, tout se passe comme si les choses parlaient – leur possible silence même étant réinterprété comme une modalité de parole. C’est là une erreur de catégorie : les choses ne parlent pas ; c’est nous qui parlons. Et ce qui importe, là où nous voulons exercer une prise correcte sur les choses, c’est de débrouiller les différentes façons que nous avons d’en parler. La phénoménologie doit être remplacée par une analyse des différents formats descriptifs possibles et des déterminations réelles de ces formats : que supposent-ils (et non : énoncent-ils) de la réalité ?
AP : Parallèlement, tu insistes de plus en plus sur ce qu’il y a de non-problématique dans la perception. Lorsque tu dis, dès Les limites de l’intentionalité qu’il y a plus dans la perception que n’en contient notre philosophie, tu dis d’abord simplement ceci : que dans la perception, il y a la perception. La perception dépasse ce qu’on peut en dire non parce qu’elle se phénoménaliserait selon une structure de frappe ou de ravissement, mais parce qu’elle est définie, dans son rapport au langage par cette extériorité mutuelle. Il n’y aurait pas de « comment » de la perception – mais peut-être un caractère actif. Dans Les limites de l’intentionalité tu précises : ce qu’il y a dans l’acte de percevoir, « c’est qu’il faut le faire. » Ce faisant toutefois, tu passes progressivement d’une pensée de l’action à une pensée de la manipulation dans laquelle le résidu phénoménologique se dissout. C’est déjà manifeste dans l’article « Mettre les structures en mouvement : la phénoménologie et la dynamique de l’intuition conceptuelle. Sur la pertinence phénoménologique de la théorie des catégories. », Rediscovering Phenomenology. L’intuition catégoriale est retraduite dans le langage de la manipulation au sens le plus ordinaire : la théorie des catégories relèverait d’une dimension manipulatoire des mathématiques. C’est ce paradigme du jeu et de la manipulation qui me semble récupérer ce que la phénoménologie abandonne. De la même façon que la contextualité a sur la mondanité ou l’horizontalité l’avantage d’être « silencieuse » : le contexte est une structure descriptive, il n’y a pas de sens à parler d’expérience du contexte…

JB : D’abord, je voudrais lever une équivoque. Le fait que la perception soit « non-problématique » ne veut certainement pas dire qu’elle soit simple. C’est très compliqué, la perception, et il est probable que, scientifiquement, nous ne nous tenions qu’à l’orée de la découverte de cette complexité. D’autre part, les philosophes, qui ont l’habitude de poser à la perception des questions auxquelles, constitutivement, elle ne répond pas, mais qui, par bien des côtés, s’appliquent à un niveau qui n’est gagné qu’au prix d’une essentielle opération de simplification, ont tendance à ignorer la richesse constitutive du perçu, qui est celle du sensible. Il est finalement très rare qu’une philosophie parle réellement de la perception.
En revanche, que la perception soit non-problématique veut dire qu’elle est de ce genre de fait en amont duquel cela n’a pas de sens de vouloir se placer. Il y a une tendance de la philosophie à vouloir constituer la perception de l’extérieur, à expliquer comment nous pouvons percevoir, ceci non pas au sens d’une explication génétique et causale, mais en celui d’une analyse transcendantale, en termes de conditions de possibilité a priori. Le problème c’est qu’alors, on ignore que la perception est partout présupposée par les structures qui sont censées la rendre possible. La perception est un fait premier, et une contrainte très forte sur notre ontologie : cela ne veut pas dire que celle-ci se réduise à celle du perçu, mais que, à l’arrière-plan d’une bonne part de nos concepts, il y a une référence à la perception. Nous ne pouvons pas faire comme si nous n’avions pas de perception et faire mine de nous la donner de l’extérieur. Nous ne pouvons pas non plus faire comme si, ce que nous percevrions, ce ne serait pas des choses, pour nous mettre en position d’établir que nous arriverions tout de même, au bout du compte, on ne sait trop par quelle opération (quelle « intentionalité ») à en percevoir : en effet la référence à la perception est déjà présente dans le concept de « chose » que nous manipulons alors. La première fournit l’étalon du second.
Après, ta lecture de mon assertion dans Les limites de l’intentionalité (2005) selon laquelle il y a plus dans la perception que n’en contient notre philosophie, est un peu généreuse. Certes, maintenant, je ne lui accorderais plus d’autre sens que celui, tautologique, que tu pointes, suivant lequel « dans la perception, il y a la perception » – autrement dit : rien que la perception, mais aussi toute la perception, dans sa richesse souvent insoupçonnée des philosophes ou négligée par eux. Cependant, à l’époque, je pense qu’il y avait encore sous ma plume plus qu’un résidu de l’interprétation phénoménologique, que tu évoques aussi. Quelque chose comme une réimmanentisation du thème du dépassement de limite, qui fait voler en éclat le moule intentionnel, la perception, dans son absolue facticité mais aussi son caractère potentiellement surprenant, jouant ici le rôle de l’expérience extrême. Au fond, dans mon texte sur perception et réalisme qui clôt Les limites de l’intentionalité, j’accorde à la perception une forme de transcendance – par rapport à la structure intentionnelle.
AP : Dans cette perspective s’inscrit aussi le séminaire mis en place avec Jean Petitot sur les « Structures linguistiques et structures perceptives», ainsi que la journée suivant la réédition du livre de Roger Chambon, Le monde comme perception et réalité (livre tout à fait fascinant d’ailleurs) ? Je me souviens que la présentation que tu en faisais mettait déjà en relief une sorte de paradoxe à ce type d’approche : en introduisant une sorte de nécessité métaphysique de l’apparaître dans l’être, Chambon sort d’emblée d’une certaine façon du terrain de l’apparaître.
JB : Le séminaire avec Jean sur « Structures linguistiques et structures perceptives » (2004-2006) répondait à mon désir d’explorer la différence entre niveaux d’organisation linguistique et perceptif. En la matière, l’aide de Jean, qui a consacré des travaux importants à l’irréductibilité du format perceptif, m’a été précieuse.
La journée sur Chambon (2007) répondait à des objectifs un peu différents. J’ai trouvé, pour ma part, chez Chambon, dont l’œuvre a été trop négligée, les ressources d’un réalisme perceptuel. Dans ma communication, je le lisais, non sans quelque détournement, en un sens très wittgensteinien. C’est dire que l’aspect métaphysique, de déduction de la nécessité de l’apparaître dans l’être, n’était pas ma tasse de thé. Cet aspect métaphysique de la pensée de Chambon m’était déjà opaque, et l’est encore plus aujourd’hui. Je ne crois pas que « l’apparaître » soit quoi que ce soit qu’il faille « déduire ».
Pour revenir à la supposée « transcendance » de la perception à l’intentionalité, j’aurais plutôt tendance, maintenant, à présenter la perception comme en-deçà de la structure intentionnelle au sens de non-concernée par elle. La perception n’a pas besoin d’être inédite pour être ce qu’elle est, avoir la facticité qu’elle a. Si elle frappe par sa « nouveauté », c’est toujours pour des raisons externes à elle, compte tenu d’un usage qu’on en fait et de quelque chose qu’on attend d’elle.
Dans l’ensemble, toute l’histoire de mon cheminement ces dix dernières années est celle du passage de la recherche de ce qui pourrait échapper à la structure intentionnelle, par le haut ou par le bas, parce qu’y résisterait, s’y déroberait, à la prise de conscience des limites dans lesquelles cela a un sens d’appliquer le paradigme intentionnel et de la différence de catégorie entre ce sur quoi on raisonne en termes d’intentionalité et ce sur quoi on ne le fait pas. Ce qui tombe dans la seconde catégorie : la réalité, n’échappe ni ne résiste à l’intentionalité, ne la « dépasse » pas. Ne peut, en effet, être en porte-à-faux par rapport à l’intentionalité que ce qui, à un niveau ou un autre, participe de la structure de l’intentionalité, n’est pas simplement de l’ordre de l’être, mais de la norme. La perception, quant à elle, qui est ce qu’elle est, a la puissance de la réalité – elle ne peut que posséder cette puissance, puisqu’elle constitue un ingrédient essentiel de notre concept même de « réalité ».
Quand, dans Les limites de l’intentionalité, j’écrivais que, ce qu’il y a dans l’acte de percevoir, « c’est qu’il faut le faire », cet énoncé présentait également encore une certaine équivoque.
Je retiendrai encore aujourd’hui la contrainte d’effectivité qui en est un aspect. Il n’y a de perception que la perception effective. Percevoir est quelque chose qu’on fait, non qu’on représente – ou, si on le représente, c’est qu’on ne perçoit plus. C’est pourquoi aussi la perception est la butée sur laquelle ne peut que se retourner le principe idéaliste de la phénoménologie suivant lequel « plus haut que l’effectivité, se tiendrait la possibilité ». Elle est ce qui, précisément, ne peut s’entendre en ces termes-là. Encore une fois, la perception n’est pas un remplissement. Bien sûr, on peut parler de remplissement perceptuel ; mais un tel remplissement n’intervient que selon une norme, et si celle-ci mérite le nom de « perceptuelle », c’est que, dans sa structure, elle a intégré la référence à des perceptions effectives. En la matière, l’effectivité vient d’abord.
En revanche, si, par « faire », on entend une activité, je me montrerais maintenant plus réservé sur ce point que je ne l’ai été. Bien sûr, il y a une activité perceptuelle, et on ne peut expurger ce qu’on appelle « perception » de sa dimension exploratoire et d’enquête. Nous sommes actifs dans la perception et on peut même dire que nous y faisons toute sorte de choses. Cependant, tout d’abord, en règle générale, cette activité n’est pas de l’ordre d’une action, sauf circonstances exceptionnelles. Et il ne faudrait de toute façon pas retomber dans la représentation selon laquelle cette activité se tiendrait en quelque sorte en amont de ce qu’on appelle « perception » et la rendrait possible. Elle suppose bien plutôt la perception réalisée, puisqu’elle n’a de sens qu’en son sein : c’est dans la perception que j’explore, je chemine et qu’il peut se passer des choses, qu’il peut y avoir des « surprises » perceptuelles.
Quant à la notion d’« acte » perceptuel, qui relevait d’une assez grossière transposition du modèle des actes de langage en philosophie de l’esprit, y compris pour traiter le bord non intentionnel de celle-ci, elle me laisse maintenant perplexe. Y a-t-il vraiment des « actes perceptuels » ? C’est-à-dire : cela a-t-il un sens de raisonner dans ces termes-là ? Je ne vois pas bien ce que cela pourrait vouloir dire. Il y a des gestes, des mouvements dans la perception. Mais « la perception » n’est pas faite d’actes isolés.
Pour ce qui est de l’idée de « manipulation », là encore, ton analyse est peut-être un peu généreuse. Je n’avais pas aperçu aussi nettement qu’elle était au centre de ce que je faisais. Ce qui est certain, c’est que, dans ma considération de la pensée mathématique, puisque c’est ce à quoi tu fais référence, je privilégie toujours l’effectivité, et plus précisément l’effectuation. La mathématique renvoie à des opérations, transformations, etc., que l’on peut faire.
Plus généralement, plus je devenais sceptique eu égard à toute interrogation consistant à se demander comment nous pouvons avoir ce nous avons, plus s’imposait à moi l’idée que la véritable tâche philosophique consistait à préciser le sens de ce que nous faisons de ce que nous avons, en prêtant la plus grande attention aux gestes que nous effectuons par rapport à ce à quoi nous sommes confrontés. Ce qui compte ainsi, par exemple, c’est la façon dont nous sommes capables de transformer le sensible en signes, en faisant fonctionner d’une certaine façon ses différences. Bien sûr, cela n’a jamais signifié que le sensible ait besoin de fonctionner comme un signe pour être ce qu’il est. Mais l’encoder ainsi nous donne une certaine prise sur ses différences. Ce sont bien elles-mêmes, et aucunes autres, qui constituent la matière de cet encodage. La perception n’a rien de symbolique. Mais ce n’en est pas moins elle qui donne sa teneur à une certaine symbolicité. Et c’est cela qui au fond est intéressant. C’est ce à quoi en réalité se réduit la question de l’intentionalité : que pouvons-nous faire avec le réel – perceptuel ou autre ?
Quant au contexte, oui, il est essentiel qu’il ne soit pas représenté – dans la posture intentionnelle dont il est le contexte, tout au moins. C’est qu’il n’a de sens précisément que par rapport à un faire et non un savoir. Il est le contexte des opérations que nous effectuons, ce qui est présupposé et laissé hors-jeu, non transformé, par elles, et par là-même la condition de cette signification intentionnelle qu’elles déterminent par leur opérativité, et donc également du savoir.
Sens
AP : Tu t’es attaché, dans un certain nombre de travaux à la fin des années 90, à libérer le sens de son attachement à ce dont il serait sens. D’abord, soulignant que chez Husserl (et dans le débat autrichien et néo-kantien de son époque), la séparation des catégories de la signification et des catégories de l’être, et que cette séparation ouvrait le sens comme champ d’investigation à part entière (par exemple dans « Les Recherches logiques de Husserl : le catégorial, entre grammaire et intuition », (ed. JF. Courtine) Phénoménologie et logique). En analysant la mise en place progressive des catégories et outils de la phénoménologie dans le contexte de son époque, tu as souligné l’importance de l’écart qu’ouvrait la thématique de la signification, et plus largement, de l’écart chez Husserl entre les différentes modalités intentionnelles, entre l’intentionnalité et l’objet, etc. Je cite : « C’est le passage d’une modalité de l’intentionnalité à une autre qui libère la puissance de l’essence et fait du réel ce milieu structural pourvu d’une épaisseur morphologique intrinsèque dont la vérité réside dans l’écart bien plutôt que dans un remplissement vu comme simple présence de fait d’un contenu cognitif », « L’identité d’un sens : Husserl des espèces à la grammaire », Liminaires phénoménologiques, Recherches sur le développement de la théorie de la signification de Husserl. Tu insistes alors sur la plasticité du système intentionnel et prolonges d’ailleurs cette libération de la signification en soulignant avec Frege – dans la conclusion d’Intentionnalité et langage dans les « Recherches Logiques » de Husserl – en soulignant, avec l’idée fregéenne de la « force » de la signification, qu’on peut faire beaucoup plus de choses avec une signification que de dire l’être ou que connaître. Il y a une dimension fictionnante – en tout cas dont la véracité n’est pas la problématique – dans l’usage qu’on peut faire de la signification.
JB : Etre réaliste, c’est devenir capable de bien distinguer ce qui relève de la réalité et ce qui relève des prises normées que nous exerçons sur celle-ci, y compris celles qui ont par rapport à elle valeur d’identification. Tout ce qui est de l’ordre du sens tombe dans cette deuxième catégorie. Il faut donc apprendre à désintriquer le sens de la réalité et à ne pas le traiter ontologiquement, si on veut dégager le sens même que prend le concept de réalité, dans son étrangeté au sens, suivant les circonstances.
Cependant ta remarque pointe également une évolution dans mes explorations sémantiques des quinze dernières années. Arracher le sens à toute interprétation métaphysiquement réaliste, qui en ferait pour lui-même un domaine ontologique, m’est apparu très tôt comme une condition de la libération symétrique du sens de la réalité comme ce qui ne relève pas de l’ordre du sens, mais, purement et simplement, de l’être. J’ai donc, en un premier temps, poussé très loin la thèse de l’autonomie du sens, suivant l’intuition que son désengagement ontologique était la condition de cette différence. D’où les textes auxquels tu penses, où je mets en avant le statut en lui-même non référentiel du sens, en suivant une piste ouverte par Bolzano et Frege. Il n’est pas dit qu’à tout sens corresponde une référence. Plus exactement, comme l’avait bien vu Strawson, la référence est un acte pragmatique, dépendant de l’usage du sens, et rien qui serait intrinsèquement attaché au sens. Dès lors, d’autres usages sont également possibles, comme l’a entrevu Frege, avec sa théorie de la fiction. Ce n’est pas la signification elle-même qui aurait une « force » : il s’agit plutôt de souligner qu’il y a des régimes de discours où aucun jugement – et donc aucune mise en jeu de la force assertive – n’est possible. Et pourtant, ces discours sont, par définition, pourvus de sens. Dans cet apparent décrochage par rapport à toute prétention référentielle directe j’ai vu comme une prise de conscience de la dimension d’usage de la parole et donc du caractère construit, normé, y compris de la prise référentielle là où elle s’exerce et où elle définit le cadre de l’ontologie, c’est-à-dire de l’identification explicite de la réalité à laquelle nous sommes confrontés. La prise en compte de la fiction m’a permis en quelque sorte de restituer son épaisseur au discours, loin de tout mythe de la transparence et de tout écrasement des normes discursives sur la réalité même, présentée comme saisie, en quelque sorte, en-deçà des normes – comme on le voit trop souvent, aujourd’hui, dans les formes de réalismes naïfs et/ou métaphysiques, qui pullulent. L’idée directrice, très simple mais dont il est apparemment difficile de tirer toutes les conséquences, est que parler est quelque chose que l’on fait, et qui, comme tel, à des règles.
Cependant, il ne faut pas qu’une telle intuition, que je continue de tenir pour juste, nous porte à adopter une conception du sens ou de la parole comme constituant un empire dans un empire. Comme si, sous prétexte qu’il n’a pas immédiatement sens d’être – sauf sous le regard de la théorie qui l’objective – le sens constituait un domaine à part, pensable indépendamment de tout rapport avec la réalité. En fait ce qu’il faut entendre, c’est comment il y a d’autres façons de construire des normes par rapport à la réalité que celles de l’identification référentielle. J’ai essayé d’entrouvrir une telle perspective dans le chapitre des Limites de l’intentionalité intitulé « Esquisse d’une théorie non intentionaliste de la fiction », en introduisant une sorte de théorie enactiviste de la fiction, qui conçoit celle-ci comme épreuve du monde, répétition d’un usage possible de ce monde. Toute norme sur les choses, dès lors n’est pas ontologique – identifiante de leur être de choses. Elle peut juste définir une simple façon de s’y rapporter. Mais ce n’en est pas moins une norme et qui, comme telle, ne peut s’appliquer qu’à la réalité, la mesurer alors à une « signification-de-jeu ». Ouvrir d’autres dimensions pour la signification que celle de la détermination ontologique de ce qu’il y a ou ce qu’il n’y a pas, ce n’est pas couper son lien (normatif) avec la réalité.
AP : Plus tard, tu parleras à nouveau de suspendre le « préjugé en faveur de l’effectivité » pour raisonner de façon plus neutre en terme d’objectivité, c’est-à-dire de ce qui peut d’abord être signifié et ce qui, au sein de la signification, lui confère ou non le statut de l’objectivité, cf. « Variétés d’objectivisme sémantique », Propositions et états de choses. Ou encore, dans Lectures de Husserl « Introduction », tu notes encore que l’idée même de phénoménologie implique que soit mis en question « (…) le sens nécessaire pour qu’un contact avec l’être soit possible » (p. 12)., mais ce sera à la suite d’un parcours qui t’aura mené du sens au réel puis du réel au sens – dans la mesure ou le réel n’est pas une garantie ontologique derrière le sens, mais qu’il faut poser la question du réel à même le sens et ses conditions d’utilisation.
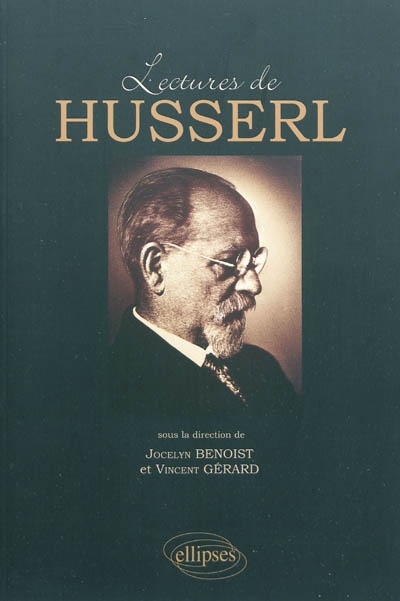
JB : Levons une équivoque. Lorsque, dans Propositions et états de choses (2006), j’ai introduit le concept d’ « objectivisme sémantique », cette notion avait valeur descriptive, d’un certain nombre de théories à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, et non de slogan. Bien sûr, il me paraissait important que ces théories aient pu marquer une différence entre les sphères du référent et de la signification, et, pour certaines d’entre elles, entre celle de la signification et celle de l’être. Cependant, distinguer « être » et « objet », en mettant en avant un emploi non ontologique de la notion d’objet, ne suffit pas, bien au contraire. Tout d’abord parce que ce que la modernité a appelé « ontologie » se définit précisément par le fait de déterminer l’être comme « objet » et donc, ouvrir au-delà de l’être l’espace d’une « théorie de l’objet » qui ne serait pas l’étant, ce n’est au fond que continuer l’ontologie par d’autres moyens. Entendre le sens comme sens, c’est-à-dire comme normation, ce n’est plus le confondre avec la norme qui en résulte comme, par exemple, celle de l’objet – qui n’est rien d’autre qu’une forme d’identification.
L’objectivisme est une voie sans issue. Tout au plus son mérite est-il de rendre explicite la nature de normes des concepts ontologiques fondamentaux, qui n’adressent la réalité qu’en tant qu’elle fait l’objet d’une identification ou une autre.
Ensuite, reste à poser la question de la détermination contextuelle de telles identifications. A ce niveau resurgit un sens – le sens primordial – de la réalité qui n’est pas justiciable de l’ontologie, ni, à plus forte raison, d’aucune « théorie de l’objet » déchargé d’effectivité.
De la même façon, lorsque, dans l’introduction de l’ouvrage collectif Lectures de Husserl (2010), je remarque, comme tu le relèves, que l’idée même de phénoménologie implique que soit mis en question « le sens nécessaire pour qu’un contact avec l’être soit possible », il s’agit d’une prise de distance de critique, et cela signe mon éloignement par rapport au projet d’une phénoménologie, qui me permet en quelque sorte de voir celui-ci de l’extérieur et de le résumer ainsi. Pour ma part, je ne crois pas que cela ait vraiment un sens de parler de « contact avec l’être », ou d’ailleurs plutôt avec la réalité, puisque c’est de cela qu’il s’agit. Celle-ci n’est rien avec quoi il faudrait faire contact. Nous y sommes de toute façon, et c’est d’elle qu’il faut partir pour analyser les différentes donnes du sens, qui sont structurées comme autant de façons de construire des normes sur elle. Je pense encore moins que, si tel « contact » il y a, car après tout la question est plutôt verbale et si on veut dire par là que ce que nous pensons et faisons est toujours une façon de définir une certaine prise normative sur la réalité, alors pourquoi pas, ce contact doive être « rendu possible », et l’être par un sens. La vérité est au contraire qu’un tel « sens » suppose toujours d’abord la réalité qu’il prétend, d’une façon ou d’une autre, normer. En fait, c’est même là la définition de ce qu’il faut entendre par « réalité » : ce que le sens suppose. En revanche, la phrase que tu cites me paraît offrir une bonne caractérisation de la phénoménologie, en tant que doctrine de la phénoménalisation – ce que je rejette à présent.
Entretien avec Jocelyn Benoist (2) : Autour des Eléments de philosophie réaliste
- Les limites de l’intentionalité. Recherches phénoménologiques et analytiques, Paris, Vrin, collection « Problèmes & controverses », février 2005
- Concepts. Introduction à l’analyse, Paris, Les éditions du Cerf, collection « Passages », septembre 2010
- Eléments de Philosophie Réaliste. Réflexions sur ce que l’on a, Paris, Vrin, collection « Moments philosophiques », mai 2011
- https://www.actu-philosophia.com/spip.php?article379
- Cf. L’idée de phénoménologie, « Le « tournant théologique » », Paris : Beauchesne, 2001








