Jean-marc Ferry est l’auteur d’une oeuvre abondante et importante dans le cadre général de la philosophie politique et celui plus particulier de l’Union européenne. Pour ses deux derniers ouvrages, La République crépusculaire1 et La religion réflexive2, il nous a accordé un long entretien entre deux séminaires, à Paris. Qu’il soit ici remercié pour sa disponibilité et son amabilité.
A : La question cosmopolitique
Actu-Philosophia : Je voudrais commencer l’entretien par une réflexion autour d’une remarque que vous avez faite quant au projet européen dont vous restituez l’origine étymologique, en rappelant que le terme même d’Europe viendrait du vieil akkadien erebu qui signifie crépuscule ; en vertu de cette étymologie, vous montrez que le malaise que connaît actuellement le projet européen serait d’ordre structurel et non conjoncturel. Ce que je voudrais vous demander, dans un premier temps, c’est ceci : pour quelle raison peut-on dire que le malaise est comme consubstantiel à la nature du projet européen ?
Jean-Marc Ferry : C’est un pathos quelque peu romantique qui m’a fait parler de cette étymologie, avec l’insinuation selon laquelle il s’agirait d’un crépuscule historique plutôt que géographique : géographiquement, le crépuscule signifie l’Ouest ; mais ici il s’agit de penser la fin d’une certaine forme politique, la forme de la République au sens moderne, c’est-à-dire au sens où l’entendait presque de façon paradigmatique Jean Bodin, au sens donc de ce qui a pour fondement une souveraineté consubstantielle à la République. Nous aborderions donc à la fois la fin de la forme nation comme principe politique dominant – ce qui ne veut pas dire la fin des nations – sans pouvoir parler non plus, parce que je ne veux pas être trop optimiste, d’une nouvelle aurore, comme Nietzsche avait pu en parler à propos d’Europe, car l’avenir me semble très incertain. La connotation crépusculaire, si je puis dire, est aussi une connotation un peu pessimiste en ce qui concerne le projet européen lui-même. On en vient ici à la difficulté même de votre question : y a-t-il des facteurs structurels du malaise européen ? Sans parler de malaise, je dirais en tout cas que, s’il est vrai que le projet européen marque la fin d’un certain principe politique, un principe souverainiste, et le départ fragile d’un nouveau principe, ce dernier est marqué par des différenciations déroutantes. Ce sont des différenciations catégoriales qui perturbent l’imaginaire politique moderne, surtout français.
La première différenciation est celle bien connue. C’est la différenciation entre citoyenneté et nationalité. Elle n’est qu’amorcée dans l’Union européenne, car la citoyenneté européenne demeure indexée sur l’appartenance à un État membre. Cependant, les attributs de la citoyenneté commencent à être déconnectés de la nationalité. Cela permet d’asseoir des perspectives de différenciation réalisées. Aujourd’hui j’entends souvent des critiques affirmant qu’il n’y a plus de raisons d’indexer la citoyenneté à la nationalité ; qu’il n’y aurait plus lieu de conditionner la citoyenneté à l’appartenance à un Etat membre. On pourrait par exemple imaginer que l’Union européenne décide d’attribuer la citoyenneté à des demandeurs d’asile qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union. Entre citoyenneté et nationalité s’élabore une première différenciation qui peut dérouter, et qui permet en même temps de prendre un recul sur des identifications et des amalgames spontanés.
Il y a une seconde différenciation : la différenciation entre Peuple et Nation. Elle est plus difficile à saisir, moins évidente, moins claire, pose davantage de problèmes conceptuels : nous sommes portés à admettre que le projet européen fait signe vers l’idée d’un peuple européen, mais en même temps nous savons bien qu’il existe des peuples européens qui sont des peuples nationaux. Cela suscite un embarras. Il se marque par certaines expressions ; par exemple, celle de « demoïcratie », que vous pouvez trouver sous la plume d’auteurs tout à fait remarquables, comme Paul Magnette3, comme Kalypso Nicolaïdis, comme Francis Cheneval. Mais là on met l’accent sur la pluralité des peuples sans, en même temps, penser l’unité du peuple européen. Pour lever la difficulté au niveau terminologique et au niveau conceptuel, on est invité à penser la différence entre Peuple et Nation, et cela nous permet du même coup de concevoir l’idée d’un Peuple plurinational.
AP : Est-ce cela le cosmopolitisme que vous appelez de vos vœux pour redonner vie au projet européen ?
JMF : Permettez-moi, avant d’y répondre, d’ajouter une nouvelle différenciation qui me paraît décisive : la différenciation entre Etat et Constitution. Il me paraît important de pouvoir penser une Constitution européenne sans pour autant penser un Etat européen qui serait nécessairement supranational, ce qui me semble être une profonde erreur, à la fois politiquement dangereuse et conceptuellement faible. Mais il y a un autre élément perturbant expliquant le malaise européen, c’est le type d’intégration vers lequel on s’achemine avec l’Union européenne, dans la mesure où l’on n’est ni dans le strict intergouvernemental ni dans le supranational. Par conséquent, on rompt avec le schéma vertical d’une intégration par voie étatique, et toute la difficulté est de penser une voie post-étatique ou encore une voie d’intégration horizontale, une voie qui ne passe par la subordination ni par des piliers d’affiliation comme l’obligation scolaire, militaire, civique, fiscale, mais par des voies horizontales : de la coopération, de la concertation, des droits transversaux transnationaux. Pour le dire simplement, c’est un mode de co-souveraineté, qui vient s’imposer, en attendant, peut-être, son remplacement par les principes d’une « gouvernance multiniveaux » : subsidiarité, proportionnalité, proximité, notamment. C’est une voie difficile, nous le constatons aujourd’hui avec la situation très critique dans laquelle se trouve l’Union européenne : c’est un défi presque improbable que d’engager l’intégration sur la voie horizontale de la concertation interétatique mais intracommunautaire, plutôt que sur la voie verticale de la subordination des États membres à un État fédéral supranational. Il reste que le pari de la co-souveraineté a déjà produit de grands résultats. Cela présuppose que l’on puisse s’entendre, y compris lorsqu’il y a des questions graves qui se posent comme l’Euro ou les interventions en Lybie. Les avancées sur cette voie requièrent un consensus relativement large qui, jusqu’à présent, était piloté par le tandem franco-allemand. Surtout, la voie de la concertation interétatique plutôt que supranationale se justifie dans la perspective d’une Europe qui serait cependant capable de jouer un rôle de « puissance » mondiale efficace et responsable. Clairement, l’Union européenne a besoin d’un leadership. Comprenez que cela n’implique pas l’approche fédéraliste (au sens de l’État fédéral supranational). Au contraire : une Europe fédérale fonctionne logiquement sur la règle de la majorité. Or, il est actuellement impensable que l’on puisse prendre à la majorité, même qualifiée, des États membres, des décisions diplomatiques ou militaires importantes, là où en particulier il y va de la vie et de la mort. Les États membres doivent absolument rester souverains dans ces domaines, ce qui implique l’unanimité des décisions graves, c’est-à-dire le maintien d’un droit de véto. Ce schéma contredit le principe d’un État fédéral souverain. Par conséquent, nous sommes face à un double dilemme : ou bien on opte pour l’Europe fédérale, mais on renonce à la puissance conventionnelle au profit d’une simple « puissance civile », ce qui équivaut à s’en remettre à l’Amérique et à l’OTAN pour la sécurité extérieure et la défense. Ou bien on opte pour l’Europe en co-souveraineté (ce qui n’est pas l’Europe des patries, chère à de Gaulle), mais on doit alors assumer la responsabilité d’une diplomatie et d’une défense européenne, ce qui pratiquement requiert un leadership. Même pour des gens qui, pour parler clair, jugeaient nécessaire de court-circuiter dans une bonne mesure la souveraineté des nations, comme Pascal Lamy, il apparaît maintenant évident que le cadre national est incontournable. Pascal Lamy a récemment admis, c’est à son honneur, qu’il avait sous-estimé l’importance du cadre national4 pour la légitimation du projet européen, bien sûr, mais également pour l’absence cruelle d’un leadership.
AP : Pascal Lamy est directeur de l’OMC. Son raisonnement vaut-il au niveau seulement européen ou à l’échelle mondiale dont il régule le commerce ?
JMF : Il raisonne aussi au niveau européen, et sans doute estime-t-il (mais je n’ai aucun titre à parler pour lui) indispensable que l’Europe puisse peser, pas seulement à l’OMC, mais aussi au G8, au G20, au conseil de sécurité, etc. Le problème est toutefois que l’intégration horizontale, qui suppose la co-souveraineté, est difficilement compatible avec le leadership. Le modèle cosmopolitique pose un problème politique : il repose sur un partage du pouvoir et la concertation entre les États membres. Philosophiquement parlant, c’est un modèle qui repose sur un principe d’intersubjectivité alors que nous avons besoin d’un sujet Un. Nous avons besoin d’une persona, d’un acteur-porte-voix du peuple européen ; il faut que l’Union européenne, si plurielle soit-elle, puisse pouvoir se présenter dans son unité face au monde, donc qu’elle dispose d’un masque, comme, jadis, les porteurs d’un rôle au théâtre, c’est-à-dire d’une personnalité. Mais le plus grave est peut-être ailleurs. C’est le problème de la légitimation. La grande légitimation fondatrice du projet européen, c’était le refus des guerres civiles européennes, la fin de ces « guerres en chaîne » dont parlait Raymond Aron, et le motif de la paix. Or, cette légitimation fondatrice s’est écroulée avec le Mur de Berlin. Avec la fin du monde bipolaire, on a cru, à tort ou à raison, que le danger nucléaire était écarté, si bien que le motif de la paix s’est écroulé. En même temps, les générations ont passé et celles qui étaient sensibles au motif de la paix ne sont plus démographiquement dominantes aujourd’hui, et l’on ne possède pas de légitimation de relève évidente, visible et, surtout, crédible. La « légitimation de relève », si je puis dire, ce n’est plus la paix, c’est la mondialisation. Là où la mondialisation est vécue par les peuples comme un phénomène problématique, c’est d’abord sous l’aspect économique. La crise de 2007 a fait un sort à la fausse équation officielle entre mondialisation et prospérité, tandis que les politiques n’ont pas su trouver le discours qui convenait à la nouvelle situation : ils n’ont pas expliqué que ce qui légitimait le projet européen, aujourd’hui, c’est certes toujours la paix, mais ce qui est actuel, à cet égard, c’est surtout le défi que pose la mondialisation, soit : la reconquête politique de l’économie. Les dirigeants des États membres n’ont pas expliqué cela, mais il faut dire que le comportement de l’Union européenne, suivant son idéologie dominante, néolibérale, ne rend pas plausible une telle possibilité. De ce fait, le projet européen se trouve maintenant en crise de légitimation. Il est en soi important et actuel. Mais il est en voie de discrédit auprès des peuples que leurs dirigeants n’aident pas à surmonter l’impression d’une collusion entre gouvernance européenne et mondialisation capitaliste.
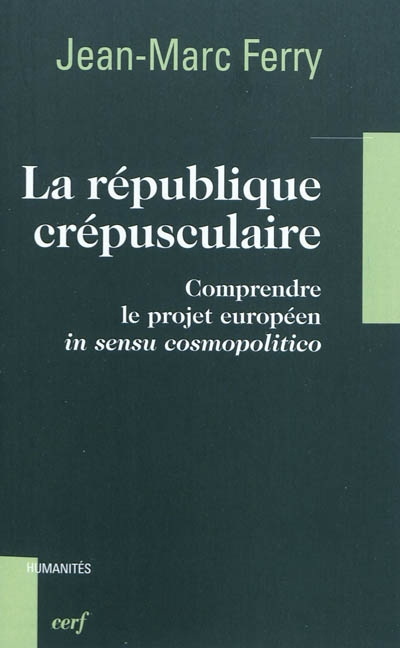
AP : Pour quelle raison qualifiez-vous de « dangereux » l’Etat supranational ?
JMF : Politiquement dangereux, oui. C’est une idée ancienne. On la trouve par exemple chez Montesquieu puis chez Kant à travers le spectre d’une « Monarchie universelle », « despotisme sans âme », qui cumulerait les deux maux politiques principaux qu’étaient (pour l’époque) l’impuissance et l’autoritarisme, l’anarchie et la tyrannie. On dirait aujourd’hui qu’une supposée « démocratie » globale cumulerait en vérité l’ingouvernabilité et le dogmatisme technocratique, avec à la clé une intégration politique à peu près impossible, et, partant, un déficit chronique de légitimation et de motivation.
AP : Le défi de votre démarche consiste donc à penser la possibilité d’une société post-étatique qui soit, en même temps, gouvernable.
JMF : Oui c’est cela ; mais j’hésite parce que je pense qu’il faut que je mette fin à ces expressions de « post »… Le « post-étatique », dans mon esprit, veut dire cosmopolitique. J’insiste sur le « post-étatique » pour dire que l’intégration politique doit se faire, mais pas par l’Etat supranational.
Cela étant, je parlerais d’une union post-étatique, plus que d’une société post-étatique. Certes, il ne faut pas, en ce qui concerne l’Union européenne, gommer le côté supranational de l’intégration. Cet aspect existe, il ne faut pas le dénier. Cependant, le gouvernement de l’Union ne joue pas un rôle d’Etat au sens classique. Les Pouvoirs publics de l’UE ne disposent pas, à la différence des États nationaux « classiques », du monopole de la législation ou de la domination ou de l’éducation légitimes. S’il y a un monopole, de leur côté, c’est seulement celui de la coordination légitime des politiques publiques des États membres. Cette voie non étatique est dite de « gouvernance ». En effet, on ne peut pas parler vraiment de gouvernement, cela renvoie à l’idée d’État. Mais le mot de gouvernance est lui-même d’origine contestable. Nonobstant une philologie « poétique » qui invoque le vieux français, ce mot, trivialement mais de façon significative, vient de la banque… Il demeure que dans la mesure où il désigne un mode de gouvernement et de coordination essentiellement horizontal, il est assez juste. Pour répondre donc à votre question, je dirais qu’on peut croire à la viabilité d’une union politique post-étatique. Il y a un acquis européen consistant, qui a quand même été réalisé sur ce mode d’intergouvernementalité et de co-souveraineté. Donc c’est gouvernable à condition que l’on rompe avec cette mauvaise utopie, l’illusion selon laquelle le projet européen aurait pour « vocation » ou bonne fin de passer le Rubicond de l’Etat fédéral et de liquider les souverainetés des Etats membres. Encore une fois, Pascal Lamy a compris que ce serait une erreur, je m’en réjouis. Les personnes avec qui j’essaie de travailler sans toutefois être « philosophiquement » d’accord avec elles sur les fins du projet européen – Daniel Cohn-Bendit, Guy Verhofstadt, également Joschka Fischer – sont, voyez-vous, résolument fédéralistes. Ils ne semblent pas voir d’autres possibilités que les « États-Unis d’Europe » de construire une Europe politique qui soit efficace. Ils ont des arguments : le leadership, l’efficacité décisionnelle, mais il est philosophiquement dommage de ne pas voir du tout la puissance conceptuelle de la voie horizontale, celle qui ne passe pas par la subordination des Etats à une puissance publique supranationale, mais par la concertation et la coordination de leur politique publique commune. C’est une voie difficile, longue et risquée, mais les acquis sont très solides, et surtout, elle ouvre vers un nouveau principe politique, qui est adapté à la mondialisation, ainsi que l’a bien montré Nicole Gnesotto. La voie horizontale de la concertation, de la coordination des politiques publiques entre États libres crée une nouvelle culture et un nouvel apprentissage politique. C’est une voie qui devrait être très stimulante, et on touche là à votre question sur la vitalisation que représenterait l’idée cosmopolitique.
AP : Cela suppose aussi, peut-être, que l’on ait une autre image du libéralisme politique. Vous avez montré dans votre ouvrage que, pour les citoyens, le libéralisme politique c’est l’agent de la mondialisation économique. Il y a peut-être aussi dans la communication politique des instances européennes la nécessité de réviser ce point-là.
JMF : Je distingue évidemment libéralisme politique et ce que l’on nomme « néolibéralisme », bien que personne à ma connaissance ne revendique une telle étiquette. Le marché libre n’implique pas le libéralisme politique ; mais il n’y a pas de libéralisme politique sans marché libre. Nous avons tous eu droit, chez des présentateurs TV et ailleurs, à un usage inconsidéré du mot « libéralisme ». Je me souviens d’une présentatrice vedette affirmant que la Chine avait choisi la voie du libéralisme ! Bref. Je ne voudrais pas dissocier trop fortement libéralisme politique et libéralisme économique puisqu’il n’est pas possible de concevoir un libéralisme politique sans libéralisme économique mais un bon libéralisme politique doit développer un projet qui consisterait à notamment domestiquer le marché sans en briser les mécanismes et cela c’est la voie qui devrait, normalement, être européenne. Traditionnellement on distingue une voie européenne, continentale, d’une voie plus anglo-américaine, plus atlantique si je puis dire. La voie proprement européenne qui est celle de ce « capitalisme rhénan » a été éclipsée. Je trouve cela dommage. C’est cette voie-là qu’il conviendrait de réactiver. Il est vrai que, surtout en France, quand on dit « libéralisme » on entend ce néolibéralisme anglo-américain, celui qui découle de la « révolution conservatrice », initiée par Thatcher suivie par Reagan, et qui a créé les bases d’une flexibilité dont ont profité les travaillistes britanniques, largement ralliés aux thèses du Workfare State, version dure dudit « État social actif ». Pour le moment, l’Europe est néolibérale.
AP : Parmi les différenciations déroutantes dont vous parliez, la troisième portait sur la séparation possible entre l’Etat et la Constitution. Est-ce qu’il serait possible de penser qu’une Constitution mondiale voie le jour, conjuguée néanmoins avec la persistance d’Etats ?
JMF : Il n’est pas question dans mon esprit de penser un Etat mondial. Presque personne, d’ailleurs, parmi les théoriciens de la « démocratie cosmopolitique » ne vise explicitement un Etat mondial. Je pense que si une Constitution mondiale advient – elle est déjà présente sous forme embryonnaire –, elle ne sera pas politique : elle ne peut être que juridique et limitée. Elle doit être limitée aux droits fondamentaux. Ceux-ci peuvent être enrichis par rapport à la Déclaration universelle. On pourrait même parler de « valeurs » très générales. Mais il ne saurait, autant que je puisse juger, être question au niveau mondial proprement de principes politiques. Le socle juridique d’une démocratie cosmopolitique serait plutôt une charte qu’une Constitution. Mais même s’il n’est qu’une Charte, plutôt qu’une Constitution, ce socle normatif s’exposera à l’objection d’être la projection néo-impérialiste d’une vision occidentale des droits et des valeurs. Pour désamorcer ce genre d’objection, qui peut couvrir des exactions, il semble nécessaire de parvenir à un accord normatif intercontinental de ces droits fondamentaux.
AP : Mais les vecteurs de cette charte sont déjà en place à travers l’ONU, et même l’OTAN.
JMF : Oui, la charte est déjà là avec l’ONU mais elle est à modifier. Il conviendrait de développer les droits fondamentaux individuels, pour assurer mieux leur pouvoir normatif, leur opposabilité à la souveraineté des États, ce qui n’est pas encore le cas. Suivant le chapitre 7 de la charte des Nations unies, les interventions militaires ne sont guère justifiées que dans le cas où l’on porte atteinte à la souveraineté des Etats et non quand on porte atteinte aux droits fondamentaux des individus. Il a fallu surinterpréter la charte des Nations unies pour rendre possibles des interventions du type du Kossovo ou lors de la première guerre du Golfe quand il a fallu protéger les Kurdes. Je pense donc qu’il faudrait reconstruire le concept de « droit des peuples » pour les affranchir de leur conditionnement nationaliste et positiviste. Le droit international général demeure, à l’heure actuelle, encore très souverainiste, si bien que son concept normatif, le droit des gens – ou le droit des peuples comme on dit en anglais et en allemand – tend à se confondre avec le droit des Etats. Le problème est qu’il n’y a pas que des peuples étatiques ; il y a aussi des peuples diasporiques. Ceux-ci relèvent des droits de l’Homme et non du droit des gens, ce qui est discutable : le concept de « droit des gens » devrait lui aussi être enrichi, de sorte que soient reconnus deux types de droits fondamentaux : les droits fondamentaux des individus ou droits de l’Homme et le droit des peuples ou droit des gens. Philosophiquement, les droits des peuples sont fondés sur l’idée que les individus sont libres de s’associer comme pour former une communauté politique. On aurait ainsi une Charte plus complète qui, au lieu d’accorder une préséance au droit des États, mettrait concurremment en exergue les droits fondamentaux des individus et des peuples.
B : Droits et politique
AP : En lisant votre ouvrage, j’ai eu l’impression que vous invitiez à renoncer à penser l’origine du politique, afin de faire comme s’il était toujours déjà là, en vue de penser bien plutôt les conditions de son application et de son dépassement, contrairement à la réflexion sur l’origine du pouvoir politique qu’avaient poursuivie la plupart des grands théoriciens de l’Etat moderne, exception faite de Montesquieu.
JMF : C’est une impression tout à fait correcte. Mais les grands théoriciens modernes sont ambigus. Les théories du contrat, qui sont des théories de l’origine d’une certaine façon, et telles qu’elles ont pu, après Rousseau, être pensées chez Kant ou chez Fichte, sont des conceptions contrefactuelles. A partir de Rousseau, le modèle du Contrat social ne vise pas à figurer une origine de la société, mais à faire comprendre les conditions auxquelles une société serait juste. Même chose chez John Rawls. Ici, il ne s’agit donc pas d’une origine plus ou moins stylisée, mais plutôt d’un fondement de validité. J’accepte cette perspective. Dans ce cas, il est vrai que je ne peux pas entrer dans la question de l’origine du politique. C’est une question quasi-métaphysique que je ne peux pas résoudre, bien qu’on l’ait fait dans la tradition marxiste, avec Engels notamment5. Sur la question de l’origine de la domination ou du politique, on a aussi discuté du côté de l’anthropologie politique, par exemple, celle de Pierre Clastres – Pierre Clastres dont la position est d’ailleurs tout aussi douteuse que celle d’Engels, le primat marxien de l’économique sur le politique étant simplement inversé, ce qui, sans être moins dogmatique, est moins plausible. Mais sur un tout autre plan, non pas celui de la genèse, mais celui de la validité, on peut parler d’origine. Dans ce cas je peux parler d’une co-originarité de deux principes que sont, d’une part, la démocratie, et d’autre part les droits de l’Homme. Quand je parle de co-originarité, je veux simplement penser la question du primat normatif de l’un ou de l’autre. Je considère qu’il n’y a pas de primat normatif des droits fondamentaux sur la souveraineté populaire, ni l’inverse. La co-originarité ne veut pas simplement dire qu’ils sont à égalité dans l’ordre d’importance normative ou axiologique mais qu’ils sont en présupposition réciproque. Vous avez une figure rousseauiste qui considère que ce qui est premier dans l’ordre normatif, c’est la souveraineté populaire, tandis que ses critiques libéraux comme Constant posent que ce qui est premier dans l’ordre normatif, ce sont les droits fondamentaux individuels. Il y a dans les deux cas, qu’on soit rousseauiste ou qu’on soit libéral, un déséquilibre. Mais là où ce sont de grands penseurs, c’est que, d’une part, Rousseau considérait qu’en faisant passer la souveraineté populaire sous la volonté générale, de ce fait les droits fondamentaux étaient garantis en raison de la structure de la volonté générale, tandis que, de son côté, Benjamin Constant pensait que les droits fondamentaux individuels devaient être dits naturels, une « illusion lucide » qu’il opposait à la « vérité trompeuse » des Jacobins, donc des rousseauistes. Rousseau comme Constant avaient donc, l’un et l’autre, entrevu la présupposition réciproque de la démocratie et de l’État de droit, de la souveraineté populaire et des droits de l’homme. Justement, « l’Etat de droit démocratique », comme l’expression l’indique, tient ensemble et en tension ces deux pôles, le pôle de l’universel, c’est-à-dire la justice politique, et le pôle du commun, c’est-à-dire la souveraineté populaire, la démocratie. Et s’il ne tient pas en tension ces deux pôles, il n’est plus l’Etat de droit démocratique à proprement parler.
AP : Est-ce qu’une organisation qui serait transétatique, ou qui serait au-delà des Etats sans être supranationale, ne prendrait pas le risque de redéséquilibrer cette co-originarité, en prenant avec elle la question des droits fondamentaux et en laissant de côté la souveraineté populaire ?
JMF : Il y a ici une dissociation qui se joue peut-être : on a l’impression, et je suis d’accord avec vous, que l’Union européenne a une fonction d’Etat de droit, une fonction juridiquement disciplinaire qui a été représentée historiquement par la Cour européenne de Justice. C’est le côté paternaliste de la notion de gouvernance… Les Etats membres auraient eux, en revanche, pour charge la démocratie. Mais l’Union européenne c’est l’ensemble de tout cela : ce n’est pas seulement le cadre représenté par les pouvoirs publics de l’Union où, là, prime le droit ; l’Union, si on la comprend bien, c’est aussi les Etats membres. Ne voyons donc pas les choses d’un point de vue antithétique : l’Union n’est pas contre les Etats. Dans mon esprit, j’aimerais que les souverainistes et les fédéralistes comprennent que l’une des grandes fonctions de l’Union européenne est de protéger les synthèses réalisées par les États. Il s’agit, si l’on suit une proposition de Michael Walzer, de la « synthèse » entre, d’une part, la « communauté morale » des valeurs partagées entre des ressortissants d’une nations et, d’autre part, la « communauté légale » des normes opposables à ces mêmes ressortissants, par quoi advient la « communauté politique ». Ce pôle du commun est représenté par des Etats membres, et c’est la démocratie qui se joue là. Je ne crois pas trop que l’Union européenne comme telle puisse réaliser la démocratie : ce sont les Etats-Nations qui sont les cadres d’intégration proprement démocratique. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne doit pas y avoir une forme de démocratisation qui pourrait se jouer sur deux niveaux. En ce qui concerne proprement l’Union européenne, il faut que les espaces publics nationaux puissent s’ouvrir les uns aux autres. Là, l’espace européen doit aussi être démocratique. Pour ce faire il y aurait beaucoup de réformes à mener, en particulier la mise en place d’un système de parlements locaux, régionaux, et nationaux interconnectés entre eux, et connectés avec le parlement européen lui-même. Cependant, le Parlement européen semble vouloir tenir le monopole du pouvoir parlementaire de l’Union, comme s’il pouvait à lui seul représenter le pouvoir parlementaire européen, ce qui est absurde : il n’en a ni la stature ni l’envergure. Par ailleurs, il y a aussi une perspective de démocratisation qui s’ouvre à un niveau inhabituel pour nous. C’est ce que Norberto Bobbio avait pu nommer « démocratie internationale »6. Il s’agit d’une forme de démocratisation ou de socialisation qui se développe entre les Etats. C’est un aspect peu visible mais important, qui relève presque de la civilisation.
AP : Parmi les propositions que vous faites, outre le réseau des parlements, vous évoquez également la réforme des modes d’élection en Europe : pourriez-vous préciser ce que vous envisagez quant à cette réforme ?
JMF : Sur ce point, je n’ai pas vraiment de conseils à donner. Je parle simplement du fait que les députés européens n’ont que peu de visibilité, et que la pratique dominante est une pratique de partitocratie qui consiste à gratifier et à récompenser les membres de partis politiques en les mettant sur des listes politiques européennes. C’est donc de la cooptation beaucoup plus que de l’élection si bien que les députés européens ne présentent pas tous les attendus de véritables élus. A cela s’ajoute le fait que certains parlementaires européens ont refusé l’unification du mode de scrutin. Il me semble que le scrutin uninominal se recommanderait. C’est lui qui donne le plus de visibilité. En plus, il y a un absentéisme scandaleux, compte tenu surtout du fait que les eurodéputés sont grassement payés.
AP : La description que vous faites de cette cooptation ressemble énormément à la description qu’avait déjà faite en 1914 Robert Michels7 de l’oligarchie inhérente aux partis politiques : la parenté est ici troublante.
JMF : Tout à fait ; la partitocratie est vraiment une atteinte à la démocratie. Sur ce plan, je suis assez gaulliste…
C : La religion et l’espace public
AP : Je voudrais poser une question très générale pour aborder la question religieuse. Vous accordez une place assez importante à la religion dans votre ouvrage et dans d’autres8, et je me demandais si vous considériez que les sociétés modernes et libérales étaient encore en mesure de penser un apport collectif de la religion alors que les sociétés libérales ont relégué la religion dans une sphère privée.
JMF : Je pense qu’il faut comprendre les choses d’un point de vue historique. La privatisation des convictions religieuses et de la religion en général a une origine historique que sont les guerres de religion. C’est sans doute la solution la plus puissante – il y a eu d’autres solutions comme « cujus regio, ejus religio » – qui consiste à effectuer un grand partage entre d’un côté convictions religieuses privées et de l’autre raison politique publique. C’était un partage salutaire dans le cadre de ces guerres de religion qui ont failli disloquer l’Europe. L’un des résultats positifs si je puis dire de cette expérience tout à fait dramatique, ce fut l’apprentissage de la tolérance, dans l’Europe de l’Ouest et du Centre, qui fut en même temps assorti d’une séparation symbolique beaucoup plus ferme entre les sphères religieuses et politiques. Voilà donc des ingrédients historiques qui sont des arrière-plans de nos démocraties : qu’on soit dans des systèmes laïques, comme en France, ou dans des systèmes plus séculiers que laïques comme l’Allemagne luthérienne, peu importe car le schéma fondamental est le même. Si nous considérons cette histoire, nous pouvons admettre que la tolérance est inscrite dans notre culture publique. Le partage entre conviction privée et raison publique a permis de faire émerger le libéralisme car, au départ, il n’y avait pas de liberté d’expression : il y avait tout au plus une liberté de conscience. Ce n’est qu’une fois qu’on a eu le sentiment que les convictions pouvaient commencer à s’exprimer que le libéralisme a pu développer sur les thèmes de la liberté d’expression et de communication, mais toujours en considérant qu’il valait mieux mettre sous le boisseau les convictions religieuses. Cela a induit un schéma posant que ces convictions religieuses doivent rester privées bien que leur puissance de motivation doive servir quand même au soutien des institutions publiques, moyennant des filtrages, de telle sorte que nous puissions adhérer à des normes communes alors même que nous avons des visions du monde et des valeurs différentes. Le libéralisme a eu cette intelligence de considérer qu’il y avait à la fois une dissociation indispensable entre normes et valeurs, les normes relevant de l’ordre juridique et les valeurs des convictions morales, sans qu’il n’y ait pour autant de véritable rupture entre elles. Il y a un fil ténu de continuité entre normes et valeurs, et cette formule a trouvé son classicisme dans la théorie de la justice de John Rawls à travers le concept de « consensus par recoupement ». C’est là que nous en sommes, et il faut se demander si des éléments nouveaux permettent de penser un dépassement un dépassement de ce partage classico-moderne dont je parlais, c’est-à-dire un acheminement vers quelque chose comme un espace public que l’on dit post-séculier. Il y a des conditions à cela : je dirais qu’un des facteurs premiers est que nous assistons à une certaine fluidification de ce qu’avec Rawls on appelle la « raison publique ». Moins qu’auparavant cette raison publique semble préjugée par des images modernes, des objectivations suivant le droit ou la science ou l’ histoire. La Science, le Droit, l’Histoire, la Critique elle-même ont pu, un temps, représenter la Raison de façon parfois concurrente. Mais il semble qu’à présent la raison consiste plutôt dans les raisons qui se confrontent dans des discussions plus ou moins institutionnalisées. On parle alors de « démocratie délibérative ». Une deuxième fluidification intervient là-dessus : parmi ces raisons, il n’y a plus seulement des arguments plutôt durs de style juridique, qui aient le droit de cité au titre de la raison publique ; on assouplit et on élargit les registres. C’est-à-dire que l’on se dirige vers le narratif, vers l’interprétatif, vers l’expressif, tandis que l’on se demande comment « argumenter l’émotion »L’émotion argumentée9. Nous devons pouvoir faire passer dans la raison publique des thèmes ou des motifs qui, au départ, sont considérés comme non-rationnels. La peine de mort est un bon cas : à la base, les arguments strictement juridiques sont impuissants. On est donc amené à faire fond sur des arguments intuitifs ou des intuitions morales spontanées. Avec les nouvelles questions de société qui relèvent de problèmes éthico-sociaux, mais qui appellent un traitement juridique, comme l’IVG, la manipulation génétique, l’euthanasie, le clonage, nous sommes démunis ou plutôt le législateur est particulièrement démuni, parce que la grammaire du droit moderne n’a pas la puissance intégratrice qui permet de faire face. Nous sommes mis brutalement face à notre ignorance métaphysique. Cela ne veut pas dire que les religions vont nous donner leurs recettes, mais quand je parle d’un apport – je ne suis pas le seul, l’article 17 du Traité de l’Union européenne consacre cette insertion des religions dans l’espace public démocratique – il ne s’agit pas pour les religions abrahamiques, en particulier la religion chrétienne sous ses divers aspects, d’apporter leur dogme. Dans un dialogue social ouvert, les religions n’ont pas à mettre pas en avant une position doctrinaire, même si elles n’ont pas à cacher leurs convictions. Elles doivent plutôt s’efforcer de se montrer sensibles aux autres et d’articuler leurs intellections fondamentales. Elles mettent en quelque sorte « en service du public », au service de tous, les expériences spirituelles qu’elles ont archivées. La situation actuelle est intéressante et en même temps problématique parce que ce thesaurus que représentent les religions est un arrière-plan assez largement préjudiciel pour les fondements du droit lui-même : le droit n’aurait pas de sens sans les notions de personne, de dignité, de liberté, qui sont des catégories développées dans le contexte théologique. L’arrière-plan religieux est toujours explicatif mais il est devenu opaque. Il est décisif comme source mais il n’est pas thématisé du fait de la privatisation. En raison même de cette privatisation, il s’est dogmatisé et opacifié, car il n’avait pas à s’affronter à une critique pluraliste et publique comme dans le cas, par exemple, de la philosophie. Ce qui est demandé à la raison religieuse appelée à entrer dans la raison publique, ce n’est pas de cesser l’usage privé mais de développer désormais un usage public de la raison, ce qui est nouveau.
AP : Dans les exemples que vous avez pris, on a l’impression que c’est à la faveur de la technique et des conséquences qui s’ensuivent que l’usage public de la religion devient possible.
JMF : Il y a deux choses : d’une part, il y a les nouveaux problèmes liés au développement de la techno-biologie mais il y a d’autre part cette fluidification de la raison dont j’ai parlé. On n’est plus à cette époque où l’on pensait que la raison c’était la science ou l’histoire ; c’est cela que j’appelle les hypostases modernes de la raison. Il n’y a donc plus de différences aussi marquées entre les raisons séculières et les convictions religieuses : on peut aussi bien parler de raison religieuse que de convictions séculières et à vrai dire de raisons religieuses comme de raisons séculières. Du coup ce sont des raisons qui doivent se confronter.
AP : La fluidification pourrait alors être la condition de possibilité du retour de la religion dans l’espace public, tandis que les questions technoscientifiques seraient plutôt la cause occasionnelle de ce retour.
JMF : Oui, ce sont des questions qui débordent la compétence du droit ou de la rationalité juridique. Le droit a toujours un inconscient, et cet inconscient est théologique.
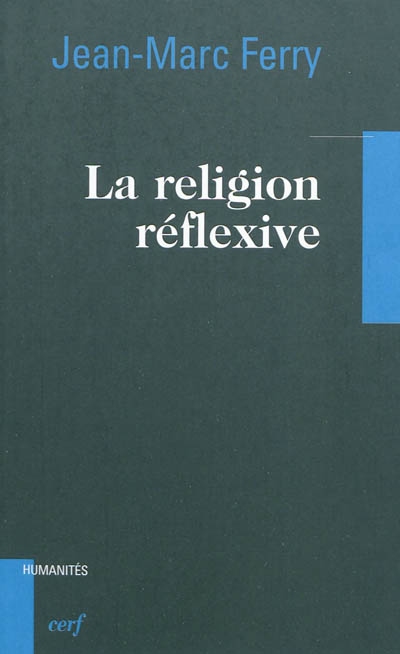
AP : Je voudrais vous poser une question autour du christianisme en particulier et sur la manière dont l’Union européenne l’envisage. Vous écrivez ceci dans votre ouvrage : « En réalité, l’Union européenne ne cherche pas à occulter l’identité chrétienne, ou tout autre héritage, de l’Europe. Simplement elle a élaboré des critères d’appartenance qui ne sont pas préjugés par les caractéristiques culturelles de l’Europe. »10 Ma question est très circonstancielle : la Commission européenne a édité récemment un agenda mentionnant les fêtes de toutes les religions, exception faite des fêtes chrétiennes. N’est-ce pas là un symptôme particulièrement éloquent d’un certain anti-christianisme de l’Union ou, en tout cas, de la commission ?
JMF : Il y a des avatars idéologiques et des questions de pouvoir. Peut-être que Joseph Weiler, lorsqu’il parle d’un triumvirat laïciste italo-belgo-français, a raison : on sait qu’il y a eu cette querelle entre Allemands et Français sur l’héritage « religieux » (les Allemands) ou « spirituel » (les Français). Les Français l’ont emporté. Les sensibilités ne sont pas les mêmes ; dans la Constitution allemande il y a une référence à Dieu, ainsi que dans la Constitution polonaise et dans la Constitution irlandaise… Mais en gros, si je me place sur le plan de la philosophie officielle de l’Union ; si l’on suit les principes déclarés et non les avatars des rapports de force idéologiques, on constate que l’on peut rappeler les héritages divers – plutôt que les patrimoines –, et le christianisme est mentionné. Mais on ne veut pas en faire une référence normative : on ne veut pas faire d’une tradition, si constitutive soit-elle d’un point de vue historique et civilisationnel, un socle normatif, contrairement à ce que propose Weiler. Je pense que cette philosophie officielle de l’Union est, à cet égard, raisonnable et réfléchie : l’Europe politique n’est pas l’Europe historique. Ses limites n’ont pas à être en quelque sorte prédéterminées par l’histoire ou même la géographie. L’appartenance à l’Union revêt en effet des exigences normatives, ce sont les critères de Copenhague (notamment, l’adhésion aux principes de l’État de droit démocratique), et ces conditions normatives sont premières. Elles ont préséance sur les considérations d’origine culturelle ou autre.
AP : Oui mais j’évoquais moins le problème religieux que le problème chrétien dans ce cas précis. L’Union européenne n’assimile-t-elle pas le christianisme au Même qu’elle a tendance à éradiquer au profit de ce que vous appelez vous-même, à travers la question de la Turquie, un « multiculturalisme postmoderne qui ne voit que l’enrichissement par la différence. »11 ?
JMF : Il est difficile de dégager des soupçons dans un sens ou dans l’autre. Si nous nous en tenons aux textes « constitutionnels », l’article 16 C du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité de Lisbonne) prévoit un « dialogue ouvert, transparent et régulier » avec les Eglises, religions et organisations philosophiques non confessionnelles. L’Eglise catholique est, de fait, très engagée dans ce dialogue avec les Pouvoirs publics de l’Union. Mais il n’y a absolument pas lieu de proclamer la « christianité » de l’Europe dans un texte officiel. D’une façon générale, c’est que ce n’est pas parce qu’on met en exergue « constitutionnelle » des principes politiques plutôt que des traditions culturelles, qu’il y a un déni de l’identité ; c’est faux. On ne veut simplement pas exclure a priori ceux qui ne seraient pas « européens » au sens de l’origine ethnoculturelle. Même avec la meilleure volonté du monde – Joseph Weiler n’est pas, par exemple, hostile à l’entrée de la Turquie dans l’Union européenne – cela reviendrait à affirmer pour l’« Europe » – en vérité, l’Union européenne, c’est-à-dire l’Europe politique – une « identité » excluant ceux qui ne seraient pas historiquement liés à un supposé patrimoine culturel, « spirituel » ou « religieux », de l’Europe historique. Si donc on inscrit un héritage comme le christianisme au titre de référence constitutionnelle, si on l’érige en élément normatif officiel, il est évident que les limites de l’Europe politique seront prédéfinies par les limites de l’Europe historique, ce qui n’est pas du tout conforme à la philosophie de l’Union européenne. C’est cela que j’ai voulu dire.
AP : Sur ce point, vous reprenez Jürgen Habermas en expliquant que sa position consiste à dire que nos valeurs sont à ce point universalistes que l’inclusion politique vous permettra de vous sentir chez vous et non chez nous.
JMF : « Chez vous, dans l’Union », oui, plutôt que « chez nous, dans l’Union ». Les États membres de l’Union ne sont pas des « invités », même s’ils ne sont pas « européens » au sens du patrimoine culturel. Accueillir la Turquie dans l’Union, c’est considérer qu’elle y est chez elle au même titre que nous. En disant cela, je n’insinue pas que l’on doive maintenant accueillir l’État turc. C’est une autre question. Je m’en tiens aux principes qui correspondaient à la philosophie officielle de l’Union, principes qui ont été rappelés aux sommets d’Amsterdam, de Nice, de Laeken, et que, hélas, on a maintenant envie de renier sous l’effet d’une régression communautariste à peine inavouée. Jusqu’au projet constitutionnel de la Convention inclus, la philosophie officielle de l’Union était en phase avec le concept du patriotisme constitutionnel. C’est un concept qui nous vient du philosophe Karl Jaspers. Le lexique juridique se l’est approprié, en Allemagne, avec Dolff Sternberger, mais c’est par Jürgen Habermas qu’il a pris une nouvelle ampleur, avec le grand débat qui éclata au cours de l’été 1986, en RFA, à propos du passé national-socialiste. De là, l’idée du patriotisme constitutionnel a commencé de prendre corps dans la culture publique européenne. J’oppose le « patriotisme constitutionnel » de Jürgen Habermas à la « tolérance constitutionnelle » invoquée par Joseph Weiler, afin de montrer l’implication différente d’une mise en exergue de principes politico-juridiques plutôt que de traditions culturelles. Proclamer qu’appartiennent à l’Union européenne, non pas ceux qui sont d’origine européenne, mais ceux qui adhèrent aux principes et valeurs mis en exergue par les textes officiels de l’Union, c’est là, me semble-t-il, assurer à la citoyenneté européenne un fondement digne d’une identité émancipée des attaches pré-politiques, ethnicistes ou culturalistes. Des « étrangers » peuvent en principe se sentir chez eux dans l’Union européenne, si la condition posée à leur appartenance se tient à requérir de leur part une adhésion authentique aux principes de l’État de droit démocratique, tandis que si on leur dit (comme le voudrait Weiler) : « nos traditions culturelles (judéo-chrétiennes) sont assez tolérantes pour que vous vous sentiez bien chez nous », c’est moins évidemment moins inclusif. Qu’on le veuille ou non, on projette alors l’image de citoyens de seconde zone dans l’Union, ceux qui ne seraient pas « vraiment européens ».
D : Droit public de la communication
AP : J’aurais une question sur la conciliation de la justice politique avec l’autonomie publique : à ce propos vous évoquez le droit public de la communication et, comme directeur de la collection « Humanités » au Cerf, vous avez publié un livre de Jacques Lenoble qui s’appelle Droit et communication12 puis en 2002 vous avez préfacé le livre de Boris Libois sur la communication publique13 où vous envisagez trois critères concernant la construction de ce doit public de la communication que sont la cohérence, la consistance et la pertinence. Que seraient aujourd’hui les fondements d’un droit public de la communication à l’échelle européenne ?
JMF : Je me souviens des travaux de Boris Libois dont j’avais dirigé la thèse. Dans une existence antérieure, j’avais travaillé au CNRS sur ces questions-là. Ce que je pense, pour le dire vite, c’est que le droit de la communication n’est encore qu’embryonnaire. Il n’est pas systématisé et surtout il repose sur des prémisses fausses car il est fondamentalement pensé sur le modèle individualiste de la liberté d’expression (préférentiellement, d’ailleurs, celle du journaliste). Appliqué au cas de la radio et de la télévision, ce modèle revient à poser que la liberté de communication doit résulter d’une limitation réciproque des libertés d’expression : l’approche est classique, elle repose sur l’idée simple selon laquelle si tout le monde parle en même temps, la parole devient impossible. Il est donc fait fond sur un système des libertés négatives où la limitation des libertés individuelles rend possible la communication ; c’est un schéma individualiste. Je pense que nous aurions intérêt à envisager un autre point de départ, qui ne serait pas individualiste, mais holiste : demander à quelle condition il est possible de réaliser une communication dont la liberté serait notamment une fonction de la qualité et de la diversité des thèmes susceptibles d’être portés à l’attention du public. Ici, le problème n’est plus celui d’une compossibilité des expressions individuelles ; le problème vise plutôt des questions de qualité des émissions dans l’audio-visuel, c’est-à-dire la diversité des genres et le pluralisme. Ces critères ont plus à voir avec la liberté d’opinion et d’information qu’avec la liberté d’expression proprement dite. Appliquée aux grands médias de diffusion comme la télévision, la liberté d’expression du journaliste peut très bien déboucher sur une absence de pluralisme ; les journalistes sont libres, il n’y a pas de censure d’Etat qui pèse sur eux ; les présentateurs programment comme ils veulent leurs journaux télévisés. Mais les journaux télévisés se ressemblent entre eux à s’y méprendre, l’agenda est le même, la sélection et la hiérarchisation des thèmes jugés dignes d’être portés à l’attention des publics obéit aux mêmes critères opaques. Là est le vrai problème et nous devons développer une réflexion sur ce qu’est une communication libre au niveau des médias de diffusion selon des critères de qualité. C’est la raison pour laquelle j’avais avancé l’idée d’une charte européenne de l’audiovisuel. Une telle Charte ne serait pas contraignante, elle serait seulement indicative, mais elle pourrait fournir une référence normative à des commissions d’évaluation qui ne seraient pas composées uniquement de professionnels, car les publics usagers pourraient également s’y exprimer. Je pense à une Charte européenne de l’Audiovisuel, ayant pour objectif de pourvoir à une offre globale audiovisuelle capable d’honorer sa mission de responsabilité civique (l’information) et culturelle (la formation). Les chaînes seraient libres de leur programmation, certes, mais seraient placées en coresponsabilité vis-à-vis des critères de la Charte. En clair, elles devraient contribuer d’une façon ou d’une autre à la satisfaction de ces critères : soit elles y contribueraient directement de manière satisfaisante (du point de vue de ces critères) par leur programmation même, soit elles y contribueraient indirectement par le versement d’une partie de leurs recettes publicitaires. Après tout, une chaîne a toujours le droit de se consacrer aux jeux, ou aux sports, ou aux variétés, mais il est important, si l’on accepte l’idée d’une responsabilité civique et culturelle des médias, d’assurer une offre audiovisuelle qui soit pluraliste et satisfasse ces missions de responsabilité. La stratégie conceptuelle me semble importante : il ne faut plus partir de la liberté d’expression individuelle, la liberté de communication ne dérive pas de la liberté d’expression.
AP : Dans la République crépusculaire, vous expliquez également qu’il est important que les médias de chaque pays fassent remonter les débats publics pour pouvoir justement établir une résonnance entre les Etats.
JMF : Oui, cela est de la responsabilité des médias. On ne peut pas leur imposer quoi que ce soit, ils sont libres, mais on peut quand même exercer une pression démocratique et faire remarquer qu’il n’y a aucune raison pour que les médias soient souverains. Ce faux quatrième pouvoir est en passe de devenir le premier des pouvoirs. Il détient un pouvoir de publicité dont les critères sont tout sauf publics. Comprenons que les critères de sélection, de hiérarchisation et de programmation en général sont parfaitement « privés », et cela ne va pas. Je ne dis pas qu’ils sont mauvais, je dis simplement qu’ils sont opaques et que nous devons pouvoir exiger qu’il y ait des critères publics qui président à la sélection et à la programmation en général. Il n’y a pas de raisons de laisser cela à la discrétion de cette petite élite, elle-même non médiatisée, que sont les programmateurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez…
AP : Je suis d’accord avec vous pour dire que tout est à faire, que le droit public de la communication n’est pas thématisé et qu’il faut réfléchir à ses fondements ; mais je pense tout de même au conseil de l’Europe et à la cour européenne des droits de l’Homme, ainsi qu’à l’ensemble de la jurisprudence, qui participent à la construction de ce droit en amont. Et en aval, on a des associations dans différents pays européens qui contribuent aux expertises proposées par le conseil de l’Europe.
JMF : Je suis bien d’accord pour dire qu’il y a des perspectives de construction, mais ce que je veux dire seulement, c’est qu’on part de prémisses qui sont strictement individualistes au sens où on part de la liberté d’expression qu’on limitera ensuite par des considérations d’ordre public.
AP : Dans l’article 10 de la convention européenne des droits de l’Homme, vous avez à la fois l’extension de la liberté de la communication et ses limites.
JMF : Ce schéma n’est pas approprié, la stratégie individualiste n’est pas appropriée à la question. Il nous faut développer un droit qui permette que, globalement, nous ayons le résultat visé : par exemple, le pluralisme des genres et pas seulement le pluralisme idéologique. Et pour cela vous ne pouvez pas vous en remettre à la liberté d’expression ; au contraire même ! C’est un paradoxe bien connu : le modèle BBC reste un modèle pluraliste de qualité indéniable, mais la privatisation des chaînes a abouti à une grande uniformisation, la concurrence faisant que les chaînes s’alignent les unes sur les autres au détriment du public.
AP : C’est un paradoxe que Bourdieu avait relevé dans la presse hebdomadaire qui tendait, en tout cas en France, à s’uniformiser de manière impressionnante.
JMF : Oui ; si je puis souscrire à Bourdieu, c’est sur son concept de violence symbolique : c’est un concept intelligent, opératoire pour penser les médias. La vraie censure est enchâssée dans les médias eux-mêmes, c’est une censure au sens de Bourdieu, bien plus qu’au sens conventionnel.
AP : Dans l’épilogue, vous écrivez qu’une telle approche, celle de l’audiovisuel, « ne peut qu’exciter la réclamation, quelque peu déraisonnable, d’un « droit pour tous » plein et effectif d’accès aux médias de masse. Cela trahit une dépendance conceptuelle à l’égard de la liberté d’expression comme droit essentiellement privé et individuel. En rattachant la liberté de communication, en tant que droit public, à la catégorie des droits de participation politique, on ouvre en revanche la perspective depuis laquelle l’espace public lui-même doit pouvoir être organisé de telle sorte que la délibération des citoyens puisse se dérouler dans les meilleures conditions d’information et d’autonomie en ce qui concerne le maîtrise de l’agenda, c’est-à-dire la sélection et la hiérarchisation des thèmes jugés dignes d’attention publique. »14 Vous reprenez Jürgen Habermas en expliquant qu’un certain nombre de conditions est nécessaire : l’égalité dans la prise de parole, la liberté des prises de position et enfin la publicité des débats. Vous ajoutez quelque chose de décisif qui ne figure pas chez Habermas, à savoir la reconnaissance de la prise de parole et de position.
JMF : Je distingue trois « situations idéales », en effet : 1) une situation idéale de pouvoir, où il s’agit que la représentation soit proportionnelle suivant un modèle d’équité dans la répartition des forces appelées au compromis ; 2) une situation idéale de parole (je reprends Habermas), qui donne un cadre quasi-juridique pour structurer un espace public sur les bases de la liberté et de l’égalité de parole ; 3) une situation idéale de reconnaissance, qui explicite la situation de parole d’un point de vue moral. Il y va de réquisits plus internes que l’égale participation des acteurs. Ces réquisits concernent directement les liens et les effets (succès ou échecs) dits « illocutionnaires » (acceptation, rejet de ce qui est proposé, sur la base d’un assentiment ou d’un dissentiment ayant trait à la validité). Il faut véritablement que ce que dit l’un puisse engager l’autre sous la question de la vérité. Là, on touche à un réquisit qui n’est plus juridique. Il s’agit d’un réquisit fondamental où la justice politique et l’autonomie civique se rejoignent. Ce que je veux dire par là, c’est qu’il ne s’agit pas pour les principes de la justice politique de s’appliquer directement à des contentieux sociaux mais de s’appliquer à la structure délibérative qui va régler les contentieux sociaux. C’est à ce niveau-là qu’il y a jonction : de là, je développe encore d’autres principes qui font signe vers mon autre livre, La religion réflexive, qui pose la question du fondement de la moralité. Un problème philosophique pendant, me semble-t-il, est d’expliquer le caractère catégorique des commandements moraux. Mais, pour revenir à mon ouvrage sur l’Europe, là où j’esquisse notamment un concept normatif d’espace public, ma « situation idéale de reconnaissance » fait signe vers un réquisit moral qui est au-delà des réquisits formels dont parle Habermas à propos d’une « situation idéale de parole ». Si je vois juste, en ce qui concerne la nécessité logique d’un réquisit moral, c’est un peu troublant, d’une certaine manière, car cela revient à pointer la limite des garanties juridiques. On risque alors des dérives conservatrices si l’on en vient à dire que, sans la moralité, rien n’est politiquement possible… On aimerait bien, n’est-ce pas ?, que le droit puisse par lui-même assurer les conditions d’une société juste.
- Jean-Marc Ferry, La République crépusculaire. Comprendre le projet européen in sensu cosmopolitico, Cerf, Paris, 2010
- Jean-Marc Ferry, La religion réflexive, Cerf, 2010
- cf. Paul Magnette, L’Europe, l’Etat et la démocratie, Bruxelles, Editions Complexe, 2000
- Pascal Lamy avait théorisé la nécessité de dépasser le cadre national dans un ouvrage important, La démocratie monde. Pour une autre gouvernance mondiale, Seuil, 2004
- cf. Engels, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’Etat, 1884
- cf. Norberto Bobbio, L’Etat et la démocratie internationale. De l’histoire des idées à la science politique, Bruxelles, Complexe, 1999
- Cf. Robert Michels, Les partis politiques. Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties.
- cf. notamment Jean-Marc Ferry, La religion réflexive, Cerf, 2010
- Raphaël Micheli, L’émotion argumentée, Cerf, 2010
- J.-M. Ferry, La République crépusculaire, op. cit., p. 71
- Ibid. p. 93
- Jacques Lenoble, Droit et communication. La transformation du droit contemporain, Cerf, 1994
- Boris Libois, La communication publique, L’Harmattan, 2002
- Ferry, La République crépusculaire, op. cit., p. 287








