Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et membre senior de l’Institut universitaire de France depuis 2007, Jean-François Kervégan est une figure cruciale des études hégéliennes et des recherches contemporaines en philosophie politique. A la faveur d’une importante actualité éditoriale, il a bien voulu nous accorder ce long entretien, ce pour quoi nous lui adressons toute notre gratitude.
A : « Hegel sans métaphysique ? »
Actu-Philosophia : Je voudrais commencer cet entretien, si vous le voulez bien, par interroger votre rapport à l’interprétation générale de Hegel. Dans L’effectif et le rationnel, vous annonciez dès l’avant-propos l’intention de présenter un Hegel sans métaphysique tout en exposant votre évolution à l’égard de cette question : « Parti d’une position orthodoxe (vieille-hégélienne) nourrie par une longue fréquentation de la Logique, je me suis peu à peu aperçu que ce qui m’intéressait le plus et me paraissait être le plus actuel dans la doctrine de l’esprit objectif n’avait pas toujours besoin, pour être jugé valide, d’être corrélé à l’infrastructure logico-métaphysique du système. »1 Si je vous suis bien, il ne s’agit pas pour vous de rompre tout lien entre la doctrine de l’esprit objectif et ce que vous appelez l’infrastructure logico-métaphysique du système, mais bien plutôt de savoir lâcher du lest pour maintenir actuelle la pensée hégélienne. Ma première question est donc très simple : de quelle manière entendez-vous ce « Hegel sans métaphysique » qui ouvre votre livre ?
Jean-François Kervégan : Votre expression, « lâcher du lest », décrit de façon exacte ce que j’essaie de faire avec Hegel. D’un côté, parce que j’ai passé de longues années à potasser la Logique, et aussi, tout simplement, parce que Hegel ne cesse de souligner, dans les Principes de la philosophie du droit, que toute son argumentation présuppose la refonte des concepts classiques de la métaphysique opérée dans la Science de la Logique, véritable poumon de l’œuvre entière (du « système »), il ne me paraît pas possible de faire fi, comme certaines lectures anglo-saxonnes contemporaines (pas toutes, d’ailleurs !), du travail considérable de redéfinition du langage même de la philosophie qui y est accompli. En ce sens, on ne peut couper la philosophie pratique de Hegel, qui est ce qui chez lui m’intéresse au premier chef, de sa métaphysique, s’il est vrai que la Logique est ce qui, chez lui, prend la place de la métaphysique.
Mais, d’un autre côté, il n’est pas certain que l’on doive prendre en charge toute la métaphysique de Hegel, et en particulier toute sa philosophie de « l’esprit absolu », pour faire un usage sensé et créatif de sa philosophie du droit, de sa philosophie morale ou de sa philosophie politique. De ce point de vue, s’il s’agissait de rejouer le débat qui a eu lieu après la mort de Hegel entre les « vieux hégéliens », pour lesquels le système était un bloc insécable, et les « jeunes hégéliens » qui, avec Feuerbach ou Marx, considéraient qu’un usage vivant des catégories hégéliennes suppose qu’on se libère de la lettre du système afin de le « ramener sur terre », je serais dans le camp de ces derniers. Pour autant, il n’est pas question de vendre l’hégélianisme par appartements. Simplement, si on lit Hegel selon d’autres canons que ceux d’une histoire scolastique de la philosophie (qui a au demeurant sa valeur et même sa nécessité !), si l’on s’attache à ce qui chez lui peut aider à penser au présent, alors on doit sans doute « lâcher du lest ». Un Hegel sans métaphysique, c’est un Hegel qui, sans rien abandonner ce qui constitue le propre de son geste intellectuel, met en veilleuse certaines des ambitions qui lui sont prêtées, qui se met à l’écoute de questions qui dans le hégélianisme historique n’avaient pas encore trouvé de formulation, tout simplement parce que l’esprit du temps ne le permettait pas, et qui aide à y proposer des réponses intempestives.
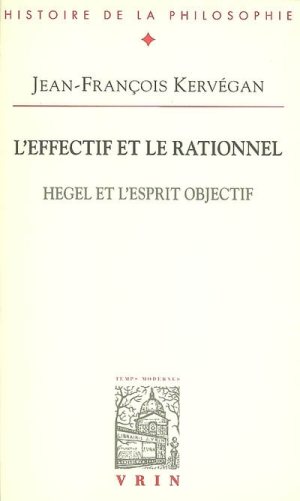
Actu-Philosophia : On note d’ailleurs qu’il n’est pas rare que vous proposiez d’établir des correspondances entre la Logique et l’Esprit objectif rendant intelligibles les articulations du système. Par exemple, votre analyse de la moralité comme ce qui relie la subjectivité du vouloir à des normes devant être réalisées par des actions de sorte que la subjectivité exprime le droit comme manifestation objective de la libre subjectivité, est reliée à la Logique puisque le principe de l’autonomie subjectif est un principe structurellement objectif. « La subjectivité morale a dans la structure de l’esprit objectif une fonction qui correspond à celle de l’objectivité dans la logique du concept : fournir une médiation grâce à laquelle le concept d’abord formel et abstrait se retrouve lui-même dans le monde effectif qui, pour la représentation commune, lui est étranger. »2 La Logique n’est donc pas caduque pour rendre compte de l’Esprit objectif, ce par quoi d’ailleurs, la pensée hégélienne est bel et bien systématique.
JFK : Comme je viens de l’indiquer, la Logique est ce qui chez Hegel tient lieu de métaphysique, de philosophie première. Elle est, si l’on veut, une ontologie, en ce sens qu’elle est une théorie non pas de l’être, mais du discours (du logos) sur l’être (ou sur les étants). Cette ontologie ou, comme je préfère dire, cette onto-logique procède à un immense travail de redéfinition non seulement des catégories majeures de la métaphysique (cela en particulier dans la Logique de l’essence), mais aussi des significations sédimentées dans l’usage ordinaire de la langue, un usage qui est selon Hegel fréquemment empreint d’une mauvaise métaphysique – mauvaise parce qu’inconsciente et non questionnée. Tout ce travail conceptuel est présupposé par les autres parties du système, aussi bien par la philosophie de la nature que par celle de l’esprit subjectif et objectif. Et Hegel ne cesse de le souligner, en particulier dans les Principes de la philosophie du droit, où il écrit que « le tout, ainsi que la formation de ses maillons, repose sur l’esprit logique »3. Il ne s’agit pas seulement d’une déclaration de principe. A maintes reprises, Hegel convoque la Logique pour justifier les torsions qu’il fait subir aux significations communes. On peut le vérifier sur deux exemples remarquables. Tout le monde connaît la (trop ?) fameuse formule de la Préface des Principes de la philosophie du droit : « Ce qui est rationnel est effectif ; et ce qui est effectif est rationnel ». Et, presque toujours, conformément à l’usage commun, on interprète le mot ‘effectif’ (wirklich) comme s’il signifiait la même chose que ‘réel’ (reell ou real). Ce qu’on sait moins, c’est que, au § 6 de la 2e édition de l’Encyclopédie (1827), Hegel récuse les interprétations qui ont été faites de ce distique et rappelle que la Logique distingue expressément entre le ‘réel’ (ou, si l’on veut, l’étant), qui relève de la logique de l’être et participe d’une économie du passage ou du changement, et ‘l’effectif’, qui relève de la logique de l’essence et participe d’une économie de la manifestation, à même l’étant, de la raison d’être (c’est-à-dire en fin de compte du concept). La formule de la Préface est donc loin de souligner, comme on le croit souvent, que « tout ce qui est réel est rationnel » ; d’ailleurs, ajoute ironiquement Hegel, « Qui ne serait pas assez avisé pour voir dans ce qui l’entoure beaucoup de choses qui en fait ne sont pas comme elles doivent être ? » (Encyclopédie, § 6, trad. Bourgeois, t. 1, Vrin, 1970, p. 170). Second exemple, le concept de sujet : lorsque Hegel traite du « sujet » dans les Principes et, plus généralement, dans sa philosophie de l’esprit, on doit avoir en mémoire les développements de la ‘Doctrine du concept’, troisième partie de la Logique, où la subjectivité est présentée comme la propriété caractéristique du concept, et non pas d’abord du sujet concevant. La subjectivité, selon Hegel, ne doit pas être pensée à partir de déterminations anthropologiques, ni comme chez Kant dans une perspective transcendantale, mais comme cette propriété qu’a la pensée de s’engendrer elle-même, en quelque sorte objectivement ; il dit d’ailleurs des catégories de la Logique (dont celle de sujet) qu’elles sont des « pensées objectives » (Encyclopédie, § 24, t. 1, p. 290). Et ce que nous appelons le sujet – Hegel parle à ce propos de « subjectivité finie » – est le spectateur plutôt que l’auteur de cette pensée qui se développe de façon immanente. Ce n’est donc pas par feinte modestie qu’il prétendait n’être que le secrétaire de l’esprit du monde : pour lui, la pensée, y compris sa propre pensée, est un processus autonome, objectif, en sorte qu’on pourrait paradoxalement attribuer à Hegel la formule qu’Althusser a forgée dans un but expressément anti-hégélien : « procès sans sujet »… Pour toutes ces raisons, la Logique n’est pas caduque ; ou alors, si elle l’est, et là où elle l’est, c’est tout un pan du propos hégélien qui perd une bonne partie de sa signification, et probablement de son intérêt.
AP : Dans un article extrêmement clair 4, vous précisez le sens que revêt la métaphysique chez Hegel à partir d’une apparente contradiction dans l’Encyclopédie. Le § 27 du Concept préliminaire semble faire de la métaphysique quelque chose d’ancien et de cantonné à l’entendement donc d’incapable de s’élever au point de vue de la raison. Ce que Hegel appelle l’ancienne métaphysique est la « simple vision d’entendement des ob-jets de raison. »5 Et de l’autre, Hegel assume parfaitement, par exemple dans le § 24, que « La Logique coïncide (…) avec la Métaphysique, la science des choses, saisies en des pensées qui passaient pour exprimer les essentialités des choses. »6. Et vous montrez que le § 32 éclaire cela en associant l’ancienne métaphysique à un certain dogmatisme qui considérait que deux affirmations opposées étaient nécessairement vraies et fausses. La vraie métaphysique combat ainsi le dogmatisme du « ou bien ou bien ». Mais dans ce cas, si la métaphysique que revendique Hegel est de faire valoir le point de vue de la médiation et de révéler que l’immédiat est déjà saturé de médiation, comment peut-on imaginer que la pensée hégélienne soit comprise sans la métaphysique prise en ce sens-là ?
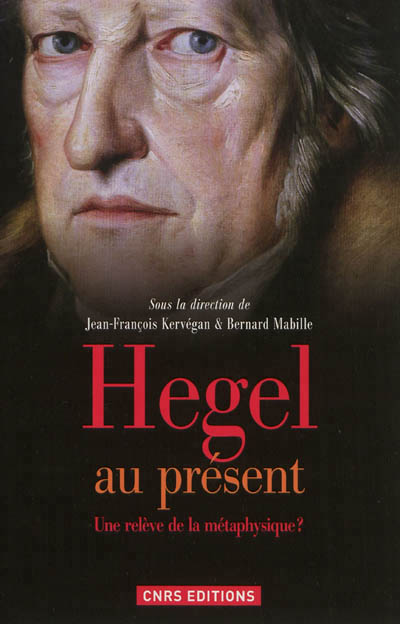
JFK : Vous avez raison, le rapport de Hegel avec la métaphysique est loin d’être simple ; je l’ai déjà souligné en réponse à votre première question. Une des raisons en est que, selon les contextes, Hegel dénomme ainsi des choses bien différentes. En un sens étroit et péjoratif, la métaphysique désigne chez lui l’édifice scolaire construit par Christian Wolff, et qui constituait du temps de Kant, et même encore de Hegel, la base de l’enseignement philosophique universitaire ; cette métaphysique, avec sa subdivision en métaphysique générale (ou ontologie) et métaphysique spéciale (cosmologie, psychologie et théologie rationnelles) constitue l’arrière-plan aussi bien de la Critique de la raison pure que de la Science de la logique, et ce que chacune de ces œuvres s’efforce à sa manière de réfuter. En ce premier sens, « l’ancienne métaphysique », qui est celle de Wolff et des scolastiques, mais pas celle des Anciens, est bien ce qu’il s’agit pour Hegel de détruire. Il faut ajouter que cette mauvais métaphysique et la vision dualiste dont elle est porteuse (le dogmatisme du « ou bien … ou bien », comme vous le rappelez) règnent non seulement dans le champ de la philosophie universitaire, mais aussi dans celui des sciences de la nature et des mathématiques, bref dans ces « sciences d’entendement » dont Hegel dénonce la pauvreté des attendus philosophiques autant qu’il en loue la fécondité opératoire. Les longues remarques que la Logique consacre au traitement mathématique de l’infini sont un exemple remarquable de cette traque des présupposés métaphysiques (souvent inaperçus) qui se logent jusque dans les productions les plus fécondes de la science en train de se faire (et dont Hegel, je le rappelle, avait une solide connaissance).
Mais, à côté de cette mauvaise métaphysique d’entendement qu’il entend éradiquer, il y a aussi la grande tradition métaphysique que Hegel assume et dont il se réclame constamment, même s’il préfère pour sa part les dénominations de spéculation ou de pensée spéculative : Héraclite, Platon, Aristote, Plotin, mais aussi quelques modernes (Spinoza plutôt que Leibniz ou Descartes), en sont les représentants les plus attentivement commentés, comme on le voit dans les cours sur l’histoire de la philosophie. Cette tradition, Hegel, conscient du fait que depuis Kant le sens même de l’entreprise philosophique a changé du tout au tout, entend tout à la fois la prolonger et lui faire subir une inflexion décisive. D’où la formule de l’Encyclopédie que vous citez : si la vraie métaphysique est la « science des choses saisies dans des pensées », la pensée de la pensée (noèsis noèseôs), alors, puisque les choses sont déjà en un sens des pensées, la logique hégélienne entend bien coïncider avec la métaphysique, en lui imprimant un cours nouveau.
C’est pour rendre compte de ce double aspect – destruction de la mauvaise métaphysique, assomption et radicalisation de la vraie métaphysique spéculative – que la Science de la logique juxtapose deux propositions à première vue contradictoires : la Logique, tout à la fois, « prend tout simplement la place » de la métaphysique7 et prend sa suite, au point d’être « la métaphysique proprement dite »8. A cet égard, tout en revendiquant une lecture aussi peu métaphysique que possible de Hegel, je m’accorde avec mon ami le regretté Bernard Mabille, métaphysicien convaincu, qui dans sa propre contribution à l’ouvrage que nous avons édité ensemble, Hegel au présent. Une relève de la métaphysique ?, soulignait la complexité du rapport de Hegel avec la, ou plutôt les métaphysiques : car si il y a beaucoup de mauvaise métaphysique, il en est aussi de la bonne, et celle-ci est et reste indispensable. Encore faut-il s’entendre sur le sens des mots.
AP : On se rappelle que parmi les nombreux commentaires hégéliens existe tout un courant dit « anti-métaphysique » d’inspiration marxiste, comprenant des noms aussi prestigieux qu’Althusser, Marcuse et Lukacs. De toute évidence, votre propre position n’est pas anti-métaphysique mais plutôt « hors » métaphysique. Pourriez-vous alors préciser ce qui distingue une lecture anti-métaphysique de Hegel d’une lecture « sans » ou « hors » métaphysique ?
JFK : Il y a aussi d’autres courants interprétatifs anti-métaphysiques, en particulier dans le monde anglo-saxon ; je pense aux lectures pragmatistes anciennes (Dewey) ou actuelles (MacDowell, Brandom)… Mais laissons cela. Votre question me touche particulièrement, car il se trouve que je suis moi-même issu du courant que vous évoquez. En effet, comme beaucoup de gens de ma génération, c’est à partir de Marx, et dans mon cas du Marx d’Althusser et de Lire le Capital plutôt que du Marx de Lukàcs ou de celui de Marcuse, que j’en suis venu à lire Hegel, au départ dans l’intention de « vérifier » que la pensée de Hegel était bien saturée d’une métaphysique idéaliste dont il convenait de la purger en la remettant sur ses pieds, selon la fameuse formule de la Postface de la 2e édition allemande du Capital… Ma lecture des écrits de Hegel, à laquelle la lecture du livre de Gérard Lebrun, La patience du concept, donna une impulsion décisive, changea profondément la donne et me convainquit du caractère inadéquat de mes présupposés. Ce que j’ai conservé de ma position initiale, c’est une forte réticence à l’égard de la métaphysique débordante, dont certains courants philosophiques français ou allemands (ou franco-allemands, dans le cas si particulier de l’heideggerianisme français) offrent maint exemple. (Je précise que je ne pense pas prioritairement ici à Heidegger lui-même, qui à sa manière développe une critique aiguë de ce que je viens de nommer la métaphysique débordante). Mais cette suspicion, qui m’incite à jeter sur ce genre de production un regard occamien et qui me conduit à éprouver de la sympathie pour tout ce qui, dans la philosophie anglo-saxonne, résiste vigoureusement à la prolifération des entités (et, ce qui va souvent de pair, des majuscules), aboutit plutôt, comme vous le dites justement, à une position « hors » métaphysique (et encore, puisque je considère avec Hegel que la métaphysique est en un sens inéluctable, sauf à renoncer à parler) qu’à une position anti-métaphysique qui risquerait de reproduire en négatif les unilatéralités de la mauvaise métaphysique. D’une certaine façon, tout pensée forte (y compris, bien entendu, celle de Marx) comporte un noyau qu’on peut qualifier de métaphysique en un sens minimal : une prise de position à l’égard de l’être de l’étant, comme on dit dans un lexique qui n’est pas le mien, et une définition des conditions de sa saisie discursive ; en ce sens, il est vain de prétendre en sortir radicalement. En revanche, il me paraît salutaire de conserver, comme Hegel, une prudente méfiance à l’égard de la sacralisation des entités et des alternatives sommaires auxquelles elles donnent lieu.
AP : Bernard Bourgeois explique souvent qu’« il n’y a pas pour [lui] de métaphysique hégélienne et, si l’on a pu désigner comme le métaphysique ce qui, chez l’homme, s’exprimerait dans la métaphysique, sa désignation complète, concrète, vraie, est tout simplement pour Hegel, celle de la pensée en sa potentialité rationnelle. »9 Iriez-vous jusqu’à soutenir un tel point de vue ou considérez-vous que la Logique est métaphysique ? Et si elle vous semble l’être, pour quelle raison faudrait-il tenir la révélation des médiations qu’accomplit la Logique pour une métaphysique ?
JFK : Votre question rappelle à quel point ce problème du rapport de Hegel et de la métaphysique est embrouillé. Je souscris entièrement au propos de Bernard Bourgeois que vous citez (la métaphysique désigne la pensée en sa potentialité rationnelle), alors même que le type de lecture que nous développons lui et moi du hégélianisme en son ensemble est assez différent. J’ai fait précédemment référence au débat entre « vieux » et « jeunes hégéliens » dans les années 1830-1840. J’aurais tendance à dire que, dans le spectre actuel des lectures de Hegel, Bernard Bourgeois, qui a joué comme on le sait un rôle majeur dans le développement des études hégéliennes en France et à qui je n’avais pas par hasard demandé d’être mon directeur de thèse, incarne peut-être une position « vieille-hégélienne », en ce sens que pour lui le système est à prendre comme un tout qu’il est impossible de démembrer sans qu’il perde sa cohérence. De mon côté, j’assume une position « jeune hégélienne » qui m’autorise, sur la base d’une interprétation sérieuse (du moins je l’espère !) des fondements spéculatifs du philosopher hégélien (autrement dit de sa métaphysique au sens étroit et fort du terme), de « faire mon marché » (on me pardonnera cette familiarité) et de laisser jusqu’à un certain point de côté certains segments du système qui m’intéressent moins (par exemple, la philosophie de la religion, en dépit du fait que les cours de Hegel sur ce sujet contiennent des pépites même pour celui qui n’éprouve pas un intérêt prioritaire pour ce genre de questions). Cela tient peut-être au fait que, contrairement à Bernard Bourgeois, je ne me suis jamais considéré comme un historien de la philosophie, ce qui me permet de prendre des libertés avec la discipline interprétative que m’ont inculquée mes maîtres, formés pour beaucoup à l’école de Martial Gueroult.
Pour conclure sur ce point, peut-être vaudrait-il mieux mettre en réserve ou contourner cette question « Hegel avec ou sans métaphysique », tant la nature des réponses qu’on peut y apporter est dépendants de choix définitionnels qu’il conviendrait à chaque fois d’expliciter. Je continuerai de revendiquer, en ce qui concerne aussi bien l’interprétation de Hegel que mes positions philosophiques personnelles, une attitude sobre à l’égard de « la » métaphysique. D’un côté, je ne crois pas que les questions métaphysiques résultent seulement d’un usage insuffisamment précautionneux du langage, et je ne caresse pas l’espoir d’une éradication de la métaphysique qu’ont nourri certains courants philosophiques pour lesquels, par ailleurs, je n’éprouve pas d’antipathie (je pense ici aussi bien au positivisme logique qu’à la philosophie analytique et à la philosophie du langage ordinaire). Mais, de l’autre, je persiste à penser que la rationalité philosophique – qui est une pensée des médiations, comme vous le dites justement – doit se garder des hypostases essentialistes auxquelles, historiquement, les métaphysiciens se sont si volontiers livrés. S’il est une chose que nous apprend Hegel, c’est qu’il est vain de s’enquérir du premier principe, tant il est vrai que ce ‘premier’ (par exemple : l’être pur de la Logique, la certitude sensible de la Phénoménologie) est toujours déjà habité par ce qui, apparemment, résulte de lui et le présuppose.
B : Hegel et l’Esprit objectif
AP : Outre cette interprétation générale portant sur la nature de la pensée hégélienne, vos travaux portent également sur la philosophie politique en général et sur celle de Hegel en particulier. Vous avez ainsi proposé l’édition de référence des Principes de la philosophie du droit qui a été récemment republiée avec de notables suppléments10. Cette nouvelle édition introduit, outre le texte intégral et des extraits de cours de 1817/18 et de 1819/20, la traduction intégrale des Additions composées par Eduard Gans (1798-1839), philosophie, historien et juriste, à la fois disciple de Hegel et professeur de Marx. Qu’apportent aujourd’hui pour la recherche et l’intelligibilité de Hegel les additions de Gans ?
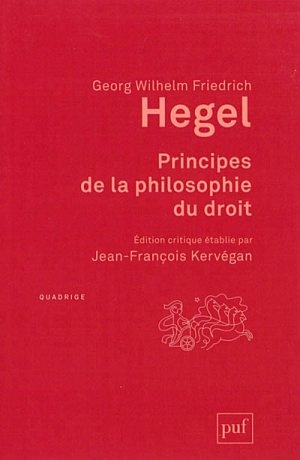
JFK : C’est une longue histoire… Les Additions ont été composées par Gans en 1833, à l’occasion de la publication des Principes de la philosophie du droit au tome VIII de « l’édition du cercle des amis du défunt », première édition (encore incomplète) des Œuvres de Hegel. Nul n’était plus qualifié que lui pour faire ce travail : proche disciple de Hegel, lui-même professeur de droit à Berlin, Gans, au cours des années 1825-1831, a assuré régulièrement le cours de philosophie du droit sur la base du manuel publié par Hegel en 1820 ; il y ajoutait des commentaires personnels dont le caractère libéral, voire républicain, suscita, dit-on, l’ire du roi de Prusse.
Gans a utilisé pour composer les Additions deux cahiers d’étudiants restituant respectivement le propos du cours de 1822-1823 (cahier Hotho) et celui du cours de 1824-1825 (cahier von Griesheim) ; il s’est aussi servi de notes manuscrites de Hegel (il s’agit en fait d’annotations griffonnées par ce dernier sur son exemplaire personnel, dont j’ai aussi traduit certains extraits). Gans a fait des choix ; il a parfois interverti l’ordre des phrases retenues, modifié le choix des termes et amélioré le style. Cela ne suffit pas à rendre élégant le propos très « oral » de ces notes d’étudiants ; toutefois, il est généralement clair, plus en tout cas que le texte même de Hegel. Comme dit Gans, les Additions « permettent un passage plus aisé dans la conscience commune » du contenu souvent aride du livre…
Certains des éditeurs ultérieurs des Principes ont critiqué le travail de Gans. Pourtant, il apparaît aujourd’hui parfaitement sérieux et scientifiquement peu discutable, d’autant plus que nous avons désormais (grâce à l’édition d’autres cahiers d’étudiants) une ample connaissance du contenu de l’enseignement de « droit naturel et science de l’Etat » donné régulièrement par Hegel à Heidelberg puis à Berlin (toutes les Nachschriften connues des différents cours donnés par Hegel sur la philosophie du droit à Heidelberg et Berlin sont désormais publiées en trois volumes au tome 26 des Gesammelte Werke). On peut donc souscrire au jugement de l’expert qu’était Karl Heinz Ilting, qui a édité les deux cahiers utilisés par Gans : « en tant qu’éditeur [des cahiers Hotho et von Griesheim], Gans respecte les exigences les plus sévères en matière de probité philologique »11. Et cela n’est pas surprenant, quand on sait à quel point Gans était proche de Hegel, et maintenant que nous disposons aussi de documents sur ce qu’était son propre enseignement lorsqu’il suppléait Hegel12. Bien entendu, on peut discuter certains de ses choix. On peut aussi regretter qu’il n’ait pas intégré plus d’éléments figurant dans ces cahiers, tant leur propos est riche et (quelquefois) innovant par rapport au texte publié. Je n’irai pourtant pas jusqu’à soutenir comme Ilting que les cours sont plus conforme à la véritable pensée de Hegel que le livre. Au contraire, je me suis convaincu qu’il n’existe pas de différence significative entre le propos du livre publié par Hegel et celui des Additions composées par Gans. C’est la raison pour laquelle je me suis résolu, quinze ans après la première édition de ma traduction des Principes, à y adjoindre celle des Additions, qui n’étaient jusqu’alors accessibles que dans l’édition Derathé-Frick. Mon seul remords est de ne pas l’avoir fait dès la première édition.
AP : Permettent-elles de mettre un peu à bas la légende d’un Hegel philosophe officiel de l’Etat prussien ?
JFK : Qu’il s’agisse d’une légende, je crois qu’il n’y a pas besoin des Additions pour l’établir, mais elles la rendent encore plus improbable par les multiples observations critiques qu’elles contiennent à l’égard de l’état de choses existant. On peut d’abord réfuter cette légende à l’aide d’arguments factuels. L’image du philosophe de l’Etat prussien a été construite par Rudolf Haym dans un livre publié en 1857, dont la thèse centrale est que « le système de Hegel [est] la résidence scientifique de l’esprit de la restauration prussienne »13. Mais de telles vues se rencontrent déjà, aussitôt après la parution des Principes, dans une lettre adressée à Hegel par Nikolaus von Thaden, lui-même fonctionnaire prussien et disciple revendiqué du philosophe14. Ce qui a motivé ce soupçon est évidemment la fameuse Préface dans laquelle, selon toute apparence, Hegel justifie le cours répressif adopté par la politique prussienne à la suite des décisions de Carlsbad (1819), dont le prétexte a été fourni par l’assassinat d’un écrivain conservateur. Hegel revendique même apparemment cette attitude. Dans une dédicace au chancelier prussien Hardenberg, il indique que son livre est « une tentative pour saisir dans ses traits essentiels ce qui se présente à nos yeux », en sorte que la philosophie se montre « une auxiliaire immédiate des intentions bienfaisantes du gouvernement » 15. Le propos paraît accablant ; mais il ne faut pas oublier qu’il s’adresse au dernier des grands ministres de l’ère des réformes, qui précisément prend fin en 1819.
En fait, la « rencontre de Hegel avec la Prusse » (c’est le titre d’un article d’Otto Pöggeler) repose dès le départ sur un malentendu. Ce qui l’a conduit à accepter la chaire de philosophie de l’Université de Berlin, outre le fait qu’il succédait ainsi à Fichte, était que la Prusse faisait figure d’îlot de résistance dans la vague réactionnaire qui, sous l’impulsion de Metternich, déferle sur l’Europe post-napoléonienne. Depuis 1806, la Prusse avait engagé des réformes économiques et sociales profondes, et s’était dotée du système éducatif le plus moderne d’Europe. Fondée par Humboldt en 1810, l’Université de Berlin regroupe certains des grands esprits de l’époque et ses professeurs jouissent d’une liberté plus grande qu’ailleurs. Or, la Prusse où Hegel arrive en 1818 n’est plus celle qu’il entendait servir. L’ère réformatrice est à son terme ; Humboldt, symbole de l’alliance temporaire du pouvoir et du savoir, et les autres promoteurs des réformes vont quitter le gouvernement ou en être évincés ; désormais, la politique prussienne sera de plus en plus conservatrice. Lorsque Hegel fait l’hommage de sa Philosophie du Droit à Hardenberg, ce n’est plus Humboldt, savant indianiste et linguiste, que l’on écoute à la Cour : ce sont l’ultra-réactionnaire Haller, auquel Hegel s’en prend avec une extrême véhémence dans les Principes (voir les remarques des § 219 et 258), et d’autres idéologues de la Restauration. De fait, jusqu’à sa mort, Hegel, qui a la réputation d’un « libéral », ne sera jamais très bien vu à la Cour, en particulier dans l’entourage du prince héritier, le futur Frédéric-Guillaume IV. Donc, si c’est la Prusse qui est glorifiée dans les Principes, il faut convenir que c’est une Prusse rêvée plutôt que la Prusse réelle. Un élément factuel l’atteste : alors que Hegel proclame que la monarchie constitutionnelle est « la constitution de la raison développée »16, le royaume, en dépit de promesses réitérées de ses monarques successifs, n’adoptera une constitution qu’en 1850, vingt ans après la mort de Hegel ; encore aura-t-il fallu pour cela la grande vague du « printemps des peuples », en 1848.
Mais la meilleure réfutation de la légende est d’ordre philosophique ; elle consiste à s’interroger sur le statut du texte publié en 1820. Les jugements de von Thaden et de Haym seraient à la rigueur justifiés si la Philosophie du Droit, en particulier sa Préface, pouvait être lue comme un écrit politique. Or, selon moi, il s’agit là d’une erreur de perspective semblable à celle qui consiste à interpréter la République de Platon – à laquelle Hegel se réfère à deux reprises – comme une simple machine de guerre contre la démocratie athénienne. Comme la République, les Principes ne sont pas un écrit politique de circonstance, mais une œuvre de philosophie politique. Certes, cette œuvre est de son temps, car la philosophie – et ceci est une thèse spéculative et non pas un constat – est « son temps appréhendé en pensées » (PPD, p. 132) ; mais ceci ne veut pas dire qu’elle le raconte, qu’elle le condamne ou encore moins le bénit (c’est Haym qui disait que Hegel accordait la bénédiction du concept à l’état de choses existant). La tâche de la philosophie est de penser la nature rationnelle, jamais apparente, de ce qui est, « car ce qui est est la raison » (PPD, p. 132). Autrement dit, si la philosophie est simultanément une « appréhension du présent et de l’effectif » et « l’examen approfondi du rationnel » (PPD, p. 128), c’est qu’il existe – voici la thèse philosophique forte de Hegel – une relation bijective entre « le rationnel » et « l’effectif », comme l’indique la formule la plus célèbre et la moins bien comprise de Hegel. Dans un cours, la formule de la Préface s’énonce ainsi : « Ce qui est rationnel devient effectif, et ce qui est effectif devient rationnel ». On comprend alors que de l’effectif – qui n’est pas le réel, mais ce qui, du réel, peut être pensé comme rendant raison de soi – au rationnel – dont la philosophie est l’exposition dans l’élément de la pure pensée – il y a acheminement, acclimatation plus ou moins ardue, et non plate équivalence statique. La réalité historique, dans son empiricité et sa contingence, présente sans doute les traces de ce mouvement, comme la nature contient les traces du concept17 ; mais de là à penser que les événements empiriques auxquels la Préface fait incontestablement allusion seraient pour Hegel marqués au sceau de la libre nécessité du concept, il y a un grand pas, comme le souligne un petit écrit de jeunesse, Comment le sens commun comprend la philosophie (trad. Lardic, Actes Sud, 1989).
AP : Il me semble que l’interprétation que vous donnez des Principes tourne souvent autour de la question de l’action. Si je prends l’exemple de la moralité, vous précisez dans la substantielle introduction que vous consacrez à ce texte, qu’« en réalité, ce n’est pas la subjectivité comme telle qui est le ressort de l’analyse de la moralité, mais bien plutôt l’action (Handlung, examinée sous l’angle de son imputabilité à un sujet et dans son rapport avec les normes qui structurent l’agir, et avec le monde humain dans lequel il s’inscrit. C’est ainsi qu’il faut comprendre cette formule étonnante de notre texte : « Ce qu’est le sujet, c’est la série de ses actions ». »18 Est-ce à dire que l’action prend le pas sur la subjectivité parce qu’elle seule objective l’intériorité ?
JFK : Question difficile ! Je suis tenté d’y répondre en deux temps. Sur un plan personnel, tout d’abord, j’ai éprouvé toujours une certaine méfiance à l’égard des discours de la subjectivité entendue comme intériorité fondatrice à l’origine du « sens » pouvant être conféré à des actes. Cela s’explique sans doute par le contexte dans lequel s’est opérée ma formation philosophique, au cœur de la grande vague « anti-subjective » des années 1960-1970 (si diverses que soient les critiques auxquelles a été exposée la ‘philosophie du sujet’ de la part de ceux qu’on a rassemblés sous l’étiquette du structuralisme). Cette méfiance, au demeurant, concernait moins les pensées puissantes de la subjectivité (qu’il s’agisse de Descartes, de Kant ou de la phénoménologie husserlienne) que leurs effets émollients dans une tradition philosophique française imprégnée de spiritualisme ; elle a, en tout cas partie liée avec l’affect non-métaphysique qui a nourri, comme je l’ai dit plus haut, ma lecture de Hegel. Plus tard, j’ai retrouvé dans certains secteurs de la philosophie anglo-saxonne, en particulier dans la philosophie de l’action, la même réserve à l’égard du « mythe de l’intériorité », pour reprendre le titre d’un livre de Jacques Bouveresse.
Cela dit, et je parviens ici au deuxième moment de la réponse, ce que je trouve particulièrement intéressant dans la philosophie morale de Hegel est qu’elle ne se contente pas de déconstruire la subjectivité. En effet, il ne suffit pas d’opposer une conception forte (non subjectiviste, conceptuelle) de la subjectivité aux conceptions molles qui ont pour seul horizon la « subjectivité mauvaise et finie »19 ; il faut aussi rendre compte de cette dernière, il faut aussi une « philosophie du sujet », et en particulier du sujet moral qui doit opérer des choix en fonction de contraintes normatives et dans un environnement social et humain qui échappe largement à son emprise. Là aussi, l’angle d’attaque choisi par Hegel est judicieux ; il consiste, comme vous l’avez rappelé, à penser l’action comme l’espace où se constitue le sujet et non pas comme l’effet, réussi ou manqué, des choix opérés par une volonté antécédente. C’est tout le sens de cette phrase que vous citez, et que j’ai souvent évoquée : « Ce qu’est le sujet, c’est la série de ses actions »20. Elle est la clef d’une philosophie morale originale, qui trouve sa place, en un apparent paradoxe, dans une doctrine de l’esprit objectif. Si le sujet moral est, comme la personne juridique, l’homo oeconomicus ou le citoyen politique, une figure constituante du procès d’objectivation de l’esprit, ce n’est pas sous l’aspect de sa pure intériorité, aspect qui peut précisément donner libre cours à l’absolutisation moralisante du point de vue moral que dénonce énergiquement la Remarque du § 140 des Principes, mais dans la mesure où il est tout entier investi et présent dans son action ; c’est par elle, en effet, que le sujet se mesure à une normativité universelle et objective (que résume l’idée abstraite du Bien) et prend sa place dans un monde peuplé d’autres subjectivités et où s’entrelacent les actions. Si la philosophie morale doit partir de l’action, ce n’est pas seulement en raison de l’adoption par Hegel d’une optique conséquentialiste (que l’on est tenté d’opposer à l’optique déontologique de la morale kantienne, mais les choses à mon sens sont un peu plus compliquées) ; c’est aussi parce que c’est le moyen de développer une théorie non subjectiviste de la subjectivité, qui en dernier recours est ancrée dans la Logique.
AP : Hegel écrit au § 113 des Principes de la philosophie du droit que « l’expression-extérieure de la volonté en tant que subjective ou morale est l’action. »21 On entend souvent dire que Hegel réfère l’action au sujet comme l’effet à sa cause ; pourtant Hegel parle bien d’une expression-extérieure et donc de quelque chose comme un devenir, comme un processus même qui ne se réduit nullement au cadre causal que l’on peut lire ici ou là. L’action n’est pas tant l’effet du sujet qu’elle ne semble en être la continuité processuelle. Ne faut-il pas alors en déduire que l’action ne saurait être un événement explicable par les états du sujet ?
JFK : Effectivement, le terme Äusserung, que j’ai intentionnellement surtraduit au moyen d’une locution redondante (« expression-extérieure »), donne d’abord à penser que dans l’action s’exprime une intériorité constituante, donatrice de sens, fondatrice. Or l’analyse de Hegel consiste au contraire à montrer que l’intériorité subjective se constitue dans l’enchaînement complexe de ses actions et dans leur grammaire. Il faut lire, à cet égard, la suite de la formule précédemment citée : « Ce qu’est le sujet, c’est la série de ses actions. Celles-ci sont-elles une série de productions sans valeur, la subjectivité du vouloir est elle aussi sans valeur ; la série de ses actes est-elle au contraire de nature substantielle, la volonté interne de l’individu l’est aussi » (PPD, § 124, p. 276). L’action, comme vous le dites justement, n’est pas un « événement » (et ici, on ne peut que penser à la distinction désormais classique que fait Davidson dans Actions et événements), elle n’est donc pas explicable en termes de causalité, pas plus qu’elle n’est réductible à une donation de sens intentionnelle : elle est le lieu d’une dialectique où l’intériorité subjective et l’extériorité de l’acte se constituent réciproquement. Ce qui distingue une action (Handlung) d’un acte ou d’un ‘fait’ (Tat) dont ‘je’ me trouve être l’agent (PPD, § 117, p. 269), c’est qu’elle donne lieu à une prise de position subjective, à un ‘engagement’ (positif ou négatif).
Etrangement, lorsque Hegel, dans la deuxième partie des Principes, parle du rapport du sujet et de l’action, lorsqu’il décortique la notion d’intention, lorsqu’il montre que l’action constitue, pour la subjectivité, l’épreuve décisive de sa capacité à outrepasser dans son agir ses limitations constitutives, il me paraît à certains égards, et en dépit de ce qui les oppose (Hegel est pour sa part un conséquentialiste résolu : ne dit-il pas que les conséquences sont « la configuration immanente propre de l’action » ? [PPD, § 118, p. 270]), proche des analyses ‘grammaticales’ d’Anscombe, par exemple lorsqu’elle écrit : « En général, la question de savoir si les faits et gestes d’un homme sont intentionnels ne se pose pas »22. Le rapprochement n’est pas saugrenu : il permet de comprendre qu’un philosophe d’inspiration wittgensteinienne comme Vincent Descombes se soit emparé de la notion hégélienne d’esprit objectif.
AP : Toujours à partir de vos indications, je voudrais interroger le sens qu’il convient alors de prêter au sujet chez Hegel. Si les actions expriment le sujet sans en être simplement l’effet, alors elles doivent contribuer à l’identité de celui-ci. Vous dites dans « Une pensée non métaphysique de l’action », que le sujet est au fond le principe de cohérence émergent d’une série d’événements obéissant à des raisons si bien que l’évaluation morale de la subjectivité ne puisse passer que par les traces de ses actions. Ainsi, « la subjectivité morale est pourtant d’abord appréhendée à travers le système objectif des actions qui lui sont imputables et à partir du contexte de celles-ci, et non directement comme telle. C’est le concept d’action, non celui de subjectivité, qui est le fil conducteur de l’étude de la moralité : c’est qu’il s’agit précisément de « se libérer de l’unilatéralité de la simple subjectivité ». »23 Ne peut-on pas voir ici quelque chose qui préfigurerait un certain nombre d’analyses sartriennes ? Peut-être même peut-on aller jusqu’à se demander ce que Sartre apporte réellement par rapport à cette saisie hégélienne de la définition du sujet.
JFK : L’expression que vous citez, « principe de cohérence émergent », résume en effet mon interprétation de la théorie hégélienne de la subjectivité morale, telle qu’elle se trouve formulée – cette circonstance est notable – non pas dans la philosophie de l’esprit subjectif, mais dans la doctrine de l’esprit objectif. Quant au rapprochement que vous suggérez avec Sartre, je demeure circonspect (mais il est vrai que je n’ai jamais étudié de manière très approfondie la pensée sartrienne) ; en effet, de par ses prémisses phénoménologiques, Sartre est attaché à une conception de la subjectivité constituante impliquant un privilège de la conscience que Hegel pour sa part n’a cessé de remettre en question ; ce n’est pas un hasard si la « science de l’expérience de la conscience » qu’il projetait d’écrire est devenue la Phénoménologie de l’esprit. Et l’esprit, chez Hegel, est tout autant de l’ordre de l’objectivité que de celui de la subjectivité.
Cela dit, comme je l’ai indiqué, la conception hégélienne de la subjectivité ne se restreint pas à la théorie de la subjectivité morale exposée de façon détaillée dans les Principes de la philosophie du droit. Un des grands intérêts que j’ai éprouvé à lire Hegel (cela commença pour moi par la Phénoménologie et la Logique) est que l’on trouve chez lui les éléments d’une philosophie non subjectiviste de la subjectivité, mettant au premier plan l’auto-engendrement objectif de la pensée (le mouvement du concept) et non pas la subjectivité « mauvaise et finie », celle qui « fait face à la Chose »24 au lieu d’épouser son procès. Lorsque, dans un grand texte programmatique, Hegel affirme que la tâche de la philosophie est d’appréhender le vrai non pas comme substance, mais comme sujet25, c’est selon moi de ce concept fort, objectif si l’on veut, de la subjectivité qu’il est question. Je précise que cette lecture de la théorie hégélienne de la subjectivité fut nourrie par celle du texte de Cavaillès, Sur la logique et la théorie de la science, qui souligne limpidement les apories de la phénoménologie husserlienne (sur laquelle portaient, sous l’influence d’A. Lécrivain et de J.-T. Desanti, mes premiers travaux universitaires) et la nécessité d’une philosophie non pas de la conscience, mais du concept.
AP : Dans le collectif très récent qui vient de paraître au Cerf et qui est consacré à l’idéalisme allemand, vous vous occupez de tout ce qui concerne la moralité et la philosophie politique de Hegel. Vous montrez l’importance de l’éthicité (Sittlichkeit chez Hegel, éthicité conçue comme unité et vérité des deux moments abstraits que sont le droit et la morale. Peut-on dire que Hegel fait ici jouer l’étymologie en ceci que l’éthicité renvoie à l’éthique donc au comportement ou à l’action au sens grec du terme, si bien que sa saisie de l’action comme expression extérieure de la volonté devait l’amener nécessairement à compléter la moralité par une éthicité ?
JFK : Tout d’abord, je précise que les deux chapitres en question ont été écrits en collaboration avec Georg Mohr. En ce qui concerne la Sittlichkeit, que je me permets de traduire littéralement par ‘éthicité’ pour faire ressortir, comme Hegel le fait lui-même, la parenté avec le sens qu’a l’ethos dans la philosophie grecque, en particulier chez Aristote, elle est effectivement la « vérité » du droit et de la moralité, en ce sens qu’elle combine les deux dimensions de l’objectivité et de la subjectivité maintenues séparées aussi bien dans la sphère du droit « abstrait » (privé), dont les normes semblent extérieures à la personne aux actes de laquelle elles s’appliquent, que dans celle de la moralité, où une tension demeure entre l’intériorité subjective du propos, des intentions, etc., et l’objectivité aussi bien des normes morales que du monde de l’intersubjectivité socialement constituée. Ce que Hegel nomme Sittlichkeit est un système de normes et de pratiques institutionnalisées dans lequel, idéalement, les individus reconnaissent ce qui leur permet d’être eux-mêmes, un « cercle de la nécessité » (PPD, § 145, p. 316) qui, de façon apparemment paradoxale, rend effective la liberté des sujets, laquelle risquerait hors de ce cadre éthico-politique de demeurer une revendication abstraite. L’indisponibilité des « lois éthiques » (croyances collectives, pratiques institutionnalisées, règles formalisées) en fait une « seconde nature » (PPD, § 151, p. 322) qui en quelque sorte, pour paraphraser Rousseau, contraint les individus à être libres, c’est-à-dire fait d’eux les sujets effectifs de leur agir, et non leur simple point de survenance ; Hegel écrit que la subjectivité, « terrain » de « l’existence » du concept de liberté (PPD, § 106, p. 260), trouve dans l’éthicité « l’existence qui lui est adéquate » (PPD, § 152, p. 323). On pourrait dire, selon une lecture téléologique, que l’éthicité est le résultat qui vient dépasser la double abstraction du droit et de la moralité. Toutefois, ce serait oublier que, conformément à la démarche progressive-régressive que Hegel expose et justifie dans l’ultime chapitre de la Logique, « L’idée absolue », le résultat est aussi, de manière circulaire, le fondement de ce dont il résulte. De la sorte, le réseau institutionnel de l’éthicité ne « dépasse » pas seulement le droit et la moralité, il leur donne sens tout en fixant les limites de ce à quoi ils peuvent parvenir : c’est parce que l’éthicité est « l’unité et la vérité de ces deux moments abstraits » que sont le droit et la moralité (PPD, § 33, p. 179) qu’elle leur évite de fonctionner pour ainsi dire à vide et permet à l’esprit objectif de franchir les deux obstacles toujours menaçants que sont le juridisme et le moralisme.
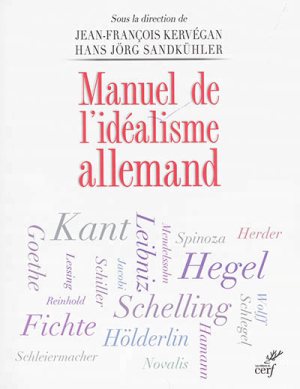
AP : Vous écrivez, au sujet de l’éthicité, que Hegel poursuit l’exigence kantienne de l’autonomie de la raison : « Il s’agit plutôt pour Hegel de formuler dans une autre langue (selon lui plus appropriée) l’exigence kantienne fondamentale d’autonomie de la raison. »26 Comment l’autonomie de la raison peut-elle être maintenue dans une philosophie qui pense précisément la nécessité de l’objectivation ?
JFK : Tout simplement en renonçant à penser exclusivement la raison comme une faculté du sujet… Pour Hegel, il est essentiel de concevoir la raison comme s’accomplissant dans le monde tout autant que dans nos têtes ; elle est (voir PPD, Préface, p. 132) tout aussi bien subjective (la raison qui pense, la « raison en tant qu’esprit conscient de soi ») qu’objective (la raison qui est, la « raison en tant qu’effectivité présente-là ») ; la raison est donc fondamentalement « subjective-objective ». On sait que Hegel – c’est la source de bien des malentendus – nomme « idée » cette rationalité subjective-objective, qui n’est rien d’autre que le procès grâce auquel la pensée et le monde s’ajustent continuellement. Du coup, le principe kantien de l’autonomie de la raison reçoit une portée nouvelle : il ne signifie pas seulement que la raison subjective se donne des lois et des normes, mais surtout que la raison subjective-objective s’engendre elle-même et, du même coup, produit les formes de la subjectivité (par exemples les attitudes morales) tout comme celles de l’objectivité (les structures du monde naturel et social). Au demeurant, je me demande si l’on ne peut pas déjà détecter chez Kant lui-même les prémices d’une telle conception de la rationalité ; mais nous allons sans doute revenir sur ce point.
AP : Je profite de cette question pour présenter le Manuel de l’idéalisme allemand. Un collectif international de chercheurs spécialistes de l’idéalisme allemand et que vous codirigez vient de publier une sorte de guide introductif quoique non dénué de certains parti-pris interprétatifs à cette période. Un tel livre est, à ma connaissance, inédit, et permet de présenter sous une forme synthétique et très claire ce sommet de la philosophie européenne. L’avant-propos précise que ce livre est le produit de séminaires tenus entre 1999 et 2002 à l’université de Brême ayant pour thème : « La philosophie au centre de la civilisation européenne. L’idéalisme allemand dans une perspective comparatiste : genèse, réception, interactions, tendances actuelles de la recherche ». Qu’est-ce qui vous a décidés d’éditer un tel manuel 13 ans après le dernier séminaire ?
JFK : En réalité, le livre est paru en langue allemande en 2005, grâce à l’énergie de Hans Jörg Sandkühler, organisateur des séminaires de Brême, à qui revient la paternité de toute l’entreprise. Dès le départ, le projet était d’en publier des traductions ‘actualisées’ dans les différentes langues des chercheurs participant au séminaire, mais la traduction française est la première réalisation de ce programme. Mes co-traductrices et moi-même ne nous sommes pas contentés, au demeurant, de traduire les différents chapitres de ce livre. Les bibliographies de chaque chapitre et la bibliographie générale ont été actualisées, et une place plus importante que dans l’original a été faite à la littérature secondaire francophone. L’intérêt du livre, outre le caractère résolument transnational qu’il a de par la provenance de ses auteurs, est peut-être qu’il traite de « l’idéalisme allemand » (en y incluant Schleiermacher et le romantisme, dont les liens avec la philosophie post-kantienne sont très étroits) comme un tout. Par delà ce qui distingue les œuvres de Kant, Fichte, Schelling et Hegel, pour s’en tenir aux quatre auteurs qui sont constamment présents, le propos de l’ouvrage est de ressaisir, au-delà des lieux communs sur la triplette « Idéalisme subjectif, objectif, absolu », le fil qui rattache en profondeur leurs œuvres ; ce projet commun, qui se décline de façon générale chez chacun de ces grands penseurs et chez ceux qu’ils ont inspirés, c’est, comme l’a écrit Dieter Henrich, un des plus profonds commentateurs de la philosophie classique allemande, de penser en ses ultimes conséquences l’autonomie de la raison, une raison qui ne peut plus dès lors être entendue comme une faculté de l’esprit humain parmi d’autres, mais comme l’acte même de la pensée se confrontant au réel.
AP : L’avant-propos mentionne également que selon les huit pays participant au projet, le sens et la réception de l’idéalisme allemand diffèrent sensiblement. Est-ce à dire qu’aujourd’hui encore, un chercheur italien ne peut pas lire l’idéalisme allemand comme un chercheur polonais ou finlandais ?
JFK : C’est une des choses que j’ai apprises en participant aux séminaires estivaux de Brême et à la rédaction du Manuel : les réceptions de la philosophie classique allemande ont été fort différentes d’un pays à l’autre en raison de la diversité des traditions intellectuelles propres à chaque aire linguistique et culturelle. La réception est un phénomène étrange, qui ne se limite pas du tout au fait de recevoir : c’est une chimie complexe, où se forment des synthèses inattendues et originales. Le chapitre consacré aux réceptions de l’idéalisme allemand en Europe en donne quelques exemples frappants ; par exemple, il montre le rôle majeur qu’a eu dans la philosophie espagnole le ‘krausisme’, alors que l’œuvre du philosophe Karl Christian Krause, assez obscur contemporain de Schelling et de Hegel, est largement ignorée partout ailleurs. On pourrait également évoquer ce phénomène si particulier qu’est l’idéalisme britannique (Bradley, MacTaggart, Bosanquet), qui a joué un rôle majeur en Grande-Bretagne vers la fin du 19e siècle, et auquel la philosophie analytique naissante va, avec Russell, réagir avec vigueur. Une bonne partie des malentendus entre la philosophie anglo-saxonne et la tradition allemande au cours du 20e siècle s’explique sans doute par là. Enfin, un regard comparatif nous permet de prendre conscience des spécificités de la réception française de la philosophie classique allemande, intimement liée, pour ce qui est de son courant dominant, au républicanisme laïc, alors que, dans d’autres pays, cette réception a été guidée par des préoccupations religieuses.
La suite de l’entretien est consultable à cette adresse.
- Jean-François Kervégan, L’effectif et le rationnel. Hegel et l’esprit objectif, Paris, Vrin, 2007, p. 11
- Ibid., p. 331
- cf. PPD, Préface, trad. Kervégan, PUF, 2013, p. 115
- cf. pour toutes ces analyses, Jean-François Kervégan, « Une pensée non métaphysique de l’action », in Jean-François Kervégan et Bernard Mabille (dir.), Hegel au présent. Une relève de la métaphysique ?, Paris, CNRS, 2012
- Hegel, Encyclopédie, Concept préliminaire, § 27, Traduction Bourgeois, Paris, Vrin, 1970, p. 294
- Ibid., § 24, p. 290
- Science de la Logique, éd. de 1812, traduction Labarrière-Jarczkyk, Kimé, 2006, p. 37
- op. cit., p. 5
- Bernard Bourgeois, « Hegel ou la métaphysique réformée », in Jean-François Kervégan et Bernard Mabille (dir.), op. cit., p. 25
- cf. Hegel, Principes de la philosophie du droit, Edition critique établie par Jean-François Kervégan, PUF, coll. Quadrige, 2013
- Ilting, « Einleitung », in Hegel, Vorlesungen über Rechtsphilosophie, Band 1, Stuttgart, Frommann-Holzboog, 1973, p. 122
- voir Eduard Gans, Naturrecht und Universalgeschichte, éd. par J. Braun, Tübingen, Mohr-Siebeck, 2005
- Hegel et son temps, Paris, Gallimard, 2008, p. 421
- voir Correspondance, tome II, Gallimard, 1967, p. 244-247
- Correspondance, tome II, p. 213-214
- Encyclopédie, § 542, trad. Bourgeois, t. 3, Vrin, 1988, p. 319
- Encyclopédie, § 250, t. 2, p. 190
- Jean-François Kervégan, L’institution de la liberté, in Hegel, Principes de la philosophie du droit, op. cit., p. 62-63
- Encyclopédie, § 147, t. 1, p. 582
- PPD, § 124, p. 276
- Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 113, op. cit., p. 265
- L’intention, Gallimard, 2001, p. 71
- Jean-François Kervégan, « Une pensée non métaphysique de l’action », art. cit., p. 301
- Encyclopédie, § 147, t. 1, p. 582
- Phénoménologie de l’esprit, trad. Bourgeois, Vrin, 2006, p. 68
- Jean-François Kervégan, « Droit et politique, in Jean-François Kervégan, Hans Jörg Sandkühler (dir.), Manuel de l’idéalisme allemand, Paris, Cerf, 2015, p. 237








