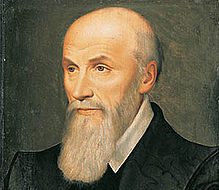Acheter Philippe le Bel. Puissance et grandeur.
Entretien avec Jacques Krynen : Autour de Philippe le Bel. La puissance et la grandeur (partie I)
C : Réflexions sur la souveraineté
AP : Pour finir, j’aimerais aborder en profondeur la réflexion que vous développez autour de la naissance de la notion de souveraineté et du vocabulaire dans lequel elle a pu s’exprimer. La défense que vous semblez conduire de l’enracinement du droit dans la loi me semble en effet corrélée à la question de la souveraineté. Or, si votre Philippe le Bel a été commenté dans la presse[1], il semble avoir été reçu comme une étude sur l’origine du complexe de supériorité français, origine qui s’enracinerait dans l’idéologie répandue par Philippe le Bel – et il est vrai que la fin de votre ouvrage, notamment les 6ème et 7ème parties, souligne cet aspect – alors qu’il me semble également que se trouve menée en parallèle une analyse de la souveraineté française, qui est au fond la forme que prend la défense du politique, et qui constitue une constante de vos écrits. Dans L’Empire du Roi, déjà, vous montriez que la condition de possibilité d’une souveraineté monarchique supposait de rompre avec la féodalité elle-même conçue comme une machine de guerre davantage tournée contre la souveraineté monarchique que contre le monarque lui-même. Je vous cite :
« La féodalité a désintégré la souveraineté monarchique, elle n’a cependant jamais songé à détruire la royauté. Les grands feudataires restent liés au roi par l’hommage et la foi. Ils les lui refusent parfois, c’est vrai. Et le Capétien n’obtient d’eux que le service qu’ils veulent bien lui rendre. Mais nul ne conteste qu’ils lui sont dus[2]. »
De là ma question : quelle place la réflexion sur la souveraineté occupe-t-elle dans vos écrits, et qu’a de singulier la souveraineté monarchique française ?
JK : Je me félicite que des commentateurs aient bien relevé que je retrace dans ce Philippe le Bel la naissance d’un orgueil français, source d’un durable complexe collectif de supériorité. C’est une originalité de mon livre mais, vous avez raison, en parallèle, j’y synthétise l’analyse de la formation doctrinale de la souveraineté que j’ai menée dans plusieurs travaux.
Chez nous, la notion de souveraineté apparaît fort clairement dans les têtes, déjà, à la fin du Moyen Age, cela par la rencontre complémentaire, à bien des égards harmonieuse, du droit romain et de la religion royale. N’oublions pas que ce droit romain fut codifié et publié par Justinien, empereur chrétien, sous l’invocation de la divine Providence !
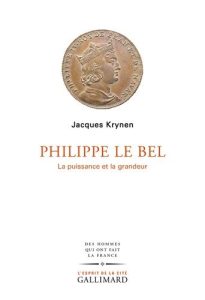
Ce droit impérial romain, étudié dans les facultés d’Orléans, de Toulouse, de Montpellier, a fourni aux théoriciens du pouvoir un réservoir de vocables expressifs de l’unicité de la puissance suprême, de son caractère impartageable et perpétuel. Tout ce qu’a écrit Bodin, le premier à systématiser la notion de souveraineté, mais certainement pas son inventeur, se trouve, relativement dispersé, sous la plume des grands juristes médiévaux, qu’il connaît bien et auxquels il renvoie expressément, on ne le dira jamais assez… Ces juristes médiévaux ont à partir du XIIIe siècle commencé d’expliquer le contenu de la souveraineté, celle du pape, celle de l’empereur germanique, celle du Capétien au moyen des termes désignant la position et les prérogatives de l’imperator antique : la majestas, l’imperium, l’auctoritas, la plena potestas, la generalis jurisdictio. Les « marques de la souveraineté » qu’expose Bodin dans plusieurs chapitres doivent tout à la théorie des iura imperialia (les droits exclusifs et inaliénables de l’empereur antique), que les conseillers et administrateurs de Philippe le Bel, déjà, brandissent régulièrement sous le nom de « droits régaliens » (iura regalia), avec, au premier rang, le monopole législatif, le pouvoir « condere legem », soit la puissance de « donner et casser la loi » comme le dira Bodin.
L’autre source propice à l’essor de la notion de souveraineté c’est, bien sûr, le droit divin de la royauté. Encore faut-il réaliser le tour spécifique qu’il a pris chez nous dans les derniers siècles du Moyen Age. C’est un leitmotiv de la littérature politique française, comment ne pas insister, le Capétien est christianissimus, il est le plus chrétien des rois de la terre, issu d’une lignée en laquelle Dieu lui-même a placé immédiatement sa confiance depuis Clovis, d’une lignée qui enfanta Charlemagne et Saint Louis. Qui met en péril la souveraineté capétienne commet un crime de lèse-majesté divine, pas seulement royale. De cette conception un certain nombre de sujets de Philippe le Bel firent les frais, y compris des évêques (Bernard Saisset, Guichard de Troyes)…
En résumé, la double nature, juridique et religieuse, du roi de France « empereur en son royaume » et monarque « Très chrétien », est venue signifier sans contredit possible son indépendance vis-à-vis des puissances étrangères aspirant à la domination universelle (la Papauté et l’Empire germanique). Cette double personnalité a d’autre part, et surtout, servi à justifier dans les frontières du royaume, vis-à-vis des sujets, son pouvoir absolu.
AP : Ce point est capital parce que si la souveraineté se dit, avant même que Bodin n’en fasse la théorie, dans un lexique latin que vous venez de rappeler, alors elle exprime la position suprême sous l’angle d’une domination, et ne se dit pas dans le vocabulaire de la politeia mais bien dans celui du pouvoir. Cela est assez marquant parce que si l’on se réfère à la pensée grecque dont Aristote est l’expression la mieux connue, il est très clair que ce que l’on peut appeler le fameux to kurion, le principe directeur, ne peut pas être souverain au sens où nous l’entendons aujourd’hui. Au sens propre, chez Aristote, c’est la politeia, la constitution anonyme qui est souveraine, qui distribue les pouvoirs et qui, par-dessus tout, signe l’indépendance de la cité à l’endroit des autres. La capacité d’un peuple à vivre indépendant suppose donc qu’il se constitue via la constitution qui n’est pas un principe d’autorité mais bel et bien d’indépendance et de distribution des pouvoirs ; en revanche, le monde latin semble indexer la souveraineté sur la question de l’autorité et du pouvoir, peut-être en raison de son aspect plus militaire. Mais alors, comment expliquer que, tout en redécouvrant Aristote, la notion médiévale de « souveraineté » ait semblé incliner davantage vers l’approche romaine ?
JK : Si Aristote, comme il me semble, n’a rien apporté de concret à l’affirmation médiévale de l’idée de souveraineté, sa Politique, ses Ethiques, jointes à la découverte de Cicéron, ont joué en revanche un rôle, capital, dans l’adossement de l’absolutisme monarchique à une éthique supérieure. Empereur en son royaume, roi très chrétien, le monarque absolu demeure soumis aux lois divines et naturelles, il gouverne éclairé par la raison, l’esprit de justice et d’équité, sans jamais perdre de vue l’utilité publique et la poursuite du bien commun. Sauf à être indigne. Les légistes, au moins autant que les théologiens, ont fait jusqu’au XVIe siècle le meilleur accueil aux avertissements fondamentaux du Policraticus, ce magnifique traité de Jean de Salisbury (vers 1150) qui dessine le portrait du roi-tyran et soulève le problème du tyrannicide.
AP : Un autre point assez marquant tient à la manière dont Bodin lui-même établit la généalogie de la souveraineté dans le chapitre VIII du livre I de La République :
« La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une République, que les latins appellent majestatem, les Grecs arkhan éonsian et kurian arkhè et kurion politeuma, les Italiens segnoria, duquel mot ils usent aussi envers les particuliers, et envers ceux-là qui manient toutes les affaires d’état d’une République. »[3]
En référant la souveraineté à ce que les Grecs appellent kurion politeuma, il élimine de fait la politeia et donc la constitution, au profit de ce que l’on peut traduire par « pouvoir suprême ». Par ce biais, rend-il explicite la volonté des siècles antérieurs telle qu’elle s’était exprimée dans l’élaboration de la souveraineté ?
JK : Oui, je le pense vraiment. Pour autant on ne sous-estimera pas la fécondité des théories médiévales de limitations de la souveraineté apparues dans la pensée ecclésiologique, prônant une papauté sous contrôle de l’assemblée des chrétiens représentée dans le concile. Ce premier constitutionalisme, (les historiens anglo-américains y ont vu la résurgence médiévale de la pensée démocratique antique), on le voit recyclé au XVIe siècle, fortement proclamé durant les Guerres de religion par les Monarchomaques de tout bord, en lutte contre le Valois. En défense de la royauté française alors très affaiblie, contre leur doctrine de la résistance légitime, Bodin compose les Six livres de la République.
AP : Un des textes qui m’a toujours intrigué est celui de Giovanni Botero qui fonde l’usage du mot Etat non suivi d’un génitif en réfléchissant sur la notion de raison d’Etat. Or, ce qui est frappant, c’est que l’on a l’habitude de présenter l’œuvre de Botero comme une réaction hostile à la pensée française, et notamment au concept de souveraineté tel qu’élaboré par Bodin, parce que Botero souhaiterait maintenir la prééminence du pouvoir papal sur l’autorité politique. Mais, on peut se demander jusqu’à quel point, en pensant la souveraineté depuis le « pouvoir suprême » et non depuis l’indépendance ou l’autonomie absolue que permet la politeia aristotélicienne, Bodin ne serait pas finalement assez proche de Botero, puisque l’un et l’autre ne semblent pas concevoir la souveraineté dans les termes de l’autonomie.
JK : Je ne sais pas trop répondre.
AP : Revenons alors à Bodin. Si l’on raisonne de manière rétrospective, il est flagrant de constater que les théories hobbésienne ou rousseauiste de la souveraineté sont des théories d’une souveraineté par nature absolue ; or, lorsque Bodin explicite le sens de la souveraineté, c’est justement cet adjectif, « absolu », dont il souhaite d’abord rendre compte :
« disons ce que signifient ces mots, puissance absolue. Car le peuple ou les seigneurs d’une République peuvent donner purement et simplement la puissance souveraine et perpétuelle à quelqu’un pour disposer des biens, des personnes, et de tout l’état à son plaisir, et puis le laisser à qui il voudra, et tout ainsi que le propriétaire peut donner son bien purement et simplement, sans autre cause que de sa libéralité, qui est la vraie donation, et qui ne reçoit plus de conditions, étant une fois parfaite et accomplie, attendu que les autres donations, qui portent charge et condition, ne sont pas vraies donations. Aussi la souveraineté donnée à un Prince sous charges et conditions, n’est pas proprement souveraineté, ni puissance absolue, si ce n’est que les conditions apposées en la création du Prince, soient de la Loi de Dieu ou de nature (…)[4]. »
Si Bodin explicite ce qui était en cours de construction depuis environ trois siècles, et conceptualise la souveraineté comme devant être inconditionnée, on comprend assez vite qu’il ne juge pas que cette souveraineté est illimitée : elle est essentiellement non partagée, indivisible et inaliénable mais elle est toutefois limitée par la loi divine, mais aussi par les « contrats » passés avec les sujets, ce en quoi la puissance absolue de Bodin paraît très éloignée de celle de Hobbes dont les accents sont plus proches de l’arbitraire du souverain. D’où la question suivante : si la souveraineté se dit Imperium chez Philippe le Bel, est-ce une souveraineté qui se veut limitée, et même encadrée au sens de Bodin, ou est-ce au contraire une souveraineté déjà en partie hobbésienne qui pourrait contenir de l’arbitraire ?
JK : Regardons comment sont structurées les ordonnances de Philippe le Bel : d’abord un préambule explicitant la juste cause de l’intervention législative du roi, et attestant une décision mûrement réfléchie, issue d’une large prise de conseil ; le pouvoir législatif royal n’est pas du tout pensé comme pouvant être arbitraire. Les formules romano-canoniques de la toute-puissance n’interviennent que dans un second temps, quand le roi déclare ordonner telle et telle chose auctoritate regia, de plenitudine potestatis et ex certa scientia. Jamais un juriste théoricien de la souveraineté au Moyen Age ne se montre partisan du pro ratione voluntas. Dans les facultés de droit, la question du Princeps legibus solutus (le Prince peut-il se placer au-dessus des lois ?) se résout généralement sur le mode thomasien : le souverain exceptionnellement le peut, de honestate, non pas de voluntate. Les légistes de Philippe le Bel ont une approche religieuse et justicière de la loi, pas seulement utilitaire. L’absolutisme législatif royal est pour ces juristes le moyen de réaliser des fins très hautes, qui ne sauraient déroger à la Loi divine et naturelle (ce n’est qu’au XVIe siècle que les juristes y ajoutent le respect des Lois fondamentales du royaume). Je ne vois rien de pré-hobbien sous Philippe le Bel. Hobbes est un esprit athée, qui désespère de son temps, son Léviathan ne fait aucune place à la Loi divine, aux lois naturelles, il tronque Bodin…
AP : Je me permets d’exprimer une réserve ; dans les chapitres XIV et XV du Léviathan, Hobbes déploie toutes les lois naturelles, présentées comme des ordres universels découverts par la raison et adressés par Dieu. A telle enseigne que beaucoup de commentateurs font remarquer que la première loi naturelle, soit l’obligation de préserver sa vie, constitue le fondement du droit naturel hobbésien (ce que conteste Leo Strauss).
En outre, les troisième et quatrième parties du Léviathan examinent la « République chrétienne » qu’il appelle de ses vœux, les conditions du salut, le rôle du Christ en tant qu’instrument du salut, et condamnent les interprétations incorrectes de l’Écriture. Il y a peut-être un « art d’écrire » dans tout cela, mais en quel sens peut-on parler d’un « esprit athée » ?
JK : Je ne sais répondre. Une confidence …: en matière d’idées politiques, le théoricien le plus tardif que j’ai étudié assez à fond, c’est Bodin[5]. Encore ne m’y suis-je livré que pour montrer l’immensité de sa dette envers les médiévaux, et considérant, après Pierre Legendre, que « le rejet des médiévaux hors de la modernité (du point de vue du discours sur le Pouvoir) demeure une extraordinaire tricherie ». Du Léviathan parcouru il y a longtemps je n’ai retenu que des bribes. Dire de son auteur qu’il est un « esprit athée » est probablement tout à fait erroné.
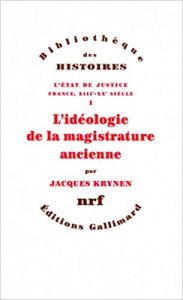
Conclusion : de quoi souffrons-nous ?
AP : J’aimerais dans ce cas finir l’entretien par un saut du monde hobbésien vers notre actualité. A rebours d’un très grand nombre d’auteurs, vous ne semblez pas considérer que l’inflation normative porte préjudice au politique ni même à la société. Dans Le théâtre juridique, vous ambitionnez de défendre la nécessité du droit et émettez de très vives réserves à l’encontre de l’idée selon laquelle il conviendrait de le simplifier et de le clarifier, demandes dont vous montrez à quel point ce sont des arlésiennes depuis Geoffroy Paris, poète contemporain de Philippe le Bel. Mais je confesse ne pas comprendre un point : pour quelle raison ce que vous appelez la « fabrique inexorable du droit[6] » légitimerait-elle d’un côté l’inflation du nombre de normes et de l’autre leur complexité croissante ? La nécessité du droit et de son évolution peut fort bien s’accompagner d’une modération quantitative et d’une clarté expressive.
JK : D’une clarté expressive, on ne peut qu’être d’accord, au vu du caractère illisible de la majorité des textes de loi contemporains. Quant à la modération quantitative, tant réclamée par les législateurs eux-mêmes, les énarques, les juges, les avocats, les médias, c’est une vue de l’esprit. Quand j’évoque « la fabrique inexorable du droit », j’entends ici par droit l’océan des textes à caractère normatif (traités internationaux, lois, décrets, arrêtés, circulaires ministérielles, règlements européens, directives européennes…). Comment voulez-vous réduire sensiblement cet océan? Ces textes sont-ils apparus pour la forme ? Pour le plaisir de démagogues ? La pure satisfaction des cabinets ? Le droit, entendu comme l’ensemble des règles obligatoires devant être sanctionnées, jaillit des revendications et des besoins profonds de la société. De cette source inextinguible naissent des fleuves inarrêtables de prescriptions normatives. Dans nos sociétés devenues complexes, instruites, industrialisées, urbanisées, communautarisées, européanisées, mondialisées, inégalitaires, souffrantes…, vous ne pouvez espérer ralentir la production normative. Qui faut-il oublier ? Que laisser tomber ? N’y a-t-il pas urgence à protéger la nature et sauver le climat ?
On devrait beaucoup plus sérieusement songer à ce que notre positivisme nous a fait oublier : le droit est avant tout « l’art du juste et du bon » (Digeste, 1,1,1). Par cette définition, les Romains ont voulu signifier qu’il ne peut être réduit à des règles. Plutôt que d’imaginer possible une cure d’amaigrissement des textes juridiques, mieux vaudrait s’inquiéter du rôle invasif de la jurisprudence, autrement dit du pouvoir normatif supérieur des cours et tribunaux.
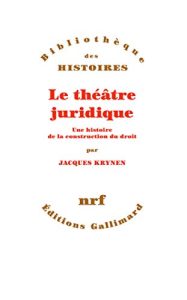
AP : Cela nous amène, pour conclure, à questionner ce que vous appelez « l’Etat de justice », mais aussi l’appréciation que vous portez sur lui. Pour autant que je vous comprenne, il me semble que « l’Etat de justice » désigne une forme d’emprise de la magistrature sur le pouvoir, dont l’Etat de droit serait une incarnation moderne et contemporaine : « L’Etat de droit dans lequel nous nous mouvons au XXIè siècle est un Etat de justice. C’est un formidable retour en arrière. La monarchie était un Etat de justice[7]. » Mais en même temps, si je vous ai bien compris, il semble que l’Etat de justice soit une réalité depuis sept siècles, sous des formes différentes, à l’exception de la Révolution française et de ses développements. Ce qui signifie que vous ne considérez absolument pas que le pouvoir des Juges soit une singularité contemporaine mais qu’il constitue au contraire une quasi-constante du système français.
JK : Par « Etat de justice », j’entends un système politique où les cours de justice contrôlent la fabrication par le pouvoir politique des normes juridiques, interprètent souverainement ses lois, en diminuent ou augmentent la portée, éventuellement les invalident. Ce qui avait été le cas sous l’Ancien Régime, l’absolutisme monarchique ne cessant de buter contre des hautes juridictions (les parlements) affichant une prêtrise juridique. C’est bien connu. J’ai voulu montrer qu’un semblable Etat de justice renaît en France dès après la Révolution et l’Empire, qui avaient tout fait pour stériliser le pouvoir de la magistrature. Au XIXe siècle, la jurisprudence, celle de la Cour de cassation, celle aussi du Conseil d’Etat commencent d’en imposer au politique, redevient source essentielle du droit français. A partir de 1970 le Conseil constitutionnel fait une mue qui le pose en censeur des volontés du législateur, quand parallèlement deux autres cours suprêmes, la Cour européenne des droits de l’Homme et la Cour de justice des communautés développent une jurisprudence obligeant chaque Etat signataire des traités. C’est vraiment un retour en arrière, sous le manteau conceptuel de « l’Etat de droit ». Car dans l’Etat de droit européen et dans l’Etat de droit national c’est le juge qui gouverne, puisqu’il préside à la création et à l’évolution du droit. Le légicentrisme n’a eu en somme quelque réalité en France qu’un temps très court, de 1790 à 1814. Pourquoi cette supériorité historique de la Justice sur la Loi ?
AP : Je voudrais approfondir cette notion. Vous prenez acte du fait que « dans nos régimes, le Pouvoir ne se rend pas tolérable s’il ne peut se maintenir sans la médiation des juges de tout acabit. » Et vous ajoutez : « Aucune philosophie, aucun dogme politique n’empêcheront jamais chez nous que ne s’exerce l’emprise de la justice sur la marche des droits, des libertés, des valeurs[8]. » Ou, pour vous citer à nouveau, « le droit sera toujours ce que prononce le Juge[9]. » De ce fait, une déploration du pouvoir des juges serait tout aussi vaine qu’abstraite car le fait est que, depuis qu’il y a un Etat, un tel pouvoir serait de fait consubstantiel à la pratique française. Mais en même temps, vous n’esquivez pas les difficultés que cela soulève, de manière générale lorsque la magistrature « veut s’exonérer de tout contrôle et de toute responsabilité devant le Souverain[10] », et de manière plus spécifique lorsque le système est démocratique car cela revient à confier de fait une part non négligeable à un corps non élu. L’Etat de justice contient ainsi des « apories[11] » que vous ne cessez de creuser. Il semble donc que vous soyez amené à considérer que l’enjeu consiste moins à éliminer l’inéliminable l’Etat de justice qu’à réfléchir ce qui en fait la légitimité. Et vous n’éludez aucune question, en particulier celle de l’élection, ce qui vous amène d’une part à établir une rapide fresque historique et d’autre part à différencier les types de juridiction. Les juges des tribunaux de commerce, rappelez-vous, sont ainsi élus depuis cinq siècles.
JK : Vous résumez parfaitement mon cheminement intellectuel. En termes moins scientifiques, je dirais que la Justice a toujours été première dans le cœur de l’homme occidental, et qu’à défaut de pouvoir l’en extraire, il faut concilier cette donnée anthropologique avec le principe démocratique. En démocratie la magistrature (le juge judiciaire, administratif, constitutionnel, européen) ne saurait œuvrer en surplomb, sans un mandat de nature politique qui l’empêche de se considérer, depuis le Moyen Age, comme une sorte de clergé.
AP : Je me demande toutefois, pour finir, si cette place inéluctable que vous accordez au juge ne vient pas d’un élément dont nous avons déjà discuté, à savoir de votre défense presqu’inconditionnée du droit, au sens où la légitimité que vous accordez par principe au droit vous conduirait à accepter non pas de facto mais bien de iure le fait que la magistrature soit conduite à devenir un « pouvoir ». Ainsi ce fait que vous semblez présenter comme presqu’inéluctable pourrait être l’expression d’une nécessité inscrite dans la défense même du droit à laquelle vous vous attelez.
JK : Au stade actuel de son évolution, ce que nous nommons l’Etat de droit ne sert pas la démocratie. Il ne fait que conforter le Juge dans une religieuse indépendance. Je rêve d’un système qui réserverait l’énonciation du droit au politique, aux élus, et confierait aux justiciables, aux électeurs, directement ou indirectement, le contrôle de sa nécessaire interprétation par la magistrature.
AP : Je vous remercie infiniment.
[1] Par exemple par Jacques de Saint Victor dans le Figaro : https://www.lefigaro.fr/livres/philippe-le-bel-l-autre-grand-roi-20221005
[2] Jacques Krynen, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIè-XVè siècle, Paris, Gallimard, 1993, p. 47.
[3] Jean Bodin, De la République, I, chap. VIII, Edition de Gérard Mairet, Paris, LGF, 1993, p. 111.
[4] Ibid., p. 119.
[5] Cf. en particulier L’Etat de justice. France XIIIè-XXè siècle, tome I, L’idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Gallimard, 2011, pp. 31-38, qui insiste sur le chapitre VI du livre IV de La République pour comprendre la formation de l’idéologie de « l’idéologie judiciaire française », ainsi que les pages 159-161, notamment le passage suivant : « Bodin reste bien l’héritier d’une tradition herméneutique propre à sa discipline. La promotion de la souveraineté de l’Etat et la primauté reconnue à la Loi n’impliquent pas chez lui se mise au pas de la magistrature, même inférieure. » (page 161).
[6] Jacques Krynen, Le théâtre juridique., op. cit., p. 374.
[7] Jacques Krynen, L’Etat de justice. France, XIIIè-XXè siècle, Tome I, L’idéologie de la magistrature ancienne, Paris, Gallimard, 2009, p. 11.
[8] Jacques Krynen, L’Etat de justice, Tome II, op. cit., p. 422.
[9] Ibid.
[10] Ibid., p. 388.
[11] Ibid., p. 416.