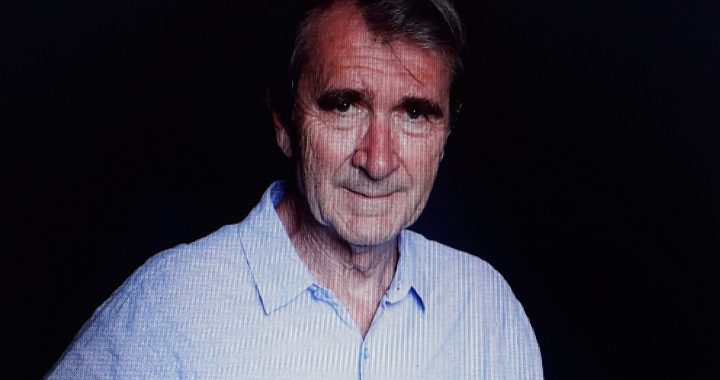Acheter Philippe le Bel, puissance et grandeur.
Acheter Le droit saisi par la morale.
Célèbre historien du droit et professeur émérite à l’Université Toulouse 1-Capitole, Jacques Krynen a consacré de nombreux écrits à l’évolution du droit médiéval, à l’émergence des publicistes et aux relations complexes entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire, dont il n’a cessé de sonder et de restituer l’idéologie. Il publie cette année un livre consacré à Philippe le Bel, ouvrage particulièrement dense croisant à de nombreuses reprises de profondes questions philosophiques sous-jacentes à l’émergence de l’Etat monarchique.
Nous remercions Jacques Krynen d’avoir accepté le principe de cet entretien et d’avoir si rapidement répondu à nos questions.
Actu-Philosophia : Jacques Krynen, vous venez de publier un passionnant et même fascinant Philippe le Bel[1] qui, à l’encontre des attaques classiques qui lui sont adressées, semble réhabiliter aussi bien l’engagement du roi dans les affaires du royaume que sa piété authentique. Si vous le voulez bien, j’aimerais orienter l’entretien vers ce qui, dans votre ouvrage, au-delà de la question historique, exprime une réflexion relevant de la philosophie politique, et donc partir de cette étude sur Philippe le Bel pour questionner les notions de souveraineté, d’Etat ainsi que les relations entre la morale, le droit et le politique. Mais avant toutes choses, j’aimerais vous interroger sur les raisons qui ont poussé l’historien du droit que vous êtes à publier une biographie politique de Philippe le Bel.
Jacques Krynen : Ce livre est une commande de Ran Halévi pour, dans la collection qu’il dirige chez Gallimard (L’Esprit de la Cité), rejoindre la série nommée « Des hommes qui ont fait la France ». Je n’avais pas jusque-là envisagé d’écrire un ouvrage sur un monarque en particulier, mais produire un essai qui, en un petit nombre de pages, détache clairement ce que le règne de Philippe IV le Bel (1285-1314) a spécifiquement et durablement imprimé dans notre histoire nationale était une proposition des plus intéressante pour un historien du droit et des idées politiques. Malgré l’éclairage des travaux érudits parus depuis Michelet, en effet, l’image commune de Philippe le Bel et de son gouvernement est demeurée associée à une dérive autoritaire de l’Etat naissant, où le spectaculaire (l’attentat d’Anagni) côtoie le tragique (la persécution des Templiers). Il m’apparaissait d’autre part que les meilleurs spécialistes de ce Capétien n’avaient pas assez fait le partage entre ce que ce règne avait de continuateur (au plan institutionnel) et d’initiateur (au plan idéologique).
En liminaire de mon livre, il m’a fallu naturellement rappeler combien ce roi, dans la voie ouverte un siècle auparavant par Philippe Auguste, a œuvré à la genèse de l’Etat moderne. Doté d’incontestables qualités, notamment intellectuelles, il a vraiment dirigé. Sans jamais subir la domination de son entourage familial et de ses grands conseillers, il a travaillé avec succès à la dilatation du domaine royal, à l’essor des services centraux, au difficile établissement de l’impôt pour le financement de ses guerres, de sa diplomatie, de l’administration centrale et locale…
Une fois ce décor planté, je me suis efforcé de mettre en relief ce qui m’apparaît être la marque la plus originale et la plus féconde de ses vingt-neuf années de règne : sous ce roi encore médiéval a été opéré un véritable modelage idéologique de la France. Par une intense propagande martelant sous tous les registres que la puissance de la royauté capétienne est incoercible, et sa grandeur incomparable, a surgi à la manière d’une certitude l’idée que ce pays est promis à un rôle supérieur. Une idée formidablement constitutive : jamais perdue à la fin du Moyen Age, on la verra réaffirmée sous les derniers Valois et la monarchie bourbonienne. Revitalisée à la Révolution, réinterprétée sous le premier et le Second Empire, elle animera notre expansion coloniale, motivera enfin l’aventure et la doctrine gaulliennes.
A : Questions morales sur le monde médiéval
AP : Le premier point qui frappe dans votre ouvrage, outre la volonté d’identifier une espèce d’envoi du sentiment français d’exceptionnalité politique, est la réhabilitation que vous proposez de Philippe le Bel et que vous étendez jusqu’à celle de Guillaume de Nogaret que, contrairement à une idée fort répandue, vous ne présentez pas comme un illuminé sanguinaire mais au contraire comme un théoricien réfléchi, conceptualisant ce que vous appelez la « surchristianisation » de la France. Vous dites à son sujet : « Toute sa carrière il a agi en homme de savoir et en doctrinaire de l’Etat[2]. » Cette défense si je puis dire de Nogaret et, par ricochet, de Philippe le Bel, me semble exprimer toute la complexité des enjeux que vous décortiquez. Tout semble indiquer en effet que se met en place une défense de l’autorité royale, fondée sur une inspiration religieuse, dont la victime s’apparente à une certaine morale, bien que la défense de l’autorité royale, investie d’une dimension religieuse ou théocratique, semble se parer d’attributs moraux. De là ma première question : peut-on dire que, pour l’époque que vous étudiez, apparaît une justification théologique d’une relativisation de la morale au profit d’une défense presque inconditionnelle du politique ? Et, si oui, pourrait-on aller jusqu’à dire que la défense du politique devient elle-même une nouvelle morale ?
JK : Les légistes, experts en droit romain, hommes cultivés, souvent très bons orateurs en plus d’être des conseillers, des juges et des administrateurs dévoués, ne forment pas vers 1300 la seule élite au service du pouvoir. En soutien des actions les plus audacieuses de Philippe le Bel (contre Boniface VIII notamment, puis contre le Temple) on voit intervenir de solides théologiens, comme Jean de Paris, qui savent exploiter Aristote aussi bien que la Bible. D’autres dominicains prennent comme lui le parti du monarque contre le souverain pontife, expliquent, ce qu’un Nogaret et d’autres légistes scandent parallèlement, que le « très chrétien roi de France » est complètement dans son rôle en entreprenant de libérer l’Eglise d’un pape tyrannique, ennemi de la France, puis en anéantissant un ordre militaro-pontifical pullulant, indique la rumeur, de moines démonolâtres et sodomites… Oui, à l’époque étudiée, chez beaucoup d’universitaires, de diplômés, pas seulement chez les hommes du Conseil du roi, la défense des actes du pouvoir royal devient une obligation de conscience, indissociablement religieuse et morale. Pour comprendre ce phénomène, il faut avoir bien égard à ce que depuis des décennies (au sein même du clergé, en témoigne l’essor des ordres mendiants) une soif de reconquête spirituelle s’était éloquemment manifestée face au relâchement des mœurs, à l’inconduite et à la cupidité affectant les divers rangs du clergé. L’Eglise continûment empêtrée dans le siècle, trop de ses cadres fournissant le pire des exemples, éclate finalement chez nombre de gens de pouvoir et (ou) de savoir cette conviction qu’il revient à la royauté française de purger cette institution de ses effroyables turpitudes. La royauté française, proclame-t-on partout, privilégiée dans les desseins de Dieu depuis le baptême de Clovis, championne de la foi depuis Pépin et Charlemagne, récemment sanctifiée par la canonisation de Louis IX (1297), ne saurait se dérober. Nogaret n’est pas seul à proclamer l’urgence de ce combat !
La dogmatique des rapports de la puissance temporelle et de la puissance spirituelle en vient alors à charrier plus que jamais des préoccupations terre-à-terre. Du côté de l’Etat, il n’est pas uniquement question de faire du clergé national un contribuable régulier. Il importe de contrôler son fonctionnement intérieur, administratif et financier. Un Pierre Dubois, simple officier royal de province, adresse même au roi des mémoires pour qu’il force la papauté à abandonner à la France la direction des finances pontificales, et qu’ainsi, par une bonne administration capétienne du patrimoine de Saint-Pierre, l’Eglise entière puisse enfin être replacée dans sa mission authentique, qui est uniquement le soin des âmes… Sur le terrain, dans les bailliages et les sénéchaussées, les juges royaux font tout pour que les tribunaux ecclésiastiques ne traitent plus aucun contentieux temporel. On ne comprend rien à la grande secousse politico-intellectuelle de l’époque si l’on ne prend pas en compte le puissant mélange d’anticléricalisme et d’antiromanisme ayant gagné bien des élites effrayées par le grand désordre moral qui règne dans l’Eglise. Quelques évêques, vers 1300, ont le courage de protester contre cet interventionnisme royal dans leurs affaires, bien sûr, mais leurs plaintes restent vaines. Comment convaincre le Pouvoir de ne pas toucher aux « libertés » et « franchises » de l’Eglise, quand du Conseil du roi jusqu’au moindre agent de la royauté l’on est convaincu du caractère supérieurement chrétien de la couronne ?
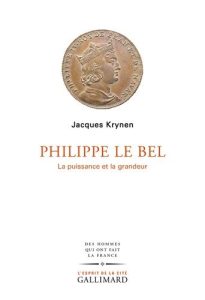
Dans la surchristianisation intellectuelle de la royauté capétienne, il ne fait aucun doute que la canonisation de Louis IX, grand-père de Philippe le Bel, a joué un rôle on ne peut plus décisif.
Saint Louis a constitué le modèle charnel, immédiat, de notre roi. La sincère et profonde piété dont a fait preuve ce dernier est bien documentée. Mais c’est le culte absolument éperdu qu’il voua à son aïeul qui s’avère plein d’enseignements. Philippe le Bel se livre à une véritable imitatio des comportements individuels de son grand-père (jeûnes, mortifications, pèlerinages, donations religieuses, dons aux églises), mais tout autant à une imitation de ses actions proprement gouvernementales (répression du blasphème, interdiction des guerres privées, enquêtes administratives et ordonnances de réforme). Sa lutte sans merci contre le pape Boniface qu’il juge (avec tant d’autres) hérétique, tout comme son horreur de « l’hérésie » templière lui sont pour ainsi dire commandées par l’exceptionnalité du sang qui coule dans ses veines. Tout se passe comme si notre roi s’était demandé à chaque difficulté comment Saint Louis aurait agi à sa place. Rappelons que Louis IX n’avait craint ni le pape ni les évêques, et que les premiers germes d’un gallicanisme royal s’étaient fait jour avec lui. Philippe le Bel veut même réussir le grand projet où son fascinant prédécesseur a échoué par deux fois : la croisade. Il prend la croix à la Pentecôte 1313, quelques mois avant sa mort accidentelle.
AP : Vous mentionnez à plusieurs reprises l’importance cruciale de Gilles de Rome (1247-1316) et de son De Regimine Principum, à telle enseigne que vous présentez Philippe le Bel comme « l’élève de Gilles de Rome ». Or, justement, ce traité subordonne toute forme d’action à une vertu théologale, la charité, qui impose de voir en son prochain non pas la particularité d’un individu mais la créature de Dieu, de sorte que l’on se demande en quel sens le politique comme domaine spécifique d’action est possible à partir de Gilles de Rome. Je veux dire par-là que l’analyse des vertus morales du Prince par la maîtrise de ses passions en vue d’agir par charité devient l’élément central, dont l’action politique n’est jamais qu’un effet dérivé. Comme vous le dites fort bien dans L’Empire du roi, à travers une formule reprise dans votre Philippe le Bel, « c’est en philosophe moral que Gilles de Rome s’adresse à son élève (…)[3]. » N’est-ce pas une manière de dire que les fondements du politique sont extérieurs au politique et n’est-il pas paradoxal de faire de ce traité de Gilles ce qui contribua à « faire accepter progressivement le phénomène de l’Etat monarchique[4] » ?
JK : Je ne partage pas votre interprétation de l’enseignement de Gilles de Rome destiné au jeune Philippe le Bel, ne voyant nulle part dominer, ou même planer, dans son fameux traité du gouvernement des rois, l’idée de charité.
C’est en aristotélicien qu’il délivre ses leçons politiques et morales, le dirigeant étant présenté comme un être de raison en charge du bien commun, seul législateur, sous le regard de Dieu, c’est implicite, mais sans aucun contrôle ni frein de nature institutionnelle. Il n’est jamais dans cet enseignement question des relations entre les deux puissances, temporelle et spirituelle, le monarque surgissant absolument souverain, « une sorte de loi vivante », médiatrice entre la loi divine et la loi humaine. Le De regimine principum est antérieur à 1285. Gilles de Rome est alors moine augustin, une des grandes figures de l’université de Paris.
Philippe le Bel a bien été « l’élève de Gilles de Rome » en ce sens que de nombreux pans de son action régnante ont jailli en étroite résonnance avec les contenus de son enseignement. Gilles de Rome n’y faisait non plus aucune allusion à la féodalité encore prégnante pourtant, qui réclamait un système de gouvernement conditionnel fondé sur la réciprocité des engagements. Comment ne pas admettre que la politique antinobiliaire de Philippe le Bel, ses interdictions des guerres privées, et même des tournois, furent débitrices de l’image de royauté pleinement souveraine que ce précepteur lui avait déroulée ?
AP : Oui mais justement, la figure de Gilles de Rome me paraît ambiguë et n’est pas sans nous réserver quelques surprises. Nous savons que le De ecclesiastica potestate (vers 1302) est rapidement apparu comme le traité essentiel dans la défense de la papauté au sein de la querelle médiévale entre le Pape et l’Empereur. Comme le rappelle Alain de Libera, « le De ecclesiastica potestate de Gilles de Rome, OESA, peut être considéré comme le véritable manifeste de la théologie politique pontificale du XIVè siècle. Fondement théologique de la Bulle Unam sanctam, il sera l’objet de multiples réfutations de la part des juristes et théologiens de Philippe le Bel[5]. » Vous-même évoquez « les violentes prises de position ultérieures [de Gilles de Rome] en faveur de la théologie pontificale[6] (…) ». N’est-ce pas justement dû au fait que dès le départ, en subordonnant totalement le politique à la morale, Gilles de Rome ne pouvait pas concevoir une autorité véritable et autonome du temporel ? Et ne peut-on pas concevoir qu’il y aurait eu comme un « malentendu » quant à la réception de son De Regimine Principum ?
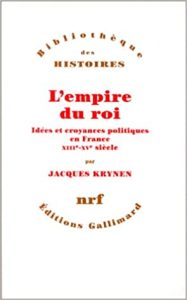
JK : Quand quarante ans plus tard il écrit pour Boniface VIII le De ecclesiastica potestate, il a changé de statut, et d’employeur, puisque le voici (depuis 1295) archevêque de Bourges (nommé par ledit pape devenu un ami). Le fait que ce dernier traité réactive avec force de vieilles lunes remontant à Grégoire VII, qu’il fonde la souveraineté universelle du Sacerdoce en invoquant la supériorité de l’âme sur le corps, ne tire pas, pour notre propos, à conséquence : Gilles de Rome devient en 1301-1302 ardent apôtre de la théocratie pontificale, mais ce qu’il a écrit auparavant pour l’éducation d’un futur roi de France, en pur philosophe et non en homme d’église, est demeuré. Aucun traité avant le De regimine principum n’avait mis en évidence la figure suréminente du rex sur la base d’une argumentation ne devant rien à l’Ecriture ni à ses commentateurs. D’où son gigantesque succès, dans toute l’Europe, jusqu’au XVIIe siècle…
AP : J’aimerais élargir le domaine de la réflexion. Si je comprends bien votre pensée, il me semble que vous êtes partisan d’un droit qui soit, ainsi que l’avait souhaité la Révolution française, né de la loi et rien que de la loi, et hostile donc à des principes abstraits ou éthérés du droit. Si vous déplorez à certains moments les excès d’un certain positivisme juridique, vous déplorez peut-être plus encore le parasitage du droit par des « principes » qui, se voulant universels, cherchent à penser le droit ailleurs que dans la loi et le font basculer dans les mystères indicibles de l’universel. Et à cet égard il me semble que la morale constitue l’une des formes que peuvent adopter les principes universels abstraits, ce que d’ailleurs vous dites explicitement dans la présentation du remarquable collectif que vous avez dirigé et intitulé Le droit saisi par la morale :
« D’abord surgi parmi les branches du droit, voici le droit européen en passe d’en devenir le tronc. Une puissante dose de sève morale y fut introduite dès le Statut qui fonda le Conseil de l’Europe, avant que la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (et ses protocoles additionnels) ne viennent consacrer juridiquement nombre de valeurs morales. Par la suite, alors que dans leurs premières versions les traités constitutifs des Communautés ont privilégié les objectifs économiques, les divers textes qui ont construit l’Europe, au premier rang les traités de Maastricht et d’Amsterdam, n’ont eu de cesse que de promouvoir des « principes », qualifiés de « fondateurs » et de « communs aux États membres ». Ces mêmes principes ont été repris plus tard sous l’appellation plus nettement morale de « valeurs », jugées « indivisibles et universelles ». Plus remarquable encore, ces valeurs ne sont pas aujourd’hui aux yeux de l’Union cantonnées à l’espace européen mais destinées à s’étendre « au reste du monde ». Dans le Traité établissant une constitution pour l’Europe, l’Union est tenue « d’affirmer et de promouvoir » ces valeurs. Ce que déjà elle fait dans les accords passés avec les pays tiers. Nous sommes bien en présence d’un droit ostensiblement porteur d’une morale en action[7]. »
Est-ce en tant que principe universel échappant à la particularité et la clarté de la loi que vous développez à l’endroit des principes moraux quelque chose comme une méfiance si j’ose dire « de principe » ?
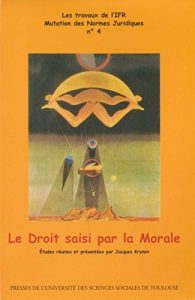
JK : Oui, une grande méfiance, du fait que ces principes « fondateurs » des traités n’ont cessé d’être déclinés par la jurisprudence des cours européennes en principes « supérieurs », formant une morale européenne extrêmement vaporeuse et plastique. La liste de ces principes sortis du crâne des quelques juges européens ne cesse de s’étendre, et ces principes s’imposent au législateur national, pas seulement aux juridictions nationales (hautes et basses). Je ne serai jamais partisan d’un droit évoluant hors sa source fondamentale : la Loi, jamais rassuré que la maîtrise de l’évolution des normes échappe au politique.
AP : Oui, et l’on voit ainsi dans vos écrits que vous cherchez à établir une sorte de pulsation des fondements du droit et, qu’à cet égard, après un retrait des principes généraux abstraits cherchant à fonder le droit, ceux-ci auraient retrouvé de la vigueur, notamment depuis l’entre deux guerres, la notion de « principe général » réactivant une sorte de soubassement moral mystérieux réactivant les principes sur lesquels s’appuyait la magistrature ancienne. De surcroît, le cadre prétorien serait favorable à l’invocation de ces principes abstraits, rendant le droit extérieur à la loi. Je vous cite à nouveau :
« Employée sans aucune précision dans le règlement de nombreux procès, placée au cœur de la motivation, la notion de « principe général » a été promue de façon totalement prétorienne par les juges en référent opposable à toutes les règles écrites susceptibles d’être invoquées. L’exhumation de « principes généraux du droit », dont toute une série d’expressions synonymes souligne le caractère infranchissable (« principe fondamental », « principe supérieur », « principe directeur », « principe essentiel »), la part de mystère qui les nimbe en tant que « source non écrite du droit » ont depuis une cinquantaine d’années bien évidemment suscité l’attention critique des auteurs de la doctrine. Comment ne pas voir que dans ce mode autonome de formulation et de hiérarchisation des normes les juges contemporains ont emboîté le pas aux anciens prêtres de la justice ?[8] »
JK : Je confirme.
B : Le temporel et le spirituel
AP : Tout en continuant de questionner les rapports de l’universel et du particulier, je voudrais quitter le terrain moral pour aborder celui de l’articulation du spirituel et du temporel, au sujet duquel j’aimerais vous soumettre deux questions.
Il y a en la matière quelque chose de troublant dans l’articulation que vous suggérez entre la foi sincère de Philippe le Bel et la conscience politique d’une mission royale spécifique. Je vous cite : « Ce que de nos jours on aperçoit bien chez Philippe IV le Bel, c’est la symbiose d’une conscience extrêmement religieuse et d’une conception on ne peut plus élevée de la mission royale[9]. » L’Eglise en tant que catholique a en effet une vocation universelle, qui certes doit s’accomplir à chaque fois dans un cadre particulier, mais en tant que le particulier exemplifie l’universel. Mais avec ce que vous appelez la « mission royale » dont Philippe le Bel serait dépositaire, on passe du particulier au singulier : quelque chose de spécifiquement français ne semble plus particulariser l’universel mais bel et bien s’imposer sui generis, de sorte que l’on peine à comprendre ce que signifie exactement la portée religieuse de l’entreprise de Philippe le Bel. Du reste, dans L’Empire du roi, vous notez un changement lexical après la seconde croisade au sujet de la paix : il ne s’agit plus de défendre la paix de Dieu mais « la paix du royaume ». Le fondement religieux de l’autonomisation du politique n’est-il pas alors un artifice ou un leurre ?
Par ailleurs, de manière générale, peut-on penser la compatibilité d’une authentique souveraineté politique et d’un fondement religieux ? Au détour d’une analyse consacrée à la redécouverte d’Aristote et à l’atténuation de l’inspiration augustinienne, vous écrivez cette phrase particulièrement significative : « L’instinct social ne réclame pas l’unité du genre humain[10]. » C’est évident chez Aristote, mais cela n’a de sens chez ce dernier que parce que le fondement du politique suppose une certaine anthropologie : les humains sont par nature des animaux politiques, et ils sont donc par nature appelés à vivre dans des cités différenciées, si bien que l’universalité de leur nature les détermine à vivre dans la particularité des cités. Or, l’anthropologie religieuse chrétienne n’inscrit pas la partition des hommes dans la vie particulière des cités mais bien plutôt dans la destination sotériologique d’une âme qui cherche à être sauvée, le politique n’étant alors que le moyen du salut. De ce fait, comment est-il possible, en pensant les hommes comme créatures de Dieu destinées au salut, de fonder une souveraineté ou une autonomie du politique sur une telle anthropologie ? Autrement dit : n’y a-t-il pas une profonde incompatibilité entre l’idée même de souveraineté politique et l’anthropologie chrétienne, telle qu’elle fut théologiquement élaborée ? Au fond, l’autonomie du temporel ne témoigne-t-elle pas d’une erreur anthropologique d’un point de vue strictement chrétien ?
JK : Ce n’est pas « l’anthropologie chrétienne » – terme trop générique à mes yeux – qui réduisit le politique à un moyen du salut, moyen placé sous l’égide de l’Eglise, mais l’augustinisme politique. L’augustinisme politique est drastiquement battu en brèche au XIIIe siècle par le développement d’un aristotélisme chrétien (ne parlons pas de l’averroïsme). Certes, des théologiens demeurent à la fin du Moyen Age foncièrement augustinistes. Ce sont d’étonnants attardés, si l’on considère les fractures au sein de la Chrétienté : dans la péninsule italienne et dans l’empire germanique le gibelinisme, en France le gallicanisme, ailleurs bientôt l’anglicanisme et le protestantisme. Dès le XIVe, conforté par le Grand Schisme, le conciliarisme proposé par de très grands théologiens secondarise l’institution papale. On voit simultanément des spirituels franciscains en divorce de l’autorité pontificale chercher appui auprès des puissances laïques. En définitive, à la fin du Moyen Age, rares sont les clercs qui ne reconnaissent pas aux Etats une dignité propre. Au XVIe siècle, les jésuites, comme Suàrez, Bellarmin, les dominicains comme Vitoria reformulant la doctrine de la théocratie pontificale sauront au fond d’eux-mêmes qu’ils militent à contre-courant.
Pour s’en tenir au royaume de France, on peut s’y montrer grand chrétien, même solide théologien, sans croire que le Capétien doive sa royauté à l’investiture ecclésiastique. Dans ce royaume, on considère dès le XIVe siècle que le sacre, cérémonie auguste, certes, ne fait pas juridiquement le roi. Dans ce royaume champion de la chrétienté militante il revient à son monarque « très chrétien » de relever l’Eglise dès lors que la papauté s’avère d’une façon ou d’une autre défaillante. Sous Philippe le Bel renaît le rêve carolingien, celui d’un Occident rassemblé sous un souverain unique, nouveau Constantin, le pape réduit à n’être qu’un ministre des cultes, les prêtres et les religieux uniquement voués à la prière et distribution des sacrements. Sous ce roi débute le processus politique d’inclusion du clergé dans l’Etat, processus consacré par le Concordat de 1516, poursuivi jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, renouvelé sous la Constituante, réalisé sous le Consulat et l’Empire. On peut dire que l’Etat, en France, dans la ligne de Philippe le Bel, aura bien eu raison de l’Eglise et soumis son clergé.
AP : De manière générale, il me semble que vous laissez entendre qu’une philosophie politique universelle est elle-même illusoire ; chaque pays semble ancré dans des traditions très particularisantes qui finissent par rendre caduque aussi bien une réflexion générale sur ce que devrait être le politique que sur le meilleur régime. Ainsi, vous insistez sur le fait que les théoriciens qui entourent Philippe le Bel élaborent bien moins une théorie générale du politique qu’une détermination des principes politiques qui ne conviennent qu’à la France seule. D’où une question peut-être naïve : croyez-vous à la pertinence d’une philosophie politique, conçue comme détermination universelle de ce qui conviendrait politiquement aux hommes ?
JK : Non, je n’y crois guère. L’esprit de l’Evangile m’émerveille, le souffle de 89 me transporte. Mais prétendre que telle philosophie politique est bonne universellement relève de la croyance, pas de l’observation. Le bonheur, la liberté, le bien commun, le droit sont et seront toujours à géographie et marche historique variables. J’adhère au relativisme d’Aristote, de Montesquieu, de Lévi-Strauss… Quoique l’universalisme (dans toutes ses expressions, antiques, médiévales, modernes) soit porteur d’enviables projets d’avenir, aucun projet ne peut avoir de place dans l’étude scientifique du passé.
Entretien avec Jacques Krynen : Autour de Philippe le Bel. Puissance et grandeur (partie II)
[1]Jacques Krynen, Philippe le Bel. La puissance et la grandeur, Paris, Gallimard, 2022.
[2] Ibid., p. 63.
[3] Jacques Krynen, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIII-XVè siècles, Paris, Gallimard, 1993, p. 183.
[4] Ibid., p. 187.
[5] Alain de Libera, La philosophie médiévale, Paris, PUF, 1993, p. 457.
[6] Jacques Krynen, L’Empire du roi, op. cit., p. 187.
[7] Jacques Krynen avant-propos, de Jacques Krynen (dir.), Le droit saisi par la morale, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1, 2005, p. 14-15.
[8] Jacques Krynen, L’Etat de justice. France, XIIIè-XXè siècle, Tome II, L’emprise contemporaine des juges, Paris, Gallimard, 2012, p. 338-339.
[9] Jacques Krynen, Philippe le Bel, op. cit., p. 17.
[10] Ibid., p. 69.