B : L’occultation du consentement
AP : Toute la première partie de l’ouvrage consiste d’une certaine manière à démontrer que le consentement fiscal est à la fois ce qu’impose la première modernité et en même temps ce qui relève chaque jour davantage d’une « illusion » ; à cet égard, la dimension contractuelle de l’impôt procède d’une entourloupe de plus en plus visible en dépit des intentions initiales. « La modernité, écrivez-vous, conduit alors à une réappropriation du consentement à l’impôt par le citoyen et à une densification de son concept[1]. » Et en même temps, si je vous ai bien lu, le développement de la modernité s’accompagne d’une occultation du consentement, ce par quoi vous retrouvez une analyse de P. Sloterdijk pour qui « si l’on devait trouver une expression compacte pour désigner l’automaticité de la main qui prend et la mentalité qui lui est inhérente, ce serait forcément « l’oubli du donneur »[2]. »
Parallèlement, vous proposez une nuance entre en distinguant consentement à l’impôt, et consentement de l’impôt. Que signifie cette nuance et quel usage en faites-vous dans votre analyse ?
HE : Cette distinction est effectivement importante et je la dois à Michel Bouvier. Le consentement à l’impôt renvoie au concept qui nous est intuitif ; il s’agit de la soumission explicite et volontaire du citoyen à la collecte fiscale, alors même qu’il pourrait s’y opposer. Le consentement de l’impôt en revanche est un consentement implicite, supposé et indirect. Il renvoie à cette phrase de Rousseau, dangereuse s’il en est, selon laquelle « du silence universel on doit présumer le consentement du peuple[3] ». Dès lors, tant que le peuple ne se révolte pas, on supposera ses représentants légitimes pour relayer son consentement à l’impôt lorsqu’ils votent des lois de finance et Bouvier ajoute que c’est sur ce second mode de consentement que les institutions françaises se sont développées. Or le silence est tout autant associé à l’homme satisfait par une décision qu’à celui bâillonné, que l’on attache sur sa chaise.
Pour attester du silence des autres, il faut d’abord que l’Etat ait des oreilles pour les entendre, ensuite que ces derniers aient une voie pour s’exprimer. Ce sont ces oreilles que le développement moderne de l’administration fiscale a coupées à l’Etat, ces voies qu’il a ôtées au peuple. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que l’on se relaie aujourd’hui pour hurler son mécontentement. Certains le font dans un mégaphone, d’autres par l’exil ou par la fraude fiscale, mais ces messages sont incompréhensibles à l’Etat qui n’y voit que des agents économiques cherchant à maximiser leur utilité au détriment de l’utilité collective. Il n’y a pas de citoyen mécontent, seulement des free riders.
Le consentement est une entourloupe et elle apparaît de plus en plus nettement quand il s’agit de consentir à des conditions d’utilisation de plateformes numériques : le consentement libre et éclairé est un fantasme au même titre que la liberté, la justice ou l’autonomie du sujet. Ce sont des illusions nécessaires qui nous permettent de vivre. Ce qui est bien réel en revanche, c’est l’émotion provoquée par une expérience interprétée comme un déni de liberté, de justice ou d’autonomie. Voilà pourquoi le problème politique que pose la fiscalité aujourd’hui n’a rien à voir avec les niveaux d’imposition : c’est un problème communicationnel. Parce qu’il y a rupture entre le paradigme à partir duquel l’impôt est pensé d’en haut et des interprétations qui lui sont associées en bas, l’impôt produit de la souffrance, c’est-à-dire de violence.
AP : Vous consacrez des pages très stimulantes au prélèvement à la source, qui fait disparaître dans l’acte même le consentement puisqu’il rend le paiement invisible.
Si le prélèvement à la source retient votre attention, l’impôt sur le revenu est abordé dans l’ouvrage selon le problème de sa progressivité, comme chez Hayek[4]. Mais l’impôt sur le revenu en tant que tel ne va pourtant pas de soi : il suppose à la fois que l’Etat ait le droit de regard sur ce que gagnent les citoyens, mais aussi de contrôle sur ces derniers, ce qui implique que les revenus ne soient pas une affaire privée mais d’emblée une affaire publique rendant d’une part le consentement individuel inessentiel, et d’autre part le contrôle des biens universel, y compris en mettant à contribution les institutions financières comme le veut par exemple le service de TRACFIN – le tout bien sûr au nom de la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme.
Dans ces conditions, si l’on peut parfaitement admettre que le prélèvement à la source « invisibilise » définitivement le consentement fiscal, ne peut-on pas en même temps penser qu’il n’introduit aucune nouveauté de principe mais achève la logique fiscale qu’exprime intrinsèquement l’existence d’un impôt sur le revenu ?
HE : L’impôt sur le revenu ne va pas de soi et le problème est qu’il semble désormais aller de soi, au point que celui qui entend le questionner passe pour un illuminé. C’est pourtant un impôt qui n’existait pas avant 1914 et qui fut voté dans un contexte très particulier (la guerre), pour un taux très faible (2%) et en dépit d’une opposition farouche représentée par Adolphe Thiers. Ce qu’il y a de grave avec le prélèvement à la source, c’est qu’il ne se contente pas d’invisibiliser le consentement mais le révoque de manière explicite et incontestable. En prétendant rationaliser les procédures de collecte de l’impôt, c’est le consentement à l’impôt que l’on supprime sous un vernis paternaliste – l’Etat entend ainsi aider les citoyens à gérer leurs revenus pour qu’ils ne se retrouvent pas en défaut de paiement lorsque retentit son glas.
Pour consentir, il faut avoir la possibilité de faire ou de ne pas faire. Ce n’est plus le cas dès lors que l’impôt est prélevé par l’employeur au nom de l’Etat, avant même que le salaire du travailleur ne lui soit parvenu. Les économistes disent que cela revient au même, s’agissant d’une somme dont le citoyen allait s’acquitter de toute manière ; ce sont ces raisonnements rationalistes qui empêchent les économistes modernes de comprendre quoi que ce soit aux logiques du social.
AP : Une autre absente de vos analyses est la Sécurité Sociale. Le financement de cette dernière est pratiquement invisible, alors même qu’il suppose des prélèvements patronaux et salariaux considérables, dont le salarié ne s’acquitte pas directement en dépit des 22 % de prélèvements sur son salaire brut. Pourquoi ne pas avoir analysé l’exemple si délicat du consentement au financement de la Sécurité Sociale, qui constitue dans l’économie de votre ouvrage un cas pourtant idéal d’invisibilité du prélèvement sur les revenus ?
HE : Vous avez raison, il faut lever le voile ! Aujourd’hui, un employé célibataire en CDD qui coûte 7 000€ à son employeur reçoit un salaire brut de 4 500 €, soit 3 500 € après cotisations sociales et 2655 € après impôt sur le revenu. Mettons qu’il paie un loyer mensuel de 1 000 €, le reste de son revenu servira à payer des biens et des services taxés à hauteur de 20%, soit 331 € de TVA. Sur un revenu de 7 000 €, l’Etat ponctionne donc 4 676 €, soit 67% : c’est énorme !
Je présente l’ensemble de ces contributions dans le livre, résumant les arguments des uns et des autres au sujet de la proportionnalité ou de la progressivité de l’impôt, des contributions sur les richesses ou sur les revenus et des taxes incitatives ou punitives sur les comportements de consommation. J’ai toutefois choisi de ne pas me positionner sur ces débats, d’abord parce que d’autres l’ont fait avant moi, ensuite parce qu’il ne me semble pas que ce soit ici que se trouve la question la plus pertinente. Il ne s’agit pas de s’écharper pour décider qui taxer et comment, mais de remarquer que derrière les disputes, les taxes se sont multipliées dans leurs formes et que leurs nombre, autant que leurs montants, ont cru de manière exponentielle au cours des cent dernières années. En s’y habituant, on s’interdit de penser une société différente dont les solutions aux problèmes passeraient par des voies différentes de celle de l’impôt pour financer des mesures étatiques qui, pourtant, conduisent rarement aux résultats brandit pour les justifier.
C : Le triomphe du rationalisme ou la victoire du saint-simonisme ?
AP : La deuxième partie de votre ouvrage est consacrée à ce que vous appelez « le triomphe du rationalisme », qui envisage une transformation des sociétés et de l’homme bien au-delà de la question fiscale. Un peu à la manière d’un James Burnham vous montrez le développement conjoint, aussi bien dans les blocs socialiste que « capitaliste », d’une idéologie organisationnelle visant des fins « scientifiquement établies », appelant une technocratie et sa cohorte bureaucratique. En convoquant des textes de Lénine de 1920 célébrant l’arrivée des technocrates, des ingénieurs, des administrateurs, vous montrez que l’organisation scientifique du travail et de la société constitue un idéal aussi bien soviétique que « capitaliste », et vous faites appel à Harold Berman, professeur de droit américain et spécialiste du droit soviétique, pour décrire ce changement comme le passage d’un Etat de rule of law à un Etat de rule by law. Pouvez-vous expliciter le sens de ce changement ?
HE : La pensée rationaliste s’est imposée ; c’est un état de fait autant qu’un état de siège pour ceux qui entendent rendre compte du monde selon d’autres schémas de pensée. Du contractualisme rationnel de Hobbes à la théorie de la décision rationnelle de Leonard Savage et John von Neumann jusqu’aux agents artificiels que l’on modélise aujourd’hui pour battre mes champions d’échec et de Go, c’est à une même anthropologie que l’on se réfère. L’homme est imparfaitement rationnel dit-on aujourd’hui, aussi faut-il l’aider à « corriger ses biais ». On croirait entendre ici des formules tout droit tirées d’une œuvre de George Orwell, et pourtant, ce sont des propos banalisés parmi les chercheurs en intelligence artificielle.
Le passage du livre auquel vous faites référence s’appuie sur les réflexions d’Alain Supiot dans son excellent livre La Gouvernance par les nombres. Ce qu’il y montre avec cette référence à Berman, c’est le passage d’un Etat organisé par l’obéissance à une loi d’hommes, une loi politique décidée par eux et à laquelle ils acceptent plus ou moins de se soumettre, à un système organisé selon des lois mécaniques. Cette substitution révèle un fantasme qui n’a cessé de croître à mesure que la société se mécanisait : celui de dissoudre l’homme dans les rouages d’un système pour en évacuer toute subjectivité.
AP : Oui ; au fond la « subjectivité » n’est désormais plus pensée que comme le lieu du biais…
A de nombreuses reprises, vous évoquez la « desessentialisation de la loi » consécutive au changement analysé dans la question précédente. On comprend ce que devient la loi, à savoir « l’instrument organisationnel d’une société mécanique, réduisant le droit à une manuel de procédures. En d’autres termes, il s’agit de désessentialiser la loi, de la vider de sa substance pour lui soustraire le projet de société qu’elle incarne afin d’en faire une loi première, au même titre qu’une loi normale[5]. » Mais quelle serait alors l’essence normale de la loi ?
HE : Quelle belle formule vous avez là ! Je me suis laissé un peu emporté par la vision de Supiot, qui est un juriste, car il faudrait mieux parler ici de signification que d’essence. La loi est une construction humaine ; ce qui compte, c’est la signification qu’on lui attribue et plus encore que cette signification nous soit commune, qu’elle nous aide à cohabiter pacifiquement pour trouver un sens dans nos existences. Comme tous les instruments d’auto-transcendance du social, la loi est un subterfuge dont la valeur se jauge à ses effets. Celui qui lui reconnaît un sens fort dans une perspective rousseauiste se donne les moyens de trouver un sens dans la vie en société. Mais du moment que la loi devient celle d’un système dont on cherche à nous faire accepter qu’il émane de la nature elle-même des hommes et du monde, elle plonge les individus dans une profonde détresse. Ce n’est pas le type de loi qui est ici en cause – qu’il s’agisse d’une loi politique rousseauiste ou d’une loi systémique des mécanistes cybernéticiens – mais le fait que ce changement provoque un double bind. La crise de la modernité, c’est la lente digestion d’une promesse non tenue, l’effet produit lorsque les hommes prennent conscience que l’autonomie du sujet annoncée par les Lumières et sa possibilité de devenir tout ce à quoi il aspire est une illusion.
AP : Vous citez un texte de Lénine de 1928 voulant que « la société tout entière ne soit plus qu’un seul bureau, un seul atelier. » Plus encore, vous citez un passage d’Engels tiré de l’Anti-Dühring et qui, décrivant la fin de l’Etat avec l’avènement d’une société socialiste, retrouve une formule fort célèbre :
« L’intervention d’un pouvoir d’État dans des rapports sociaux devient superflue dans un domaine après l’autre, et entre alors naturellement en sommeil. Le gouvernement des personnes fait place à l’administration des choses et à la direction des opérations de production[6]. »
La formule d’une substitution d’une administration des choses au gouvernement des personnes fait évidemment écho au saint-simonisme, et reprend littéralement celle de Prosper Enfantin souhaitant remplacer le gouvernement des hommes par l’administration des choses. Pourquoi dans ces conditions ne pas avoir évoqué le saint-simonisme comme idéal structurant du « rationalisme » et de la dépolitisation au profit de l’« organisation » prétendument scientifique de la production et de la vie humaine ? Pourquoi le saint-simonisme est-il absent de la deuxième partie de votre ouvrage comme cadre conceptuel interprétatif de ce qui y est décrit ?

HE : Votre critique est tout à fait justifiée car je n’évoque effectivement le saint-simonisme qu’une seule fois. Vous me pardonnerez alors une réponse qui ne peut être que décevante : par souci de concision. Les références à Lénine et Engels sont également brèves car il me semble que ce sont des choses relativement admises de nos jours, aussi ai-je préféré développer des exemples des conséquences concrets de ces visions, dans les réformes et les pratiques administratives.
AP : Passons alors des textes théoriques à la pratique. Comment interpréter la nature des organisations internationales et européennes ? En tant qu’organisations, sont-elles des symptômes de visées organisationnelles, jugeant possible de déterminer « scientifiquement » des objectifs précis, indépendamment du politique ?
HE : En principe sans doute, en pratique certainement pas. Les administrations nationales comme internationales dans lesquelles ces structures se déploient visent toujours à établir une forme de système cybernétique ; un système dans lequel des informations remontent des branches à la cime pour formuler des mesures, lesquelles répondent d’objectifs précis et sont assorties de critères de performance. Le flux continu d’informations sert ensuite à suivre en continu l’atteinte des objectifs et à adapter les mesures selon des boucles de rétroaction. On retrouve ici l’esprit du système soviétique et, comme pour ce dernier, ce sont les logiques de pouvoir qui ont pris le pas sur l’esprit du système. Les institutions internationales sont avant tout, comme Supiot l’a bien vu, des mécanismes de pouvoir et de soumission. C’est par des prêts aux pays en développement que la Banque mondiale contraint ces derniers à ouvrir leur économie et à s’engager dans des mesures économiques servant les objectifs prônés par certains Etats.
Les institutions européennes sont quelque peu différentes en ceci qu’il y eu, dès les débuts de l’Union Européenne, une volonté d’unification politique et identitaire. C’est de cela que répond la monnaie unique, alors même que la Zone euro n’était pas une zone monétaire optimale au sens des économistes : la mesure était donc bien politique et non économique. Lorsque différentes institutions sont en concurrence pour gouverner une population, cette dernière peut en tirer profit. J’ai ainsi soutenu ailleurs que l’Europe des technocrates, tant décriée par les populistes, pourrait bien être un atout pour les peuples européens, en vue de limiter l’augmentation du pouvoir que les Etats prennent sur leurs populations[7].
AP : De manière générale, partagez-vous avec Hayek l’analyse selon laquelle il est justement impossible d’un point de vue scientifique de déterminer les fins optimales que devrait viser une société complexe ? Et est-ce là le motif de votre vif scepticisme à l’endroit des politiques incitatives jouant sur le levier fiscal en tant qu’elles présupposent la connaissance possible d’objectifs souhaitables à atteindre ?
HE : Tout dépend de ce que l’on appelle scientifique. S’il y a une science de l’homme, je pense qu’elle est à trouver dans le paradigme girardien, à savoir dans la dynamique du désir mimétique et le mécanisme sacrificiel du bouc-émissaire. Les approches que l’on dit scientifiques aujourd’hui renvoient trop souvent au scientisme, désormais décrié par des mathématiciens philosophes à l’instar d’Olivier Rey ou de Dupuy ; ce sont des pratiques très éloignées des ambitions originelles de la science, au point qu’elles en sont venues à se prendre elles-mêmes pour but, perdant au passage le sens des connaissances qu’elles entendent produire.
Il n’y a pas de mal à vouloir gouverner par des incitations plutôt que par la coercition ; c’est même une voie plutôt salutaire et je pense que des approches comme le nudge ou la captologie constituent un futur désirable des techniques de gouvernement. Le problème des politiques fiscales incitatives, c’est qu’elles se fondent sur une conception erronée de l’homme comme agent rationnel, qu’elles contribuent à rationaliser les individus par leur caractère performatif et qu’elles prennent pour but la santé économique d’un pays plutôt que la santé mentale de ses habitants.
D : Propositions fiscales
AP : Venons-en à la troisième partie de votre ouvrage qui avance des propositions pour retrouver le sens de l’impôt via le retour du consentement et, peut-être plus encore, de la place de la volonté dans le consentement. C’est pourquoi émerge une proposition en faveur du volontariat fiscal, que vous appelez « don démocratique ».
AP : Est-ce que vous retrouvez sur ce point les propositions de Sloterdijk défendant une contribution civique volontaire ?
HE : Sloterdijk met les pieds dans le plat et il faut l’en remercier. Il fait exister une réflexion dans l’attention collective, ce qui réouvre l’espace des futuribles à une époque où l’on s’est résigné à un fatum fiscal. Ce n’est pas parce que la société fonctionne aujourd’hui ainsi qu’il ne pourra en aller autrement. Dans cette voie, il faut le suivre et aller plus loin que lui, car Sloterdijk se contente d’ouvrir une porte sans la franchir. Il est convaincant quand il parle de volontariat, mais ne propose pas de système concret et pragmatique qui permettrait de mettre en œuvre le changement qu’il appelle de ses vœux. C’est ce que j’ai tenté de faire dans cette troisième partie.
AP : Comme Sloterdijk, vous considérez qu’une « éthique du don » suppose une réhabilitation du thymos, de l’honneur et de l’orgueil, qui inverserait « la logique néo-féodalisante de l’isolationnisme galopant des petits-bourgeois[8]. » Le retour du thymos est-il possible lorsque le soubassement idéologique général s’apparente à l’utilitarisme ? Autrement dit, votre solution est-elle compatible avec la racine profonde des « instincts » actuels ?
HE : Très clairement non. C’est pour cela qu’il faut changer la société, pour qu’elle se rende capable d’un système politique dans lequel l’impôt serait de plus en plus consenti plutôt qu’imposé. Nous ne sommes pas utilitaristes, nous le sommes devenus parce que c’est ainsi que la société nous a éduqué. Mais ni l’argent, ni l’utilité (quoi que cela veuille dire) ne sont des fins en soi. L’homme ne recherche l’enrichissement et les postes en vue que parce que l’on en a fait les supports sur lesquels la symbolique du prestige social a été projetée. Ce que l’homme cherche, c’est la reconnaissance des autres : d’un seul, d’un petit groupe, ou de toute la société. C’est sur cette symbolique, dont il nous appartient de choisir les supports, que réside notre pouvoir de transformation du social et, si ceux qui contribuent le plus au financement des services publics venaient à en tirer une reconnaissance sociale, la question du consentement serait alors résolue. Sloterdijk parle du thymos et je le suis dans cette perspective, mais je pense de plus en plus que c’est l’empathie qu’il faut chercher à développer au premier chef.
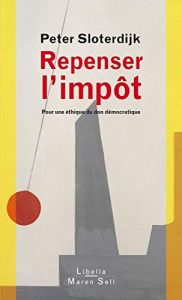
AP : Mais pour changer la société, ne faut-il pas instaurer une sorte d’ingénierie sociale que par ailleurs vous semblez déplorer ?
HE : Je déplore le paradigme rationaliste à partir duquel l’ingénierie fiscale est pensée, mais les individus sont toujours modelés par les structures sociales qui organisent leurs interactions. Il faut penser ces structures à partir d’une anthropologie véritable et leur donner pour but la réalisation des hommes plutôt que la maximisation de moyens. L’impôt est un moyen pour l’Etat mais il doit aussi participer d’une fin pour les individus.
AP : Vous proposez une sorte de célébration publique des donateurs qui honorerait les cent plus généreux de ces derniers.
« La cérémonie du don démocratique doit être un rituel et non un sacre ; elle doit personnifier le don sans le personnaliser. Le riche est ainsi célébré au moment du don en tant que personnage incarnant une élite pécuniaire dont il ne fera surement plus partie après l’acte, ne comptant plus parmi les cent premiers[9]. »
On peut se demander si cette solution est authentiquement politique et si elle ne consiste pas bien plutôt à recycler une forme de charité – qui n’a rien de politique – dans les canons contemporains de l’organisation, de sorte qu’une vertu théologale réinterprétée organisationnellement se substituerait à une approche politique de l’impôt.
HE : L’approche que je suggère n’est sans doute pas la bonne ; c’est une proposition qui invite à être itérée. La charité me pose toutefois problème en ce qu’elle n’implique pas une reconnaissance de l’autre comme un égal. Parmi les trois grands principes de l’impôt, on trouve celui de la non contrepartie directe et il est problématique car il faut bien une contrepartie qui soit d’un autre ordre. Il ne s’agit pas de verser un impôt dont on choisirait l’utilisation, mais d’arriver à faire en sorte qu’en cédant une partie de sa richesse à l’entreprise commune, le contribuable en retire immédiatement une forme de satisfaction, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. En somme, le problème de l’impôt n’est pas à chercher dans ses quotités mais dans sa symbolique, telle qu’elle est interprétée par le citoyen ; il ne faut pas parler de justice mais d’affect. Toutes les institutions politiques se délitent, de la monnaie à l’autorité de l’Etat, du respect de la loi à l’efficacité de la justice, et c’est cela que Girard avait bien compris. Les institutions sociales reposent tout entières sur la confiance des citoyens et c’est cette confiance qui s’est structurellement érodée, conduisant Pierre Rosanvallon à parler de « société de défiance ». L’historien analyse les nouvelles institutions qui en ont émergé, mais la société ne peut se maintenir par des structures qui reposent sur la défiance.
[1] Ibid., p. 24.
[2] Peter Sloterdijk, op. cit., p. 55.
[3] Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social (1762), présenté par B. Bernardi, Paris, Garnier-Flammarion, 2011, p. 50.
[4] Cf. Hayek, Constitution de la liberté, Traduction Raoul Audouin et Jacques Garello, Litec, 1994, p. 306, sq.
[5] Le cens de l’Etat., op. cit., p. 100.
[6] Engels, L’anti-Dühring, Editions sociales, Paris-Moscou, 1973, p. 160.
[7] Hubert Etienne, « L’impôt européen au défi du consentement fiscal », postface de Jean-François Boudet, Droit fiscal européen comparé, Bruxelles, Bruylant, 2021.
[8] Le cens de l’Etat, op. cit., p. 200.
[9] Ibid., p. 215.








