La première partie de l’entretien se trouve à cette adresse.
B : Nicolas de Cues et le De Visione Dei.
AP : Venons-en maintenant au De Visione Dei. Dès les premières lignes de l’introduction, vous dites qu’il s’agit de « l’œuvre la plus belle du Cusain »1 ce qui appelle deux questions : une première, générale, consiste à vous demander ce qu’est une belle œuvre en philosophie. Levinas, dans ses entretiens avec Philippe Nemo, emploie cette épithète pour qualifier le Phèdre de Platon, mais comment entendez-vous la beauté d’une œuvre ? Et, de manière subséquente, en quel sens le De icona est-il une « belle œuvre » ?
HP : Si une belle œuvre est, comme dit Aristote dans son Éthique à Nicomaque, une œuvre achevée à laquelle on ne peut rien ajouter ni enlever, on peut dire que le De Icona est une œuvre belle, car elle est formellement parfaite, et la plus belle parce que la plus achevée des œuvres de Nicolas de Cues. Mais elle n’est pas la plus importante. La plus importante demeure, sans doute, le De docta ignorantia. Si la beauté est la splendeur du vrai, selon la formule de Platon évoqué par Levinas dans les entretiens que vous citez, et si la vérité est ce que définit Nicolas de Cues comme étant la « précision absolue », alors on ne peut parler de « l’œuvre la plus belle » que si elle approche le plus la précision absolue et, en ce sens, elle demeure inachevée, car la précision absolue – qui est l’égalité parfaite de l’unité avec elle-même – ne se trouve pas dans le monde multiple de l’inégalité et demeure inaccessible. Dans cette perspective, rien n’est beau qui ne peut être encore plus beau. Quand je dis, donc, du De icona qu’elle est « l’œuvre la plus belle » du Cusain, j’émets une opinion personnelle, je ne parle pas le langage de Cues qui est déjà celui de Kant, en quelque sorte, lequel parle du sublime (sub-limina), c’est-à-dire de ce qui demeure en deçà d’une limite infranchissable, au-delà de laquelle le beau en soi reste inaccessible et resplendit de ce côté-ci par son absence.
AP : Dans votre introduction, vous développez également le thème de la « coïncidence de l’acte de créer et d’être créé »2 en vous appuyant sur la communication de l’être de Dieu à toutes choses. Puis, poursuivez-vous, Nicolas de Cues distingue Dieu comme créateur de Dieu « au-delà de l’acte de créer et de ce qui est créé. »3. Comment l’acte de créer et d’être créé peuvent-ils coïncider et comment Dieu peut-il à la fois être créateur et ne pas l’être ?
![]()
HP : Le lexique du créé, auquel recourt Nicolas de Cues est tributaire des distinctions de Scot Érigène énoncées dans son Periphyseon : « ce qui n’est pas créé et qui crée » (Dieu comme origine du monde multiple); « ce qui est créé et qui crée » (Les idées) ; « ce qui est créé et ne crée pas » (l’homme) ; « ce qui n’est pas créé et qui ne crée pas » (Dieu comme terme du retour de tout ce qui est à l’Un). L’expression « créer et être créé » correspond selon cette nomenclature aux idées, c’est-à-dire aux formes et par extension à la Forme des formes, c’est-à-dire à l’Intellect, auquel Eckhart identifie Dieu. L’apport de Maître Eckhart s’ajoute à l’héritage érigénien et l’enrichit en lui donnant un sens nouveau. Pour Eckhart, Dieu est Intellectus : il est parce qu’il intellige, il n’intellige pas parce qu’il est, comme il dit dans ses Questions Parisiennes. Le primat revient, dès lors, à l’intellect. L’intellectus surgit du fond sans fond de l’Un qui se retire dans son inintelligibilité : il se retire – quand l’intelligence s’éveille – au-delà de l’intellect. Nicolas de Cues ne distingue pas Dieu comme « créateur » et Dieu comme « au-delà de l’acte de créer et de ce qui est créé » : il distingue Dieu, identifié à l’intellect, à un pur surgissement ou manifestation, et la Déité, identifiée à l’Unité une et nue, qui se retire dans la pureté de son néant au moment même où Dieu se manifeste au monde. Cette manifestation est aussi retour sur soi, dans la mesure où l’Intellect est Forme des formes. Créer signifie se manifester et en ce sens intelliger, c’est-à-dire voir. Dieu se manifeste pour être vu et voir en étant vu. Mais alors, il devient captif. Nietzsche en tirera l’ultime conclusion en assumant cette captivité dans son Zarathoustra : « Ô grand astre ! Quel serait ton bonheur, si tu n’avais pas ceux que tu éclaires ? / Depuis dix ans que tu viens vers ma caverne : tu te serais lassé de ta lumière et de ce chemin, sans moi, mon aigle et mon serpent. / Mais nous t’attendions chaque matin, nous te prenions ton superflu et nous t’en bénissions ».
AP : Un autre élément, lié au précédent, a retenu mon attention : vous insistez à de nombreuses reprises sur le fait que « l’étant créé rend Dieu visible en se voyant lui-même comme étant vu par Dieu. La vision de l’étant par Dieu et la vision de Dieu par l’étant sont une unique vision, un seul œil. »4 Que signifie concrètement cette reprise de la célèbre proposition de Maître Eckhart selon laquelle l’œil dans lequel je vois Dieu est le même œil que celui dans lequel Dieu me voit ?
HP : Dieu en tant qu’Unité absolue ne peut se dédoubler en deux manières de voir : une pour se voir et une autre pour voir ce qu’il voit. En voyant les choses, il se voit lui-même voyant les choses. Mais le regard de l’Icône est captif, il ne voit que s’il est vu. Voir et être vu se confondent et ils se confondent en une unique vision. Or, Dieu est pure vision. Theos, dit Nicolas en recourant à une étymologie d’origine stoïcienne utilisée par Scot Érigène, vient de theoro qui signifie « je vois » et « je cours ». Dieu est vision et « crée » ce qu’il voit en étant vu. Il n’est pas un Être subsistant en soi et pour soi, l’Esse subsistens de l’Aquinate séparé et indépendant du monde créé. Il est vision et il n’y a pas de vision sans être vu.
AP : Le génitif « de Dieu » dans « vision de Dieu » doit-il être alors entendu dans son sens subjectif, objectif, ou dans les deux sens simultanément ?
HP : Les deux sens du génitif se rejoignent ici dans la mesure ou « voir » et « courir » se confondent avec ce qui se communique. Créer c’est se communiquer, comme voir c’est courir et parcourir du regard. L’agir prend le dessus. Une dynamique est mise en place qui est celle de la manifestation. Dieu advient comme vision en même temps que vu, alors que la Déité se retire dans l’« invu » – pour utiliser un néologisme de Jean-Luc Marion dans « La croisée du visible », si je me souviens bien – de son unité pure et nue.
AP : Agnès Minazzoli avait traduit Icona par « tableau » ; vous préférez, comme souvent, rester au plus près du mot original en choisissant le terme d’ « icône ». Pour quelle raison préférez-vous le terme d’ « icône » à celui de « tableau » ?
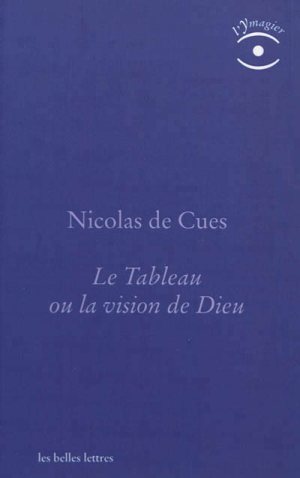
HP : En premier lieu, pour la raison que donne Nicolas lui-même dans son Compendium (16) où il renvoie expressément au « De Icona ou De visione Dei ». En deuxième lieu, parce que l’icône est tout entière dans son regard qui transcende le cadre dans lequel le tableau s’enferme. Ce dernier capte et arrête le regard de celui qui le contemple et le fixe sur lui-même, alors que le regard de l’icône ouvre une perspective et donne vie à celui qui le contemple en unissant son regard au sien. Le tableau est représentation, l’icône est présence expérimentale qui révèle ce qui est vu comme ce qui voit.
C : Nicolas de Cues et le néoplatonisme
AP : Passons maintenant, si vous le voulez bien, au contenu de la philosophie de Nicolas de Cues. Ma question est peut-être, là aussi, un peu trop vaste, mais elle me semble importante. Qu’est-ce que la philosophie du Cusain a à nous apprendre aujourd’hui ? Je veux dire par là : peut-elle échapper à un moment daté de l’histoire de la philosophie pour nous enseigner philosophiquement une (ou plusieurs) vérité(s) atemporelle(s) ?
HP : La philosophie ne se réduit pas à son histoire, elle la transcende en quelque sorte en ravivant de génération en génération un questionnement sans cesse renaissant, après être rentré dans un long sommeil ou enseveli dans une masse de réponses inadéquates. Ce questionnement, sans lequel la philosophie ne vaudrait pas une heure de peine, est celui du sens de l’existence d’où doit suivre un art de vivre qui échappe à l’absurde et réponde au désir universel de bonheur. Car tous « les hommes veulent être heureux même ceux qui vont se pendre », comme dit Pascal. Il n’y a pas, à mes yeux, de plus grand échec pour le philosophe que de renoncer à la recherche du bonheur. La recherche devient alors intransitive, on cherche pour chercher : la seule vraie trouvaille était qu’il fallait se contenter de chercher et on a appelé cela liberté. Le chemin devient le but. Telle est l’issue sans issue de la philosophie d’inspiration hénologique, pour laquelle l’Un est ineffable et inaccessible parce qu’il se confond avec le non-être. L’intelligence reste sans objet et le sujet sans complément d’objet. Cela débouche sur une sorte de quiétisme universel. Le quiétisme soutient la doctrine de « l’amour pur » : l’amour n’est pur que s’il n’est pas motivé, c’est-à-dire intéressé, par l’être aimé ; de même la « bonne volonté », pour Kant : elle est bonne à condition de ne rien vouloir de bon. Telle est l’hénologie négative véhiculée par le néoplatonisme qui triomphe à la Renaissance, plongeant la philosophie dans l’histoire, c’est-à-dire en la rendant captive d’une « époque », comme celle du nihilisme apophatique qui domine de nos jours.
AP : Si vous avez consacré à Maître Eckhart un passionnant ouvrage5, vous n’avez pas, à ma connaissance, écrit de livre sur la pensée de Nicolas et ce nonobstant de substantielles introductions qui ouvrent toutes vos traductions. Un ouvrage sur la pensée du Cusain est-il prévu ou en préparation ?
HP : Oui, après Maître Eckhart, le Procès de l’Un, je travaille à un Nicolas de Cues, l’Un sans l’Être, qui constitueraient à vrai dire les deux volets d’un triptyque dont le troisième volet serait intitulé L’Être en tant qu’Être où je poursuivrai une discussion avec la pensée contemporaine.
AP : En attendant, donc, ce Nicolas de Cues, l’Un sans l’Être, nous pouvons d’ores et déjà noter que, dans vos introductions aux œuvres traduites par vos soins, se dessine une lecture très précise, rattachant la pensée du Cusain aux spéculations d’origine néoplatonicienne sur l’Un et son rapport avec l’Être. Dans l’introduction de la Chasse de la sagesse, vous rappelez cette interprétation en ces termes :
« La pensée cusaine demeure dans la sphère essentialiste du néoplatonisme pour lequel le Noûs, surgissant du fond sans fond de l’Un, avant de s’identifier à la Forma formarum eckhartienne telle qu’elle sera reprise par Nicolas, précède et accompagne ce qui est. Les essences des choses sont antérieures aux réalités créées. »6.
Cette lecture avait été proposée déjà par Maurice de Gandillac qui, dans sa monumentale étude consacrée à Nicolas avait, dès l’avant-propos, noté « la parenté évidente avec le Néo-platonisme, avec les Spirituels rhénans. »7 Et le même Gandillac avait attiré l’attention sur l’homologie entre la première hypothèse du Parménide et la réflexion cusanienne sur l’Un supra-essentiel, ainsi que sur l’importance du Commentaire du Parménide de Proclus pour Nicolas8. Puis-je alors vous demander quel est votre rapport à la lecture que Gandillac avait proposée du Cusain ?
HP : Je dois beaucoup à la lecture de Maurice de Gandillac, que j’ai eu le plaisir de rencontrer à Louvain-la-Neuve. C’est un défricheur, il fut le premier universitaire – avec Edmond Vansteenberghe – à se rendre compte de l’importance de l’œuvre du Cusain et à attirer l’attention sur lui, comme en témoigne son gros œuvre sur la philosophie de Nicolas de Cues et ses traductions. Il a mis en avant la filiation néoplatonicienne de la pensée du Mosellan et sa profonde originalité : l’influence conjuguée de Proclus et Denys, l’héritage de Maître Eckhart et de la mystique rhénane qui ont contribué à approfondir la conception cusaine de l’Unitrinité. Cela m’a permis de découvrir à quel point cette option hénologique se révèle être fondamentale, par delà l’œuvre de Nicolas. Elle se révèle être à mes yeux à l’origine de la philosophie moderne du sujet qui s’accompagne, pour parler comme Heidegger, de l’oubli inexorable de l’être, en phase avec la problématique que je développe sur le rapport entre l’Un et l’Être qui, je pense, constitue la question fondamentale de la philosophie.
AP : La question du Parménide est centrale dans votre interprétation. Pourriez-vous rappeler ce que sont les deux premières hypothèses du Parménide et le rôle que vous leur attribuez dans la pensée du Cusain ?
HP : Le Parménide de Platon est d’une importance décisive pour toute l’histoire de la philosophie. Si l’ensemble des neuf hypothèses font en quelque sorte système, les deux premières constituent un point de départ du néoplatonisme en particulier. Elles révèlent le primat accordé à l’Un sur l’Être. Si l’Un est un, nous dit la première, il n’est pas. Si l’Un est, il est tout le multiple, il ne peut donc être l’Un pur et nu, nous dit la seconde. Dans un cas comme dans l’autre, il n’est jamais question de savoir si l’Être est et s’il est un. Ce que j’appelle l’hénologie négative consiste précisément à mettre l’accent sur la négation de l’être. Il est aisé à partir de là de comprendre l’affirmation de Lévinas selon laquelle « l’être est le mal », il empêche en effet l’Un (le Bien) d’être un en s’ajoutant à lui ! Il est de trop pour la pureté de l’Un. Cela nous éloigne de Cues, mais apparemment. Car, pour ce dernier, le monde est un reflet multiple de l’Un diffracté, ou comme dit le Cusain « contracté ». Chaque un est solitaire dans le monde de la séparation et de l’inégalité. Il n’est pas étonnant de voir se développer une conception atomiste et monadologique. L’être introduit la multiplicité, la « multiplication des seuls », selon un mot de Valéry. Aussi, ne s’agit-il pas pour chaque un de sortir de la solitude, mais de sortir de l’être, afin que l’Un soit Un et unique.
AP : Une question m’intrigue toutefois qui prend deux directions : la première porte sur le nombre des hypothèses. Pourquoi privilégier régulièrement les deux premières hypothèses et ne pas envisager les autres dans l’interprétation du Cusain ? Et par ailleurs, la convocation du Parménide a-t-elle une valeur exclusive ou est-elle compatible avec d’autres sources explicatives en faisant appel à une plage historique plus étendue ?
HP : La référence au Parménide a une valeur théorique, non historique. Je viens de le dire, les deux premières hypothèses sont un point de départ de tout le néoplatonisme et, plus particulièrement, la première : l’Un n’est un que s’il n’est pas. Ce point de départ, pour parler avec un accent nietzschéo-heideggérien, est à l’origine d’une dérive qui a entraîné la pensée humaine au nihilisme.
AP : Il est des cas où la lecture hénologique paraît absolument incontestable, mais d’autres où je dois avouer que je suis plus réservé. Par exemple, dans le chapitre II de La Docte Ignorance, Nicolas évoque la science maxima de l’ignorance, et définit le Maximum. Je cite :
« J’appelle Maximum ce qui est tel que rien ne peut être plus grand [quo nihil maius esse potest]. Or, la plénitude convient à ce qui est un. C’est pourquoi l’Unité [unitas] – qui est aussi Entité [quae est et entitas] – coïncide avec la Maximité [coincidit maximitati]. Mais si une telle Unité [talis unitas] est absolue et totalement en dehors de toute relation et contraction, il est manifeste que rien ne s’oppose à elle en tant que Maximité absolue [maximitas absoluta]. »9
La définition du Maximum rappelle celle par laquelle Anselme définit Dieu – quelque chose de tel que rien de plus grand ne puisse être conçu – mais elle embraye aussitôt sur l’Unité qu’elle identifie à la Maximité. Ce qui est le plus grand est donc Un de sorte que, par sa suprématie même, l’Unité soit affranchie de toute relation, positive ou négative ; l’Unité n’est relative à rien, elle est absolue, en-soi, elle est absolument grande. Or, vous y voyez, si je vous comprends bien, la deuxième hypothèse du Parménide, la dyade où l’Un-qui-est se distingue de la « Monade de l’Un sans l’être de la première hypothèse. »10 Mais n’est-ce pas plutôt la première hypothèse qui est ici en jeu, celle de l’Un pur, absolu, précisément non relié à l’Être, et plus précisément non relié à la contraction de l’Univers ? Je soulève cette question car il me semble que, parfois, il n’est pas aisé de déterminer à quelle hypothèse du Parménide nous avons affaire.
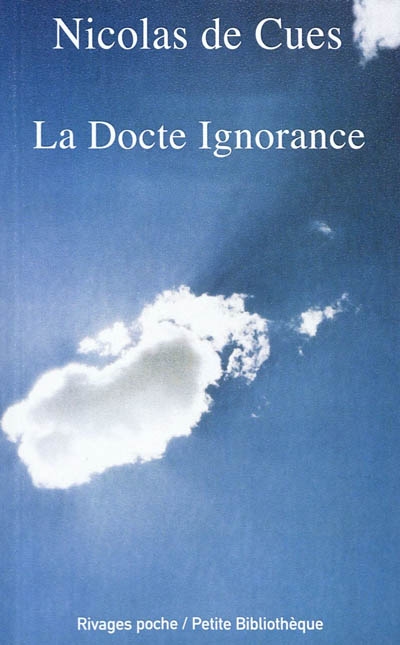
HP : Nous sommes toujours en hénologie, dès lors que le Maximum est l’Un au sens de ce qui ne peut être plus grand. Il ne s’agit pas ici d’une grandeur quantitative, c’est-à-dire de ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. En ce sens, l’Un est un infini négatif, c’est-à-dire ce au-delà de quoi il n’y a plus rien. Nous sommes bien devant l’Un de la première hypothèse du Parménide. Nicolas de Cues le distingue de l’infini privatif désignant l’univers qui est l’image contractée c’est-à-dire déterminée de l’Un, mais déterminée sans limites fixes et, par conséquent, comme étant ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. Nous sommes devant, d’un côté, l’infini comme totalité et, de l’autre, devant l’infini comme ouverture. Une analyse plus approfondie montrerait que cette distinction recoupe la distinction entre les deux premières hypothèses du Parménide.
AP : Si l’on élargit la réflexion, quel gain philosophique la notion d’Un apporte-t-elle à celle de Dieu ? Et peut-on dire de l’Un qu’il est un nom de Dieu ?
HP : L’Un n’est pas, il est sans nom. Le nommer serait le déterminer. Or, l’Un est indétermination pure. Il est in-fini, non limité. Le déterminer serait le nier, car ce serait ajouter à son unité et du coup la détruire. La meilleure définition qu’on peut lui donner, à la suite d’Eckhart, est : negatio negationis. L’Un nie ce qui le nie, en premier lieu : l’être. Innommable, il ne saurait nommer Dieu. Le seul nom propre qui pourrait être donné à Dieu est Être, dans la perspective selon laquelle Dieu ne saurait s’identifier à l’Un impersonnel. Car dire l’Être est, qu’il est un, ne lui enlève ni ne lui ajoute rien qui puisse compromettre sa pureté d’acte d’être. C’est parce qu’il est, qu’il est un, ce n’est parce qu’il est un qu’il est. Autrement dit, l’unité est une perfection et une richesse pour l’Être, alors que l’Être est une imperfection pour l’Un.
Moins qu’un gain philosophique apporté à la notion de Dieu, je dirai que c’est la conception trinitaire du Dieu chrétien qui constitue un gain pour l’hénologie cusaine. Nicolas définit l’Un comme unitrine. C’est là un apport essentiel. Dès la Docte Ignorance, il parle d’unitas, d’aequalitas et de connexio. L’unité de l’Un n’est pas l’unitas initiale, sans vie, inodore et sans saveur, mais le résultat d’un retour auto-constitutif de soi. La définition de la vérité inspirée des mathématiques, comme précision absolue, permet de considérer l’Un comme Egalité. Mais l’Aequalitas creuse entre l’Un et l’Un une distance qui doit être comblée par le geste de la Connexio qui est retour sur soi. Car, l’Un ne peut verser dans le Non-Un. Ainsi, l’identité de l’Un avec lui-même, au contraire de l’unitas initiale est un résultat, elle prend vie. L’Un apparaît comme auto-constitutif de soi. On perçoit ce qu’a d’original et de fondateur cette doctrine qui prolonge, en l’ordonnant, la conception eckhartienne de Dieu comme naissance. On la retrouvera dans la philosophie dialectique de l’idéalisme allemand. Que l’on pense à la dialectique fichtéenne du Moi et du Non-Moi : elle se calque exactement sur la dialectique de l’Un et du Non-Un, en dehors de toute perspective d’un Esse per se subsistens aucunement menacé par le Non-Être.
Suite et fin de l’entretien à cette adresse.
- De Visione Dei, op. cit., p. 9
- Ibid., p. 17
- Ibid.
- Ibid., p. 16
- Hervé Pasqua, Maître Eckhart, le procès de l’Un, Paris, Cerf, 2006
- Introduction à Nicolas de Cues, La chasse de la sagesse, op. cit., p. 24
- Maurice de GANDILLAC, La philosophie de Nicolas de Cues, Paris, Aubier, p. 6
- Rappelant la grande probabilité que Nicolas ait possédé assez tôt le commentaire du Parménide par Proclus, Gandillac considéra que l’influence la plus nette de Platon (le Parménide) se faisait sentir dans le traité De principio, pris pour un sermon et publié comme Tu qui es. Cf. Maurice de GANDILLAC, « platonisme et aristotélisme chez Nicolas de Cues », in XVIème colloque international de Tours, Platon et Aristote à la Renaissance, Paris, Vrin, 1976, p. 7-12
- Nicolas de CUES, La Docte Ignorance, I, 2, 5, Traduction H. Pasqua, Paris, Payot, 2011, p. 50-51
- Ibid., note 3, p. 50








