Etienne Bimbenet est maître de conférences à l’Université Jean Moulin, Lyon III. A l’occasion de la sortie chez Gallimard de L’animal que je ne suis plus il a fort aimablement accepté de donner un entretien au site Actu-Philosophia ; qu’il soit ici remercié pour l’accueil qu’il a réservé à notre demande, et pour la grande disponibilité dont il a fait preuve. Propos recueillis par Thibaut Gress
A : Anthropologie et philosophie
Actu-Philosophia : J’aimerais partir, pour cet entretien, d’une référence à vos écrits antérieurs, notamment à ce livre consacré à Merleau-Ponty, intitulé Nature et humanité. Le problème anthropologique dans l’œuvre de Merleau-Ponty1 Dès le début, donc, la question anthropologique est, pour vous, centrale et ma question sera donc la suivante : est-ce Merleau-Ponty lui-même qui vous a donné l’envie de creuser ce problème anthropologique, ou était-ce une préoccupation inaugurale que vous aviez souhaité traiter chez Merleau-Ponty en particulier ?
Etienne Bimbenet : C’est clairement une préoccupation « inaugurale », comme vous dites, autrement dit une préoccupation ancienne et qui n’a cessé de m’accompagner depuis que j’ai fait le choix de la philosophie. Je me souviens de certaines lectures d’enfant, comme par exemple le fameux Singe nu, de Desmond Morris. Ce fut un véritable best-seller, à la fin des années soixante. L’auteur nous expliquait preuves à l’appui, dans un mélange assez british de science, d’humour et de provocation, que nous ne descendons pas du singe, tout simplement parce que nous en sommes un nous-même…Donc pour répondre à votre question : j’ai délibérément « choisi » Merleau-Ponty en pensant qu’il constituerait un bon outil théorique pour approfondir la question de notre origine animale, et du propre de l’homme. L’année précédente, en DEA, j’avais traité du « Statut biologique de l’homme chez Aristote » – donc toujours la même question, mais sur un auteur scientifiquement un peu « daté », si bien que j’avais alors volontairement cherché qui, au XXème siècle, s’était montré suffisamment ouvert à la recherche scientifique de son époque pour offrir des réponses crédibles aux questions que je me posais.
AP : Une des constantes de votre œuvre me semble être de chercher à cerner le sens de l’homme, sans pour autant adopter une perspective humaniste ; en d’autres termes, l’homme constitue votre objet fondamental de recherche, mais il n’en constitue pas pour autant l’objet de votre admiration. Ainsi, dans l’ouvrage que j’ai cité, écriviez-vous ceci : « La possibilité d’une anthropologie proprement philosophique se mesure sans doute à la puissance d’interrogation qu’un tel discours entend préserver, aussi bien face aux énoncés positifs engrangés par les sciences que face à la réserve de certitudes sans questions dont nous pourvoit si souvent l’humanisme. » Et vous ajoutiez aussitôt : « Une anthropologie se définirait comme philosophique lorsqu’elle accepterait de faire reposer l’ensemble de ses assertions sur le sol, inquiétant pour tout savoir, d’un questionnement fondamental – lorsqu’elle accepterait de confronter les certitudes de la science ou du dogme à la démesure philosophique de l’étonnement. »2 Je trouve pour ma part cette définition très belle mais en même temps elle appelle deux questions dont voici la première : en quel sens peut-on associer, comme vous le faites plus ou moins explicitement, l’humanisme à un dogmatisme ?

EB : C’est simplement une décision, de type heuristique. Il y a mille façons d’être humaniste ; mais il y en a une dans laquelle je ne me reconnais pas parce qu’elle est d’allure pré-darwinienne, c’est celle qui consiste à postuler dogmatiquement une nature humaine éternelle. C’est elle que je vise ici. Il est vrai que peu de gens soutiendraient aujourd’hui une telle thèse. Nous sommes pour la plupart officiellement darwiniens, donc sincèrement convaincus de notre origine animale. Pourtant je pense que l’idée d’une « nature humaine » pérenne reste largement opératoire chez la plupart d’entre nous, sur un mode implicite ou inconscient. L’être humain, nous le « précomprenons » d’une certaine manière, comme dirait Heidegger ; nous le préjugeons éternellement ou nécessairement humain, quand toute la paléoanthropologie récente nous apprend le contraire. Il y a à cela, sans doute, des raisons anthropologiques profondes, qu’il faudrait préciser. Il appartient peut-être à l’être humain de se réfléchir humain, dans ses manières de dire ou de faire, donc de projeter en avant de soi une certaine image immuable de l’homme. Mais une telle image peut être anthropologiquement efficiente tout en étant scientifiquement fausse. C’est pourquoi il revient aujourd’hui à la philosophie de nous apprendre à voir autrement l’humain, loin d’un « humanisme de droit divin », comme disait Merleau-Ponty.
AP : Par ailleurs, si l’anthropologie philosophique ne se laisse pas ramener à la science, elle doit toutefois connaître cette dernière puisqu’elle doit s’y confronter. L’anthropologie philosophique peut-elle alors avoir raison contre la science positive ?
EB : La science fournit à la philosophie un ensemble de faits et de lois susceptibles de donner à penser, comme peut le faire tout autre fait directement tiré de notre vie. Au même titre que notre expérience vécue, elle offre au philosophe la matière première de ses élaborations conceptuelles. Il n’est donc pas question de penser contre la science, mais plutôt à partir d’elle et même, d’une certaine manière, le plus possible : car ce matériau est riche, indéfiniment explorable, et souvent fascinant ; je pense par exemple au recueil des observations primatologiques, ou à l’enquête paléontologique sur nos origines. Pour autant une science n’est jamais exempte de présuppositions qui guident implicitement ses démarches, et jusqu’à la manière dont elle configure son objet. C’est pourquoi la philosophie lorsqu’elle recueille les conclusions d’une enquête positive ne peut le faire qu’avec une « pensée de derrière », et donc en prenant un recul critique à l’égard de ces présuppositions. La phénoménologie connaît par cœur, ou par droit de naissance, cette idée qu’il faut suspendre tout le pré-savoir qui structure la science, et ce non pas pour révoquer en doute cette science, mais au contraire pour l’agrandir, en la rendant plus lucide à l’égard d’elle-même. Merleau-Ponty constitue à cet égard un guide précieux. Il a pris par exemple tout ce qu’il pouvait prendre à la psychologie expérimentale de son époque, mais sans méconnaître en même temps le problème que pouvait poser l’objectivisme de cette psychologie. C’est exactement l’attitude que je m’efforce d’avoir à l’égard de la psychologie cognitive d’aujourd’hui. Parce qu’elle fait office de paradigme dans l’investigation sur les comportements vivants, on la trouve partout à l’honneur, nous disant l’essentiel de ce qu’il y a à connaître en éthologie animale, en psychologie de l’enfant, etc. Mais cette connaissance se doit en même temps d’être réfléchie, c’est-à-dire consciente du fait que le point de vue objectif, abordant le psychisme comme un manipulateur d’informations objectives sur le milieu objectif, n’est qu’un point de vue parmi d’autres possibles en psychologie. Cette dernière doit rester ouverte, en particulier pour accueillir le point de vue subjectif de la signification : quelle signification a pour l’animal tel événement ; qu’est-ce que cet événement « lui fait » ; c’est le type de questions que la phénoménologie entend poser avant de s’interroger sur ce que cet événement est en soi ou objectivement.
AP : J’aimerais alors effectuer une transition vers votre nouvel ouvrage, publié en 2012, et intitulé d’une fort belle manière l’animal que je ne suis plus3 Ma première question, toujours dans la lignée de la précédente, portera sur cette affirmation à la fois forte et sans doute propice à discussions : « Bien sûr, l’homme fut un animal ; et pourtant il ne l’est plus. Il est « privé » de son origine animale, au sens que Heidegger donnait à ce terme : vivant avec elle, et pourtant sans elle. Cela signifie d’une part que le naturalisme est vrai, et qu’il nous est interdit définitivement de rêver d’impossibles idoles métaphysiques, ou de survenances mentales non vérifiables. Mais la continuité du fil généalogique qui nous relie à l’animal n’empêche pas le saut qualitatif : il nous faut reconnaître une différence de comportements radicale entre l’homme et l’animal. »4 Sans doute beaucoup trouveraient-ils à redire quant au fait que vous ratifiez comme une évidence – le « bien sûr » – la perspective naturaliste, qui n’est ainsi plus une hypothèse mais présentée comme une vérité apodictique. N’aurait-il pas fallu être plus prudent et adopter une sorte de ruse du type : « faisons comme si le naturalisme était vrai », ou quelque chose dans ce genre ?
EB : Je pense qu’il faut absolument distinguer ici entre deux types bien différents de naturalisme. Le naturalisme dont je parle ici est de type ontologique : nous sommes de part en part des êtres de nature, parce qu’évolutivement issus de l’animal et transformés selon des voies qui ont nécessairement dû se révéler concluantes au plan adaptatif. Même une « exaptation », d’une certaine manière, est une adaptation ; la vie peut improviser des comportements sans utilité biologique immédiate, cela n’empêche que cette improvisation fut elle-même, à l’origine, motivée biologiquement. En ce sens je pense que nous restons de part en part naturels, c’est-à-dire naturels jusque dans nos distances prises à l’égard de la nature. On peut envisager un naturalisme « de la seconde nature », pour reprendre l’expression du philosophe analytique John McDowell 5. Un tel naturalisme est à distinguer en revanche d’un naturalisme de type épistémologique. Ce dernier consisterait plutôt à appliquer au phénomène humain les procédures et les méthodes issues des sciences de la nature – comme si ces sciences étaient les seules possibles, et les seules à pouvoir nous dire ce que nous sommes ; comme si les sciences humaines n’avaient pas inventé d’autres procédures, et construit un autre type d’intelligibilité sur le phénomène humain. Donc pour répondre à votre question, je pense qu’on peut être naturaliste sans être réductionniste ; on peut penser l’homme depuis la nature sans méconnaître, sous l’effet d’une décision méthodologique préalable, la spécificité du « culturel », par exemple, à l’égard du naturel.
AP : Mais ce qui m’intéresse est ailleurs : si l’on adopte une telle perspective a priori, que reste-t-il réellement à penser ? Que dire de philosophiquement fécond si la question de la nature humaine est d’emblée résolue ? Autrement demandé : la « différence de comportement » que vous évoquez entre l’animal et l’homme est-elle réellement décisive ?
EB : En fait la décision « a priori » dont vous parlez ne veut pas être clôturante. Elle parie au contraire sur l’idée d’une nature accueillante à toute transformation et à toute nouveauté, comme peuvent l’être par exemple la physis aristotélicienne, ou encore la vie chez Bergson. Mais encore une fois, cela implique de ne pas réduire la nature ainsi entendue à une explication mécaniste ou nomologique des phénomènes.
B : Questions de méthode
AP : Pour mener à bien votre enquête, vous proposez d’adopter une méthode phénoménologique dont vous dites très bien quelles pourraient en être les vertus. Là encore, je vous cite : « L’essentialisme de la phénoménologie est ce que la science ne peut ou ne veut pas voir, et dont il est à cet égard crucial de défendre la légitimité. Il est, en quelque sorte, le bien propre de la philosophie, et plus exactement d’une philosophie qui, comme la phénoménologie, décide de forger une méthode qui ne serait pas celle des sciences de la nature. »6 Pourriez-vous expliciter une telle différence ?
EB : La méthode propre à la phénoménologie c’est la description, en un sens particulier : décrire, c’est rendre compte de ce qui m’est donné, donc de ce que j’expérimente en première personne. Et c’est exporter cette méthode dans la connaissance d’êtres comme les animaux, dont je sais par avance qu’ils vivent ce qu’ils vivent, qu’ils en ont une expérience propre. À la différence de l’éthologie animale ou des différentes formes de psychologie, à qui il arrive souvent d’être « descriptives » en ce sens, la phénoménologie décide de l’être toujours et systématiquement. Or en investissant ainsi le terrain subjectif de l’expérience vécue, la phénoménologie rencontre inévitablement un type de phénomènes que le savoir empirique ou en troisième personne ne peut pas rencontrer, le phénomène de l’idéalité. Est idéal au sens husserlien ce qui se maintient identique à soi en ses différentes apparitions– ce qui est nécessairement le même, quand tout événement empirique au contraire peut toujours ne pas être, ou être autrement qu’il n’est. Une connaissance empirique ne rencontrera jamais du nécessaire, mais toujours du contingent. En réalité on ne « rencontre » pas le nécessaire, on y prétend, par un acte subjectif qui est un véritable coup de force – la visée d’un absolu au-delà de tout ce qu’on peut factuellement rencontrer dans l’expérience. Prenons un exemple. Il n’y a rien de nécessaire dans le visage empirique qu’a pris notre humanité. Le pouce opposable en fait partie, mais rien n’empêche d’imaginer des hommes qui en seraient dépourvus. Dès qu’on « décrit » notre humanité, en revanche, tout change : car il nous faut bien alors restituer la manière dont nous nous « visons » ou « présumons » humains, avant toute rencontre effective. Il se trouve que notre humanité fait droit de manière idéale ; et même si le contenu de cette idéalité varie de peuple à peuple, même si la reconnaissance de ce contenu est empiriquement fragile (requérant éducation, pédagogie, vigilance, etc.), lorsqu’il est question d’humanité c’est toujours à une humanité subjectivement prétendue qu’on a affaire. Voilà par exemple ce qu’il faut être phénoménologue pour voir en face.

AP : La phénoménologie semble donc, dans votre propos, pouvoir traiter de ce que, habituellement, la philosophie de l’esprit considère comme son objet. Or, le fait d’adopter une perspective phénoménologique sur cette question anthropologique revient à délégitimer la philosophie de l’esprit dans ce domaine ; que reprochez-vous concrètement à cette dernière ?
EB : Il est difficile de prendre en bloc la philosophie de l’esprit contemporaine. Elle est vivace et infiniment diverse ; il serait étrange de la ramener à un courant unifié et homogène de la réflexion sur « le corps et l’esprit ». Si en revanche on la pense depuis son paradigme fondateur (la redéfinition de l’esprit ou du « mental » en termes de représentations cognitives), si on la réduit à ce qu’elle doit à ce paradigme de départ, alors on peut stigmatiser un certain nombre de manques récurrents, dans les recherches en cours. Pour le dire d’un mot, emprunté une fois de plus à Merleau-Ponty : on a le sentiment que règne ici, d’une façon souvent ininterrogée, la « pensée objective ». Ce qu’on décrit de la vie animale ou humaine, c’est l’ensemble des informations dont l’organisme dispose sur son environnement objectivement donné. Mais en ceci on présuppose qu’un environnement est « objectivement » accessible à tout vivant ; comme s’il suffisait d’être ouvert sur cet environnement pour y collecter des informations « objectives ». On sait bien pourtant que vivre c’est toujours anticiper et informer le donné depuis les possibilités fonctionnelles et les dispositions affectives du sujet percevant. En ce sens l’objectivité ne peut être que construite, et d’une certaine manière gagnée « contre » une forme de partialité initiale. L’objectivité que le cognitivisme contemporain postule au départ de la vie est à cet égard un préjugé qui mériterait d’être interrogé et critiqué, et ce depuis l’idée que vivre, c’est d’abord vivre « pour soi » et « à partir de soi ».
AP : si je comprends bien, la phénoménologie permettrait, contrairement à la philosophie de l’esprit, au moins de décrire plus fidèlement l’expérience vécue, d’une part et, d’autre part, de déterminer un concept éidétique de notre humanité.
EB : Oui, c’est à peu près ça. Et les deux, comme j’ai essayé de le montrer, sont inséparables : seul un sujet vivant peut « prétendre » à du nécessaire ; et donc il n’y a d’eidétique (d’exhibition du nécessaire) que pour une description en première personne.
AP : Est-il absolument nécessaire que le concept éidétique de l’humanité soit déterminé à partir de ce que l’on peut phénoménologiquement décrire de l’animal ? Cette relativité du concept est-elle, aujourd’hui, un incontournable pré-requis de la démarche anthropologique ?
EB : Pour tout dire ce n’est pas « absolument » nécessaire, non. On peut parfaitement imaginer par exemple une anthropologie d’un point de vue théologique – l’homme mesuré à Dieu, plutôt qu’à l’animal. Et c’est ainsi du reste que l’homme s’est pensé pendant des siècles. Mais je dirais que c’est plutôt historiquement nécessaire, ou imposé par une certaine « époque » du savoir. Nous vivons aujourd’hui à l’ombre de Darwin ; l’idée que nous descendons de l’animal implique de redéfinir de fond en comble notre image de l’homme. Or une fois que nous avons intégré à notre réflexion sur l’être humain son origine animale, on ne voit pas comment il pourrait être question de faire sans. Notre origine animale, et donc une réflexion anthropologique du point de vue animal, sont donc devenues nécessaires. Sauf à rater beaucoup, il nous faut désormais penser l’être humain sur fond d’animalité passée ; c’est un tout nouveau paysage intellectuel qui s’ouvre à nous.
AP : Dernière question concernant la méthode, si vous le voulez bien : à vous lire, il apparaît que le problème inhérent à la différence anthropologique ne semble pouvoir être résolu que dans « une pensée structurale seule capable, apparemment, d’articuler d’un côté l’ « adhérence indubitable de l’homme à la nature, au sein de laquelle il apparaît sans faire exception à ses lois », et de l’autre le « caractère d’ « étrangeté » que revêt l’existence humaine par rapport à l’existence de tous les autres vivants ». »7 On comprend ce que désigne l’anthropologie structurale, mais pourriez-vous expliquer ce que signifie précisément « structural » dans le présent cas, et éventuellement le lien qui pourrait en être fait avec ce que vous identifiiez déjà en 2004 comme étant l’anthropologie structurale de Merleau-Ponty dont vous disiez que « le thème anthropologique que met en place La Structure du comportement veut être compris dans le prolongement exact de la philosophie de la forme et s’apparaître comme une véritable « anthropologie structurale ». »8 ?
EB : Oui, c’est en effet un point important, directement issu de ma thèse sur Merleau-Ponty, et plus exactement de ma lecture de La Structure du comportement. Dans cet ouvrage Merleau-Ponty entendait en effet élaborer une véritable « philosophie de la forme », capable de donner un sens systématique et rigoureux aux résultats de la Gestaltpsychologie. Cela passait en particulier par cet énoncé anthropologique récapitulé à la fin du troisième chapitre : la vie humaine représente une nouvelle « structure de comportement », dont tous les aspects sont organiquement interdépendants. Ainsi nous pouvons hériter de la nature l’essentiel de nos comportements ; mais ceux-ci une fois intégrés dans l’univers humain de la culture et du langage en reçoivent un sens nouveau. Tout est naturel en l’homme, mais tout y est culturel en même temps ; les notions de structure, et avec elle les notions connexes d’intégration ou de sublimation, permettent d’assumer tout à la fois une inscription de l’homme dans la nature, et en même une spécificité radicale de l’humain. C’est ce que Merleau-Ponty appelait dans son ouvrage le « double aspect de l’analyse qui, en même temps, libérait le supérieur de l’inférieur et le “fondait” sur lui » 9. Une anthropologie « structurale » en ce sens précis connaît tout ce que l’homme reçoit de son animalité passée, mais en même temps toutes les transformations qu’une structure de comportement totalisante peut imprimer à cet héritage. Elle conjoint la continuité et l’effet de seuil, le naturalisme et la « seconde nature ».
AP : Que peut apporter Lévi-Strauss, que vous citez fréquemment, à l’élucidation d’une telle anthropologie ?
EB : En réalité le mot « structure » tel que je l’emploie à la suite de Merleau-Ponty n’est en rien redevable à « l’analyse structurale » de Lévi-Strauss. D’un côté une modélisation organique largement infléchie par la Gestaltpsychologie de l’École de Berlin (Wertheimer, Köhler, Koffka) et la biologie philosophique de Goldstein ; de l’autre une modélisation linguistique héritée de la phonologie de Jakobson et Troubetzkoï. Si Lévi-Strauss joue un rôle dans mon ouvrage, c’est donc « par la bande », d’une manière qui contourne la question de la méthode structurale. Fort heureusement l’anthropologie sociale de Lévi-Strauss ne se réduit pas à cette méthode, qui est à mon avis ce qui a le plus mal vieilli dans cette anthropologie. Par exemple toute l’analyse de la prohibition de l’inceste dans Les Structures élémentaires de la parenté, et la relecture du phénomène du don impliquée par cette analyse, voilà typiquement ce qu’on peut autonomiser et considérer comme indépendant du binarisme de Jakobson, c’est-à-dire non fondé sur lui.
C : Continuité ou exception ?
AP : Il m’a semblé lire, à plusieurs reprises, un certain nombre de remarques consacrées à la question de l’exception humaine et de sa contestation, notamment chez Jean-Marie Schaeffer dont le livre sur La fin de l’exception humaine avait fait grand bruit[cf. Jean-Marie Schaeffer, La fin de l’exception humaine, Gallimard, 2007 ; cf. Notre [recension. [/efn_note] Or, à la fin de l’introduction, sans contester le naturalisme qui est votre point de départ, vous n’adoptez pas pour autant la thèse d’une continuité absolue et écrivez ceci : « A trop prendre le parti de la continuité contre celui de l’exception, à s’obnubiler du piège métaphysique, on risque tout simplement de rater ce qu’une transformation hominisante peut avoir de radical. (…). N’ayons pas peur : nous n’avons aucunement affaire ici à un arrière-monde, nul esprit divin ne vient survoler les eaux. L’homme est devenu lui-même par un dépassement sur place de l’animalité, par une « désanimalisation » qui n’a jamais puisé à d’autres sources que celles de la vie elle-même. »10 Pourriez-vous indiquer très précisément le lieu de votre désaccord avec les métaphysiques naturalistes, incarnées en France, entre autres, par Schaeffer ?
EB : Ce qui était très frappant dans l’ouvrage de Jean-Marie Schaeffer, et assez symptomatique du naturalisme que vous évoquez, c’est qu’on s’y trouvait constamment mis en demeure de choisir entre deux options extrêmes et au fond intenables : soit vous étiez ouverts à ce que dit la biologie évolutionniste, et alors vous ne pouviez pas croire à une « exception humaine » ; soit vous teniez à une telle exception, mais parce que vous étiez resté incurablement dualiste (l’esprit au-delà du corps), voire théologien (l’homme créé unique à l’image du dieu unique). Donc soit la science, soit l’obscurantisme. On posait d’entrée de jeu et avant tout examen qu’une différence anthropologique radicale ne pouvait être que métaphysique et contraire à la science : difficile dans ces conditions de croire encore à un propre de l’homme, ou à une différence profonde entre l’homme et l’animal. Or je pense qu’on a affaire à un véritable dogmatisme. Considérer que la différence d’homme à animal est nécessairement comparable à la différence qui sépare les espèces vivantes les unes des autres, c’est prendre pour mesure une différence de part en part biologique ; c’est d’emblée « biologiser » la question. De fait il est frappant de voir que c’est chaque fois la biologie, de la génétique à la primatologie en passant par les différentes éthologies animales, qui est convoquée quand est réfutée l’idée d’un propre de l’homme. Or une comparaison digne de ce nom ne devrait-elle pas être rigoureuse et « équitable », en s’instruisant aussi bien du côté biologique que du côté humain ? Les sciences humaines (psychologie de l’enfant, psycholinguistique, psychanalyse, sociologie, histoire, etc.) n’ont-elles rien à nous dire d’intéressant sur l’humain ? N’ont-elles pas, au XXème siècle, incroyablement enrichi et affiné notre vision de l’humain ? Il y a là une véritable pétition de principe, contraire à toute forme de rigueur intellectuelle.
AP : S’il est nécessaire de ménager une place à un discours phénoménologique, c’est donc que le naturalisme ne dit pas tout de l’homme : comment alors concrètement, dans le cadre de votre propre démarche, traiter les connaissances biologiques, que faire par exemple de la neurophysiologie ?
EB : Le naturalisme « épistémique » ne dit pas tout de l’homme car il se documente du seul côté des sciences de la nature. Tout le problème est là. En soi il n’est pas faux, mais seulement incomplet ou unilatéral. Il faudrait s’habituer à le faire dialoguer avec un autre type de discours, celui qui est à l’œuvre du côté des sciences humaines ou de la psychologie. Comprendre, interpréter, décrire : autant de démarches qui créditent l’expérience vécue d’une logique qui n’est pas celle, nomologique ou causale, des sciences de la nature. Je vais prendre un exemple exagérément simpliste, mais assez révélateur. Vous pouvez aborder « de l’extérieur » le phénomène politique, comme le font souvent Frans De Waal ou, en France, Pascal Picq ; vous pouvez pointer le caractère agonistique des échanges, et les envisager comme un combat de primates pour la domination ; mais on voit bien que cette explication strictement pulsionnelle ne représente qu’une moitié de la vérité. Un homme politique en campagne parle, argumente, avance des raisons pour convaincre ses auditeurs de rallier son camp. On peut penser ce qu’on veut de ces raisons ; on peut considérer qu’elles ne sont qu’un alibi, que l’homme politique au fond ne veut « que » le pouvoir, et que donc la vraie vie est ailleurs, du côté du pulsionnel. D’accord. Mais le fait est qu’un homme politique ne dit jamais son cynisme. Il ne tente jamais la domination nue. Partout et en tout lieu humain il donne des raisons, parle au nom du bien commun, et tente de se faire passer pour légitime. Même si le bien commun n’est jamais que le bien d’un seul, même si la légitimité n’est qu’un leurre, il se trouve pourtant qu’elle est partout invoquée et qu’il y a là une constante anthropologique qu’on ne peut pas méconnaître. Or pour commencer à comprendre cela il faut entendre ce que dit l’homme politique et les raisons qu’il allègue ; il faut faire droit à un « espace logique des raisons », qui n’est pas « l’espace logique de la nature »11.
AP : Sur le récit de l’hominisation, vous proposez une réflexion modale dont le critère est le temps : la bipédie ne nous emmenait pas nécessairement vers la cérébralisation mais une fois établie, celle-ci devient nécessaire. « L’homme est une somme de hasards évolutifs mais, une fois apparu, il doit se laisser décrire comme un ensemble de fonctions convergentes, et comme structuralement distinct de ses plus proches parents. »12 Votre analyse du devenir humain, du récit de l’hominisation, me rappelle un peu les critiques que Hegel adresse à une certaine forme d’histoire qui, en introduisant la causalité dans le récit, croit être quitte de la contingence. Autrement dit, elle crée des nécessités externes qui subordonnent l’effet nécessaire à une cause contingente au sens où la cause aurait pu ne pas avoir lieu. D’une certaine manière, vous reprenez cette idée mais vous la renversez complètement : au lieu de faire du devenir le lieu de nécessités causales vous en faites le lieu d’une pure contingence, mais une fois établie cette pure contingence semble acquérir une sorte de nécessité interne affranchie de la causalité de son devenir.
EB : Pour bien comprendre ce point il faut revenir à ce que je disais à l’instant : on ne comprend bien le phénomène humain qu’en le situant à la croisée de deux espaces, l’espace logique des raisons et l’espace logique de la nature. Les événements naturels qui président au processus de l’hominisation sont tous par principe contingents, en ce sens précis qu’ils sont produits d’une manière qui n’est pas rationnelle ou délibérée. Ils ont eu lieu, mais on peut parfaitement imaginer qu’ils n’aient pas eu lieu – que dans d’autres circonstances, par exemple, Neandertal ait survécu, et qu’il y ait donc aujourd’hui deux espèces humaines plutôt qu’une. À la différence de ce type de phénomènes, la nécessité dont je parle et dont je dis qu’elle n’advient qu’avec l’humain, nous réfère à un ordre spécifiquement langagier et rationnel. Parler, penser, c’est élever des prétentions idéales ou absolues. Dans un contexte « ethnocentrique » par exemple, c’est considérer qu’il y a les « vrais » hommes et ceux qui, étrangers, barbares, ne parlant pas notre langue, ne sont pas vraiment humains. Dans un contexte moderne, c’est considérer que l’être humain, même s’il est une espèce naturelle particulière, contingente, tard venue dans l’histoire de l’évolution, mérite comme tel un respect absolu – qu’on ne peut pas ne pas respecter un homme, quelle que soit la forme empirique qui est la sienne. Et même si cet homme est moralement un monstre, c’est toujours au vu de cette norme absolue que je le jugerai. Comme vous le voyez, dans les deux cas (ethnocentrisme ou universalisme), une visée rationnelle vise du nécessaire qui nous fait échapper à la contingence des événements naturels. Ce n’est pas que cette visée nous situe ontologiquement « ailleurs », dans un ciel d’idées éternelles ; c’est tout simplement qu’elle relève d’un autre type d’intelligibilité. Comprendre ou décrire l’expérience d’un être humain c’est accompagner le mouvement subjectif qui le fait viser, au-delà de l’empirique, du nécessaire. Encore une fois on peut être cynique et considérer que de telles visées sont vides de sens. Mais cela n’empêche qu’elles sont là et que, même vaines, elles continuent à structurer la vie humaine.
D : La perception animale et le réalisme humain
AP : Venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à ce qui me semble constituer le cœur de votre ouvrage, à savoir la description phénoménologique de ce que signifie « avoir un monde » pour un animal. Première remarque, puisque la description se veut phénoménologique, vous allez attribuer une intentionalité à l’animal, ce qui vous impose de redéfinir celle-ci : si, chez Husserl, la perception est par essence inadéquate, elle ne l’est qu’au regard d’une comparaison avec l’apodicticité du vécu ; or l’animal ne connaît pas cette inadéquation, ce qui revient à dire que pour lui son voir est parfait. Avec lui, « le perçu n’est rien de plus que ce qui a été visé. L’intentionalité animale est au fond la seule forme pure de l’intentionnalité : elle est une visée qui rencontre à tout coup son objet, non que cette visée soit parfaite en son genre, mais plutôt parce qu’elle ne sait toucher rien d’autre que ce qu’elle a visé. »13 Si je comprends bien, vous considérez que la perception animale est une perspective sur le monde mais elle ne peut l’être que de notre propre point de vue, au sens où pour l’animal l’objet ne pourrait rien être de plus que ce qu’il en perçoit ; il n’y a pas de perspectivisme animal. Mais là me vient une question presque naïve : comment est-il possible de le savoir ; quelles sont, pour le demander autrement, les conditions de possibilité d’une description de l’intentionalité animale pour nous qui sommes humains ?
EB : C’est une question souvent posée. C’est étrange, car d’une certaine manière on y a toujours déjà répondu. On vit avec les animaux, à commencer par les animaux domestiques, et on ne se pose pas la question de savoir si le chien est « vraiment » heureux quand il aboie et fait des bonds au retour de son maître, ou si ce qu’il ressent est « vraiment » de la douleur quand il est battu et qu’il hurle : c’est pour nous une évidence. Avant le doute, avant l’interrogation, il y a la vie, avec ses compréhensions naturelles et ses empathies spontanées. Tout part de là. Nous prêtons à l’animal des sentiments, des désirs, des perceptions qui sont bien sûr les nôtres, et que nous projetons en eux. Nous sommes des vivants, et d’eux à nous « l’accompagnement », comme dit Heidegger, est la règle. Reste qu’il traîne par définition beaucoup d’anthropomorphisme dans ces projections, et qu’il faut bien à un moment prendre un certain recul critique. C’est ici qu’interviennent l’éthologie et la psychologie animale. Entre elles et notre perception spontanée des animaux il y a échange de services. Tout ce que nous donnons spontanément à l’animal est la seule voie d’entrée possible vers lui ; mais c’est une voie susceptible ensuite d’être affinée, critiquée, confirmée par voie d’expérimentation. L’animal par exemple a-t-il une « théorie de l’esprit », c’est-à-dire une compréhension du point de vue du congénère comme distinct du sien ? Comme vous le savez cette question est ardemment débattue par les primatologues depuis les années quatre-vingt, avec expériences, controverses, hypothèses, réfutations, etc. Et c’est une bonne chose : cette science qui avance, entre convictions et expérimentations, sera toujours plus intéressante que le « mol oreiller » du doute.
AP : Je m’interroge sur ce point car si vous soulevez la grande difficulté qu’il y a à interroger le langage animal à partir du nôtre14, vous ne semblez pas rencontrer la même difficulté lorsqu’il est question de conceptualiser l’intentionalité animale à partir de la nôtre ; pourquoi ?
EB : En réalité c’est la même chose, le procédé est le même dans les deux cas. Dans mon ouvrage j’essaie d’articuler, sur ces deux points, l’intuition et la documentation scientifique…
AP : Une des conséquences très fortes que vous tirez de l’intentionalité animale ainsi décrite est une appréhension à nouveaux frais du réalisme ; d’une certaine manière, seul l’être humain peut avoir l’idée d’être réaliste ; pourriez-vous expliquer en quoi le réalisme ne peut être une croyance qu’humaine ?
EB : Oui, je peux bien sûr vous l’expliquer, même s’il m’a fallu un ouvrage entier pour le montrer ! Ce qui est sûr c’est qu’on est ici au cœur de la question. Si on définit le réalisme comme le fait de croire que le monde « existe », ou que ce que nous percevons est « là », offert à tous les autres vivants en même temps qu’à moi, et restera « là » quand plus aucun vivant ne sera là pour le faire apparaître ; si on définit le réalisme de cette manière, non comme une conception philosophique parmi d’autres mais comme une attitude spontanée, ce que Husserl appelait « l’attitude naturelle » et Merleau-Ponty la « foi primordiale » ; si le réalisme est ce mouvement irréfléchi et premier, alors oui, je pense qu’une telle attitude ne concerne que l’être humain. Elle est la « basse continue » d’une existence humaine, ça veut dire qu’elle ne s’y manifeste pas toujours frontalement ou thématiquement, mais qu’elle s’y exprime de manière systématique à travers un certain nombre de comportements qui chez l’animal sont l’exception, alors qu’ils sont la règle chez l’homme : la conversation, autrement dit le fait d’être tournés tous ensemble vers la « même » chose, que l’acte de la conversation fait justement « exister » entre nous ; la science, comme tentative d’expliquer non pas un monde possible mais « le » monde ; la pédagogie longue, comme transmission à l’enfant de l’usage « du » monde ; l’art, comme contemplation et passion pour ce qui est, etc. On ne connaît aucune espèce animale qui pratique de manière systématique l’une de ces activités, et chez qui a fortiori on les rencontre toutes ensembles. C’est ce que Mallarmé appelait « l’universel reportage » : nous sommes de grands bavards, d’incurables commentateurs « du » monde…
AP : pourrait-on aller jusqu’à dire que la croyance réaliste est le propre de l’homme ?
EB : Oui, c’est ce que j’ai essayé de montrer en effet. Comme vous le savez la liste des « propres de l’homme » (le langage référentiel, l’art, le rire, la conscience de la mort, etc.) est sans fin et à ce titre elle prête souvent à sourire. En particulier elle est invoquée de manière un peu infantile par les journalistes chaque fois qu’une découverte primatologique leur fait dire, par une forme de triomphalisme à l’envers, que la « technique », le « langage » ou la « conscience de la mort », ne sont plus le propre de l’homme. Comme s’il fallait nécessairement en rabattre sur l’orgueil humain, et en finir avec des siècles d’anthropocentrisme coupable…C’est typiquement ce que j’ai essayé de ne pas faire dans mon ouvrage. J’ai voulu montrer au contraire qu’on pouvait penser rationnellement cette notion de « propre de l’homme ». Non pas pour défendre l’honneur humain, mais simplement pour y voir plus clair. Et pour ce faire j’ai tenté de décrire une attitude humaine fondamentale, une forme de rapport au monde ou d’intentionalité qu’on retrouverait à l’œuvre chez tous les hommes et qui, inversement, ne dirait rien de fondamental concernant l’animal.
AP : Peut-on penser le perspectivisme comme le corrélat de la croyance réaliste, auquel cas on aurait un paradoxe assez étrange voulant que le réalisme ne soit jamais qu’une façon qu’aurait la conscience humaine de se représenter le monde comme étant indépendant de sa perception, bref soit une façon pour la conscience de s’auto-limiter dans sa perception d’un monde qu’elle est seule à déclarer inaccessible en son entier ? Bref, le réalisme ne serait-il pas une auto-mutilation de la conscience perceptive spécifiquement humaine ?
EB : Je n’ai rien à redire à cela. Et je trouve votre paradoxe intéressant. Le réalisme dont je parle peut se formuler en disant que pour l’être humain, le monde auquel il croit est synonyme de mort. Croire que le monde existe, c’est croire en effet que le monde sera encore là quand j’aurai disparu. Nous croyons au monde comme à quelque chose qui a bien sûr besoin de nous pour apparaître, mais non pour exister. Il est le nécessaire, nous sommes le contingent. La visée intentionnelle du monde est une visée idéalisante ; elle vise, comme on le disait tout à l’heure à propos des différentes visées humaines, du nécessaire. Nous savons bien, et nous le savons même intimement, que mourir ce n’est pas abolir le monde, mais le quitter. C’est laisser toutes choses en l’état. Et c’est bien pour cette raison que la mort est si difficile, voire impossible, à supporter. La solitude du mourir dont parle Heidegger, c’est la solitude de celui qui sait que « tout le monde » reste, et que lui part tout seul. Donc oui, vous avez raison, dire que l’être humain se connaît comme un simple point de vue sur ce qui est, c’est faire état d’une ouverture et en même temps d’une finitude.
AP : Dans un récent article consacré au perspectivisme husserlien, vous concluiez celui-ci en expliquant qu’aux yeux de Husserl, le perspectivisme était une donnée absolue de toute conscience. Et vous écriviez ceci : « Dieu lui-même verrait encore de quelque part. Le perspectivisme est l’intentionnalité elle-même, comme œuvre d’identification du multiple ; il est la tournure même de notre insertion dans l’être. »15 Mais si le perspectivisme est le corrélat du réalisme, et si le réalisme n’est lui-même qu’une certaine façon humaine de voir le monde, comment peut-on dire que le perspectivisme est l’intentionnalité elle-même si l’animal en est doté, sans totalement désavouer Husserl sur ce point ?
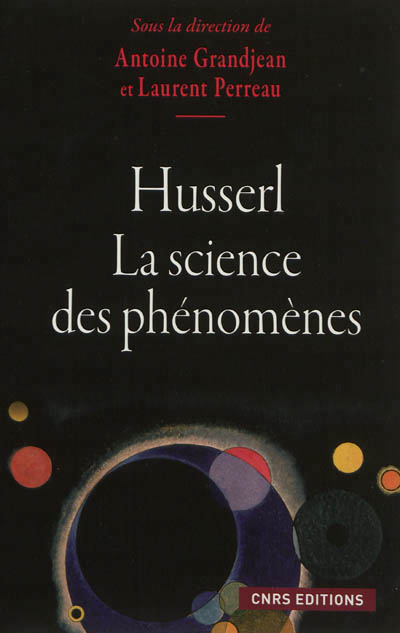
EB : En réalité la différence n’est pas entre perspectivisme et absence de perspectivisme, mais plutôt entre deux perspectivismes, l’un connu comme tel, l’autre non. Il y a bien sûr une intentionalité animale, et celle-ci procède sans aucun doute d’un point-de-vue particulier pris sur le monde. Jusqu’ici l’eidétique husserlienne est imparable : un vivant, animal ou humain, perçoit nécessairement de quelque part. Mais l’animal a-t-il la « science des points-de-vue », comme dit Merleau-Ponty à propos des adultes ? Connaît-il son point de vue comme un point-de-vue distinct des autres, et donc comme un « simple » point-de-vue, partial et particulier, pris sur le monde ? Je ne le pense pas, et j’ai tenté de le montrer dans mon livre. Du coup cela nécessite « d’anthropologiser » l’eidétique husserlienne, ou de produire une spécification anthropologique de son eidétique générale. Toute perception vivante est perspective ; mais seule la perception du vivant humain connaît ce perspectivisme et donc sa propre limitation.
E : L’altérité des autres
AP : Une grande partie de l’ouvrage est consacrée à discuter les thèses conceptualistes et non-conceptualistes quant à la question de la perception. Pouvez-vous brièvement présenter le cœur de ce débat ?
EB : La question générale est de savoir si percevoir c’est déjà penser (juger que), ou non. Voir une chouette s’envoler, est-ce voir « que » la chouette s’envole ? ou simplement assister à un événement, et en rendre compte ensuite en disant que la chouette s’est envolée ? La perception, autrement dit, est-elle informée par des « contenus conceptuels » (les composantes nominales et verbales d’un jugement), ou au contraire innocente, d’un point de vue épistémique ? C’est un débat qui anime une certaine philosophie analytique contemporaine et qui m’a intéressé, parce que c’était l’occasion de montrer que sur une telle question, comme sur d’autres, un arbitrage « anthropologique » pouvait s’avérer décisif. On a tout à gagner, autrement dit, à spécifier la perception dont on parle comme étant celle d’un vivant humain et non animal ; à se demander « ce que ça fait » de percevoir comme un homme, plutôt que comme une chauve-souris ; donc à interroger la perception humaine sur le fond de son passé animal.
AP : Votre solution à ce débat est toujours assez nuancée, et cherche à identifier ce qu’il y a de valable dans chacune des positions. « Ce qui transforme ou humanise la perception, écrivez-vous, n’est pas la présence en elle de nouveaux contenus cognitifs. C’est bien une disposition, une attitude ou une capacité ; et l’on peut maintenant préciser (…) : c’est la disposition propre à un être parlant de viser le vrai au-delà du point de vue, ou le réel au-delà de l’apparence. La visée véritative ou réaliste qui advient avec le langage transforme de l’intérieur toute perception, la plaçant dans l’orbite de ce qui est. »16 Cela revient à dire que le non-conceptualisme est vrai sur les contenus tandis que le conceptualisme est vrai pour les dispositions. Ainsi, « ce n’est pas directement la connaissance qui humanise le sentir, mais une attitude qui est au fondement du connaître ; non pas l’adjonction de composantes cognitives nouvelles, par exemple héritées du langage et sédimentées dans l’architecture du perçu, mais une disposition générale, qu’il nous reste à définir. »17. Alors, justement, comment définir cette « disposition générale » si rien ne nous spécifie quant à nos contenus ?
EB : C’est essentiellement une disposition sociale. Dire qu’avant toute spécification cognitive nous visons « le » monde ou le monde « comme tel », dire que la connaissance n’est que l’une des modalités possibles de ce réalisme, c’est s’engager à aller chercher plus bas, du côté d’une disposition plus fondamentale, la source de ce réalisme. C’est désintellectualiser la question. Notre croyance au monde fonde la connaissance du monde plutôt qu’elle n’en dépend. En réalité, elle est originairement la visée d’un monde commun. Croire que le monde existe, c’est croire qu’il existe quelque chose comme « le » monde, commun à tous les vivants possibles – et ce avant d’en connaître quoi que ce soit de conceptuellement déterminé. C’est présumer (idéalement) que nous sommes tous ouverts sur le même monde, même si c’est chacun depuis son point de vue particulier. Un être humain autour de 9 mois commence à partager son attention avec ses proches, c’est-à-dire à percevoir des choses en sachant qu’elles sont en même temps perçues par autrui, ou à interagir autour de choses manipulées en commun. À la faveur de ces épisodes d’« attention conjointe », c’est tout son rapport au monde qui se transforme : désormais le monde ne sera plus un simple milieu de comportement centré sur l’enfant, mais un monde qui, socialement partagé, apparaîtra à distance de l’enfant comme « le » monde de tous…
AP : Quel rôle précis attribuez-vous au langage et comment différenciez-vous les langages animaux et humains ?
EB : Le langage joue sur ce point un rôle bien évidemment crucial. Mais il faut préciser, faute de quoi on retombe dans les facilités d’un intellectualisme, pour lequel ce sont la connaissance ou les « contenus conceptuels » qui universalisent le monde. En réalité la connaissance ne vient qu’en position seconde ou dérivée. Comme j’ai essayé de le montrer à travers la notion d’« attention partagée », l’universalité du monde est d’essence sociale plutôt que conceptuelle ; c’est une universalité sans concept qui est au départ du langage, plutôt qu’à son terme. On la voit poindre à l’âge de la « communication préverbale », approximativement entre 9 et 18 mois ; mais elle continue d’irriguer en même temps tout acte de parole, à travers ce geste fondamental qui s’appelle la thématisation. Parler, c’est s’entendre sur ce dont on parle ; c’est implicitement le désigner ou le montrer du doigt à l’adresse d’autrui ; c’est sous-entendre que ce thème nous est commun, le temps de l’interaction verbale. Ce thème peut varier, et ne cesse en réalité de varier, parfois même à l’intérieur d’une même phrase ; mais le point important, qui participe des « conditions de félicité » du dialogue, c’est qu’on présuppose toujours un thème commun. En ceci la parole est éminemment un acte d’attention conjointe. Il vise une référence socialement partagée, et ce de manière systématique, quand ce n’est le cas que de manière très fragmentaire chez l’animal. Je reviens très en détail sur cette question à la fin de mon livre, pour montrer que les communications animales, aussi diverses soient-elles, ne sont référentielles que de manière évanouissante, dans la mesure où l’essentiel est moins la chose à dire ou à commenter en commun, que la chose à faire. Un singe-vervet qui indique à ses congénères la présence d’un léopard n’attend pas de leur part un commentaire sur le léopard, avec échange de points-de-vue contradictoires et enrichissement progressif du thème : la question n’est tout simplement pas là.
AP : Ainsi que le révèlent vos analyses sur le langage, autrui joue une place primordiale dans votre réflexion. Mais il faut entendre par altérité celle d’autrui et celle du monde. S’humaniser, dites-vous, revient à faire sa place à autrui et au monde en tant qu’ils sont tous deux autres. L’humanisation se conçoit-elle alors comme une différenciation ?
EB : Oui, on peut dire ça : l’humanisation comme ouverture progressive, à l’échelle de l’espèce comme à l’échelle de l’individu, d’un espace de points de vue différents sur le même monde…
AP : Votre ouvrage s’achève sur une espèce de paradoxe étonnant. Si les analyses ont révélé le foncier réalisme inhérent à la conscience humaine, la réalité du monde se révèle à présent sujette à l’impact de ma propre présence dans mon rapport à autrui ; ou, pour le dire autrement, l’avènement de l’altérité de l’autre ne laisse pas intact le monde lui-même tel que j’en fais l’expérience. « Définie de cette manière l’intentionalité porte en elle, comme son secret natal, la présence d’autrui – ou sa présence comme absent : la déprésentation de la chose visée, ce qui l’empêche de m’apparaître comme une projection mienne, tient au fait que je ne suis pas autrui, qu’il n’est pas moi, et que je dois désormais faire, dans ma visée du monde, avec ce regard venu d’ailleurs. »18 C’est une seule et même chose de reconnaître l’altérité d’autrui et la transcendance du monde.
EB : Toute la question, vous l’avez compris, c’est de savoir comment un vivant peut se déprendre de soi en direction du monde, donc aller contre la logique foncièrement égocentrique du vivre. Comment, dans l’histoire de la vie, a bien pu apparaître un vivant qui prétende qu’il y a « le » monde, indifférent à sa vie et à sa mort ? Comment un tel décentrement a-t-il pu avoir lieu ? La réponse que je donne, à titre d’hypothèse, c’est que ce décentrement en direction du monde est inséparable d’un décentrement en direction d’autrui ; qu’il a fallu le partage social de l’attention et la visée d’un monde commun, pour que s’impose la transcendance du monde. En somme, c’est parce que ce monde n’est pas mien et parce qu’il appartient aux autres en même temps qu’à moi, c’est parce que je le sais profond et plein de tous les points de vue possibles sur lui, c’est parce qu’il est socialement inépuisable, qu’il est ontologiquement transcendant. Je le perçois comme existant parce que d’autres, tous les autres possibles, ont droit de regard sur lui. Mais ce n’est là qu’une hypothèse, dont je serais ravi qu’elle soit discutée. Au vu de tout ce que nous apprennent aussi bien l’éthologie et la psychologie animale que les différentes sciences humaines, la différence anthropologique représente un domaine d’investigation ouvert ; puissent les philosophes le considérer comme un chantier philosophique digne de ce nom, et ne pas considérer qu’il relève de la seule science !
- cf. Etienne Bimbenet, Nature et humanité. Le problème anthropologique dans l’œuvre de Merleau-Ponty, Vrin, 2004
- Ibid., p. 9
- Etienne Bimbenet, L’animal que je ne suis plus, Gallimard, coll. Folio-essais, 2012
- Ibid., p. 22
- John McDowell, L’Esprit et le Monde, trad. C. Alsaleh, Paris, J. Vrin, 2007, p. 118
- Ibid., p. 32
- Ibid, pp. 86-87
- E. Bimbenet, Nature et humanité, op. cit., p. 80
- M. Merleau-Ponty, La Structure du comportement, Paris, PUF, 1942, p. 199
- Ibid., p. 47
- John McDowell, L’Esprit et le Monde, op. cit., p. 23
- Ibid., p. 63
- Ibid., p. 207
- cf. « ce n’est pas que nous avons pour nous toutes les capacités linguistiques, et que les animaux n’en ont que ce qu’ils peuvent avoir ; c’est plutôt que le langage humain, qui n’est rien d’absolu ou nécessaire, est en fait le seul moyen de comparaison que nous ayons à notre disposition pour comprendre les différents codes animaux. », p. 275
- Etienne Bimbenet, « La double théorie du noème. Sur le perspectivisme husserlien », in Antoine Grandjean et Laurent Perreau (dir.), Husserl. La science des phénomènes, CNRS-Editions, 2012, p. 210
- L’animal que je ne suis plus, op. cit., p. 249
- Ibid., pp. 251-252
- Ibid., p. 373








