Actu-Philosophia : Édouard Mehl, je suis très heureux de vous interroger car, en 2019, ont paru deux livres à mes yeux capitaux concernant Descartes, à savoir d’une part la réédition augmentée et corrigée de Descartes en Allemagne, aux Presses Universitaires de Strasbourg[1], et d’autre part la publication aux PUF de votre HDR soutenue en 2013, sous le titre de Descartes et la fabrique du monde[2]. Ce sont là deux livres fort érudits, qui abordent Descartes sous un angle qui n’est pas le plus habituel – en tout cas dans les études françaises – et qui envisagent aussi bien son rapport aux Rose-Croix et à l’hermétisme que son interprétation de la Genèse dont le commentaire nous est hélas perdu. Ces deux ouvrages sont intimement liés aussi bien thématiquement que méthodologiquement, la figure de Copernic – ou, comme vous le dites, « la question copernicienne » -, étant d’ailleurs l’élément central des deux études.
Toutefois, avant d’en aborder le contenu et la méthode, je souhaiterais vous interroger sur la citation mise en exergue de Descartes en Allemagne qui mentionne une plante magique de l’Odyssée, à savoir le népenthès, drogue utilisée par Hélène pour soulager la mélancolie de son époux et de ses compagnons. On comprend certes que, parmi les compagnons de cette dernière, figurait peut-être un personnage que l’on pourrait associer à Polybe dont le nom jouera un certain rôle dans les écrits de jeunesse de Descartes ; mais il n’en demeure pas moins que cet exergue confère à l’ouvrage une portée énigmatique et même déroutante…
Édouard Mehl : Merci tout d’abord pour votre lecture, et de votre intérêt pour ces travaux. Ces deux ouvrages sont en effet liés et se tiennent par tout un ensemble de fils. Ils sont liés, bien sûr, par la figure de Descartes. Ils le sont encore par la volonté de réinscrire le corpus cartésien dans un contexte précis où s’entrecroisent l’histoire de la philosophie et l’histoire des sciences. Enfin, ils sont liés par une certaine perspective, un peu décalée, dans laquelle certains éléments du corpus, auxquels les études cartésiennes n’ont parfois accordé qu’une attention distraite, prennent ici une importance de premier plan. J’ai voulu, en somme, explorer les angles morts, visiter l’envers du décor, et reconstituer la scène primitive de la philosophie cartésienne. D’où le fait que je prends parfois certains commentaires classiques quasi à rebrousse-poil, comme Henri Gouhier dans Descartes en Allemagne, ou Ferdinand Alquié dans la Fabrique du monde.
La citation placée en exergue de Descartes en Allemagne donne, de fait, une indication essentielle, pour la reconstitution de cette scène inaugurale, et la solution d’une énigme à laquelle je travaille depuis une bonne vingtaine d’années. Je ne vous cache pas qu’au long de toutes ces années je me suis moi-même beaucoup interrogé sur la réalité de cette supposée énigme, et sur le sens de mon travail : n’avais-je pas moi-même inventé une fable ? Sans doute, mais je suis aujourd’hui pleinement persuadé que ladite fable nous fait directement entrer au cœur même de la problématique la plus essentiellement philosophique de Descartes. Mais quelle fable ? quelle énigme ? Dois-je le dire ici, de but en blanc, ou faut-il laisser nos lecteurs faire un peu de chemin avant de satisfaire leur curiosité ?
AP : Vous en avez trop dit pour ne pas en dire plus !
EM : Vous savez que dans les notes de jeunesse de Descartes se trouve le titre d’un ouvrage dans lequel on peut voir une anticipation baroque de la Géométrie de 1637 : « Le Trésor mathématique de Polybe le Cosmopolitain, dans lequel sont enseignés les vrais moyens de résoudre toutes les difficultés de cette science, etc. ». « Polybe » est aussi le nom d’emprunt qu’un mathématicien allemand à la réputation douteuse Johannes Faulhaber (1580-1635), donne à un de ses « amis » à qui il prétend avoir confié les « secrets » que celui-ci s’apprête à publier, à Venise ou à Paris. Cet « ami » est très vraisemblablement Descartes, et le nom de « Polybe » est donc ce qui a permis de retrouver sa trace en Allemagne, en 1619-1620. Nous avions donc trouvé une piste, dont il restait à comprendre le sens. Après de longues recherches, postérieures à la première édition de D. en Allemagne (2001), j’ai fini par trouver le sens de ce nom, que je tiens pour son seul sens possible. Polybe est en effet un personnage de second plan de la Télémachie d’Homère. Il fait partie de la suite d’Hélène, celle-ci étant apparemment — sans que l’on sache d’ailleurs comment — passée en Égypte après sa captivité à Troie (certains, comme Euripide, disent même au lieu de sa captivité à Troie, où Pâris et ses compagnons n’auraient poursuivi que son fantôme). Polybe est originaire de Thèbes, la ville qui « regorge de trésors ». C’est aussi dans cette même ville que Platon, dans le Phèdre, place l’origine de la géométrie, divinement transmise aux hommes par le dieu Theuth. Platon, excellent connaisseur d’Homère, souscrit d’ailleurs à l’idée que le père des mathématiques grecques, Pythagore, a été formé chez les Égyptiens, dont le savoir se perd dans la nuit des temps. Je suis convaincu que c’est cette rencontre entre le mythe platonicien de l’origine (thébaine) de la géométrie et la fable homérique qui donne la clé du pseudonyme cartésien. Polybe est le thébain qui a offert ses richesses à la divine Hélène ; non de l’or vulgaire qu’on écoule en vile monnaie, ni l’or potable avec lequel les alchimistes ont empoisonné Diane de Poitiers, mais un or intelligible, au sens où Kepler peut désigner le théorème de Pythagore comme « aureum theorema ». Or il se trouve justement que les papiers de jeunesse de Descartes contiennent, entre autres inventions curieuses, une généralisation du théorème de Pythagore à la géométrie solide, voire à un espace à quatre dimensions, ce qui laisse d’ailleurs les spécialistes assez perplexes. Que signifie tout cela ? Que Descartes, au cœur de son voyage allemand, a eu, comme Télémaque, une espèce d’apparition : celle d’une sagesse supérieure (l’Hélène divinisée de l’Odyssée) puisant toute sa force, sa majesté, et sa vertu consolatrice des sources retrouvées de la mathesis (Polybe).
N’en disons pas plus, mais cette histoire de trésor est elle-même un vrai trésor.
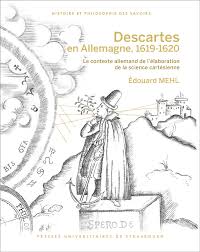
A : Questions de méthode
AP : Après la résolution de cette petite énigme – en dépit des questions qu’elle laisse en suspens sur l’espace à quatre dimensions – je voudrais partir de l’annonce programmatique de la seconde édition de Descartes en Allemagne où vous écrivez ceci :
« Descartes n’est pas né cartésien, il l’est devenu. Avant d’être « cartésien », il fallait qu’il devînt « copernicien », ce qui, au sens philosophique, ne s’entend pas comme un engouement spontané pour une thèse paradoxale (…) mais comme la conquête d’une certitude[3]. »
Et vous ajoutez aussitôt que l’on peut restituer la « collusion » entre « l’instauration cartésienne de la méthode et la question copernicienne, telle qu’elle se pose en Allemagne, au moment précis où Kepler publie l’Harmonice Mundi[4]. »
Autrement dit, votre démarche consistera à replacer Descartes dans un certain devenir vis-à-vis de lui-même, devenir dont vous rendez compte de manière historique, voire de manière historiciste. En effet, vous revendiquez cette méthode dès l’introduction de Descartes et la fabrique du monde, pour contrer les lectures héroïques faisant de Descartes une sorte d’esprit fondé sur lui-même et ne partant que de lui-même, comme si les réalités historiques ne l’atteignaient pas. Les ressorts internes de la raison classique, dites-vous, « ne relèvent pas d’une dramatique de la subjectivité ou d’on-ne-sait-quel vendredi saint spéculatif de l’Esprit, mais de changements proprement et positivement historiques qui ont été écrits et documentés – ou qui doivent l’être[5]. » Et cela vous permet d’annoncer une approche « historiciste et hétérologique[6] »
Je me demande toujours si la question du rôle du milieu historique sur la formation d’une pensée n’est pas toujours un peu biaisée et s’il ne faudrait pas distinguer le problème de la causalité de celui de la raison. Il me semble que l’on peut considérer qu’un milieu explique causalement un certain nombre de thèmes, voire un lexique, mais il me semble aussi qu’il échoue à rendre raison de la grandeur d’un philosophe. Autrement dit, ne pensez-vous pas que l’on peut en effet expliquer historiquement la présence thématique et thétique de nombre de passages d’un auteur, sans pour autant dire pourquoi Descartes fut Descartes, sans pour autant saisir la raison de la fulgurance cartésienne ? D’ailleurs, à la fin de Descartes en Allemagne, vous notez – dans une excellente formulation – qu’en dépit du contexte général, seul Descartes finira par élaborer une « vérité métaphysique du relatif[7] » Une approche historiciste peut-elle rendre compte de cette singularité qui fait la grandeur même de Descartes ? Et si elle ne le peut pas, n’est-elle pas condamnée à ne rendre compte que de ce qui n’est pas essentiel chez Descartes ?
EM : Vous avez certainement raison de rappeler que la singularité philosophique d’un auteur ne s’explique ni par son éducation, ni par ses lectures, ni par ses fréquentations, ni par ses maladies, ni même par son engagement politique. Mais êtes-vous bien sûr de savoir ce qui constitue proprement cette singularité ? Et si oui, j’ai envie de vous retourner la question : comment le savez-vous ? sinon parce que vous voyez cette singularité — la forme singulière de ce projet — apparaître et se détacher sur le fond d’une culture commune, s’extraire d’un fonds d’idées, de textes et d’arguments en circulation à une époque donnée ? Si nous n’avions jamais ouvert Mersenne ou Montaigne, Suarez ou Kepler, comment pourrions-nous avoir la moindre perception d’une telle singularité ? Par ailleurs, il y a dans les études cartésiennes un paradoxe, sinon une contradiction massive : ce sont les mêmes qui insistent sur la singularité philosophique de Descartes et qui, méthodologiquement, pensent qu’il suffit de mesurer un écart quelconque entre ses positions et celles de « la scolastique » pour la faire apparaître. Mais, assurément, cela ne suffit pas, car « la scolastique » n’existe pas, ou disons qu’elle est elle-même une série problématique de singularités, et il y a au moins autant de différences entre Duns Scot et Thomas d’Aquin, qu’entre Spinoza et Descartes. De surcroît, cela fait belle lurette que les historiens de l’époque médiévale ont fait reculer le tournant de la modernité au milieu du XIVe siècle : le primat de l’esse objectivum, qui fait basculer dans ce que Foucault appelait l’« âge de la représentation » — comme s’il s’agissait là du trait définitionnel de la modernité —, est inscrit dans le tournant nominaliste de la via moderna, au cœur du Moyen-Âge (et ce n’est nullement un hasard si c’est chez les auteurs de cette tradition qu’émerge le problème typiquement « moderne » de la certitude définie et mesurée par la certitude de soi). Il est donc assez curieux de faire reposer la prétendue « singularité » cartésienne sur un élément qui témoignerait plutôt de son inscription dans une tradition déjà ancienne et pluri-séculaire. Bref, je ne crois pas que l’enquête historiciste – excusez le pléonasme – manque l’essentiel d’une pensée philosophique : c’est plutôt par manque de sens historique que bien des philosophes, qui se croient profonds, se condamnent eux-mêmes à égrener pieusement un chapelet de platitudes dont l’intérêt et la valeur vont décroissant à mesure qu’ils les répètent.
Mais votre question comporte aussi un autre aspect, portant plus spécifiquement sur le rapport entre histoire de la philosophie et histoire des sciences. Je tiens en effet qu’il est nécessaire de resituer l’entreprise philosophique de Descartes dans la crise intellectuelle et institutionnelle qu’on appelle par métonymie « l’affaire Galilée » — bien qu’en réalité les péripéties de cette affaire ne soient que le contrecoup tardif de la crise déclenchée par la publication du De revolutionibus orbium cœlestium de Copernic (1543), mis à l’Index et suspendu en 1616, plus de soixante-dix ans après sa publication. Or, en étudiant cette conjoncture, mon intention n’était pas du tout de dissoudre la philosophie cartésienne dans l’histoire des sciences, mais de montrer, au contraire, que seule une philosophie première peut, aux yeux de Descartes, statuer sur l’objet de la physique et dire « ce que c’est que le corps ». Vous pourrez d’ailleurs noter que D. et la fabrique du monde ne fait pas l’histoire de la querelle copernicienne à l’époque moderne, mais l’histoire du « problème cosmologique », qui devient avec Descartes un problème strictement métaphysique. Je ne livre donc pas un Descartes scientiste, comme celui de Louis Liard, qui ne voulait voir dans l’« invention admirable » du XI novembre (1620) que la découverte de la méthode pour construire tous les problèmes solides à l’aide d’une parabole…, mais au contraire un Descartes singulièrement philosophe, et « métaphysicien » si l’on veut, bien que cette métaphysique examine deux problèmes fondamentaux dont il n’a précisément jamais été question dans aucun traité de « métaphysique » avant lui : la liberté, et le monde (de ce point de vue, il est positivement faux d’affirmer, comme l’a fait Heidegger, que c’est Kant qui a fait de la liberté un problème métaphysique, et même le problème de la métaphysique : qu’on relise la IVe Méditation !).
AP : En vous posant la question précédente, je songeais à la position d’Alquié, commentateur de Descartes qui m’est cher, et notamment à de nombreux passages qui visent à montrer que toutes les études historiques que l’on peut mener peinent à rendre compte de la démarche philosophique d’un homme. Et le problème se redouble dans le cas de Descartes qui opère une sorte de parcours de funambule puisque c’est lui-même qui, tout à la fois, ne cesse d’indiquer la singularité de sa pensée tout en rappelant le contexte extérieur de sa formation. Alquié note ce paradoxe, dans des propos assez durs contre les approches historicistes :
« Ils [les historiens historicistes] négligent cette sorte de dimension verticale par laquelle l’homme entre en contact avec la vérité, oublient que le projet du philosophe est de se dégager de l’histoire, et de la juger au lieu de la subir ; ils ne peuvent donc parler d’un philosophe qu’en refusant, d’abord, de l’entendre. Mais ce n’est assurément pas refuser d’entendre Descartes, ni l’expliquer par une causalité externe et mécanique, que replacer son système dans la réalité concrète où il est né, puisque Descartes, pour nous livrer ses pensées, croit nécessaire de nous entretenir de leur histoire[8]. »
A cet égard, ne peut-on pas donner raison à Alquié lorsque celui-ci affirme sa crainte que soit manquée la dimension authentiquement philosophique d’une pensée – c’est-à-dire la démarche intime du sujet pensant par laquelle il cherche à se rapporter à la vérité – lorsque celle-ci n’est approchée que par le cadre du milieu extérieur déterminant ? La méthode historiciste n’est-elle pas déphilosophante, si vous me passez l’expression ?
EM : Le problème que vous abordez ici est essentiel, parce qu’il touche à la définition même du métier d’historien de la philosophie. Implicitement, votre question n’oppose pas seulement deux types d’histoires de la philosophie – une bonne et une mauvaise : elle oppose l’histoire de la philosophie et la philosophie elle-même, comme si la première était indifférente à la teneur philosophique des problèmes dont elle étudie la constitution, et la seconde indifférente à l’historicité des concepts qu’elle utilise (ce qui fut, un temps, le cas d’une philosophie dite analytique). Or c’est une opposition mal fondée : les histoires sans concept sont aveugles, les concepts sans histoire sont creux. Il est tout à fait illusoire d’imaginer qu’on va comprendre quelque chose à l’Éthique de Spinoza si on ne se réfère pas à l’histoire cartésienne du concept de substance, et donc au problème de l’attribut essentiel. Or le métier de l’historien, tel que je le conçois, est bien de faire l’histoire génétique de ce problème : quand, comment et pourquoi Descartes a-t-il radicalement modifié la définition de la substance, en donnant à l’attribut le privilège exorbitant de « constituer l’essence de la substance » ? J’ai proposé de répondre à cette question en recentrant toute la problématique cartésienne sur l’énoncé protocolaire : « l’étendue est l’essence du corps » (Le Monde, AT XI, 36), et je suis convaincu que Descartes n’a pas pu établir les « fondements de la physique » (dont cet énoncé est le principal) sans se confronter à Kepler, qui l’a dit, en 1621, dans des termes d’une précision inédite : « soliditas est genuina materiae idea » (« la tridimensionnalité est l’idée pure de la matière »). Affirmer l’existence d’une « idée de la matière » est déjà en soi une complète révolution ; pourtant, Descartes va encore plus loin que Kepler, puisqu’il ne se contente pas de l’affirmer, comme une simple supposition, mais il entreprend de le déduire : en prouvant que les idées claires et distinctes sont vraies, on pourra alors démontrer que l’idée de l’étendue est celle d’une chose étendue, qu’on appelle le corps. Bref, ce qui intéresse l’historien de la philosophie, c’est la série de transformations qui, dans l’exemple cité, mène, via Descartes et Spinoza, de Kepler à Newton, et à la spatialisation de l’essence divine.
Si j’ai pris cet exemple, c’est aussi pour vous répondre sur le « cas » Alquié. En remplaçant l’énoncé déterminant et effectivement cartésien : « l’étendue est l’essence du corps » par cet autre, qui dit à peu près le contraire : « l’objet n’est pas l’être » — énoncé qu’Alquié imagine avoir été l’intuition philosophique de Descartes en 1630, et son ‘chemin de Damas’ — qu’a-t-il apporté à l’intelligence des lettres à Mersenne de 1630 ? Cette « nostalgie de l’être », énoncée dans un style plus kantien que cartésien, et donc parfaitement anachronique, n’a en fait aucun rapport avec le questionnement et la démarche de Descartes à ce moment décisif de son itinéraire. Cela n’ôte pas au livre de Ferdinand Alquié (La découverte métaphysique de l’homme chez Descartes, PUF, 1950) son intérêt et sa saveur, mais ce n’est pas sans raison que j’ai pris, souvent, le contrepied de ses positions. Encore une chose : Alquié tenait que le métier d’historien de la philosophie consiste à réactiver des « structures de pensée » ou des « structures mentales », plus qu’à étudier des corpus et à éplucher des textes. Un « cartésien » peut donc, en toute logique, être aussi cartésien que Descartes lui-même, s’il en a identifié et épousé les « structures de pensées » qui sont universelles ou du moins universalisables. Il peut, par exemple, douter de l’existence des corps dans la Première Méditation, performer le cogito dans la Seconde, et découvrir l’idée d’infini dans Troisième. Je vais vous dire mon sentiment : tout cela ne me paraît pas sérieux. Ces « structures » ne sont au mieux que l’hypostase d’un artifice pédagogique. Nous n’avons pas besoin de devenir nous-mêmes Descartes ou Spinoza pour comprendre leurs philosophies, et c’est tant mieux car si tel était le cas nous n’aurions, si vous me permettez, jamais rien compris à rien.
AP : Sans me faire l’avocat d’Alquié, je pourrais préciser que ce dernier aurait sans doute partagé votre propos de départ, à savoir le refus d’opposer philosophie et histoire de la philosophie ; de surcroît, je crois que les éditions qu’il a données des œuvres de Descartes et de Kant montrent sa grande attention aux corpus ; il me semble simplement qu’il chercha sans cesse à rappeler que les textes n’étaient pas sans auteurs et que les textes n’étaient qu’un réceptacle et non un point de départ.
Cela étant dit, il est un élément que je n’ai pas encore abordé mais qui apparaît comme évident à mesure que se clarifie votre démarche, à savoir votre rapport plus que distant à l’endroit de l’histoire heideggérienne de la métaphysique, laquelle est pourtant en partie historiciste quoiqu’en autre sens que le vôtre. En effet, en réancrant la pensée cartésienne au sein d’un contexte concret et réel, vous êtes du même geste automatiquement amené à refuser aussi bien la segmentation de l’histoire en autant de « moments » ou de « points de départ » que l’unilatéralité de leur contenu. Je cite longuement un passage de l’introduction de Descartes et la fabrique du monde :
« Un sujet réduit au pouvoir de connaître, « isolé et sans monde » (Heidegger), et un monde fantomatique, réduit à la structure même du représenter, voilà tout ce que la philosophie aurait reçu en fait d’héritage cartésien. Ces lectures, quoique parfois teintées d’un sensationnalisme assez pauvre, issu de la dégénérescence du Sturm und Drang, ont bien une logique et un intérêt propres, mais elles sont grevées de présupposés qui les rendent incapables d’appréhender l’histoire de la « raison classique » par ses causes prochaines et ses ressorts internes. (…).
Comment peut-on ramener et réduire l’entreprise métaphysique de Descartes à la position d’un sujet « isolé et weltlos » ? Il n’y a, pour ce faire, qu’à isoler les énoncés et philosophèmes cartésiens d’un contexte et d’un horizon de sens formé par le dialogue qu’entretiennent constamment, à l’âge classique, philosophie, science de la nature et théologie[9]. »
Je vous rejoins naturellement sur cette critique, et j’aimerais vous soumettre une hypothèse : on trouve dans nombre de lectures heideggériennes un présupposé étrange quoique constant, à savoir que le déploiement même de la réalité se laisserait ramener à un déploiement de l’histoire de la métaphysique, ce qui dispense les auteurs de ces lectures de toute connaissance positive puisque la compréhension de la réalité leur est presque magiquement donnée par la compréhension de l’histoire de la métaphysique, laquelle serait universellement explicative. A ce titre, je ne suis pas sûr qu’ils « isolent » les énoncés philosophiques en général ou cartésiens en particulier ; il me semble plutôt qu’ils font des énoncés philosophiques le sens même du cours du monde, et qu’au regard de pareille explication, tout le reste paraît secondaire et inessentiel. Autrement dit, s’il y a vraiment du destinal, si l’Etre s’est par exemple véritablement destiné comme essence de la Technique dans le Gestell, alors cette dimension destinale de l’Être soustrait le lecteur à toute exigence de connaissance positive de ce que signifie la technique, puisque l’essence même de la Technique est comprise à partir de l’histoire de la Métaphysique et à partir d’elle seulement. Or, je crois qu’il en va de même dans leur compréhension de tout énoncé philosophique : quand un énoncé philosophique acquiert une portée destinale, la connaissance positive d’un contexte apparaît profondément superfétatoire et la connaissance positive perd toute pertinence et toute utilité.
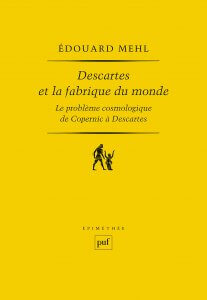
EM : Tout à fait d’accord ! Cela dit, votre analyse me suggère une ou deux remarques complémentaires. La première est que je ne crois pas que ce travers caractéristique soit spécifiquement lié à l’Histoire de l’Être dont parle Heidegger. Il y a au fond deux manières de lire les philosophes : ou bien on s’intéresse à ce qu’ils disent, ou bien l’on considère plutôt ce qu’ils font que ce qu’ils disent. S’agissant de Descartes, la première manière se trouve illustrée, entre autres, chez des commentateurs bien intentionnés et honnêtes, comme Antoine Arnauld, Henri Gouhier, Jean-Marie Beyssade, ou Denis Kambouchner. C’est une manière sobre et raisonnable d’analyser et d’expliquer le discours de la philosophie pris à la lettre. L’autre manière se trouve parfaitement incarnée, dans toute son outrance, par le jésuite Bourdin, auteur d’une diatribe que Descartes a eu la malice de publier avec la seconde édition des Meditationes. On la retrouve chez Heidegger, surtout à partir de ce moment parfaitement datable que constitue sa lecture de Nietzsche, et le projet de l’Überwindung der Metaphysik. C’est le moment où, effectivement, chez Heidegger, la métaphysique cesse de devenir un point de vue théorique, fait d’énoncés sur le réel, pour se muer en ce réel lui-même :
« Que la métaphysique soit passée, dit Heidegger, n’exclut pas mais implique au contraire que ce soit seulement de nos jours que la métaphysique arrive à sa domination absolue, au sens de l’étant lui-même et en tant que celui-ci, sous la forme dénuée de vérité du réel et des objets »[10].
Il faudrait analyser de plus près la logique de cette transformation, et la trame narrative d’une histoire qui fait de la cécité ontologique de Descartes le symptôme et le prodrome au nihilisme européen. Ce n’est pas tellement le lieu de le faire ici. Mais je trouve qu’il y a aussi beaucoup de cette manière chez le Foucault de l’Histoire de la Folie. Selon cette lecture, plus attachée à percevoir des symptômes qu’à déchiffrer des énoncés, peu importe ce que dit Descartes, puisqu’au fond il ne sait pas ce qu’il fait, ou plus exactement il ne sait pas qu’il se fait clandestinement dans le discours philosophique quelque chose qui n’y est pas dit.
J’ai comme vous une réticence de principe par rapport à ce type d’approche, qui laisse d’ailleurs complètement dans l’ombre des pans entiers de la généalogie de la modernité : Nicolas de Cues, Copernic, ou Spinoza sont les grands absents d’une fresque qui surdétermine (négativement) la figure de Descartes. C’est une des raisons pour lesquelles mes deux ouvrages tentent, chacun à leur manière, de desserrer un peu l’étau dans lequel l’onto-théologie emprisonne Descartes. Dans Descartes en Allemagne, je me suis intéressé aux affinités spéculatives qui réunissent les deux pensées majeures de l’infini, que sont celles de Nicolas de Cues et celle de Descartes. Dans la Fabrique du Monde, j’ai tenté une autre approche. Insistant sur le fait que les preuves par les effets de la Méditation III n’atteignent pas Dieu sous la figure conceptuelle et purement logicisée de l’ens a se ou causa sui, mais comme (sur-)puissance créatrice, j’ai porté beaucoup d’attention au fait que la Méditation IV a bien une portée cosmologique, quoiqu’encore indéterminée, en ce que l’ego se comprend désormais comme ayant la « raison de partie » dans l’immensité des choses qui, prises dans l’universelle création, sont toutes ensemble « très parfaites ». Au lieu de faire de l’homme la raison de la création, et ce en vue de quoi le monde lui-même est créé, Descartes ne reconnaît à l’ego que le statut de partie ou « particule », indéfinie, sans privilège particulier, noyée dans l’immensité d’un monde auquel il est impossible d’assigner aucune limite. C’est dans cette inflexion terminologique, discrète, et à laquelle Heidegger, comme beaucoup d’autres, n’a prêté aucune attention, qui ouvre, avec Descartes, l’espace de la modernité.
AP : Si vous le voulez bien, je souhaiterais aborder un autre aspect méthodologique lié à votre approche. Dans Descartes en Allemagne, vous interrogez de manière passionnante le rapport de Descartes aux Rose-Croix, et vous le faites sous un angle historique. Historiquement parlant, le problème est en effet de déterminer si Descartes a gravité autour de Cassel, s’il a pu connaître les débats qui s’y tenaient et si ceux-ci ont joué un rôle notamment en 1619 mais aussi dans la genèse de la rédaction des Regulae. Sont en jeu naturellement aussi bien le statut des songes de 1619 que l’importance de conduire sa pensée par ordre. Or, si vous montrez que Descartes a fort probablement connu les textes hermétiques de l’époque, vous défendez la thèse qu’il a aussi souhaité marquer ses distances à l’endroit de l’enthousiasme magique et, compte-tenu du contexte, d’emblée marquer ses distances à l’endroit des textes dits rosicruciens.
Je suis assez d’accord avec vous mais je me demande si l’on ne peut pas parvenir au même résultat par des voies plus économiques : si l’on admet comme vous le faites une certaine continuité dans l’œuvre de Descartes, alors il est possible de déterminer si je puis dire a priori le refus cartésien de l’hermétisme et de l’approche magique du monde : rien que l’idée de méthode chère à Descartes se situe aux antipodes de ce que peut admettre un hermétiste puisque la méthode suppose une sorte de distance entre l’esprit et son résultat et récuse en son principe même la coïncidence avec la chose. Plus encore, l’approche mécaniste cartésienne qui condamne le physicien à ne saisir la nature que selon des relations de causalité externes et mesurables renonce à toute intériorité de la nature, et prend le contre-pied exact de ce que supposait le déchiffrement paracelsien du grand livre de la Nature. Lorsque Roland Edighoffer affirme que la vision hermétique de la nature est infiniment « différente de celle qui, à partir de Galilée et de Descartes, va considérer la nature comme un objet et l’homme « comme un maître et possesseur » (…)[11]. », il parvient au même résultat que vous mais par une voie si je puis dire plus simple. Et sa précision mérite d’être citée :
« Pour les Rose-Croix, comme pour Paracelse, l’homme n’est pas un sujet extérieur à la nature, il est lui-même nature, et la nature cherche à se connaître en l’homme. Ainsi s’établit la complicité nécessaire à la compréhension des signes[12]. »
Que la pensée cartésienne soit aux antipodes de la pensée hermétique, cela se déduit de l’analyse même de la comparaison entre les deux pensées. A cet égard, qu’apporte de plus, du point de vue philosophique, une approche historique de cette question ?
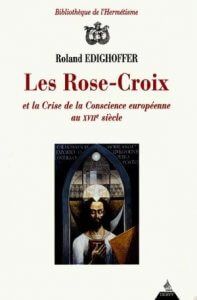
EM : Vous m’offrez ici l’occasion de revenir sur un point qui a parfois été assez mal compris dans mon Descartes en Allemagne. D’abord, si j’ai beaucoup travaillé sur le sujet des Rose-Croix, c’est parce qu’on a raconté, de très longue date, beaucoup de sottises à ce sujet ; la plupart ressortissent à une vision complotiste de l’histoire de la philosophie pour laquelle je n’ai aucune sympathie. L’existence de cette société secrète et la rumeur selon laquelle Descartes aurait fréquenté l’un ou l’autre de ses membres obéissent à la logique des « fake news » : moins on en sait, plus on en dit. Tout ce que dira Descartes (Studium bonae mentis), avec sa désarmante franchise, c’est qu’il n’en peut rien dire, puisqu’il n’en sait rien. Mais les complotistes n’ont pas désarmé, et comme leurs insinuations ne reposent sur rien que des rumeurs et des imaginations sans fondement, elles sont presque irréfutables. Je me suis donc donné beaucoup de mal pour documenter la question et la résoudre « une fois pour toutes ». A ma grande surprise, je me suis rendu compte que les choses étaient à la fois moins simples et plus intéressantes que je ne l’avais d’abord cru. D’abord, grâce aux travaux de l’infatigable Carlos Gilly, on pouvait se faire une idée beaucoup plus précise de la nature, des causes, et de l’étendue d’un phénomène qui a galvanisé l’Europe dans les années précédant immédiatement la guerre de Trente Ans. J’ai donc commencé par apprendre beaucoup de choses que j’ignorais, en dépouillant un corpus désespérant, fait d’une myriade de pamphlets anonymes qui s’attaquent et se contrattaquent, l’assaillant prenant parfois, par jeu, le nom de l’adversaire… Ensuite, il m’est apparu que ce que l’opposition entre le rationalisme classique et ce que vous appelez l’« approche magique du monde » n’est pas du tout aussi claire et tranchée qu’on peut le croire, à lire Lenoble (Mersenne ou la naissance du mécanisme) ou Les mots et les choses de Foucault. Aujourd’hui encore, je m’interroge sur la connaissance que Descartes pouvait avoir de commentaires paracelsiens sur la Genèse, qui offraient, quoi qu’il en soit, des alternatives plausibles au modèle cosmologique aristotélicien des sphères solides. Donc ce qu’il est ressorti ce labeur (plein de scories que j’ai moi-même, par bonheur, tendance à oublier), c’est qu’il faut justement faire cette descente aux enfers, en deçà de l’opposition entre science et magie, si l’on veut se donner une chance de comprendre la provenance de la science moderne. Trithème, Agrippa, Paracelse, Cardan, della Porta, pour ne citer que quelques noms dans une liste immense, n’étaient pas des arriérés, et je doute que, sans eux, nous eussions eu des Kepler et des Descartes. Mais le vent de la Contre-Réforme a soufflé fort, et peut-être bien que cette idée d’une césure radicale entre Renaissance et âge classique est une idée trop catholique, au sens confessionnel du terme, pour être vraiment « catholique » au sens propre et littéral du terme…
AP : Une dernière question à ce sujet, si vous le voulez bien, me hante quand il est question de l’hermétisme. Il y a dans toute approche hermétique une défiance totale à l’endroit de l’écrit et une préférence très marquée pour l’oralité qui est bien plus conforme à l’idée de transformation intime et intérieure des voies hermétiques que l’écrit, par nature extérieur et presque étranger à l’individu. L’initiation est toujours orale, et ce qui se transmet oralement n’a jamais à être écrit ; mais nous, historiens de la philosophie, nous sommes condamnés à ne pouvoir nous rapporter qu’aux écrits, donc à la partie la plus médiocre de ce qui concerne l’hermétisme. On retrouve au fond avec la pensée hermétique la condamnation platonicienne de l’écriture, Platon lui-même n’écrivant jamais l’essentiel, c’est-à-dire n’écrivant jamais le contenu des Idées, se contentant de dire en quoi elles ne consistent pas. Seule l’intime expérience d’une âme, par une voie dialectique, peut réellement comprendre de quoi il est question et aucun écrit ne saurait en restituer la teneur.
Dans ces conditions, une approche universitaire de la question hermétique n’est-elle pas alors condamnée à manquer son objet, dans la mesure où, tributaire du matériau écrit, elle ne peut saisir le cœur de l’hermétisme qui est par nature oral ? Et je tire de cela une seconde question : si Descartes fut peut-être amené à entrer en relation avec une société secrète – ou discrète –, ne serait-ce pas un préjugé que de considérer que les écrits de ladite société secrète seraient globalement similaires à ce que les membres de cette Société auraient pu dire oralement à Descartes ? Peut-on en somme passer légitimement de la publicité de l’écrit à l’intimité discrète de l’oralité ?
EM : Il y a plusieurs étages dans votre question, à laquelle je suis tenté de répondre évasivement que ce dont on ne peut parler… il faut le taire. Mais comme les philosophes sont bavards, et que nous n’avons pas tous la sagesse de Pythagore, je ferai ici une remarque, qui ne concerne pas la tradition hermétique, mais l’appartenance de Platon à cette tradition. Je ne sais pas d’où vient exactement l’idée que Platon ne dit pas le contenu des Idées, mais je dois confesser que je ne l’ai jamais compris ainsi. Pour moi, l’Idée est ce qui est énoncé par la définition, et Platon est celui qui a cherché les définitions dans les choses humaines, comme ses prédécesseurs ont cherché les définitions des choses naturelles. Permettez-moi de faire ici un peu d’ironie : les Rose-Croix sont un sujet sur lequel on n’a pas cessé d’écrire et de publier. Leur enseignement oral ou ésotérique n’est pas un mythe : c’est surtout une excellente recette d’imprimerie !
AP : Sans mauvais jeu de mots, il me semble que vous donnez ici l’Idée de l’Idée mais nullement le contenu spécifique des Idées. Je ne vois nulle part chez Platon de textes où il donnerait la définition spécifique du Beau, du Vrai ou du Bien. Il montre la nécessité de leur être mais nullement ne dit ce que signifient de telles Idées. On a de vagues allusions, faisant signe vers quelque chose comme une harmonie mais rien de plus.
B : La « question copernicienne » et Kepler
AP : Je reviens à présent à une citation initiale, celle par laquelle vous affirmiez qu’avant de devenir « cartésien », Descartes dut devenir « copernicien », citation conditionnant donc l’identité de la pensée cartésienne à une sorte d’incorporation du copernicianisme. Mais que signifie être copernicien ? Est-ce réductible à la seule question de défendre une position héliocentrique à l’endroit d’un cosmos d’ailleurs maintenu clos et ordonné ?
EM : C’est là une question centrale, à laquelle il ne sera pas possible de vous donner, dans les limites de cet entretien, une réponse claire et univoque. Je partirai de votre question elle-même, qui est habilement formulée, et qui, me semble-t-il suggère fortement la réponse : à l’évidence, non, être copernicien ne se résume pas à l’adoption de l’hypothèse héliocentrique dans un monde « maintenu clos et ordonné ». Pour rester succinct, disons deux choses : d’une part, Copernic n’a pas fait le choix d’un modèle cosmologique contre un autre, comme s’il s’agissait de déclarer sa préférence pour celui des deux qui lui paraît le plus élégant et le plus économique, toutes choses égales par ailleurs. Chez Copernic, il y a une exigence de motivation beaucoup plus stricte et plus impérieuse : plus qu’à l’hypothèse héliocentrique elle-même, Copernic s’attache surtout à montrer ce qui rend nécessaire le passage des « anciennes » aux « nouvelles » hypothèses. Or pour saisir ces raisons nécessaires, il faut commencer par explorer systématiquement les failles du modèle cosmologique standard, et pour cela il faut faire de l’astronomie, c’est-à-dire des mathématiques. Donc, être copernicien, ce n’est pas seulement adopter l’hypothèse héliocentrique, c’est savoir en plaider la cause au « tribunal des mathématiques », seule autorité compétente pour trancher la question. En ce sens, ma première réponse serait de dire qu’être copernicien c’est ramener toutes les disputes des philosophes devant ce « tribunal », et donc, inversement, destituer les « philosophes », physiciens et/ou métaphysiciens, de toute compétence en la matière. Deuxième point : on a dit, depuis quelques décennies, que Copernic n’était pas révolutionnaire, et qu’il était même « conservateur » ; on a pu dire que le diagramme de ses hypothèses ressemble à s’y méprendre à celui de Ptolémée, la seule différence entre les deux étant la permutation des positions de la Terre et du Soleil. Pour le reste, c’est un monde clos, fait d’un emboîtement de sphères solides et impénétrables. Certains ont même été jusqu’à soutenir que Copernic aurait pu exister à la fin de la période hellénistique, tant son outillage conceptuel et sa praxis observationnelle sont proches de l’astronomie alexandrine des premiers siècles de notre ère (cf. le film Agora d’Alejandro Amenabar, qui prête à Hypatie d’Alexandrie des opinions coperniciennes, et même plus que cela, puisque sa connaissance des sections coniques d’Apollonius lui fait anticiper la première loi de Kepler et la trajectoire elliptique des planètes !). Mais c’est oublier que le passage aux hypothèses coperniciennes a pour conséquence nécessaire un agrandissement démesuré du cosmos, puisque Copernic doit faire reculer les étoiles fixes jusqu’à cette distance extrême où, comparée à elle, la distance Terre-Soleil devient comme nulle. La théorie copernicienne ne peut donc aller sans la prise de conscience de ce que Pascal appellera, plus tard, la « disproportion de l’homme ». L’onde de choc de la révolution copernicienne s’étend bien au-delà des limites de l’astronomie mathématique. Il n’y a aucun domaine du savoir qui ne soit directement ou indirectement concerné.
AP : Quand on lit Descartes en Allemagne et Descartes et la fabrique du monde en parallèle, on peut avoir l’impression que le premier insiste sur le versant philosophique du copernicianisme tandis que le second envisage la manière dont s’impose un fondement cosmologique de l’astronomie en même temps que le besoin d’une réponse générale à un problème particulier. En dépit de ce partage, on sent bien qu’il y a à chaque fois plus que l’un et l’autre dans chacun des deux aspects. Je me permets de citer deux passages que je trouve caractéristiques, en commençant par Descartes en Allemagne :
« La révolution copernicienne, c’est bien d’assumer dans ses dernières conséquences que la connaissance vient du connaître, que l’objet se règle sur la structure de la connaissance et non la connaissance sur la structure ou l’essence de la chose. Cette révolution relève de l’ontologie dans la mesure où l’ego déploie à partir d’elle une épistémologie qui « vise à une ontologie de l’étant en tant qu’objet »[13]. »
Et voici votre hypothèse dans Descartes et la fabrique du monde :
« Notre hypothèse est que l’héliocentrisme n’est pas d’abord né d’une intuition pré-scientifique de l’ordre du monde, mais qu’il s’est imposé à Copernic pour résoudre l’embarras et la crise née de l’incapacité de l’astronomie à proposer un modèle géométrique cohérent du mouvement des étoiles fixes, en accord avec des observations dont on ignore même si elles sont fiables ou non[14]. »
Vous parlez souvent de la question copernicienne ; est-elle en jeu dans ces deux aspects et que désigne-t-elle ? Est-ce une question épistémique sur le fondement de la connaissance, une réflexion astronomique sur le problème des étoiles fixes, une manière générale de penser une cosmologie à partir du mouvement des étoiles fixes rapporté au mouvement de la Terre, ou est-elle les trois à la fois ? Mais si ce sont ces trois aspects à la fois qui caractérisent la question copernicienne, en quoi participent-ils de la même question ?
EM : Rien ne vous échappe ! Merci pour cette question qui nous propulse au cœur de ma problématique, et de ce que j’appelle en effet souvent la « question copernicienne ». Il y a au moins deux sens de la révolution copernicienne : le premier (1°) est celui que retiennent les historiens des sciences ; il a son foyer dans le bouleversement qui, avec et après Copernic, arrive dans le champ de l’astronomie mathématique et aboutit, cent ans plus tard, au renouvellement complet du modèle cosmologique, avec toutes les conséquences anthropologiques et philosophiques que l’on sait. Le second (2°) est celui des philosophes : à la suite de la célèbre image employée par Kant dans la Préface à la seconde édition de la Critique de la Raison Pure, la « révolution » désigne le fait de dériver de la « subjectivité » prise comme point fixe et immobile les conditions de possibilité de la connaissance des objets. J’appelle donc « question copernicienne » la question de savoir quel est de ces deux sens celui qui précède l’autre et en décide. Mon premier essai, D. en Allemagne, ne pose pas cette question. Il est beaucoup plus naïvement dogmatique que le second, et se contente, en gros, de répéter la lecture néo-kantienne de Descartes, qui voit elle-même dans les Règles pour la Direction de l’esprit une anticipation du criticisme kantien : primauté de l’intellectus sur les « choses à connaître », car la connaissance des choses présuppose celle de l’entendement, non l’inverse (cf. Règle VIII). Donc, D. en A. ne doute qu’il y ait, avec Descartes, une révolution copernicienne au sens 2°. Mais, dès que l’on commence à poser la « question copernicienne » au sens que l’on vient de dire, la pertinence et même l’utilité de cette lecture deviennent sujettes à caution. Ce en quoi les deux sens de cette révolution copernicienne » – le « propre » et le « figuré » – participent d’une même question, c’est, sans aucun doute, la double question de l’a priori et de la certitude (des) mathématique(s). Il y avait sur ce plan un malentendu total entre Copernic et ses contemporains : ceux-ci considéraient que l’astronomie était une science mathématique, mais elle n’était que mathématique, c’est-à-dire qu’elle ne proposait que des modèles explicatifs déconnectés de toute référence à l’explication causale des mêmes phénomènes – celle que doit fournir la physique. Or Copernic raisonne de manière diamétralement opposée, puisqu’à ses yeux seules les mathématiques offrent un savoir rigoureux et démonstratif. Partant il n’y a selon lui aucun espoir d’atteindre sans leur secours un quelconque savoir à l’égard des causes, ni aucune certitude quant à la vérité des hypothèses. C’est cette attitude qui définit le style de pensée copernicien, et qui, à terme, donne à Descartes la conviction qu’il peut atteindre « des démonstrations a priori de tout ce qui peut être produit en ce nouveau monde » (Monde, AT XI, 47).
AP : Au sujet de Descartes, vous parlez d’un « hypercopernicianisme cartésien »[15] que vous explicitez en montrant 1) que la question héliocentrique n’est plus traitée comme une question astronomique, 2) que l’immensité est assumée comme telle chez Descartes et rapportée à Dieu. Or, cette caractérisation intervient après une très convaincante analyse de l’idéalisation du réel que vous soustrayez à une sorte de laïcisation de la science moderne – analysée par Blumenberg – pour mieux en restituer les soubassements théologiques et traditionnels. Être « hypercopernicien », est-ce dans ces conditions, en plus des deux points que vous soulevez directement, être plus conforme encore au canon religieux que ne le fut le chanoine Copernic (si vous me passez le jeu de mots) ?
EM : « Hypercopernicien » veut simplement dire que Descartes a eu l’audace de supprimer la sphère des étoiles fixes, là où Copernic, bien qu’il ait dû démesurément agrandir le monde (pour rendre compte de l’invisibilité du mouvement annuel de la Terre, cf. supra), continuait de l’« enfermer dans une boule ». Car Copernic, rappelons-le, laissait aux théologiens le soin d’examiner si le monde est fini ou infini, et se refusait de trancher toute question portant sur ce qu’il y a au-delà de l’« orbe étoilé ». Selon toute apparence – et selon ce que rapporte son disciple Rheticus – Copernic semble avoir considéré que l’Écriture elle-même n’enseigne rien sur la nature des cieux que les théologiens imaginent se trouver au-dessus du firmament stellaire (cristallin, empyrée). Cette attitude de défiance, sinon de scepticisme, par rapport aux spéculations théologiennes le rapproche d’ailleurs dangereusement de Luther, et ce motif explique peut-être la réaction d’emblée hostile des théologiens catholiques à l’égard de son œuvre (e. g. le dominicain Giovanmaria Tolosani, qui fut chargé d’examiner le De Revolutionibus aussitôt après sa publication – Tolosani fait remarquer que l’immobilité est une propriété du ciel empyrée, mais en l’attribuant au ciel sidéral, comme le fait Copernic, on rend l’existence d’un ciel suprême inutile et incertaine).
Sur le plan astronomique, il y a eu des avancées considérables après Copernic, qui justifient parfaitement l’audace du geste cartésien : la théorie des comètes de Tycho Brahe, l’arrivée de la lunette astronomique, Bruno, Galilée, et Kepler, pour ne rien dire ici des idées cosmologiques d’Isaac Beeckman, mentor de Descartes : tout ceci militait en faveur de la suppression de cette sphère des étoiles fixes, dont le maintien devenait, au fur et à mesure des nouvelles avancées scientifiques, de plus en plus arbitraire. Toutefois, en dépit de son apparente assurance, et en dépit de l’apparente linéarité du progrès de la science classique (de Copernic à Newton), l’astronomie de Galilée ou Descartes s’est développée dans l’ignorance radicale des véritables dimensions du cosmos, qu’aucune observation ne permettait de déterminer. Toute détermination de la distance des étoiles fixes ne pouvait être que supposition ou spéculation. La thèse que je défends tout au long de la Fabrique du monde, est que Descartes ne s’appuie pas seulement sur l’ordre des raisons astronomique, mais qu’il s’appuie, comme sur une deuxième jambe, sur une étude des aspects strictement théologiques du problème – au sens, bien sûr, de la théologie scripturaire. Sur ce versant de la question, Descartes a remarqué (à la suite de Campanella et de Mersenne), qu’aucun concile n’a jamais formellement statué sur la question de l’infinité du/des monde(s). Il y a là comme un vide doctrinal ; c’est pourquoi, en prenant position en faveur d’un monde infini ou simplement indéfini, Descartes pense ne pas heurter les « fondements de la religion chrétienne » (ce que craint Christine de Suède) : il contredit seulement le préjugé commun selon lequel la finitude spatiale et temporelle du monde est un article de la foi catholique – ce qui est positivement faux. Mais Descartes ne s’est pas contenté de cet aspect seulement critique : il s’appuie également sur son propre commentaire de la Genèse, qu’il pensait joindre aux Méditations pour le soumettre aux théologiens de Sorbonne. Ce texte est perdu, comme vous l’avez dit tout à l’heure, mais on peut en reconstituer l’essentiel, qui portait selon toute vraisemblance sur la compatibilité de la formule cartésienne « l’étendue est l’essence du corps » avec le stereoma / rakhia / firmamentum de la Genèse. Nous n’allons peut-être pas nous replonger ici dans la reconstitution de ce problème philologique, mais nous pouvons nous contenter de la conclusion : le « firmament » céleste n’est pas un corps, mais c’est la superficie du corps, et c’est sur cette superficie que nous voyons apparaître, comme à travers une lentille convexe, toutes les étoiles des tourbillons adjacents. Donc oui, Descartes a fait par rapport à Copernic une avancée majeure vers l’immensité cosmique, et il a montré que c’était là théologiquement parfaitement justifiable. Dans le contexte de l’affaire Galilée, c’est un effort considérable qui est aujourd’hui très largement sous-estimé par les historiens des sciences.
AP : On a souvent remarqué – et vos réponses antérieures l’illustrent amplement – que la position copernicienne dépassait de beaucoup la question de l’héliocentrisme qui, d’ailleurs, avait été défendue de manière précoce par de nombreux platoniciens, dont Aristarque de Samos, ou quelques penseurs indiens puis arabophones. Dans un article assez remarquable[16], Maurice Clavelin a ainsi montré que la révolution copernicienne, loin de se ramener à la seule question de l’héliocentrisme, avait concerné une révolution principielle impliquant notamment l’intervention de Tycho Brahé et Kepler. Or vous-même, notamment dans la préface de la seconde édition de Descartes en Allemagne, pointez l’importance cruciale de la « question copernicienne » au moment où Kepler publie l’Harmonice Mundi. Quel rôle exact joua Kepler dans la question copernicienne ?
EM : Le rôle de Kepler est de toute première importance ; on ne saurait l’ignorer, ni feindre que Descartes ait pu l’ignorer lui-même, alors même qu’il a explicitement reconnu avoir eu Kepler pour « maître en optique ». D’abord, Kepler est celui qui a voulu démontrer l’héliocentrisme copernicien par des raisons entièrement a priori — ce qu’il pense avoir fait dans son opuscule de jeunesse, qu’on appelle traditionnellement le Mysterium Cosmographicum, mais que je préfère appeler de son titre plus exact et authentique : De admirabili proportione orbium cœlestium (1596). Ensuite, Kepler a provoqué un véritable séisme dans l’architectonique des savoirs en faisant de l’astronomie une science physique, ou la physique du ciel. C’est l’Astronomia Nova seu Physica cœlestis (1609). Enfin, en 1619 paraît l’Harmonice Mundi, au lieu et au moment précis où Descartes se trouve en Allemagne pour les fêtes du couronnement de l’Empereur Ferdinand, successeur de Matthias. Le dernier livre de l’Harmonice Mundi, rajouté après-coup, contient un des résultats les plus glorieux de toute l’histoire des sciences à l’époque moderne : l’énoncé de ce qu’on appellera plus tard la « troisième loi de Kepler » ou loi des temps périodiques, qui énonce le rapport déterminé entre les temps de révolution des planètes et leur distance par rapport au Soleil, foyer de leurs orbites elliptiques. Kepler donne par là, enfin, un sens mathématiquement déterminé au théorème copernicien de l’harmonie du monde. En effet, Copernic avait soutenu que seule la disposition héliocentrique des corps célestes permettait de percevoir ‘l’admirable symétrie du monde, et le lien de l’harmonie entre le mouvement et la grandeur des orbes’. En 1596, Kepler était déjà convaincu de cette parfaite proportion, et le recours à la théorie purement mathématique des solides réguliers de la géométrie euclidienne, déjà, lui avait servi pour déterminer a priori le rapport des distances entre les corps célestes. Cela dit, à cette époque, il demeurait lucide et bien conscient qu’il n’avait pas encore trouvé l’expression mathématique exacte et déterminée du rapport entre les distances et les temps périodiques, et c’est ce qu’il a découvert au printemps de l’année 1618, dans un état d’euphorie confinant à l’enthousiasme. Enthousiasme que je pense avoir été communicatif.
AP : Vous analysez longuement la relation de Descartes à Kepler, tout en notant qu’on ignore beaucoup de choses quant à cette dernière. Mais, en vous appuyant sur le texte intitulé Epitome de l’Astronomie copernicienne, notamment sur sa Quatrième partie, vous montrez que se trouve chez Kepler une recherche de bases rationnelles a priori que d’ailleurs vous interprétez comme un héritage de Nicolas de Cues. De ce fait, il semble que tout converge vers l’idée qu’à partir de questions astronomiques s’élabore une réflexion épistémologique beaucoup plus large que le simple problème de départ…
EM : La première partie de l’Epitome, publiée en 1618, a été mise à l’Index en mars 1619, sur l’intervention personnelle de Francesco Ingoli, un des premiers censeurs de Galilée en 1616. Kepler n’est donc pas en odeur de sainteté du côté de Rome, c’est le moins qu’on puisse dire. Il persiste pourtant, et publie séparément le livre IV en 1620 (à Linz), et enfin les livres V, VI et VII, l’année suivante (1621) — avec privilège impérial. La situation personnelle de Kepler est très compliquée au cours de ces années : il vit dans un pays en guerre, son statut de mathématicien impérial n’a pas été confirmé après l’accession au trône de Ferdinand, il est enferré dans le procès en sorcellerie qui vaut à sa mère de longs mois d’emprisonnement, il est exclu de la communion par les théologiens de Tübingen, harcelé par les héritiers de Tycho Brahe… Et pourtant ces circonstances chaotiques ne font qu’accroître sa productivité ! Sur l’héritage cusain de Kepler, je ne suis pas certain que cela soit décisif, car en dehors des premiers chapitres du Mysterium Cosmographicum, il n’en parle presque jamais. Mais je suis bien d’accord avec vous pour dire que la question locale du mouvement de la Terre est replacée dans un cadre beaucoup plus large, qu’on peut définir comme la question des structures mathématiques de la réalité physique : comment est-il possible que le grand livre de la nature soit écrit en langage mathématique ? C’est à cette question que Descartes tente de formuler une réponse dans les fameuses Lettres à Mersenne sur la création des vérités éternelles, dont j’espère que nous aurons l’occasion de reparler, car elles sont effectivement le cœur métaphysique de la « question copernicienne ».
AP : Voyez-vous dans l’usage cartésien de la forma corporea un héritage de la notion keplerienne d’harmonie ?
EM : Absolument, je persiste et signe ! J’avais été frappé il y a vingt ans, alors que je n’avais encore qu’une connaissance très superficielle du corpus keplérien, par un air de famille entre les notes du registre en parchemin et les écrits de Kepler. En particulier deux notes, qui n’en font peut-être qu’une, mais que les éditeurs ont séparées par un alinéa (AT X, 218, 6-14 : « Una est in rebus activa vis…. » ; « Omnis forma corporea agit per harmoniam… »). Je maintiens (contre Gouhier, qui ne voulait y voir que des « pensées d’écolier ») que ces notes ont probablement été écrites en marge de la lecture de la quatrième partie de l’Epitome (parue en 1620), qui emploie effectivement le concept de « forma corporea », qui n’est pas la forme du corps, comme dans l’hylémorphisme aristotélicien, mais bien la forme dans le corps, c’est-à-dire sa force active, et, en l’occurrence, l’attraction-répulsion que le Soleil exerce sur les planètes : « Una est actio seu ἐνέργεια naturalis, movendi corpus planetae… » (Epitome IV, GW 7, 333, 22). Ce que signifie précisément Kepler, c’est que la force qu’exerce le soleil pour attirer certaines parties des corps et pour repousser les autres est une seule et la même, comme celle de l’aimant, et elle est simple comme l’est la forma coporea qui est l’agent de cette action. Comme le syntagme « forma corporea » constitue un hapax legomenon tant chez Kepler que dans les Cogitationes Privatae, je ne vois pas ce qu’on peut désirer de plus pour attester d’une lecture cartésienne de Kepler en 1619-1620. C’est un point technique qui n’intéressera peut-être pas la majorité de nos lecteurs, mais qui montre bien comment les historiens les plus sérieux comme Alquié, Gouhier ou beaucoup d’autres, ont pu passer complètement à côté du sens des premières notes de Descartes.
AP : Le 16 novembre 1618, Kepler découvre une comète dotée d’une double queue ; quelle importance revêtit la querelle autour de cette découverte, dans la question copernicienne d’une part, et dans la réflexion cartésienne d’autre part ?
EM : L’histoire de la grande comète de 1618 est capitale pour toute cette génération, dans laquelle il faut aussi inclure Mästlin, Galilée, ou Willebrord Snell. Tout près de Descartes géographiquement, se trouve aussi un jésuite enseignant à Ingolstadt, non loin de Neuburg an der Donau. Il s’agit de Jean-Baptiste Cysat, qui est à Ingolstadt l’assistant puis le successeur du célèbre Christoph Scheiner. Avec Cysat, Snell, Kepler, on voit quelle a été l’avancée dans la question des comètes : depuis quelques décennies – depuis Tycho Brahe et la comète de 1577 – on sait que les comètes sont des phénomènes célestes, et non plus des « météores » sublunaires. On sait que leur trajectoire obéit à des lois, non moins que celle des planètes ; on les considère donc comme des phénomènes astronomiques de plein droit. Néanmoins, on s’interroge sur leur constitution matérielle – ce que fait par exemple Cysat, qui est le premier à observer et décrire le noyau de la comète à l’aide du télescope. C’est là qu’on voit concrètement la transformation de l’astronomie en « physique céleste ». Avec Descartes, la question de l’origine et de la production des comètes est effectivement très importante, et on peut noter une évolution entre les années 1620 (le Monde) et la forme finale de sa théorie (les années 1640 et les Principia Philosophiae). Dans les années 1620, Descartes considère que les comètes sont, comme les planètes, des corps opaques, terreux, qui réfléchissent la lumière du Soleil. Elles sont, quant à leur formation, issues de la collection des parties plus grossières de la matière subtile, comme les brindilles et petits corps flottants s’amassent dans le centre des petits tourbillons qu’on peut voir à la surface d’une rivière, mais ce n’est là encore qu’une comparaison. Dans les Principia Philosophiae, on découvre deux choses tout à fait nouvelles : la première, c’est que la réfraction dans la matière céleste du tourbillon explique l’apparence courbée de la queue de la comète. Or, ceci, Descartes ne pouvait pas l’intégrer à la Dioptrique et aux Météores, puisque les phénomènes célestes ont été soigneusement exclus de la publication de 1637, pour éviter tout litige sur les hypothèses cosmologiques. Le deuxième point est d’une originalité étourdissante : au lieu de reprendre sa théorie de la formation des comètes par agrégat ou collection des parties du « troisième élément » – ce qui explique plutôt, désormais, la formation des taches solaires, Descartes propose une hypothèse que certains de ses contemporains et adversaires jugeront complètement folle : les comètes sont des étoiles mortes, errant entre les gouffres amers que sont les tourbillons célestes, où elles sont parfois happées et stabilisées jusqu’à devenir de simples et banales planètes. La théorie des comètes devient donc un moment de la théorie de la formation des planètes, tout ceci se faisant dans une échelle de temps qui n’est absolument pas précisée, mais dont on voit mal comment elle pourrait s’accommoder à la durée de « cinq ou six mille ans » que les biblistes et chronologistes assignent à l’existence du monde. Dans l’hypothèse cartésienne des Principia Philosophiae, la planète Terre n’a pas pu être créée en même temps que le monde, puisqu’elle est supposée avoir été une étoile, avant qu’un effondrement cosmique ne la fasse déchoir en planète. C’est dire que commence à se fissurer l’unité indivise qui faisait coïncider parfaitement l’histoire de la Terre et celle du monde.
AP : Je me permets alors de citer à nouveau un passage décisif de Descartes en Allemagne par lequel on voit bien comment une question si je puis dire particulière finit par engager une réflexion épistémique et même noétique de premier ordre :
« la participation de Descartes au Kometenstreit de 1619, dans lequel Kepler joue le rôle de père absent, motive la réaction critique de Descartes, c’est-à-dire provoque la constitution d’une épistémologie relativiste et relativisée par le point de vue de l’entendement fini, telle qu’elle se donne à lire dans les Regulae[17]. »
Et vous ajoutez que s’il n’y eut pas de rencontre entre Kepler et Descartes, il y eut malgré tout « débat[18] »
EM : Je me demande si cette déclaration ne pèche pas par excès de néo-kantisme, et si je ne dois pas faire ici une rétractation. Il me semble d’ailleurs que je résumais ici la thèse de Lüder Gäbe, qui m’avait beaucoup inspiré à l’époque. De fait, aujourd’hui, je ne présenterais plus exactement les choses ainsi : il me semble que ce qui est essentiel chez le premier Descartes est l’« extrême satisfaction » qu’il tire de l’usage et de l’application de sa méthode. Je ne sais pas s’il y a eu véritablement un « débat » avec Kepler, ou une discussion critique de ses thèses, comme c’est par exemple le cas d’Isaac Beeckman, qui lit, commente et discute très précisément les œuvres majeures de Kepler en 1628-1629 (au premier rang desquelles l’Astronomia Nova et l’Epitome Astronomiae Copernicanae), ce que Descartes, qui le fréquente assidûment durant cette période, ne peut en aucun cas ignorer. En tous cas, ce qui est à peu près sûr, c’est que Descartes se sert de sa méthode pour aller systématiquement plus loin que Kepler, et pour résoudre des difficultés que Kepler lui-même a transmises et léguées à la postérité. On le verrait avec l’anaclastique, la réfraction, l’arc-en-ciel, la construction des problèmes solides dans le IIIe livre de la Géométrie. Sur tous ces points, qui sont d’ailleurs liés et connexes, de telle sorte que la solution de l’un aide à trouver celle des autres, Descartes s’est servi de sa méthode pour faire avancer la connaissance aussi loin qu’on le puisse, et, faute d’avoir écrasé les rebelles à la Montagne Blanche, il aura eu l’extrême satisfaction de gagner quelques batailles qui ne font pas de morts.
AP : Vous conférez à Kepler un statut de penseur rationaliste hérité de Nicolas de Cues ; pourtant, vous assumez par ailleurs ce que des historiens comme Gérard Simon ont montré[19], à savoir que Kepler fut aussi pétri de savoirs hermétiques qui lui servirent à de nombreuses occasions de fil directeur scientifique. En qualifiant Kepler de « rationaliste » en dépit de l’importance que revêtent chez lui les savoirs hermétiques, distinguez-vous le rationalisme d’un certain positivisme, celui-ci excluant toute forme de spéculation hermétique, celui-là pouvant l’intégrer ?
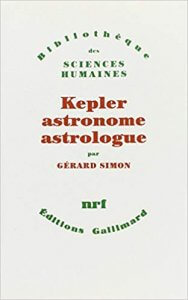
EM : J’ai une grande admiration pour Gérard Simon. Nous venons d’ailleurs d’éditer la partie inédite de sa thèse, qui porte sur l’optique et le commentaire des Paralipomènes à Vitellion (G. Simon. Kepler, rénovateur de l’optique, Paris, Classiques Garnier, 2019, éd. de D. Bellis et N. Roudet). On comprend assez bien pourquoi G. Simon n’a pas repris cette partie de sa thèse dans Kepler astronome astrologue : l’optique, c’était au fond le Kepler le plus « normal », le plus conforme aux standards de la rationalité moderne, mais une rationalité dont G. Simon voulait montrer qu’elle est un peu borgne, car lui échappe la part obscure de Kepler : l’animisme, l’astrologie, la magie, qui sont au cœur de ses préoccupations et révélateurs de « structures de pensée » qui ne sont assurément pas les nôtres. Le Kepler de G. Simon est un Janus bifrons, qui a une face tournée vers l’occultisme de la Renaissance, et l’autre vers la science classique. C’est le chaînon manquant entre John Dee et Descartes ! Historiquement cela est tout à fait exact. Mais je n’en conclurais pas, comme vous le faites, que cela implique une espèce de perméabilité de la rationalité moderne à la « spéculation hermétique », tout simplement parce que je ne vois pas bien de quoi on parle ici. Cette « perméabilité » c’est celle qu’on trouve chez Robert Fludd par exemple – qui n’a pas pris acte des travaux d’Isaac Casaubon, lesquels ont porté un coup fatal à l’hermétisme en démontrant que le corpus hermeticum est postérieur à la révélation chrétienne. Mais justement, entre le monde de Robert Fludd, « hermétique » si vous le voulez, et celui de Kepler, il y a un monde !
AP : Peut-être vais-je me permettre d’émettre une objection à une interprétation que vous proposez au sujet de la pensée de Kepler prise entre son assise hermétique et sa portée scientifique. Je vous cite :
« Quoi que l’historiographie récente ait pu mettre à jour sur le rôle de l’hermétisme dans le développement de la science moderne, on ne saurait faire oublier que l’épistémè de l’ordre et de la mesure s’établit sur les ruines d’une épistémè hermético-pythagoricienne gouvernée par le postulat d’une analogie naturelle entre inferiora et superiora[20]. »
Là où j’émets une réserve, ce n’est pas sur le principe général, à savoir que l’ordre et la mesure engagent la ruine de l’épistémè hermético-pythagoricienne, c’était même le sens de l’une de mes questions méthodologiques initiales. C’est plutôt sur le fait que tel soit le principe de Kepler : le principe de Kepler ne me semble pas être que tout ne soit qu’ordre et mesure ; autrement dit, je crois que le principe képlérien est celui de l’harmonie et que ce principe est au sens propre qualitatif, inscrit dans l’immanence même de la nature ; mais il se trouve que ce principe qualitatif peut se traduire dans l’ordre et la mesure, ces derniers mesurant sous forme quantitative ce qui est d’abord la qualité essentielle des choses. En somme, là où je suis sceptique, c’est peut-être sur l’exclusivité du quantitatif que présuppose votre lecture : le quantitatif peut bien être ce par quoi Dieu lui-même mesure et ordonne, il n’en demeure pas moins que cela n’a de sens qu’à la condition d’accomplir la qualité même du monde qu’est l’harmonie. Bref il me semble que l’investigation hermétique de l’intériorité monde peut se laisser penser et même exprimer dans la mesure mathématique, sans que pourtant cela n’implique que la mesure mathématique exclue le soubassement qualitatif ainsi exprimé.
EM : Eh bien, cher ami, vous êtes tout à fait fluddien, et moi je suis keplerien ! Plaisanterie à part, quand je dis que vous êtes fluddien, c’est parce que vous considérez que le « quantitatif », comme vous dites, n’est pas l’essence des choses, et qu’il y a des propriétés des corps qui ne sont pas réductibles – peut-être faudrait-il plutôt dire exprimables – par les paramètres purement quantitatifs que sont magnitudo, figura et motus. Mais le mathématique n’est pas un voile d’idées jeté sur une réalité intuitive d’abord donnée. Si vous pensez ainsi, vous êtes peut-être bergsonien, peut-être husserlien, mais ce n’est pas cartésien ni keplérien, pour qui c’est précisement le « soubassement » qui est quantitatif. L’étendue, c’est-à-dire la quantité continue, est dans les corps tout ce qu’il y a de plus réel, et même tout ce qu’il y a de réel, sans ombre, et sans reste. C’est pour cela que les corps n’ont rien de si merveilleux.
AP : Mais dans le Mysterium cosmographicum et dans les Harmonices Mundi, il me semble tout de même que l’établissement des rapports mathématiques entre planètes permet d’établir un chœur qu’il s’agit à la fois de relier à l’harmonie pythagoricienne des sphères et en même temps d’utiliser comme preuve de la perfection divine. Je veux dire par là qu’il y a chez Kepler l’idée que les rapports mathématiques qui structurent bel et bien la réalité physique renvoient à plus et autre qu’eux-mêmes.
EM : L’harmonie du monde est un des grands thèmes de la culture renaissante, sur lequel les héritiers de Ficin, scientifiques et artistes, ont écrit des textes splendides. Ce n’est pas seulement un objet d’étude théorique, c’est aussi un paradigme pour la création musicale ou picturale, comme on le voit dans la peinture florentine ou dans la polyphonie des maîtres du Nord. Contre toute attente, Kepler ne s’inscrit pas dans cette grande tradition spéculative de la musica mundana. Ce qu’il dit de l’harmonie (qu’elle est une pure relation, qu’elle n’est pas dans les choses mais dans la perception, qu’elle n’a qu’un être objectif…), et sa critique radicale des théories – d’inspiration pythagoricienne – prêtant de l’efficace aux nombres formels, vous ne les trouverez dans aucun de ces chefs-d’œuvre de la Renaissance. Si on le lit vraiment, on s’aperçoit que Kepler est un auteur parfaitement moderne, beaucoup plus proche, au fond, de Spinoza que de Ficin. C’est une autre époque, et un autre monde.
AP : Quand on referme Descartes et la fabrique du monde, on y lit que toute votre investigation visait à rendre justice à la position cartésienne à l’égard du problème cosmologique, en faisant entendre le sens du stat pro Copernico. A ce stade de notre discussion, comment diriez-vous qu’il nous faut finalement l’entendre ?
EM : Dans les derniers chapitres de cette longue enquête, j’examine l’étrange retournement des Principes, et la négation cartésienne du mouvement de la Terre. Ceux qui affirment le mouvement de la Terre, ce sont les disciples de Tycho, pas ceux de Copernic, ose dire effrontément Descartes, donc s’il faut blâmer quelqu’un c’est plutôt les premiers que le second ! Ce qui pourrait passer pour un insolent paradoxe ou une pirouette rhétorique est en fait la manière typiquement cartésienne de régler en trois lignes, comme s’il s’agissait d’une équation, la question qui déchire son époque. Copernic pense juste, mais il s’exprime mal. Les théologiens disent la vérité, mais ils ne la comprennent pas. Tous sont d’accord mais ils ne le savent pas. Au terme de cette enquête, la subtilité, la clarté et la fermeté philosophique de Descartes ne cessent de m’étonner. Descartes a une capacité à aller au fond et au bout d’un problème à laquelle je ne connais guère d’équivalent. Or le terme de l’enquête c’est qu’il n’y a précisément plus de problème cosmologique : on peut considérer que c’est un problème réglé. Ceux qui n’ont jamais fait l’effort de philosopher peuvent continuer à « regabeler », mais le mieux est de les laisser à leurs disputes.
La suite de l’entretien se trouve à cette adresse..
[1] Édouard Mehl, Descartes en Allemagne, 1619-1620. Le contexte allemand de l’élaboration de la science cartésienne, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2019.
[2] Édouard Mehl, Descartes et la fabrique du monde. Le problème cosmologique de Copernic à Descartes, Paris, PUF, coll. Epiméthée, 2019.
[3] Descartes en Allemagne, op. cit., p. 7-8.
[4] Ibid., p. 8.
[5] Descartes et la fabrique du monde, op. cit., p. 14.
[6] Ibid., p. 15.
[7] Edouard Mehl, Descartes en Allemagne, op. cit., p. 330.
[8] Ferdinand Alquié, Descartes. L’homme et l’œuvre, Paris, La Table ronde, 2017, p. 13.
[9] Descartes et la fabrique du monde, « Introduction », op. cit., p. 14.
[10] Heidegger, Dépassement de la métaphysique, tr. in Essais et Conférences, TEL, Gallimard, p. 81.
[11] Roland Edighoffer, Les Rose-Croix et la crise de la conscience européenne au XVIIè siècle, Paris, 1998, p. 167.
[12] Ibid., p. 167-168.
[13] Descartes en Allemagne, op. cit., p. 94.
[14] Descartes et la fabrique du monde, op. cit., p. 336.
[15] Ibid., p. 57.
[16] Cf. Maurice Clavelin, « Le copernicianisme et la mutation de la philosophie naturelle », Revue de métaphysique et de morale, vol. 43, no. 3, 2004, pp. 353-370.
[17] Descartes en Allemagne, op. cit., p. 208.
[18] Ibid.
[19] Cf. Gérard Simon, Kepler astronome astrologue, Paris, Gallimard, 1979.
[20] Ibid., p. 278.








