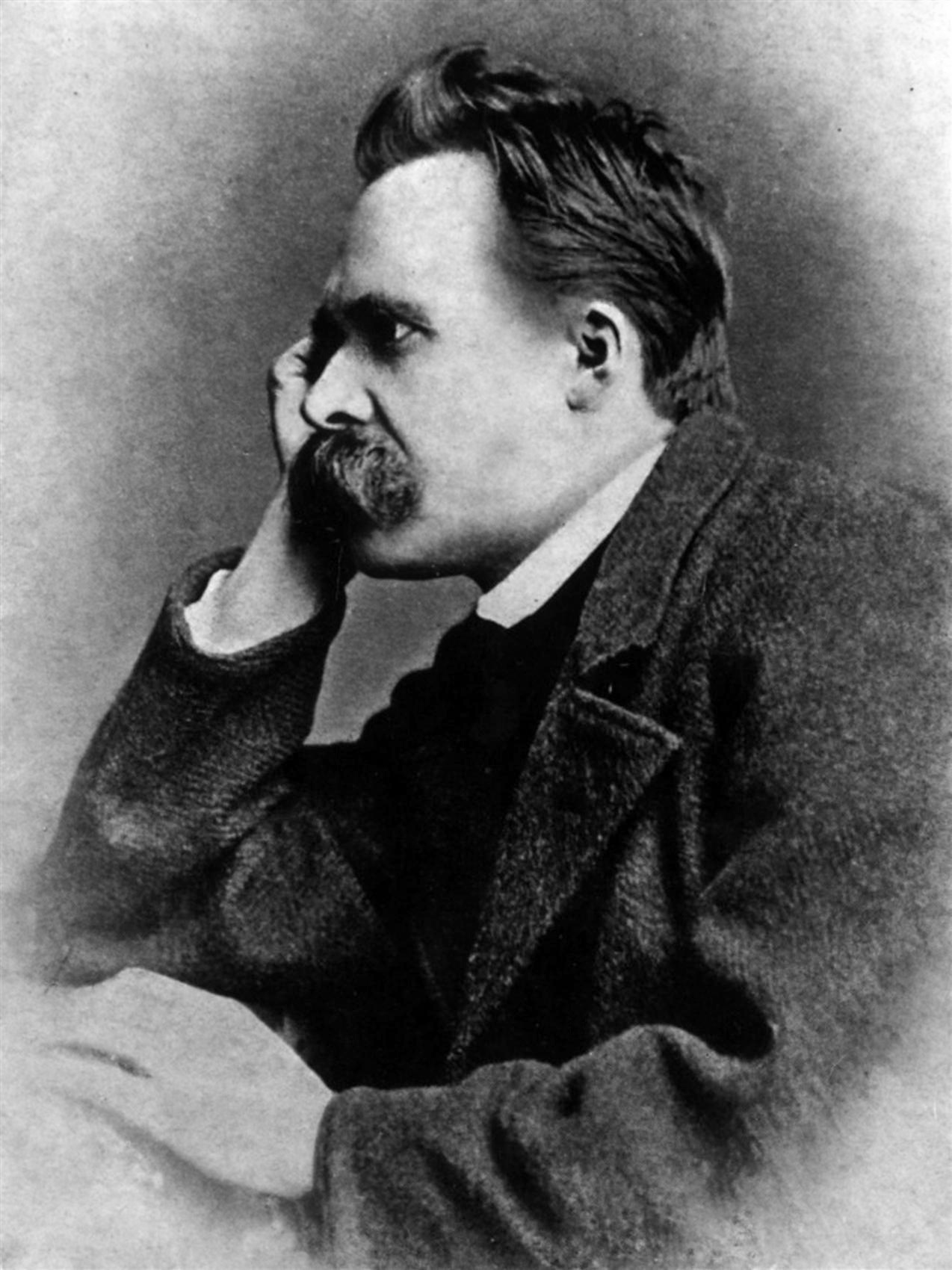Je tiens à remercier Dorian Astor pour sa disponibilité et sa générosité lors de nos échanges. Je salue également le Centre Marc Bloch (Berlin) qui nous a permis de bénéficier des meilleures conditions pour réaliser cet entretien.
Propos recueillis par Frédéric Porcher.
Actu-Philosophia : Votre parcours semble assez éclectique : germaniste, chanteur d’opéra, traducteur, biographe et philosophe. Tout se passe comme si vous étiez « devenu philosophe ». Est-ce que vous pouvez revenir sur le sens de votre parcours, de votre devenir-philosophe ?
Dorian Astor : En réalité, mon parcours a commencé de manière très académique : école préparatoire, ENS, agrégation d’allemand, sans jamais cesser d’étudier la philosophie. Mes dix années de chant ont été une expérience décisive, mais finalement une grande parenthèse, qui m’a en tout cas décidé à quitter l’université, à ne pas enseigner. Traductions, éditions pédagogiques et biographies étaient initialement des moyens de subsister, mais m’ont permis de devenir auteur indépendant, grâce à la confiance précoce de Gallimard. Aujourd’hui, poursuivant mes recherches dans le cadre d’un contrat doctoral avec l’École polytechnique, chercheur associé à l’ITEM (ENS/CNRS), je dois bien admettre que le système des grandes écoles est revenu chez moi par la fenêtre…
En revanche, « devenir philosophe », comme vous dites, était depuis longtemps une affaire personnelle, c’est devenu une affaire publique lorsque j’ai été invité à publier et à avoir une parole publique dans le domaine de la philosophie. À partir de ce moment-là s’est posée — et se pose toujours — la question de la responsabilité et du sens de ce que je faisais ou prétendais faire. En même temps, se faire reconnaître comme « spécialiste de Nietzsche » posait une autre question : qu’est-ce que cela veut dire pour soi-même que d’avoir une affinité profonde avec ce philosophe plutôt qu’un autre et, avec le temps, avec des familles ou des alliances de philosophes : pourquoi Leibniz plutôt que Descartes ? Pourquoi Nietzsche plutôt que Hegel ? Pourquoi Deleuze plutôt que Heidegger ? Ces constellations définissent un parcours vital qui est une manière de « devenir soi » en faisant le plus grand détour, celui de l’histoire de la philosophie et, en son sein, en passant par certains chemins plutôt que d’autres.
Pourquoi Nietzsche ? D’abord, je pense, comme Deleuze, qu’on écrit toujours pour et non pas contre quelque chose ou quelqu’un. J’ai écrit pour Nietzsche, par reconnaissance, parce qu’il est celui qui m’a forcé à penser ; c’est-à-dire que j’ai aussi de la reconnaissance pour l’inconfort, voire la détresse qu’il suscite, mais aussi pour la patience, la probité, voire l’ascèse qu’il réclame. Aujourd’hui, écrire pour un philosophe qui, par ailleurs, a des développements extrêmement difficiles à assumer pour nous autres démocrates, libéraux, modernes, postmodernes (comme par exemple le fait que Nietzsche est fondamentalement un penseur de la hiérarchie), c’est une épreuve. Et une responsabilité, y compris éthique et politique : il faut rendre compte à soi-même et aux autres de ses propres résistances et des raisons pour lesquelles, malgré tout, on poursuit sa route avec une telle pensée.
On m’a souvent demandé si j’étais un « nietzschéen de gauche », et si cela voulait dire quelque chose d’être nietzschéen-de-gauche. Ma question, c’est de savoir comment je peux être « nietzschéen » (avec tous les guillemets nécessaires) et de gauche (avec tout autant de guillemets ?). Ce qui ne veut pas dire pour autant que Nietzsche soit un penseur de droite, car je pense que ce sont des catégories stériles pour Nietzsche, et peut-être pour la philosophie en général. On ne peut pas dire que j’aie éludé la question : tout mon épais ouvrage de 2014, Nietzsche. La détresse du présent[Dorian Astor, Nietzsche, la détresse du présent, Paris, Gallimard, coll. Folio-essais, 2014. Ouvrage recensé [à cette adresse [/efn_note] était une manière d’y répondre, sans renoncer à la prudence et la circonspection.
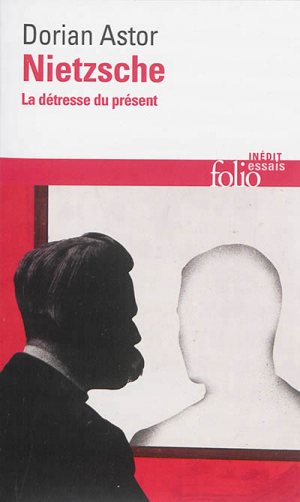
I/ Le projet éditorial et politique de Pourquoi nous sommes nietzschéens
A-P : Venons-en maintenant à l’ouvrage Pourquoi nous sommes nietzschéens1. Il se compose de 17 contributions mêlant philosophes, écrivains, poètes, éditeurs et critiques littéraires. A. Jugnon, dans son article introductif, parle de ce collectif comme d’un « aéropage d’écrivains mordus par la pensée de Nietzsche ». Comment l’ouvrage s’est-il organisé ? Quelle en est la raison d’être ? Est-ce que vous êtes l’acteur de ce projet ?
D. A : Pour être très honnête, je dois dire que ce projet est largement l’initiative d’Alain Jugnon et qu’il lui ressemble beaucoup. Ce qui lui ressemble aussi beaucoup, c’est qu’il ait tenu à ce que nos deux noms apparaissent au même niveau, et qu’il ait préféré la mention « ouvrage coordonné par » à « dirigé par ». Alain se réclame souvent du tout début de Mille Plateaux, quand Deleuze et Guattari écrivent : « Nous avons écrit L’Anti-Œdipe à deux. Comme chacun de nous était plusieurs, ça faisait déjà beaucoup de monde ». Il se méfie de la fonction auteur et voulait pour ainsi dire que nous disparaissions dans ce collectif. C’est donc à Alain que l’on doit non seulement l’initiative de ce livre, mais aussi l’essentiel de sa forme et de sa composition. Nous avons procédé simplement, en posant la question aux auteurs dont nous avions envie de lire une réponse : « voilà le titre : pourquoi nous sommes nietzschéens, êtes-vous partants ? » Certains ont répondu catégoriquement par la négative, d’autres n’ont pas osé. Se déclarer nietzschéen n’est ni évident, ni même agréable, et c’est souvent un qualificatif qu’on vous attribue de l’extérieur, malgré vous (ou contre vous). J’étais moi-même réticent, et ce qui m’a décidé, c’est que ce titre était évidemment un pendant ironique, parodique et un peu méchant de l’ouvrage de 1991, Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens2, . Nous y reviendrons peut-être. En tout cas, les auteurs qui ont accepté d’y contribuer ont précisément été sollicités par l’ambiguïté de la question, et même son caractère un peu provocant. Le résultat, on le voit bien, c’est que ce n’est pas vraiment un livre sur Nietzsche, mais plutôt avec Nietzsche : chaque auteur ressaisit sa lecture de Nietzsche au point exact où elle a été productive pour lui, où elle a donné lieu à quelque chose d’autre. La question est de savoir comment nous avons été transformés par la lecture de Nietzsche et comment nous le transformons dans nos propres lectures. Ce sont des doubles captures, pour reprendre un terme cher à Deleuze. C’est pourquoi la notion de création revient souvent dans les différents articles. Évidemment, cela ne forme pas encore un sujet collectif, le « nous » du titre reste extrêmement incertain.
A-P : Je suis ravi d’apprendre que finalement cette question pourquoi nous sommes nietzschéens n’a pas été posée simplement comme un titre d’ouvrage, mais que c’est vraiment la question de départ qui a lancé le projet, et à laquelle les différentes contributions se confrontent directement en produisant un texte singulier.
D.A : C’est un titre dissonant pour chacun de nous, une question dont chaque terme est un problème presque insoluble : « pourquoi », « être nietzschéen », « nous »… En ce sens, il a été une vraie sollicitation. Si la question est absurde, alors comment faire pour y répondre ? Si elle est mal formulée, comment la reformuler dans nos réponses ? C’était donc au fond, et à dessein, poser la plus mauvaise question pour obtenir la meilleure réponse.
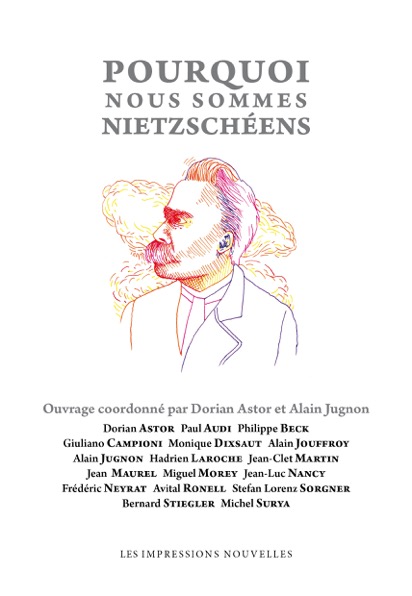
A-P : Justement, comme vous l’avez souligné, je voudrais que l’on revienne sur le « nous » et l’incertitude de ce sujet collectif. Alain Jugnon parle – en hommage évident à Deleuze – de « différences et de répétitions » comme s’il s’agissait – dans la composition même de l’ouvrage, de marquer à la fois des différences d’approches, d’analyses etc. et, en même temps, d’un refrain au sens où quelque chose se répète. Or il me semble que dans la répétition, ce qui domine, c’est le biographique : à quel moment une subjectivité a rencontré l’œuvre de Nietzsche ? Et c’est la raison pour laquelle on a l’impression – mais peut-être est-ce aussi un trait de notre temps – que les auteurs répondent à la question de savoir pourquoi nous sommes nietzschéens, en disant « je » et donc en tant que subjectivité. À ce sujet, Jugnon ajoute qu’il s’agirait, dans cet ouvrage, de « rassembler et désordonner les subjectivités ». Or ma question est au fond la suivante : si la dominante biographique de l’ouvrage est très originale en ce qu’elle permet de sortir de l’académisme, ne risque-t-elle pas, en retour, de nous faire perdre l’idée d’un sujet collectif ? Ce qui, on va y venir, n’était absolument pas le cas de l’ouvrage Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens, puisqu’il s’agissait, au contraire, de répondre collectivement à un phénomène qui, s’il n’était pas Nietzsche, demandait une réponse collective et donc politique. Pour me résumer : est-ce que le biographique n’a pas pour contrepartie de nous faire perdre ce « nous » et ainsi de dépolitiser la question et, par là-même, le rapport à Nietzsche ?
D A : Vous avez parfaitement raison. Cette question du « nous », je m’en préoccupe longuement dans mon ouvrage Nietzsche. La détresse du présent. La simple addition des « je » des 17 auteurs ne suffit pas à donner un « nous », elle ne fonctionne pas toute seule. Il s’agissait plutôt de rassembler en un seul lieu (celui du livre) des singularités qui puissent rendre compte de leur expérience à partir d’une sollicitation commune. Le « nous » qui se forme dans cette rencontre n’est pas une synthèse, mais une sorte de cartographie où les points de départ peuvent être partout, n’importe où, où les points de rencontre apparaissent là où c’est possible. Ce « nous » ne peut donc être celui d’un groupe ou d’une École, mais un « nous » susceptible de se dégager à partir de la question : qu’est-ce qui doit être sollicité dans les expériences subjectives pour que des rencontres autour de Nietzsche puissent se faire ? En ce sens, cet ouvrage serait un préalable, une première étape pour former des amitiés en rhizome. Il existe des amitiés purement philosophiques et je crois que, dans ce livre et à partir de lui, il y a de quoi développer de telles amitiés qui ne sont pas exclusivement personnelles. Il n’y a pas de « nous » politique constitué chez Nietzsche pour des raisons qui tiennent à sa philosophie, mais il y a beaucoup d’éléments qui peuvent nous aider à surmonter les grands « nous », imaginaires, identitaires, autoritaires, et à former des constellations de singularités qui redéterminent le sens du collectif. Souvenez-vous, chez Nietzsche, du rêve de former des amitiés par-delà la solitude, sous le nom de « couvent des esprits libres »… Ce livre rêve d’être un tel couvent, mais ouvert aux quatre vents, avec toujours la possibilité d’entrer et de sortir, de partir et de revenir.
II/ Retour sur l’ouvrage de 1991 Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens
A-P : Je voudrais maintenant que l’on revienne sur le livre Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens (1991) puisqu’il est présupposé par le titre, la quatrième de couverture y faisant explicitement référence à travers l’idée de « promesse du contraire ». On a donc une dichotomie entre « pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens » et « pourquoi nous sommes nietzschéens ». Or, comme vous le précisez à juste titre, je crois, dans votre article, il ne s’agissait pas tant, dans l’ouvrage de 1991, de l’œuvre de Nietzsche, ce dernier apparaissant davantage comme un « dommage collatéral ». En effet, par nietzschéisme, il s’agissait plutôt de ce qu’on peut nommer une « étiquette » que des philosophes ont voulu coller sur d’autres philosophes, sur une génération de philosophes (Deleuze, Derrida, Foucault, Lyotard, Althusser, Lacan…) jugés comme les « maîtres à penser » d’une époque dépassée (« la pensée 68 »). L’enjeu n’était donc pas tant philosophique qu’idéologique, lequel pouvant s’interpréter comme une sorte de lutte des classes dans la théorie, ou d’une volonté d’enterrer une génération dans le but d’en promouvoir une nouvelle. Comment interprétez-vous rétrospectivement ce geste ? Est-ce bien au niveau idéologique que vous lisez ce geste ou, au contraire, y voyez-vous des raisons philosophiques plus fondamentales ?
D.A : Tout n’est pas à jeter dans ce livre. Il y a de bons articles et d’autres franchement indigents, me semble-t-il. Ce qui me frappe (et c’est au fond la perversité de cet ouvrage), c’est que lors de ma première lecture comme étudiant, à l’époque, je l’avais compris, un peu naïvement, comme une série d’objections philosophiques à Nietzsche. Ce n’est que plus tard que je me suis rendu compte d’une charge idéologique qui visait tout autre chose que lui. En réalité, ce livre était une machine de guerre proprement réactionnaire dirigée contre et visant à liquider ce qu’on appelle, comme vous le dites, la « Pensée 68 ». Il s’agissait d’une lutte acharnée contre l’événement au profit du fait, contre le devenir au profit de l’histoire. Mais surtout, contre le concept critique, généalogique et antitéléologique de pouvoir. Je pense notamment, de manière exemplaire à l’article majeur de Foucault, Nietzsche, la généalogie et l’histoire (1971). Une telle conception était insupportable aux yeux du libéralisme heureux. Pensez que le début des années 90 est aussi l’époque du livre de Fukuyama, La fin de l’histoire et le dernier homme (1992). Aujourd’hui, on se rend compte que ce « oui et amen » néolibéral et néo-réactionnaire (cela va ensemble) aux états de fait, sous le masque de valeurs universelles enfin réalisées ou toujours en passe de l’être, n’est plus possible, qu’il est proprement odieux. On ne peut pas, aujourd’hui, se payer le luxe de liquider la « Pensée 68 », parce que toute l’idéologie des années 80 et 90 a consisté en une violente réaction contre elle, contre son redoutable potentiel de création et de libération. Or, c’est des conséquences démesurées de cette idéologie que nous souffrons aujourd’hui. C’est pourquoi je crois que nous sommes loin d’en avoir fini avec ces grands « nietzschéens », et au premier chef avec Deleuze ou Foucault — Foucault étant pour moi le plus nietzschéen dans la méthode, même si, à titre personnel, c’est de Deleuze que je me sens le plus proche.
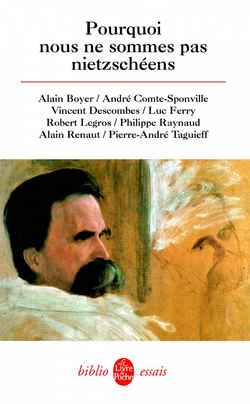
A-P : Justement, j’ai une question assez délicate à vous poser sur les rapports entre réaction et progressisme. L’ouvrage de 1991 peut se lire comme le versant idéologique d’un autre ouvrage, beaucoup plus consistant et auquel vous accordez une place importante dans votre livre La détresse du présent, qui est Le discours philosophique de la modernité de Habermas. Tout se passe en effet comme si Habermas avait préparé le terrain, spéculativement, pour que ce petit collectif puisse se constituer comme son ombre portée idéologique. Or, comme on le sait, Habermas caractérisait les néo-nietzschéens comme des néo-conservateurs et ce qui est étonnant, c’est que l’ouvrage de 1991 se trouve à l’évidence commandé par des intentions réactionnaires, nombre de ses auteurs s’étant révélés par la suite comme des penseurs de la droite la plus radicale. On a donc affaire en 1991 à des gens qui explicitement se veulent progressistes en dénonçant les néo-réactionnaires nietzschéens mais qui, implicitement, s’avèrent être des réactionnaires et des conservateurs. Je me demande donc si cet ouvrage n’est pas symptomatique d’une inversion des valeurs où ce qui se dit progressiste s’avère en réalité totalement réactionnaire. Est-ce que ces catégories de la réaction et du progrès sont pertinentes pour lire Nietzsche et, par voie de conséquence, est-ce que l’ouvrage de 1991, en mobilisant de telles catégories, ne ratent pas et Nietzsche et, philosophiquement, les enjeux de la génération qui les a précédés ?
D A : Je crois que vous avez raison d’évoquer ce livre d’Habermas, car ses objections ont une portée infiniment plus grande. Et elles concernent d’ailleurs elles aussi, pour ce qui nous intéresse, Foucault davantage que Nietzsche. Les deux chapitres qu’Habermas y consacre à Foucault et aux « apories » de sa « théorie du Pouvoir » sont extrêmement pénétrants. Et pourtant, ils se trompent sur l’essentiel : Foucault ne réintroduit pas, avec son concept de pouvoir, de catégorie transcendantale… Au contraire, et quoiqu’il s’en défende, c’est Habermas qui ne cesse d’en réintroduire. Il a beau insister sur la dimension historique de son concept de rationalité communicationnelle, c’est un transcendantal ou du « semi-transcendantal » comme il en vient à le dire lui-même… Ce qui va faire qu’une pensée progressiste et universaliste telle qu’elle se présente chez Habermas court toujours le danger de virer à la réaction, c’est de se donner, avant de commencer, des universaux. Il y a une violence propre à l’universel (voir, à ce sujet, le bel entretien que Balibar a accordé dans Le Monde le 9 février dernier[consultable [à cette adresse [/efn_note]), parce qu’il y manque toujours la dimension critique de la généalogie, en un sens précisément nietzschéen. C’est le nerf de la guerre.
Ces valeurs de gauche que nous défendons comme citoyens, nous devons les analyser avec un regard nietzschéen, c’est-à-dire généalogique. Si l’on s’aveugle sur le fait que nos valeurs sont des préférences fondamentales, qu’elles ont une histoire qui est une histoire des luttes pour la domination, pour l’avènement d’un certain type d’homme et de rapports entre les hommes, qui passe par des incorporations de valeurs et des spiritualisations d’instincts, alors on n’a aucune chance de savoir ce qu’on fait et pourquoi on le fait ; on se réclame d’une autorité supérieure (l’universel en est une), on dévalue ou instrumentalise l’historicité empirique, on hypostasie ses buts et l’on finit par devenir réactionnaire là où l’on se croyait progressiste. Je rêve d’une politique de gauche qui aurait la force de tranchant généalogique. C’est compliqué parce que c’est la droite, traditionnellement, qui présente une affinité avec l’empiricité des rapports de pouvoir arbitraires, avec le « réalisme », le « pragmatisme ». Mais ce qui lui manque, c’est l’appareillage critique, qui la rend idolâtre des états de fait, ce que Nietzsche appelait, en français, le « faitalisme ». On a accusé Foucault de néo-conservatisme parce qu’il a mis à nu cette empiricité, mais on a oublié ce faisant la portée radicalement critique d’une telle mise à nu. La nudité du pouvoir apparaît toujours aux moments où son exercice excessif ne parvient plus à se parer de ses propres valeurs. Alors il sort du bois de l’idéologie et exhibe impunément ses parties honteuses aux yeux de tous. C’est exactement le cas aujourd’hui, en France et ailleurs. Ce sont des périodes dont le scandale peut susciter de forts potentiels révolutionnaires — ou une défaite absolue des forces d’émancipation. Une pensée critique et généalogique « de gauche » aurait pour but de détecter le scandale des pouvoirs dominants avant qu’ils ne déposent le manteau de l’idéologie, car alors il est un peu tard.
III/ Que veut dire être nietzschéen aujourd’hui ?
A-P : Revenons à la question de savoir pourquoi nous sommes nietzschéens. Plusieurs contributions semblent inquiéter l’idée même de nietzschéisme au sens où elles refusent de caractériser le nietzschéisme de manière positive. Jugnon précise qu’on ne peut plus jamais « se dire nietzschéen comme un programme », Nancy déclare qu’il n’est pas « plus nietzschéen que platonicien » et Dixsaut, dont vous vous sentez proche à travers votre article, dit carrément que c’est une « question absurde » de savoir si elle est ou non nietzschéenne. Enfin, vous affirmez que personne ne peut être nietzschéen. Comment entendez-vous cette critique de l’idée même de nietzschéisme ? S’agit-il de se démarquer d’un certain usage de Nietzsche et alors pourquoi ? Comment appréhendez-vous cette tentative de démarcation, de réagencement du nietzschéisme ?
D. A : On n’est pas nietzschéen comme on est maoïste ou gaulliste. Ce n’est ni un programme ni une idéologie. Si c’était le cas, on devrait dire « nietzschéiste ». Les spécialistes de Marx ont eu besoin quant à eux de distinguer « marxien » et « marxiste ». Or en premier lieu, il faudrait réentendre « nietzschéen » au sens de « relatif à Nietzsche ». Il existe des types de problème qui appartiennent à des philosophes, qui sont leur création philosophique. Par exemple, dans L’Abécédaire, Deleuze évoque la manière spécifique qu’a Spinoza d’articuler l’ontologie et l’éthique ; et il ajoute qu’on peut dire beaucoup de choses nouvelles sur cette voie, mais que c’est une voie « spinoziste », ouverte par Spinoza. Voilà comment il faut traiter l’adjectif. Si Foucault est nietzschéen, cela ne veut pas dire qu’il suit un programme, mais qu’il reprend pour son compte un type de problème nietzschéen et qu’il y répond par la voie de la généalogie. La « volonté de savoir », la « microphysique du pouvoir », la « dramatique de la vérité » etc. sont de part en part des concepts foucaldiens ; et pourtant, ils émergent sur un champ fondamentalement nietzschéen. Alors certes, tout nietzschéen n’est pas Foucault… On fait ce qu’on peut, et faute d’inventer des concepts, on essaye tout au moins de reprendre pour son propre compte des manières de poser les problèmes et d’y répondre que nous avons apprises de Nietzsche. Encore une fois, ce sont toujours des expériences multiples et, tant que la philosophie aura quelque chose à faire avec sa propre histoire, on aura toujours appris de plusieurs philosophes. Nietzsche est lui-même pour une part héraclitéen, platonicien, humien, kantien et même (comme je tends à le montrer dans mes travaux actuels) leibnizien ! Être nietzschéen, c’est être tout cela à la fois, pour une part, et avoir célébré des noces avec d’autres encore, parfois plus surprenantes. On a beaucoup raillé les modes du « nietzschéo-marxisme » ou du freudo-nietzschéisme », mais ce sont des expérimentations nécessaires, ça fonctionne ou pas, il faut tenter. Plus profondément, la limite entre nietzschéen et non-nietzschéen se place à l’endroit exact où l’on sent une résistance à poursuivre dans cette voie. Il y a des paliers, et c’est à reculer un peu les seuils de tolérance que j’ai essayé de travailler dans mon Nietzsche. La détresse du présent. Dans mon article pour Pourquoi nous sommes nietzschéens, qui est au fond assez sombre, je tente d’exprimer « ce qui nous manque » encore pour être « nietzschéens » : un certain courage démesuré pour la « vérité », l’apprentissage de nouveaux mépris et de nouvelles hontes, le dépassement de notre fondamental perspectivisme lui-même, un « ultime scepticisme »… Il ne faut pas faire les malins, nous avons encore trop de confort intellectuel pour être tout à fait « nietzschéens ».
A-P : Je me demande si, finalement, ce livre et ce titre ne sont pas plus motivés par l’affinité ou l’amitié à des auteurs (Deleuze, Foucault) et ce, en enjambant en quelque sorte, cet épisode de l’anti-nietzschéisme – chez Jugnon et chez vous cela semble très clair. Par conséquent, ce n’est pas là encore de Nietzsche ou du nietzschéisme dont il s’agit, mais de la référence importante à ces auteurs. Or aujourd’hui, dans les études nietzschéennes disons académiques, il n’est pas rare d’entendre dire que l’interprétation deleuzienne a fait son temps, qu’elle n’est donc plus valable, notamment à travers l’introduction d’un dualisme actif/réactif qui n’est pas dans Nietzsche. N’est-ce pas l’amitié envers cette tradition de pensée post-nietzschéenne que le livre cherche à affirmer, plutôt qu’au nietzschéisme en tant que tel ?
D.A : Ce n’est pas faux, mais cela a à voir avec ce dont je parlais, avec ces noces ou alliances que l’on célèbre nécessairement quand on vient après. J’avoue bien volontiers qu’adolescent j’ai découvert Nietzsche et Deleuze à peu près en même temps et ma lecture de Nietzsche a été très marquée par celle de Deleuze, j’ai mis des années à m’en défaire — ou plutôt à renverser le rapport, puisque je suis peut-être plus « deleuzien » que jamais. Je veux dire que l’influence qu’a Deleuze sur moi ne se situe pas en amont de Nietzsche — comprendre Nietzsche par Deleuze —, mais en aval, c’est-à-dire en termes d’alliance pour le présent et pour l’avenir. Je n’ai plus besoin de Deleuze pour lire Nietzsche, et je m’en suis suffisamment affranchi, de ce point de vue, pour voir exactement où Deleuze lâche ou déplace Nietzsche dans le but de faire ce qu’il a à faire. Ce n’est pas tellement le couple actif-réactif qui illustre ce déplacement — et je ne suis pas d’accord sur ce point avec mon ami Patrick Wotling, qui est très sévère à cet égard ; je crois simplement que Deleuze insiste sur ce que Nietzsche ne systématise pas mais dont il fait sans cesse usage. (D’ailleurs, une lettre de son ami Peter Gast, datée du 23 décembre 1883, montre que le couple actif-réactif lui apparaissait comme un élément évident de la démarche de Nietzsche) —, c’est davantage l’usage deleuzien de l’Éternel Retour. Celui-ci devient, non sans métamorphoses, un élément central du travail de Deleuze sur le sens, tel qu’il se donne surtout dans Différence et répétition et Logique du sens. Dans ce cas, oui, on a à faire à une « double capture » : Deleuze nietzschéen s’allie à un Nietzsche qui par-là même se fait un peu deleuzien. Je ne ferais pas intervenir l’interprétation deleuzienne dans un cours sur la notion nietzschéenne d’Éternel Retour ; mais si je devais travailler sur une « logique du sens » qui soit en même temps une ontologie de la différence pure, je convoquerais l’Éternel Retour de Deleuze.
Mais je parlais de présent et d’avenir : la question est politique. Il est beaucoup trop difficile, voire absurde, de vouloir définir un engagement politique univoquement calqué sur une incertaine « politique nietzschéenne » en soi (mon livre de 2014 s’attèle aussi à cette question). En revanche, il y a deux points centraux auxquels je tiens comme « nietzschéen » : premièrement, la conviction qu’une émancipation sociale doit avoir pour corollaire une souveraineté de l’esprit libre telle que le texte nietzschéen la réclame directement — et qu’on pourrait, trop rapidement, résumer en trois formules : un perspectivisme de la connaissance, un scepticisme de la valeur, une ascèse de la liberté. Deuxièmement, la conviction que l’alliance irrévocable où Nietzsche s’est trouvé engagé avec la pensée de Deleuze et de Foucault possède un potentiel politique qui, loin de s’être épuisé, n’en est encore qu’à ses débuts. Il n’y a qu’à lire par exemple le petit texte magnifique de Foucault, son « Introduction à une vie non fasciste » en préface à l’édition américaine de L’Anti-Œdipe en 1975. Elle se termine par quelques « principes essentiels » pour un art politique de vivre. C’est un programme qui reste pour moi absolument indépassable. Et qui est fondamentalement — [consultable [ici [/efn_note] nietzschéen.