Dany-Robert Dufour, né en 1947, est un philosophe français qui a produit une œuvre pour le moins singulière dans le paysage universitaire français : alors que la recherche suit l’irrésistible pente de l’hyperspécialisation, il a fait le choix de la fidélité à la tradition universaliste et, plutôt que de soumettre la pensée à la production de connaissances de niche, s’est efforcé de mettre les savoirs au service d’une réflexion d’ampleur qui prend le risque d’une confrontation directe avec l’époque : avec ses contemporains d’une part, avec le nihilisme capitaliste et néolibéral d’autre part. Il en a résulté la publication d’une vingtaine d’ouvrages, à la croisée de la philosophie politique, de l’économie, de la psychanalyse, de la linguistique et de bien d’autres disciplines encore. C’est justement, en guise d’introduction à son travail et d’incitation à la lecture de ses livres, ce nouage entre ces différentes formes d’économie (psychique, politique, langagière, etc.) que nous explorons dans cet entretien.
Baptiste Rappin : Cher Dany, je te remercie chaleureusement d’avoir accepté de m’accorder cet entretien pour Actu Philosophia. J’aimerais entrer dans ton œuvre par la petite porte, par l’anecdote, en espérant pouvoir aller à l’essentiel par l’accessoire. Un passage de ton entretien biographique, paru en 2021 aux Éditions R & N sous le titre Fils d’anar et philosophe, a en effet retenu toute mon attention : tu avais soutenu une thèse de troisième cycle en 1976 sous la direction de Georges Lapassade et tu t’es inscrit en 1980 pour une thèse d’État avec un autre directeur de thèse (dont tu ne mentionnes pas le nom) et ce dernier insistait pour que tu adoptes le paradigme de la complexité d’Edgar Morin. Voici alors ta réaction : « Je refusais en effet le paradigme qu’il ne cessait de vouloir m’imposer, celui de la théorie de la complexité venu d’Edgar Morin. Je lui répondais que je n’en voulais pas, car il présentait à mes yeux un défaut épistémologique majeur : il s’appuyait sur une proposition (« Tout est dans tout »), dont l’exact contraire est également vrai […] » (p. 43). J’aimerais profiter de ce détail pour lancer notre dialogue autour de deux axes. Le premier est sociohistorique : quel est le contexte de l’Université dans ces années ? Peut-on dire que le paradigme de la complexité, dont on connaît rétrospectivement tout le succès, a en quelque sorte pris le relais d’un structuralisme arrivé en bout de course ? Et quelle fut la réaction de ton directeur de thèse à ce refus ? Rares sont les doctorants osant contredire leur directeur de thèse… hier comme aujourd’hui !
 Dany-Robert Dufour : Ce que tu évoques nous ramène à une époque ancienne où l’on faisait sa thèse en deux temps. D’abord une thèse de troisième cycle, éventuellement suivie, d’une thèse d’État. Je me souviens à cet égard qu’après avoir soutenu ma thèse de troisième cycle, s’est ouverte la possibilité d’opter pour une thèse plus courte que la thèse d’État, une thèse dite « nouveau régime », si je me souviens bien. Mais je voulais en passer par l’ascèse de la thèse d’État qui pouvait durer des années, nécessiter beaucoup de recherches originales, et faire jusqu’à cinq cent, voire mille pages. Bref, pour ma part, j’ai donc choisi de m’infliger la double peine…
Dany-Robert Dufour : Ce que tu évoques nous ramène à une époque ancienne où l’on faisait sa thèse en deux temps. D’abord une thèse de troisième cycle, éventuellement suivie, d’une thèse d’État. Je me souviens à cet égard qu’après avoir soutenu ma thèse de troisième cycle, s’est ouverte la possibilité d’opter pour une thèse plus courte que la thèse d’État, une thèse dite « nouveau régime », si je me souviens bien. Mais je voulais en passer par l’ascèse de la thèse d’État qui pouvait durer des années, nécessiter beaucoup de recherches originales, et faire jusqu’à cinq cent, voire mille pages. Bref, pour ma part, j’ai donc choisi de m’infliger la double peine…
Ça commence donc à Paris 8-Vincennes, université dite « expérimentale » créée juste après mai-juin 1968, par une thèse de troisième cycle que j’ai faite avec un intellectuel original comme il n’en existe plus aujourd’hui. Georges Lapassade était à la fois complètement marginal et cependant muni du meilleur pedigree : agrégé de philosophie, analysé par Jean Laplanche, docteur d’État à la Sorbonne après une thèse dirigée par la psychanalyste et professeure Juliette Favez-Boutonnier dans un jury qui comprenait Georges Canguilhem, Daniel Lagache et Henri Gouhier et Maurice Debesse. Bref, Lapassade présentait un double profil qui avait tout pour me plaire.
Lui avait travaillé sur des phénomènes occultés dans certaines cultures et qui faisaient retour sous des formes nouvelles. Par exemple, lorsqu’il avait enseigné en Tunisie en 1965-66, il avait pu y observer la persistance de rites de possession. De même que lorsqu’il était allé au Brésil entre 1970 et 1973, il avait rencontré la Macumba. Puis au Maroc, entre 1970 et 1996, les rituels Gnawas à Essaouira. Et enfin, en Italie du Sud, les rites de la tarentule. Sans compter son rapport à Julian Beck, le fondateur avec Judith Malina, du Living Theater, qui essayait, par le happening et l’improvisation, d’exhumer un autre théâtre occidental assez possédé, inspiré d’Artaud.
Moi, de vingt-cinq ans son cadet, je revenais d’un séjour de trois ans en Algérie où, après quelques frasques en France liées à 1968, j’avais jugé bon de me retirer pour réfléchir. J’avais repéré, avec de jeunes intellectuels algériens d’alors, que certains phénomènes culturels profonds touchant aux langues vernaculaires, aux savoirs populaires et aux religions maraboutiques, refoulés au cours de la période coloniale, continuaient de l’être par la néo-colonisation que s’infligeait les dirigeants algériens ne jurant que par l’industrialisation de leur pays ― or ces phénomènes profonds ne cessaient, sous des formes multiples, de revenir.
L’objet que j’ai proposé à Georges Lapassade, qui s’y montra fort réceptif, consistait donc à travailler sur la question du refoulement dans la culture (en l’occurrence en Algérie) et sur le retour du refoulé. C’était là une sorte de psychanalyse de la culture qu’il appelait « socianalyse ».
Je soutins ma thèse avec les honneurs, il en sortit une belle amitié qui dura jusqu’à la fin de sa vie. Il fit en sorte pour que j’obtienne une charge de cours à Paris 8 en sciences de l’éducation. Ce qui me mit le pied à l’étrier me permettant ensuite de devenir enseignant-chercheur. Nous n’avons jamais cessé de nous parler, au point qu’il me passa la question, qui avait été celle de sa thèse, L’entrée dans la vie, de la néoténie de l’homme, son inachèvement. Question qu’il laissait, et il le savait très bien… inachevée. Et, de fait, je l’ai reprise à ma façon, fort différente de la sienne. Mais de nos différends sur cette question anthropologique majeure, nous nous entretenions avec chaleur chaque fois que nous croisions dans le fameux souk de Paris 8 Vincennes que j’ai bien connus, ou ensuite dans les couloirs de Paris 8 à Saint-Denis, même lorsque ce philosophe péripatéticien moderne trainait derrière lui des grappes d’étudiants dont quelques-uns étaient sidérés par ses propos et pas mal d’autres à l’affût de menus bénéfices opportunistes (du type « on m’a vu avec le maître », ou « le maître va me valider mon unité de valeur »…).
Pourquoi n’ai-je pas continué avec lui en thèse d’État ? Parce qu’il s’intéressait beaucoup plus aux contre-cultures (jusqu’à, parfois, se fourvoyer en retenant des formes d’un intérêt discutable) qu’à la question d’une tout autre ampleur sur laquelle je voulais travailler : l’architecture des sciences humaines. J’avais été nourri au premier structuralisme, celui de Lévi-Strauss, de Jakobson et Benveniste, de Barthes et de Lacan – j’avais été impressionné par le fait que des champs profus, comme par exemple les récits ou les manières de table, pouvaient être mis en ordre par de simples structures binaires du type cru/cuit. Mais, en même temps, je voyais dans les « procès sans sujet » où le sujet est pur effet de la structure, quelque chose de fort technocratique et inquiétant. D’autant que le structuralisme semblait se réjouir de la « mort prochaine de l’homme ». Cependant que le post-structuralisme célébrait sa folie (Foucault), ou faisait du schizo le nouveau héros (Deleuze), ou s’en prenait aux fondations de la maison commune, la métaphysique (Derrida). Comment traiter ces questions ? Il me semblait qu’il manquait quelque chose dans ces sciences humaines ― quoi ? J’ai choisi comme directeur de thèse d’État celui qui était réputé comme le pire emmerdeur qu’un thésard puisse concevoir. Quelqu’un qui allait vous chercher dans vos ultimes retranchements. Bref, l’objecteur parfait. Celui qui, dès que vous formuliez une proposition, pouvait la contredire afin que vous reformuliez une proposition mieux construite. En fait, je cherchais la rigueur.
Et je me suis trompé. Je n’ai obtenu que la confusion. Pour faire bref, et cela n’engage évidemment que moi, c’était un pervers. J’étais jeune et pas très formé aux questions cliniques, j’ai donc mis du temps à m’en apercevoir. Il avait deux tactiques. L’une avec les jeunes femmes, que je te laisse deviner. L’autre avec les jeunes hommes, à qui il déniait le droit de penser quoi que ce soit, en dehors de ce à quoi il voulait les amener, pour les assujettir. En principe, quand un doctorant discute avec son directeur de thèse, ils se centrent sur l’objet de la recherche. Lui faisait de la psychanalyse sauvage, à la petite semaine, il se centrait sur le sujet, c’est-à-dire sur moi, mon être, ma personne, pour me mettre en difficulté disons psychologique de façon à profiter des faiblesses qu’il avait créées pour me refiler ses certitudes. Lesquelles tenaient en cet ensemble qui m’apparaissait informe qu’on appelle « le paradigme de la complexité ». Je dis « informe » parce que je prenais cela comme une pensée-lego, du nom de ce jouet composé de briques emboîtables qui peuvent s’assembler sans fin en des ensembles toujours différents. C’était sa façon de pratiquer « la complexité », laquelle n’avait peut-être pas grand-chose à voir avec celle a priori plus rigoureuse d’Edgar Morin. Mais elle lui permettait de toujours coincer l’autre, c’est-à-dire moi. Il ne disait jamais : nous allons discuter telle ou telle de tes propositions, il disait : tu as oublié ceci, et ceci, et ceci…
Cependant, je l’ai vu venir avec ses legos et je ne me suis pas laissé démonter, je me suis éloigné. Je n’ai pas cherché un autre directeur parce que je ne voyais pas qui je pourrais embarquer dans mon affaire sans qu’il ne m’embarque dans la sienne. Et surtout parce que j’avais pris une résolution : je ferais ma thèse avec… Personne. Personne, on le sait depuis le chant IX de l’Odyssée, ce n’est pas personne, c’est quelqu’un. Celui qui, en l’occurrence, pour moi, pourrait réellement objecter à la proposition ou aux propositions que je formais. En fait, je ne savais pas que j’étais en train de me mettre dans la position de celui qui prétend énoncer en vérité, que j’allais, au terme ma thèse, découvrir au cœur de l’énonciation philosophique inventée par Socrate. Dans le livre qui est finalement issu de cette thèse, Les mystères de la trinité, je l’ai formulée ainsi : « Le maître est celui qui a patiemment construit un savoir à propos de quelques objets et qui se donne un espace discursif où il s’offre au risque qu’aujourd’hui, demain ou après-demain, un élève, c’est-à-dire un individu qui en sait beaucoup moins que lui sur ces objets, presque rien peut-être, détruise tout ou partie de son savoir par une simple objection ». C’était donc ce « personne », n’importe qui, précieux entre tous, que je convoquais alors à la cantonade. Je le trouvais en l’occurrence en la personne des étudiants qui assistaient à mes cours à qui je présentais mes recherches auxquelles ils ne manquaient pas de réagir ― c’était le bon côté du Paris 8 d’alors : les étudiants y venaient pour parler, c’était une profonde cure de parole les amenant à poser parfois des questions essentielles. Jamais cependant je n’ai cédé au bavardage dans lequel sombraient alors beaucoup de cours. J’étais à cet égard dans une position assez singulière à Paris 8 : je faisais toujours des cours, très préparés, avec des références, des textes d’auteurs lus, cités et commentés, en vue de construire une proposition, articulée à d’autres propositions. Je tenais donc toujours la fonction proposante, ce qui les convoquait, eux, étudiants, à occuper la fonction critique. Jusqu’à temps qu’un parmi eux me sorte une objection solide. Ce que j’aimais chez eux, d’une certaine façon, c’était leur inculture. Car la culture, le savoir, empêchent parfois de voir. Quand on est cultivé, on a tendance à savoir d’avance ce qu’un texte veut dire, où la façon dont il faut prendre un problème. Une inculture, pour peu qu’elle soit curieuse de tout, est en ce sens un bon atout pour produire du savoir. Cela ressortit du thaumazein, l’étonnement, exposé par Platon dans le Théétète où il pose que la philosophie est « fille de l’étonnement ». Or, de l’inculture curieuse, mes étudiants n’en manquaient pas. Certains sont restés 5 ans de suite, un petit nombre suit encore mes travaux. Je leur dois une fière chandelle… L’objection, je la trouvais aussi dans les lignes laissées par tel ou tel auteur au fil de mes nombreuses lectures. Ou dans les discussions avec les amis, au sens grec du terme, celui de la philia où les amis sont ceux qui, justement, font passer la vérité avant les amis…
Et ça a plutôt bien marché. Mon supposé directeur de thèse a dû le reconnaître au moment de la soutenance en parlant du « directeur de thèse que Dany Dufour s’est lui-même construit ».
BR : Mon deuxième axe de questionnement est, quant à lui, proprement philosophique : quand tu affirmes que ton insatisfaction provenait de la proposition « Tout est dans tout » qui constitue en effet un postulat fort du systémisme et de la théorie de la complexité, j’y vois déjà à l’œuvre une forme d’identification de la tautologie et de l’autoréférence dont l’analyse se trouve au cœur du Bégaiement des maîtres, ton premier ouvrage, que tu ne publieras qu’en 1988. Est-ce là une lecture rétrospective injustifiée ? Ou alors, peut-être sous une forme négative, une première intuition de la thèse que tu développeras ultérieurement ?
DRD : En effet, c’est une première intuition de la thèse que j’ai développée ensuite. Aujourd’hui, je vois la théorie de la complexité, pas celle de mon supposé directeur de thèse, spécieuse, mais celle, sérieuse, de Morin par exemple, comme un effet de la pensée unaire (proposition où on retrouve le sujet en prédicat) où l’on part de définitions tautologiques qui ne cessent de proliférer en des ensembles de plus en plus grands[i]. Ce qui pousserait à se demander si, après le structuralisme (fonctionnant à la pensée binaire) qui va en gros de l’après-guerre aux années 1970, ne serait pas venu ledit paradigme de la complexité fonctionnant à la pensée unaire ? C’est fort possible. Il faut bien que, quand un paradigme s’épuise, l’autre prenne le relais.
Cependant la grande différence entre ce que j’appelle la « pensée unaire » sur laquelle j’ai fini par mettre la main après ma thèse et le « paradigme de la complexité », c’est que cette dernière théorie ne sait pas qu’elle s’engendre à partir de définitions tautologiques tandis que l’objet de la pensée sur l’unaire est de comprendre comment se produisent ces effets d’engendrement. Tu as raison de dire que c’est ce que j’ai essayé de faire dans Le Bégaiement des maîtres en plaçant aux deux bouts de la chaîne où ça parle, d’une part le sujet défini unairement par la formule (de Benveniste) « est je qui dit je » qui n’en finit pas de se replier sur elle-même et d’autre part la prolifération sans fin des récits par la succession infinie de leurs versions (Lévi-Strauss).
Voici, en une formule, ce que je proposais dans Le Bégaiement des maîtres, dialogue entre Logos et Sogol (nom anacyclique de « Logos », personnage repris du roman « d’aventures alpines et non euclidiennes », Le Mont Analogue, écrit en 1939 par René Daumal, grand explorateur de toutes les formes de l’unaire) : « L’Un se replie et l’Autre se déplie, n’est-ce pas ? Si, par hypothèse absurde, il n’y avait pas de « nœuds » entre l’Un et l’Autre : ici, nous serions dans la délitescence du repliement, du dédoublement ou de la régression sans fond de l’Un et là, dans la métastase du dépliement, du redoublement et l’expansion sans terme de l’Autre. Nous serions pris dans des formes acausales, des forces folles : entre un autisme patinant sans embrayage possible et un délire sans sujet et sans frein — ce n’est pas, après tout, tellement absurde : certains sujets en restent là et peut-être, nous, normaux, quand nous ne nous surveillons pas, passons-nous le plus clair de notre temps dans ces états ! Le nouage interrompt et ponctue ces deux processus sans issue ni fin en les liant en acte l’un à l’autre ».
Tout cela pour dire que l’homme, qui joue de ces structures plutôt qu’il n’en est le jeu, a symboliquement encore de beaux jours devant lui, à moins qu’on le transforme réellement avant qu’il ait fait son temps.
BR : Tu montres en effet que les Maîtres ont bégayé : « Est je qui dit je » (Benveniste), « Le mythe est la succession sans fin de ses versions » (Lévi-Strauss), « Le signifiant est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant » (Lacan). Or, le premier qui s’est exprimé de la sorte, qui s’est défini de et par lui-même en usant de l’auto-référence, c’est Dieu : « Dieu dit à Moïse : Je suis Celui qui suis » (Exode, III, 14). Pourrions-nous aller jusqu’à dire que les sciences de l’homme, dans lesquelles, par définition, sujet et prédicat se confondent puisque l’homme y observe l’homme, ne sont qu’une théologie déguisée ? ou sécularisée ? Ou alors, autre hypothèse, que le judaïsme a mis en scène et en mots un invariant anthropologique, celui de l’instance unaire présente sous la surface de la logique binaire, que Benveniste, Lévi-Strauss et Lacan ont su reformuler plus de deux millénaires après Yahvé ?
DRD : En fait, je crois que les Maîtres du structuralisme (Lévi-Strauss, Benveniste, Lacan et quelques autres) ne cherchaient pas à bégayer, bien au contraire. Sauf, peut-être, ici et là, le facétieux Lacan. Ils cherchaient à appliquer les principes de la phonologie structurale de Jakobson et du cercle de Prague à d’autres systèmes que celui des sons dans le langage. Cela avait été extrêmement productif puisqu’on a alors réussi à substituer aux longues descriptions par la phonétique des nombreux sons repérés dans chacune des langues, un nombre fini de phonèmes dans une langue donnée où chacun n’a plus été défini que par les traits différentiels qu’il entretenait avec les autres. Par exemple, le phonème /p/ du français s’oppose au phonème /b/ par le trait de la sonorité (ou voisement) ― rien de plus, rien de moins, quelle économie ! On est donc passés d’une phonétique descriptive à une phonologie systémique, en l’occurrence binaire. Ce que lesdits Maîtres du structuralisme ont voulu avant tout faire, c’était de transposer cela dans leur champ : les systèmes de parenté, le système énonciatif, les productions de l’inconscient soutenues par certains signifiants précis. Ce qui donne à peu près ceci : « Si le rapport frère/sœur fonctionne, alors… », « si les rapports mari/femme, père/fils, oncle maternel/fils de la sœur fonctionnent, alors… », « si le rapport entre deux signifiants fonctionne, alors… ». Bref, le structuralisme tel qu’il fonctionnait à la grande époque (1945-1970) a puisé ses sources dans la même idée, binaire, que celle qui allait amener au développement vertigineux de l’informatique dans nos sociétés.
 Je le répète donc, les Maîtres du structuralisme ne voulaient pas du tout bégayer, mais rendre compte des productions de leur champ de façon binaire, de façon à passer de la description au système. Si je puis dire, c’est moi qui les ai fait bégayer. Je pense en effet avoir montré que, pour que l’opérateur binaire fonctionne, il fallait qu’il s’applique sur des axiomes, c’est-à-dire des propositions considérées comme évidentes, admises sans démonstration. Or, ces axiomes n’étaient pas du tout binaires, mais unaires puisqu’ils soutenaient que « la version se définit par la version », « le signifiant par le signifiant » et « le je par le je ».
Je le répète donc, les Maîtres du structuralisme ne voulaient pas du tout bégayer, mais rendre compte des productions de leur champ de façon binaire, de façon à passer de la description au système. Si je puis dire, c’est moi qui les ai fait bégayer. Je pense en effet avoir montré que, pour que l’opérateur binaire fonctionne, il fallait qu’il s’applique sur des axiomes, c’est-à-dire des propositions considérées comme évidentes, admises sans démonstration. Or, ces axiomes n’étaient pas du tout binaires, mais unaires puisqu’ils soutenaient que « la version se définit par la version », « le signifiant par le signifiant » et « le je par le je ».
Moi, ça m’a beaucoup amusé de découvrir ces Maîtres (que j’admirais) la main dans un autre sac que celui de la binarité au moment de leurs professions de foi structuraliste. Comme j’étais jeune et un peu irrévérencieux, j’ai enfoncé le clou en disant que je comptais ces bégaiements parmi ce qu’ils avaient fait de mieux. Pourquoi ? Parce qu’ils nous sortaient, sans nécessairement le savoir ou le vouloir, de la logique (le Logos, comme tel binaire), prévalant depuis les fondements grecs. Ce type de définitions a en effet été proscrit par la logique classique dès que celle-ci s’est établie. Il l’a été dès Aristote qui soutenait, dans son Organon (VI. 6, Réfutations sophistiques, réduction des paralogismes), qu’il ne faut pas faire entrer en ligne de compte, dans la définition, la proposition initiale à prouver, sinon il y a paralogisme. On ne peut pas, en bonne logique (en bonne logique binaire, bien sûr), définir la chose par la définition de la chose. Il y a une bonne raison à cette proscription. Le definiens (le définissant) doit être différent du definiendum (ce qu’il faut définir), sinon on aboutit tout de suite à une antinomie. Ça se comprend : la logique pour s’établir ne peut que proscrire les paralogismes.
Par exemple, si l’on définit « je » par « je », les ennuis commencent : notre proposition se met immédiatement à présenter deux caractères différents et incompatibles l’un avec l’autre. D’une part, en effet, si « je » est défini par « je », la proposition est alors totalement auto-suffisante, parfaite en un mot et il n’y a rien à lui ajouter puisque le « je » est entièrement défini par lui-même. Mais, de l’autre et simultanément, cette définition est totalement insuffisante : « je » est « je », d’accord, mais qu’est-ce que « je » ? La réponse obtenue ne permet guère que de donner à la question originelle un tour un peu plus crucial. Et nous voici avec une réponse qui est une nouvelle question, élevée au carré par rapport à la question originelle. Bref, on se trouve donc contraint de dire dans le même temps que la définition est totalement suffisante et qu’elle est totalement insuffisante. Autrement dit, avec ce type de définitions, le paradoxe pointe tout de suite.
Force est de constater que notre langue est la proie permanente de renversements intempestifs de toute-suffisance en toute-insuffisance et plus généralement de tout en rien et de oui en non. On peut le dire autrement : l’évidence des propositions unaires relève de l' »obscure clarté ». En elles, se conjoignent les contraires. Et, de fait, la langue dont nous usons nous contraint à passer par ce type de propositions, ne serait-ce dans son mot le plus usuel : « je ». De plus, l’obscure clarté a vocation à la dissémination à mesure même que le discours se poursuit. C’est pourquoi, en certains endroits de la langue, les oppositions n’ont plus cours, les contraires ne s’opposent plus. Ce trait a d’ailleurs été relevé comme caractéristique de l’inconscient, du rêve, du récit, du mythe… lesquels gouvernent nos actes.
J’ai donc cru pouvoir déduire de ces remarques que la binarité structurale était incomplète, au sens de Gödel, aussi loin qu’on la fasse remonter, fut-ce jusqu’aux Grecs. Il y avait, derrière, autre chose, une autre logique, dont il ne fallait plus se servir subrepticement, mais explicitement. Ces définitions où la version se définit par la version, le signifiant par le signifiant, et le je par le je…, on peut certes les désigner comme relevant de la tautologie ou de l’auto-référence, mais on peut aussi se souvenir que cela renvoie à la logique, non-binaire, mais unaire, surgie ailleurs qu’à Athènes, en l’occurrence à Jérusalem. Cette forme en effet n’est pas sans rappeler le fameux « Ehyeh ascher ehyeh » d’Exode III 14 par laquelle le Dieu de la Bible se définit. Je suis resté fort calme en faisant cette découverte au sens où celle-ci n’a entraîné en moi aucun transport enthousiaste, mystique ou religieux ou sacré ou quoi que ce soit de cet ordre. Affects qui me laissent de marbre puisque, pour autant que je sois bien informé, je suis et je reste un athée sinon militant, du moins résolu.
Cette découverte de l’unaire ne m’a pas pour autant fait dire que les sciences de l’homme dans lesquelles, comme tu le fais très bien remarquer, sujet et prédicat se confondent puisque l’homme y observe l’homme, ne sont qu’une théologie déguisée ou sécularisée. Ça m’a fait presque dire le contraire : si la théologie a si bien fonctionné pendant si longtemps, c’est qu’elle a réussi à transcendantaliser la question de la réflexivité humaine, qui est peut-être le cœur mystérieux de la conscience, ce propre de l’Homme, lui donnant ainsi la meilleure figuration possible. Mais n’est-il pas temps, aujourd’hui, que l’Homme de l’époque des sciences humaines reprenne son bien le plus précieux, qu’il avait autrefois été celé là-haut dans la plus inexpugnable des cachettes, celle qui est au lu et su, si je puis dire, de tout le monde ?
C’est d’ailleurs, littéralement, ce qu’a fait Benveniste. Il a transféré au sujet parlant la définition autrefois réservée à Dieu ‑ ce qui n’est somme toute pas très étonnant quand on sait que Benveniste a fait ses études à l’École rabbinique (de Paris) avant de suivre les cours du grand linguiste Meillet et de devenir lui-même l’un des plus importants linguistes du XXe siècle[ii]. Ce fut en effet Benveniste, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a défini le sujet parlant par la formule : « est je qui dit je ». Or, bien que Benveniste n’y fasse nulle part allusion dans son œuvre, cette formule est décalquée de l’ancienne définition divine, tout à fait unaire, par laquelle Dieu, à travers Moïse, se nommait et se présentait aux hommes : Benveniste a en somme attribué au sujet parlant de tout-venant la définition auto-référentielle ou unaire autrefois accordée à Dieu.
Ce transfert de définition aurait dû frapper les esprits ― encore aurait-il fallu qu’on s’en soit seulement aperçu. Mais il était sidérant. Trop peut-être pour qu’on s’avise vraiment des conséquences d’un tel transfert. Mais moi, ça m’a ouvert un champ pour essayer de penser toutes les implications philosophiques de ce déplacement capital.
BR : Tu poursuis, en 1996, ton enquête sur la forme unaire en publiant Folie et démocratie. Logique puisque, dans ce cadre d’effondrement des grands récits, c’est l’individu qui est désormais sa propre référence et que, par conséquent, le Même est l’Autre ou, dit autrement, que le Même et l’Autre sont le Même. Serions-nous alors en train de devenir fous ? La folie, dans les sociétés postmodernes, est-elle en train de devenir ordinaire ? C’est ce que tu laisses entendre dans ce dialogue (p. 127) :
– Il reste cependant à savoir ce qui modère notre ardeur une fois le cap franchi : qu’est-ce qui fait que nous ne devenons pas nécessairement des délirants absolus ?
– Ma thèse est qu’avec la démocratie nous sommes précisément en train de le devenir. »
DRD : Oui, j’ai fait, dans ce livre de 1996, l’hypothèse d’un possible surgissement de la folie dans l’Histoire occidentale. Sévère diagnostic qui procédait de la mise en série et de l’articulation de thèses venues de Lacan, de Benveniste, de Lyotard et de… Beckett.
L’idée que la démocratie pouvait devenir folle, j’en avais beaucoup discuté avec Serge Leclaire, grand lecteur de mes premiers livres. Elle m’est venue du fait qu’il m’avait introduit aux thèses de Lacan sur la psychose. Elle s’explique en dernier recours, disait ce dernier, par la forclusion du Nom-du-Père. Ce que j’ai compris ainsi : si un « je » ne peut plus se poser ou se reposer sur une figure acceptable du « il », de l’Autre, alors ce « je » devient fou. Benveniste, quand il avait créé, après la guerre, la linguistique de l’énonciation, avait certes défini, comme je l’ai dit, le sujet parlant par cette formule unaire, est « je » qui dit « je ». Mais ce n’était là qu’un geste technique permettant la prise de parole « ici et maintenant ». En dernier ressort, ce « je » pouvait toujours renvoyer à un « là et ailleurs », le garantissant dans le risque qu’il prenait de parler en première personne.
C’est exactement ce qu’avait fait Descartes au XVIIe. Sa définition du sujet, « je pense donc je suis », était déjà une définition en « je » donc « je ». C’est pourquoi, dans sa Méditation Troisième, intitulée « De Dieu, qu’il existe », il avait corrélé son sujet à l’existence de Dieu. Signifiant qu’il n’y aurait pas d’Homme, « être fini », s’il n’existait Dieu, « substance infinie » que Descartes qualifie d' »indépendante » au sens où elle se définit toute seule, par elle-même.
En d’autres termes, on ne court aucun risque de perte du sujet dans les dédales unaires pour peu qu’il existe toujours un ou des grands récits sur lesquels ce sujet peut en dernier ressort s’appuyer. Mais que se passe-t-il si ces grands récits viennent à disparaître ?
Or, c’était justement l’hypothèse de la postmodernité, formulée en 1979 par Jean-François Lyotard, que j’appréciais beaucoup. Dans La Condition postmoderne, il définissait la postmodernité comme la chute des grands récits. Ceux qui restaient à l’époque de la modernité. C’est-à-dire celui de l’émancipation individuelle par l’accès à la raison critique que les Lumières – Kant en particulier – avaient tant célébré, celui de la fin de l’Histoire de Hegel et celui de l’émancipation sociale dont le marxisme était l’emblème. La chute des grands récits marque donc l’ouverture d’une période nouvelle, celle de la post-modernité où le sujet se retrouve un peu seul, sans grands récits pour le déployer vers un quelconque horizon.
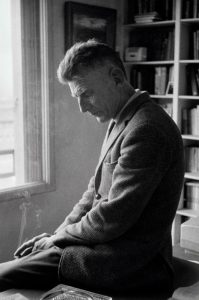 Tout cela m’a porté vers Beckett. Lequel, dans un récit écrit en 1949 et publié en 1953, L’innommable, titre hautement significatif désignant le nouveau sujet (ou a-sujet) de la postmodernité, est l’auteur d’une mémorable formule contre-benvenistienne : « je dis je en sachant que ce n’est pas moi » (p. 176). Si l’embrayage, comme disait Jakobson dans sa théorie des pronoms personnels comme « shifters », ne marche plus au sens où celui qui dit « je » n’est plus soutenu par un Tiers, alors nous voici condamnés à patiner sans fin dans le discours. C’est justement la situation unaire où se retrouve le narrateur de L’Innommable, qui se lance dans un discours sans début, ni fin. Lequel commence par : « Où maintenant ? Quand maintenant ? Qui maintenant ? Sans me le demander. Dire je. Sans le penser. Appeler ça des questions, des hypothèses ». Et le texte se termine par : « il faut continuer, je ne peux pax continuer, je vais continuer. »
Tout cela m’a porté vers Beckett. Lequel, dans un récit écrit en 1949 et publié en 1953, L’innommable, titre hautement significatif désignant le nouveau sujet (ou a-sujet) de la postmodernité, est l’auteur d’une mémorable formule contre-benvenistienne : « je dis je en sachant que ce n’est pas moi » (p. 176). Si l’embrayage, comme disait Jakobson dans sa théorie des pronoms personnels comme « shifters », ne marche plus au sens où celui qui dit « je » n’est plus soutenu par un Tiers, alors nous voici condamnés à patiner sans fin dans le discours. C’est justement la situation unaire où se retrouve le narrateur de L’Innommable, qui se lance dans un discours sans début, ni fin. Lequel commence par : « Où maintenant ? Quand maintenant ? Qui maintenant ? Sans me le demander. Dire je. Sans le penser. Appeler ça des questions, des hypothèses ». Et le texte se termine par : « il faut continuer, je ne peux pax continuer, je vais continuer. »
Soit Beckett met en scène un sujet perdu dans le discours, soit il met en scène deux sujets attendant le retour de l’Autre. Cette seconde solution explorée par Beckett, c’est celle de Vladimir et Estragon : ils attendent Godot qui ne viendra pas et ils se disputent sans fin, en attendant, pour des broutilles. Beckett est le grand romancier de la folie ordinaire (unaire) dans laquelle, faute de tiers fiable, ont sombré nos démocraties de masse. Le sujet s’emmêle, il ne sait plus de quoi il parle. Ce qui était évident lui échappe. Ou alors il discute et se dispute sans fin avec son interlocuteur sans savoir pourquoi et sur quoi.
Dans ce livre, Folie et démocratie, Logos et Sogol se retrouvaient donc pour discuter de certaines situations précises, significatives de l’époque, où des sujets, ne pouvant plus s’appuyer sur une figure du « il » portée par les grands récits, se retrouvaient en position de panne symbolique et d’emmêlement unaire. Le moins qu’on puisse dire est que la situation ne s’est pas arrangée depuis l’époque où j’ai publié ce livre, il y a presque trente ans. Aujourd’hui, tout ce qui était évident est devenu incertain. C’est ce que Freud appelait « le principe de réalité » qui semble se trouver socialement, et non plus seulement individuellement, atteint. Du coup, le sujet d’aujourd’hui ne parvient plus à s’extraire de l’hallucination, du rêve, du ressenti ― il devient comme psychotique, succombant au principe de plaisir, si on peut appeler cela « plaisir », incapable d’admettre l’existence d’une réalité qui n’est pas conforme à ses désirs réduits à son « ressenti ». En voici un exemple qui n’est pas anecdotique puisqu’il touche à notre être même, en tant que sexué. Aujourd’hui, de plus en plus de sujets ne savent plus quel est leur sexe. Ce qui compte, ce n’est plus le fait bêtement biologique d’être homme ou femme (indépendant de ma volonté), c’est le ressenti (assez versatile), ce qu’on appelle le genre. Et le droit, qui était en principe là pour mettre des garde-fous (c’est le cas de le dire) à mon ressenti, l’entérine désormais puisque, sur simple déclaration, depuis 2020, alors que les lois de la biologie sont toujours les mêmes et a priori pas ignorées par les juges, je peux en quelques jours changer de sexe à l’état civil. Autrement dit, le droit actuel rend fou puisqu’il fait comme si l’imaginaire du genre (que je peux choisir) pouvait s’imposer au réel du sexe (que je ne peux pas choisir puisqu’il est la conséquence de la loterie génétique). Autrefois, on pouvait « se prendre pour » sans croire pour autant qu’on « était ». C’est ainsi que, par exemple, dans des cultures très différentes, des hommes ont pu vivre socialement en affichant des traits féminins (outre les travelos européens, on connaît les Hijra de l’Inde, les Fa’afafine de Polynésie, les Kathoeys de Thaïlande, les Sworn virgin Virgins des Balkans, les Akava’iné Maorismaoris, les Burnesha d’Albanie, les Bakla des Philippines, les Winkte Sioux d’Amérique, les Muxe du Mexique et bien d’autres) sans croire pour autant qu’ils étaient des femmes. Maintenant, ceux qui présentent ces traits sont incités à se dire « femmes », moyennant au besoin quelques opérations chirurgicales visant à leur donner une apparence féminine. Or l’apparaître ― c’est le b.a.-ba de la philosophie ― n’est pas l’être. Cependant, cette confusion, rendue possible par la conjonction d’un droit devenu fou et par l’offre de l’industrie (ici médicale et chirurgicale), est telle aujourd’hui qu’elle gagne jusqu’à l’enfance et l’adolescence. On trouve de plus en plus de jeunes filles, dans cet âge incertain de la puberté propice à toutes les confusions, qui pensent, parfois soutenues par leurs parents, qu’elles sont des garçons et qu’elles doivent être reconnues telles (ou vice-versa), jusqu’à recevoir des traitements destinés à soutenir leur choix.
C’est cela que je voyais venir dans Folie et démocratie. Le fait que, dans les démocraties de marché, il n’y a pas de limite à ce à quoi j’ai droit. Où cela s’arrêtera-t-il ? On ne le sait guère puisque, si moi homme je peux aujourd’hui sur simple déclaration m’affirmer femme, je ne vois pas ce qui m’empêcherait d’aller demain au tribunal pour que mes papiers d’identité attestent de mon ressenti profond, celui d’être un pharaon de la IVe dynastie… Avant, cela me conduisait directement à l’HP, maintenant, cela m’ouvre grandes les portes de la maison de justice où je fais enregistrer mes choix. De même, un certain nombre d’affaires judiciaires s’enclenchent aujourd’hui à partir du simple ressenti d’un plaignant (« j’ai vu dans ses yeux [c’est un « ressenti »] qu’il voulait m’agresser ») cependant que beaucoup d’affaires où il y a des faits avérés d’agression sont classées sans suite ou sans grandes suites. J’ajoute à cette perte du sens commun l’augmentation très significative du nombre d’individus qui « ressentent » et donc pensent, par exemple, que la terre est plate (20 % des Américains et 10 % des Français) ou que Dieu a créé l’homme il y a trois mille ans ou que la cause de tous les malheurs du monde vient des Illuminatis…
Bref, j’ouvrais par ce livre un questionnement de fond : celui d’une possible modification de la condition subjective consécutive à l’entrée en post-modernité, caractérisée par la chute des grands récits.
BR : Mais tu ne considères pas la forme unaire sous les seuls aspects (tauto-) logique (l’autoréférence) et sociologique (la démocratie postmoderne) : tu l’inscris de surcroît dans l’histoire des sociétés humaines, par exemple quand tu écris dans Le bégaiement des Maîtres : « La langue et l’intelligence naturelle ont toujours installé, en leurs centres, successifs, une énigme autour de laquelle s’agrège le récit – que vous la nommiez Physis, Dieu, Roi, Homme » (p. 73). Et en lisant cette phrase, je ne peux que penser à l’un de tes derniers livres, paru en 2021 chez Actes Sud, Le Dr. Mabuse et ses doubles, dans lequel tu proposes justement un tour d’horizon des Grands sujets, Physis, Dieu, Roi, Marché. Tiens, le Marché justement : est-ce là la dernière (aux deux sens de « la plus récente » mais également de « définitive » ou « finale » ?) forme unaire de l’histoire humaine ?
DRD : Il y a bien des façons d’entrer dans ce champ, l’Histoire, que je ne vais pas inventorier ici. Ce que je peux dire, c’est que, moi, j’y suis entré à partir de la philosophie du langage en général et la linguistique de l’énonciation en particulier. Ce n’est pas très orthodoxe comme mode d’accès à la discipline, mais cela ne me semble pas plus bizarre que d’y entrer en privilégiant l’action de certains personnages historiques, des époques, des dates, des modes de production ou des régimes politiques.
Je pars donc de cette proposition qu’on me concédera, je l’espère, sans atermoyer : un homme, ça parle. Ça dit « je » à un « tu » à propos de « il » ― c’est sur cette base que j’ai construit ma logique trinitaire sur laquelle on pourra revenir. Or dire « je » est à la fois la chose la plus facile du monde parce que cela n’est pas soumis à la condition de vérité ― je n’ai pas à prouver que ce que désigne ce « je », c’est bien moi ―, et la chose la plus compliquée qui soit. On peut en effet, avant même de commencer, tomber psychotiquement dans ce « je » défini unairement et se mettre à patiner dans le délire au lieu de parler. Ça arrive de temps en temps, voire de plus en plus. Le remède, je l’ai déjà indiqué : il faut adosser ce « je » à une instance qui prendra sur elle l’auto-référence. « Lui » s’est fondé tout seul, de façon « indépendante », disait Descartes. Je me réfère donc à Lui en me disant son sujet. Ça donne un petit sujet (assujetti), moi, et un grand Sujet, Lui. En gros, ça s’énonce donc ainsi : pour que je sois ici et maintenant, il faut et il suffit que Lui soit là. En échange de cette soumission première, je peux tranquillement dire à peu près tout ce que je veux. Le gain, c’est d’échapper à la psychose ; le prix à payer, c’est d’être névrosé, c’est-à-dire sujet du grand Sujet.
Or, problème, cet Autre, il n’existe pas dans le réel. Il faut le construire. Cela peut se dire autrement : au lieu de me délirer tout seul (j’ai dit où ça menait), je vais délirer l’Autre en montant un récit au centre duquel je placerai un grand Sujet assumant une définition unaire. On ne peut pas, à mon avis, parler d’Histoire sans se référer à la succession de ces grands Sujets. Et, de fait, lorsqu’on se penche sur l’Histoire, on trouve cet Autre dans tous les mondes possibles construits par l’homme. Soit sous la forme du totem, par exemple, par quoi un groupe d’hommes se désigne une sorte de dominant (un ancêtre, un animal…). Soit sous la forme d’esprits qui hantent les lieux où résident les hommes. Soit sous la forme de dieux immanents au monde qui, comme les dieux grecs de la Physis, par exemple, interviennent sans cesse dans les affaires de l’homme. Soit sous la forme d’un Dieu transcendant, comme dans les monothéismes qui figurent un Père absolu, éternel. Soit même sous la forme de religions politiques, comme dans l’absolutisme royal qui a produit un autre grand Sujet, le Roi. Probablement trop grand puisqu’il a fallu le raccourcir : cela s’appelle la Révolution française. Et c’est un autre grand Sujet qui est apparu : le Peuple. Enfin, n’oublions pas les religions politiques qui se sont construites au xixe siècle, comme le marxisme qui présentait le Prolétariat comme le sauveur et, au xxe siècle, le nazisme qui célébrait une prétendue race supérieure (sur ce concept de « religion politique », je renvoie aux travaux d’Ernst Kantorowicz, d’Éric Voegelin et de Marcel Gauchet). Tous ces Autres ont permis la fonction symbolique dans la mesure où ils ont donné un point d’appui au sujet pour que ses discours reposent sur un fondement. Mais, bien sûr, certains, peu croyables à long terme, n’ont fait que de fugaces apparitions alors que d’autres, mieux construits, ont connu des destins millénaires. J’ai essayé de montrer, dans On achève bien les hommes (2005), que tous ces grands Sujets répondaient à la définition unaire, et pouvaient fonctionner comme ce « moteur immobile » dont parle Aristote dans Métaphysique (Livre Λ), qui se constitue d’un être qui se pense ou qui se crée lui-même. Par exemple, le Prolétariat, chez Marx est un rien qui se transforme en tout. C’est le thème du Nihil/ Totum, de facture très unaire, que Marx est allé chercher chez Hegel, lecteur de maître Eckhart, d’Angelus Silesius et de Jacob Boehme.
Il est cependant clair pour moi que ce moteur immobile est une illusion, une illusion nécessaire, permettant au sujet, au sujet parlant, d’embrayer, pour reprendre la métaphore mécanique de Jakobson, qu’on peut filer en disant qu’il s’agit alors pour lui de ne pas patiner. Je ne suis donc pas assez mystique pour penser avec Henri Bergson (cf. la fameuse conclusion de son ultime ouvrage, Les Deux sources de la morale et de la religion, 1932) que « La fonction essentielle de l’univers [est d’être] une machine à faire des dieux ». L’univers, comme la nature spinozienne, se débrouille très bien tout seul, sans dieu, mais l’homme, non. Du coup, je crois plutôt, avec le biologiste et moraliste Jean Rostand, que « C’est la destinée de l’homme de se faire des dieux de plus en plus croyables, qu’il croira de moins en moins » (Pensées d’un biologiste, 1939). Une proposition dont j’apprécie beaucoup la chute ― à mon avis, plus tragique que drôle, car elle indique que cette affaire risque de très mal se terminer.
On le voit d’ailleurs avec le Marché, drôle de grand Sujet, inventé par Adam Smith vers le milieu du XVIIIe siècle. Il y a consacré la première partie de son cours de philosophie morale, portant sur la théologie naturelle. Certes, ce cours est perdu ― ce qui arrange bien les économistes qui s’efforcent d’oublier les origines théologiques du capitalisme en parlant des « sciences économiques ». Mais le contenu de ce cours reste en grande partie accessible car l’élève et principal disciple d’Adam Smith, John Millar (1735-1801), a rendu compte de son enseignement ― je renvoie sur ce point à l’excellent livre de François Dermange, Le Dieu du marché : éthique, économie et théologie dans l’œuvre de Smith (Labor et Fides, Genève, 2003). J’en reprends ici les grandes lignes. Smith, après avoir analysé les points faibles des preuves de l’existence de dieu, se demandait comment refonder la religion. Et la réponse qu’il apportait, c’était de tenter de sortir de la religion de la transcendance et de fonder une religion naturelle, une théologie scientifique d’inspiration newtonienne. Adam Smith postule qu’à l’instar de l’univers cosmique structuré par un jeu de force reposant sur le principe de l’attraction, l’univers humain est organisé, sans que les individus le sachent, par un jeu de force reposant sur le principe de l’intérêt personnel. L’intérêt joue en somme dans la théologie naturelle le rôle de l’attraction dans la théologie scientifique de Newton. Le génie d’Adam Smith sera ici de transposer l’idée d’un dessein divin organisant l’ensemble et débordant, dépassant chaque volonté individuelle. Il y a là une vraie révolution : ce n’est plus Dieu qui commande le tout, car le tout n’est que la résultante holistique d’une multitude de forces locales. Ce tout supérieur à la somme des parties, Adam Smith le nomme : « la Main invisible » : « [L’individu] ne pense qu’à se donner personnellement une plus grande sûreté ; et en dirigeant cette industrie de manière que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu’à son propre gain ; en cela, comme dans beaucoup d’autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses intentions ; et ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus mal pour la société, que cette fin n’entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt de la société, que s’il avait réellement pour but d’y travailler » (Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, IV, 2).
Cette « main invisible », qui coordonne le tout, implique trois conséquences majeures. Premièrement, tout produit devient échangeable à sa juste valeur, laquelle est fixée par le Marché selon les lois de l’offre et de la demande. Deuxièmement, la monnaie devient ipso facto le grand équivalent général, celui qui peut tout acheter et qu’il y a donc lieu d’accumuler. Troisièmement, la « main invisible » renouvelle considérablement les problématiques de la théodicée, que Leibniz a formulées dans ses Essais de Théodicée : pourquoi le mal subsiste-t-il sur Terre si Dieu existe ? Réponse : le mal subsiste pour que le bien existe car la « main invisible » est justement ce qui permet la conversion du mal (l’égoïsme de celui qui ne pense qu’à son propre intérêt quand il échange avec un autre sur le Marché) en bien (car cet égoïste travaille, sans le savoir, à l’intérêt général de la société). La nouvelle religion naturelle corrige donc l’ancienne qui affirmait qu’il fallait réprimer le mal, les vices, les concupiscences. Ici, Smith reprend Mandeville sans le dire : il faut laisser faire ces passions car elles servent en définitive au bien, c’est-à-dire à l’augmentation de la richesse de la Nation. Un pas historial décisif me semble avoir été ici franchi : ce qui était prohibé entre égaux depuis Platon (la pleonexia grecque, « avoir plus que sa part ») devient autorisé. C’est une autre face de Dieu que cette religion naturelle révèle : un Dieu qui sait utiliser les défauts des hommes pour produire le bien en dépit d’eux-mêmes. Ce calcul d’optimisation vient en droite ligne de Leibniz. Si ce calcul est respecté, alors nous sommes dans le meilleur des mondes possibles. On peut donc dire qu’avec le libéralisme, nous sommes sortis de l’ancienne religion, mais pour entrer immédiatement dans une nouvelle. Dont on ne sait pas comment sortir puisqu’il continue d’apparaître comme le meilleur des mondes possibles :
- alors même que le Marché est en train de détruire le monde. Le Marché a en effet transformé le monde en un immense complexe de ressources à exploiter de façon rationnelle et industrielle ― trois siècles plus tard, on commence à s’apercevoir des conséquences de l’entrée dans l’ère industrielle (pollutions diverses et approche du point de rupture de certains grands écosystèmes).
- alors même que le Marché est en train de détruire la civilisation. La civilisation suppose en effet une certaine répression pulsionnelle alors le Marché implique la libération des pulsions ― ce qui débouche sur certains processus de décivilisation de plus en plus visibles, me semble-t-il.
- alors même que le Marché est en train de détruire la subjectivité de ses petits sujets. Sommés qu’ils sont de se comporter désormais non plus en névrosés, mais en pervers. Ce qu’avait annoncé Mandeville, médecin des passions, mais que Smith a préféré refouler. En effet, ce que le Marché veut, ce ne sont des sujets s’autorisant de leur pulsion d’avidité. Car eux seuls sont en effet capables de produire de la richesse en n’hésitant pas, par tous les moyens possibles, à circonvenir leurs prochains ― il suffira alors de dire que l’entourloupe que ces derniers subissent ne pourra, à terme, que leur être bénéfique (puisque la richesse globale croîtra). C’est pourquoi, j’ai donc synthétisé le commandement de ce nouveau Maître, le Marché, par cette formule : « Baise ton prochain ».
On perçoit tout de suite la limite de ce système : n’est pas pervers qui veut. Autrement dit, il reste quantité de névrosés qui ne pourront jamais s’autoriser de leur pulsion. C’est pourquoi, dans les régimes libéraux qui se sont installés ― par exemple aux États-Unis ―, la place de l’ancienne religion est restée si importante. En gros, ces régimes fonctionnent avec des pervers aux commandes visant le toujours plus, répondant à l’appel de libération pulsionnelle ordonné par le nouveau grand Sujet, et des névrosés commandés, continuant plus ou moins de répondre à la répression pulsionnelle prescrite par l’ancien grand Sujet, Dieu.
Il suffira cependant que le nouveau grand Sujet, le Marché, se retrouve en position triomphante ― ce qu’a réussi à obtenir l’École de Chicago de Hayek et Friedman à partir des années 1970 ― pour que les sociétés qu’il engendre, néolibérales, se retrouvent avec moins de névrosés s’excusant sans cesse de leur petitesse, plus de pervers affichant leur supposée grandeur et beaucoup plus de dingues délirant unairement et agressivement leur origine et leur identité. Sans compter ceux qui sont englués dans la dépression ou l’addiction.
BR : Tu l’as déjà précédemment souligné, la logique ne s’épuise pas dans le binaire et l’unaire, elle exige une instance tierce à laquelle se réfère le « je » qui s’adresse au « tu ». La tradition occidentale, selon toi, a aussi bien refoulé l’unaire que le trinitaire. D’ailleurs, dans la préface qui accompagne la nouvelle édition (2023) de tes Mystères de la trinité, tu soulignes que tu as conservé l’édition de 1990 car nous étions, il y a donc plus de trois décennies, « au bord du grand saut, du plongeon dans l’inconnu, du grand remplacement de l’ancien homme trinitaire par un nouvel homme binaire » (2023, p. 11). Et le grand remplacement, manifestement, d’avoir eu lieu car tu conclus cette préface en affirmant que nous sommes à présent submergés par le « tsunami binaire ». Pourrais-tu expliquer à nos lecteurs en quoi consiste cette logique trinitaire, dans la mesure la tradition philosophique fut incapable de la saisir et quels sont les enjeux anthropologiques de l’avènement de l’homme binaire ?
DRD : Je commencerai par la fin de ta question, par un essai de définition de ce que j’appelle « logique trinitaire ». Je ne saurais le faire, bien sûr, que par rapport à mon champ de travail : la discursivité. Pourquoi partir de là ? Parce que c’est là où l’espèce humaine habite en premier lieu, dans ses discours. Et c’est en passant par là, par ses discours, qu’elle essaie ensuite d’habiter sur terre. Elle n’y réussit pas toujours ― on s’en aperçoit un peu plus chaque jour.
Mais revenons à ce lieu où nous habitons en premier lieu, la discursivité. Les discours sont incroyablement multiples, en expansion permanente, répartis ou spécialisés en domaines distincts, relatifs à des lieux et des temps éminemment différents… Mais, quelle que soit leur diversité, ils présentent une caractéristique identique : ils sont adressés. Quoi qu’on dise et où et quand on le dit, on repère toujours trois instances : il y a celui qui parle, celui à qui je parle et ce dont je et tu parlent. Certes, il peut exister vingt pronoms personnels dans une langue, selon la position sociale, le statut familial, l’âge de ceux qui se parlent, mais quel que soit leur nombre, variable selon les différentes langues, les pronoms personnels ou les flexions verbales s’organisent toujours autour d’une structure trinitaire. Selon Benveniste, cette structure a été découverte par les grammairiens arabes : « Pour eux, la première personne est al-mutakallimu, « celui qui parle » ; la deuxième al-muhatabu, « celui à qui on s’adresse » ; mais la troisième est al-ya ibu, « celui qui est absent » » (Problèmes de linguistique générale I, p. 228).
Cette structure est décisive car elle constitue l’instrument de la conversion de la langue en discours. La langue, on sait ce que c’est. On s’accorde en général pour distinguer trois plans constitutifs de la langue : celui du sens, celui du son et celui de l’ordre des mots dans la phrase ― ce qui a donné trois sciences (la sémantique, la phonologie, la syntaxe) qui peuvent éventuellement être binaires ou binarisées. Mais lorsque la langue est convertie en discours par l’acte d’un sujet parlant qui s’est approprié ces différents plans, nous ne sommes plus dans un espace binaire, mais dans un espace trinitaire. Nous entrons alors dans l’espace où, pour le dire en français, un je parle à un tu à propos de il. Certes, on peut binariser cet ensemble en le traduisant en une série de relations dyadiques. Mais, comme le dit le fondateur de la sémiologie, Ch. S. Peirce, même si l’on peut décomposer une relation trinitaire en relations dyadiques, une relation trinitaire ne peut jamais être reconstruite comme un complexe formé à partir de relations dyadiques (Cf. Ch. Peirce, Écrits sur le Signe, Seuil, Paris 1978, « Première lettre à Lady Welby », p. 29). Peirce est ici important car tout, chez lui, contrairement à Saussure dont le binarisme a inspiré le structuralisme, se répartit en trois classes, ce qu’il appelait des trichotomies. Je rappelle que toute la réflexion de Peirce prend appui sur une critique de l’algèbre de Boole (1867) qui, on le sait, donnera le branle au mouvement qui allait conduire à la logique moderne et à l’alphabet binaire des langages-machine de l’informatique : le circuit booléen (ou circuit logique) est un circuit électronique qui accomplit les opérations de l’algèbre de Boole sur des tensions, représentant électriquement les états 1 ou 0. À partir de sa critique de l’algèbre de Boole, Peirce développera, indépendamment de Frege dont il ne connaissait pas les travaux, une logique propositionnelle où il faisait usage d’un troisième terme qui deviendra plus tard (avec Sheffer) : le « rejet » ou « bi-négation » : « ni – ni -« . On sait maintenant que ce qui sera nommé « logique trivalente » après les travaux de Lukasiewicz en 1920 et de Post en 1921 (ajout, au côté des deux valeurs du vrai et du faux d’une troisième valeur, la « possibilité » ou « contingence ») doit, en fait, être daté des travaux de Peirce en 1909 où était élaborée une « logique triadique », « universellement vraie » (je renvoie sur ces points aux travaux de P. Thibauld, La Logique de Charles S. Peirce. De l’algèbre aux graphes, Ed. de l’université de Provence. 1975).
Je le répète donc : lorsqu’on décompose une relation trinitaire en relations binaires, on fait tout simplement disparaître le trinitaire. Cette décomposition de l’énonciation trinitaire en relations binaires, c’est d’ailleurs ce qu’a fait Benveniste dans cet ouvrage majeur que sont les Problèmes de linguistique générale. Aussitôt après avoir posé l’ensemble trinitaire des pronoms personnels, celui des grammairiens arabes, il a décomposé sa définition en deux sous-ensembles binaires : d’une part, il analyse la dyade formée par la paire « je » versus « tu » (corrélation de subjectivité), ensuite, il pose « je » et « tu » ensemble d’un côté et « il » de l’autre (corrélation de personnalité). À partir de l’ensemble trinitaire, il a ainsi obtenu et étudié deux dyades binaires. Ce faisant, même s’il nous introduit à certaines questions-clefs relatives à l’accès à la subjectivité dans et par le langage (reprises notamment par Lacan dans son Séminaire III sur les psychoses), il a perdu, par dissolution du trinitaire dans le binaire, la qualité proprement trine de cet ensemble.
Autant donc l’œuvre de Benveniste fut décisive pour moi, autant elle m’a laissé un immense champ d’études à propos de la propriété trine ― c’est pourquoi j’ai écrit Les mystères de la trinité. Par « propriété trine », j’entends que, dans une « structure » à trois termes, aucun ne peut être défini sans que les deux autres soient évoqués. Autrement dit, dans cette définition, l’un quelconque implique les deux autres, si bien que trois termes sont au total nécessaires pour définir ici ce rapport. C’est là ce que figure parfaitement le fameux nœud borroméen de Lacan.
Et, de fait, cette propriété trine, je l’ai poussée dans tous les champs où ça cause : dans le mythe, dans l’inconscient, dans les modalités de subjectivation, dans les grands récits (les Écrits saints). Et j’ai vu que tous ces champs répondaient à l’hypothèse trine.
Si mon analyse du trinitaire est juste, il devrait s’ensuivre ici ce qui s’en est ensuivi là à propos de l’unaire : des champs multiples, différents et séparés sont en fait isomorphes et devraient être réductibles au schème qui les fonde. Bien sûr, pour procéder à cette « réduction », une sorte de super opérateur de forme trinitaire est nécessaire. Devrais-je donc, toute affaire cessante, m’engager dans la voie aride de la construction d’un nouvel algorithme issu d’un calcul trinitaire encore à naître ? Non, car ce nouvel algorithme nous attend depuis longtemps : il n’existe nulle part ailleurs que dans notre usage le plus spontané du langage. Car ce que j’évoque ici participe de notre expérience la plus spontanée et la plus incontrôlée d’être parlant. Impossible en effet d’ouvrir la bouche sans dire je à un tu à propos de il. Mais pour être triviale, cette donnée n’en reste pas moins « infiniment importante » dans la mesure où elle se rapporte au fait majeur de l’entrée dans la subjectivité et dans la symbolisation.
Si cet ensemble je, tu et il est « infiniment important », c’est parce qu’il fonctionne comme un dispositif de conversion de la langue en discours qui inscrit toujours à leur place les allocutaires. En somme, l’échange des énoncés, infinis, passe par un prisme énonciatif fixe à trois termes d’usage commun. Parlez, dites ce que vous voulez et vous mettrez en jeu ce système des trois personnes verbales qui contient les articulations fondamentales de notre espace symbolique. Outre les relations de personnes, ce système informe en effet les relations d’espace et de temps, elles aussi trinitaires.
L’espace, puisque je est « ici », tu est « là » et il « là-bas ». Lorsqu’ils parlent, je et tu créent une scène discursive où ils peuvent convoquer à comparaître n’importe quel objet du monde où qu’il se trouve, fut-il dans un monde imaginaire.
Le temps devient également représentable puisque, lorsque je parle, je suis au présent. Il n’y a d’ailleurs pas d’autre définition du présent que ce temps où je parle. En d’autres termes, lorsque je parle, je suis « maintenant ». Ce dont se déduit un « avant » et un « après ».
Enfin, cette relation trine permet la création des catégories symboliques fondamentales de la présence, de la co-présence et de l’absence. Le je qui parle porte en effet avec lui la présence à soi caractéristique de la conscience réflexive, mais cette présence à soi, si fragile parce qu’uniquement linguistique, ne peut jamais s’éprouver que dans une relation à l’autre, se manifestant par un rapport de co-présence entre je et tu. Cette co-présence ne peut, elle-même, s’établir que pour autant que les interlocuteurs aient fixé ensemble l’absence hors de leur champ, en l’affectant au il. Il y a donc deux il. D’un côté, ce il peut se rapporter à n’importe quel objet du monde, mais de l’autre, il doit être construit comme une instance crédible prenant en charge l’absence.
Et c’est ce que les différentes cultures depuis la nuit des temps ont toujours su faire.
Les récits polythéistes l’ont fait de deux façons. Premièrement, en utilisant ce que Lyotard a repéré sous le nom de triangle pragmatique. Car, dans les mythes, il existe certes ce que Lévi-Strauss a mis en évidence, des opérateurs binaires rendant compte de leurs contenus, mais cela ne dit rien de la transmission de ces récits. Or il faut bien que ces récits se transmettent pour qu’ils structurent l’espace mental des individus composant cette culture. Cette transmission implique ce que Lyotard a donc appelé un triangle pragmatique pouvant s’énoncer ainsi : Je raconte à tu l’histoire que je tiens de il. Cette allocution actuelle suppose toujours une allocution antérieure puisque le je qui parle ne tient sa position d’allocuteur actuel que d’avoir été un allocutaire précédent, un tu. De même, elle suppose une allocution ultérieure où le tu à qui je parle deviendra un nouveau je. Il faut au minimum trois allocutions pour qu’une histoire soit transmise. Au cours de cette transmission, l’allocutaire de référence aura parcouru toutes les possibilités d’indexation -ce parcours s’établit selon la suite : tu, je, il. Conclusion : il y a homologie structurale entre la structure trinitaire des personnes verbales et le triangle pragmatique de transmission du récit.
Mais ce n’est pas tout : le il, sur quoi, en fin de compte, repose une socialité, est un signifiant dont le signifié renvoie en dernier recours à une absence : pour que deux soient co-présents l’un à l’autre, il faut qu’un Tiers soit là-bas, absent. Et quel meilleur moyen il y a-t-il de figurer l’absence que par un sacrifice ? La vie symbolique n’a de sens qu’articulée à la mort biologique des individus. Bref, la structure ternaire est liée à la pratique, vieille comme les sociétés humaines, du sacrifice. Soit il est requis à chaque détour interlocutoire comme dans les polythéismes (en gros, quand ça va mal dans la communauté, on fait un petit sacrifice et ça va mieux), soit il est assumé une fois pour toutes par un Dieu qui prend en charge l’absence et la mort comme dans les monothéismes.
Dans les monothéismes, il existe ainsi des sortes de « scènes primitives » qui, précisément, mettent chacune en œuvre une succession tout à fait particulière de trois allocutions (ou de trois générations). Cette scène constitue une sorte de code spécifique contenant le traitement idéal de l’absence et de la présence. À partir de l’inscription particulière de l’absence effectuée dans cette succession, peuvent se lire les spécificités des dogmes juif et chrétien. Dans le judaïsme (Genèse XXII, 9-18), avec l’épisode fondateur du sacrifice d’Isaac (d’où découle la « multiple descendance » d’Abraham, c’est-à-dire toutes les séries allocutoires à venir, c’est-à-dire encore la socialité juive), c’est au temps premier qu’est finalement placée, après que le coup fatal soit détourné sur le Bélier, l’absence. Ce n’est plus un sacrifice aux dieux comme les polythéismes, c’est un sacrifice de Dieu. Dans le christianisme, c’est le temps deuxième (le Fils) qui doit assumer l’absence. D’où s’ensuit une série de conséquences dans chacun des deux cas qui spécifient en propre chacun des monothéismes : a) dans le judaïsme, la Loi ternaire me semble figurée plus clairement que dans le christianisme car la succession des générations repose sur un Dieu dont l’éternité peut, dans sa plus haute manifestation, se révéler comme absence (le sage dans la tradition juive est celui qui apprend à « faire comme si Dieu n’était pas »)… ; b) le christianisme, lui, est fort intéressant pour toutes les compensations qu’il a fallu apporter à une loi faisant mourir le Fils au lieu du Père, elle s’est alors trouvée contrainte de postuler la résurrection du Christ et des corps et d’introduire rien de moins que la Femme et l’Esprit.
Dans la psychanalyse, on trouve un savoir relatif à l’assomption du sujet dans l’ordre symbolique. Il est d’allure trinitaire. La formation du sujet est ainsi le résultat d’un procès dans lequel on distingue des phases – dites orale, anale et phallique – au terme desquelles, après une épreuve terminale, le sujet entre comme sujet parlant dans l’intersubjectivité. Que trouve-t-on dans le processus de cette assomption ? Des triades. Trois objets : « sein », « merde », « phallus« , trois sujets : « mère », « père », « enfant », trois instances dans le sujet : moi, ça, surmoi. Les phases, leurs objets, les sujets, le sujet, sont totalement inscrits dans une « logique » trinitaire. Cette problématique a beaucoup intéressé Serge Leclaire avec qui j’ai souvent discuté après la parution des Mystères de la trinité. Il voulait reprendre et développer cette hypothèse trine dans la perspective psychanalytique qui était la sienne. Il n’a malheureusement pas eu le temps d’aller bien loin, il est mort alors qu’il entamait ce travail comme en témoigne son tout dernier écrit. Il est paru dans un livre de recueil de ses derniers textes que j’ai préfacé, Écrits pour la psychanalyse.
Comme je viens d’exposer ce qu’il en est de ce que j’entends par logique trinitaire, je peux maintenant revenir au début de ta question. J’ai en effet écrit Les mystères de la trinité au moment où j’ai senti que notre civilisation marquée par la longue coexistence, jamais pacifique, entre la pensée trinitaire (née à Jérusalem, accueillie à Rome et marquant ensuite tous les arts et sciences du verbe, de la lettre, du discours et de la représentation) et la pensée binaire (née à Athènes avec le logos et sa logique bivalente, relancée par la raison moderne et sa mathesis universalis impliquant le nombre et se déployant irrésistiblement dans la révolution numérique et les techno-sciences fondées, tant le hard que dans le soft, sur la logique binaire), était en train de basculer, de façon décisive, vers le binaire. Chute du Tiers. Montée du binaire.
 Le premier millénaire fut marqué par le De Trinitate d’Augustin où le Père de l’Église s’est efforcé, grâce à l’introspection, d’en débusquer les multiples formes (par exemple, sa théorie de l’âme divisée entre sensus, spiritus et mens) au détour de chaque mouvement de pensée, comme fondatrice du « verbe de l’homme, où apparaît avec quelque ressemblance, et comme une énigme, d’une certaine manière le Verbe de Dieu » (Trinité, XV, X, 19-XI, 20). C’est-à-dire ces trois figures synchroniques d’égale importance. Puis cette forme trinitaire a mobilisé beaucoup de penseurs pendant le premier millénaire. Enfermés dans les couvents, ils ont passé dix siècles à la construire comme l’un des Mystères du dogme sans qu’elle ne cesse de faire énigme et d’alimenter les querelles (la gnose, l’arianisme, le nestorianisme, puis la querelle du Filioque qui amena au schisme de l’église d’Orient au XIe siècle).
Le premier millénaire fut marqué par le De Trinitate d’Augustin où le Père de l’Église s’est efforcé, grâce à l’introspection, d’en débusquer les multiples formes (par exemple, sa théorie de l’âme divisée entre sensus, spiritus et mens) au détour de chaque mouvement de pensée, comme fondatrice du « verbe de l’homme, où apparaît avec quelque ressemblance, et comme une énigme, d’une certaine manière le Verbe de Dieu » (Trinité, XV, X, 19-XI, 20). C’est-à-dire ces trois figures synchroniques d’égale importance. Puis cette forme trinitaire a mobilisé beaucoup de penseurs pendant le premier millénaire. Enfermés dans les couvents, ils ont passé dix siècles à la construire comme l’un des Mystères du dogme sans qu’elle ne cesse de faire énigme et d’alimenter les querelles (la gnose, l’arianisme, le nestorianisme, puis la querelle du Filioque qui amena au schisme de l’église d’Orient au XIe siècle).
La première partie du IIe millénaire sera celle de la scolastique et des tentatives (des plus sages aux plus folles) de résorption de la trinité dans le cadre de la raison et l’ordre du Deux. Jusqu’au couronnement thomiste. On connaît le couplet : grâce au bon docteur angélique, la lumière s’est enfin levée sur les ténèbres. Saint Thomas a traduit le fameux Mystère dans les termes enfin acceptables pour la Raison en le transcrivant, grâce à la dialectique aristotélicienne, dans les termes pacifiés de la logique et de la métaphysique générales. Et le mystère « Trois en Un » a cédé la place à une relation à deux termes : le mystère s’est énoncé dans la fondamentale distinction essence/existence que chaque époque depuis les origines de la rationalité occidentale réénonce à sa façon. Ce qui m’a fait dire que Saint Thomas, le saint homme, ne croyait pas vraiment au Mystère de la Sainte Trinité. L’ordre du Deux s’est depuis lors emparé de la trinité pour ne plus la lâcher. Au point que ledit Mystère semblait n’avoir été là que pour énoncer les problèmes de la raison dialectique. Depuis lors l’Église, aujourd’hui encore, brandi Saint Thomas comme gage de sa participation à l’ordre raisonnable du monde. Ainsi, après la parution de mes Mystères de la trinité, j’ai reçu une lettre de la Via Propaganda rédigée par un groupe de théologiens du Vatican qui, sans discuter mes thèses, me rappelaient le dogme : il n’y a pas de différents, ni de différences, entre l’ordre du Trois et l’ordre du Deux…
Puis vint Hegel. L’histoire, à travers une scansion ternaire (Père/Unité, Fils/Scission et Saint-Esprit/Réconciliation[iii]), est tendanciellement en marche vers sa fin, vers la réalisation de l’Esprit absolu. Or ces trois temps ne font à aucun moment sortir du Deux puisque Un, premier temps, se divise en Deux, deuxième temps, et que le temps troisième restitue l’Un. Les hommes avaient jusqu’alors cherché une cause, une origine, à leurs actes : en fait, jusque dans leurs actes involontaires ou immotivés, ils sont les instruments d’une finalité qui les tire vers elle. C’est donc sous la condition de son assujettissement à l’ordre du Deux, c’est-à-dire en un mot au prix de sa disparition, que la trinité est dite opératrice de la dialectique historique. Sauf que ce n’est plus une trinité (avec des figures synchroniques), mais une ternarité (avec des temps successifs). À ce prix, elle a décroché son titre philosophique : celui d’opérateur de l’histoire par inscription de tous les faits passés, présents et à venir, dans un procès dynamique récurrent à trois temps, une téléologie, amenant à la fin de l’histoire et à la réalisation de l’Esprit absolu. Lequel, n’en doutons pas, sera entièrement conforme à la raison entendue selon l’ordre binaire.
J’ajoute, pour finir sur ce point, qu’il me semble très important de continuer à penser selon la logique trinitaire pour ne pas sombrer complètement dans l’ordre binaire. Je ne souhaite la victoire finale ni de l’un, ni de l’autre, mais un équilibre qui me semble correspondre aux modes par lesquels nous habitons notre monde, celui de la discursivité.
BR : Tu accordes une importance considérable au phénomène néoténique qui caractérise l’« animal humain ». Ce motif apparaît en 1999 dans tes Lettres sur la nature humaine à l’usage des survivants, ouvrage dans lequel tu soutiens que « les dieux jouent structurellement pour l’homme le rôle de mâle dominant » puis que « les dieux sont à l’homme ce que l’homme est au chien » (1999, p. 102). Qu’est-ce que la néoténie ? Quels corollaires tires-tu de cette arrivée au monde prématurée du petit d’homme ? Et enfin : peut-on aller jusqu’à dire que la structure trinitaire, dont tu as exposé la logique ci-dessus, est en dernière analyse enracinée dans les propriétés biologiques de l’être humain ?
DRD : Oui, j’accorde une grande importance au phénomène néoténique qui caractérise, voire détermine l' »animal humain ». C’est à mettre en relation avec ce que j’ai mentionné au début de ma réponse précédente : c’est en premier lieu dans ses discours que l’espèce humaine habite. Le corollaire de cette proposition c’est que, si elle habite là, c’est qu’elle n’est pas capable d’habiter directement ici, sur terre comme savent le faire les autres animaux, les vrais. Il y a une bonne raison à cela : les hommes naissent en effet inachevés, ils ne sont pas finis ou finalisés à la naissance pour s’insérer dans une niche écologique précise, à la différence des autres animaux de leur groupe, les mammifères supérieurs.
Cela, ça se raconte depuis toujours dans le champ philosophique. C’est exactement ce que dit, par exemple, le mythe grec qui raconte la création des hommes. Je pense au récit exposé dans le Protagoras de Platon, qui reprend le mythe déjà présent chez Hésiode, dans la Théogonie. L’histoire est simple, à la fois comique et tragique. Je la rappelle brièvement à ma façon puisque c’est un mythe et que chaque rhapsode peut actualiser à sa façon le récit. Les Olympiens ont vaincu les Titans et ils se posent la question de la création de ce qu’ils appellent avec un certain dédain, les races mortelles, dont évidemment les hommes. Or, et cette donnée en dit déjà très long, plutôt que de s’occuper eux-mêmes de cette besogne, c’est aux dieux vaincus, des dieux de seconde zone donc, deux Titans, les frères Épiméthée et Prométhée, que les Olympiens confient la tâche de créer ces races mortelles. Comme si les Olympiens n’avaient pas voulu se salir les mains en se compromettant dans cette besogne subalterne.
On connaît l’histoire : Épiméthée est un étourdi alors que Prométhée est avisé. Bien sûr, c’est l’étourdi qui commence. Et il commence en distribuant généreusement les qualités dont il dispose en dotant en nature chaque animal (au premier, il donne les griffes, au second, le venin, au troisième, la vélocité et ainsi de suite pour les autres : la capacité de voler ou de nager sous l’eau, ou la fourrure, ou la puissance ou la légèreté, etc.). Tout va pour le mieux dans la conduite de cette grande œuvre jusqu’au moment où arrive le tour des hommes. Là, Épiméthée, l’étourdit, s’aperçoit que le grand sac des attributs et des qualités est vide. Ce qui crée une panique… titanesque, si je puis dire. C’est ici qu’intervient le second, Prométhée, l’avisé, pour tenter de réparer la faute, pour ne pas dire davantage, de son frère. Car cet être sans équipement n’aurait évidemment pu que succomber si Prométhée n’avait pas été dérober le feu aux Olympiens pour le lui donner. Du coup, ces animaux faibles et sans poils ont pu s’assembler autour d’un foyer et, partant, survivre. Mais là, nouvelle question : étant dépourvus de tout, chacun s’est trouvé conduit à penser que l’autre avait peut-être plus que lui. Vous voyez que ces farceurs sont capables de tout : être sauvés in extremis pour s’entre-tuer aussitôt pour quelques jalousies ! Du coup, ils se sont trouvés confrontés à l’abyssale question du vivre-ensemble, c’est-à-dire des lois qu’ils doivent absolument se donner afin de pouvoir être ensemble sans s’entre-tuer. Question non résolue à ce jour.
Bref, l’homme, contrairement à la légende rassurante qui en a fait l’enfant chéri de la création, procède d’une erreur. Je dirais donc que l’erreur est humaine. Bref, l’erreur, c’est moi. C’est nous. Nous sommes l’erreur humaine. Inhumaine est donc la condition humaine, originairement marquée par le fait de manquer, de ne pas avoir ce que les autres espèces animales possèdent.
Et, de fait, les autres primates mangent, dévorent, déchirent ; leurs dents de lait se forment immédiatement après la naissance et à peine sont-elles au complet que la dentition définitive commence d’apparaître. Face à cela, la survie alimentaire de l’homme est un bel exemple de totale dépendance : il lui faut plus de deux ans pour posséder toutes ses dents de lait et sitôt ce prodige accompli il les perd aussitôt pour vivre à demi édenté jusqu’à cinq ou six ans…
Le développement sexuel de cet étrange animal est aussi très intéressant : jusqu’à l’âge de cinq ans, il suit à peu près l’évolution observée chez les autres primates, sauf qu’au moment d’aboutir, tout s’interrompt brutalement pendant cinq ans. C’est sur ce développement en deux temps que Freud a construit ses théories sexuelles. Moi, j’en déduis qu’il n’est pas étonnant qu’après tant de reprises, de remords et de réorientations, l’humain ne soit jamais très sûr du sexe auquel il appartient. Et encore, je ne parle pas de cette déplorable absence de l’os pénien[iv] que les hommes sont les seuls de tous les primates males à avoir perdu et dont il leur arrive, quelquefois de regretter très amèrement l’absence.
En comparant la maturation prénatale de l’homme à celle des autres mammifères supérieurs, le psycholinguiste Steven Pinker, dans L’instinct du langage, a calculé que « S’ils [les bébés humains] restaient dans l’utérus proportionnellement aussi longtemps que les autres primates, ils ne sortiraient qu’à dix-huit mois ». L’homme sort trop tôt ! Nous sommes donc tous des prématurés. Certes, il y en a qui exagèrent en sortant encore plus tôt. Mais cela ne change rien à l’affaire puisque même ceux qui viennent à terme viennent trop tôt. On peut en effet trouver chez l’homme de multiples preuves de cette prématuration, déjà repérées par Lapassade : cloisons cardiaques non fermées à la naissance, immaturité post-natale du système nerveux pyramidal, insuffisance des alvéoles pulmonaires, circonvolutions cérébrales à peine développées, boîte crânienne non fermée (présence de la fontanelle), absence de pouce postérieur opposable, absence de système pileux, absence de dentition de lait à la naissance ‑ ce qui se solde, entre autres conséquences par un allongement considérable de la période de maternage.
Bref, nous sommes des prématurés ! Jetés dans le monde trop tôt, mal pourvu d’un organisme inachevé. Nous conservons toute notre vie les stigmates de la prématuration, de sorte que lorsque nous vieillissons, nous ne devenons pas adultes, mais de vieux prématurés…
Ce manque de nature, constaté dès la naissance de la philosophie, l’a ensuite littéralement obsédée. Ce thème en effet sera repris à la Renaissance par son théoricien, Pic de la Mirandole. Je rappelle ce passage du Discours sur la dignité de l’homme : « L’Architecte Suprême a choisi l’homme, créature d’une nature imprécise, et, le plaçant au centre du monde, s’adressa à lui en ces termes : « Nous ne t’avons donné ni place précise, ni forme qui te soit propre, ni fonction particulière, Adam, afin que, selon tes envies et ton discernement, tu puisses prendre et posséder la place, la forme et les fonctions que tu désireras. […] Nous ne t’avons créé ni de ciel, ni de terre ; ni immortel, ni mortel, pour que, par ton libre arbitre, que tu puisses sculpter ta propre statue » ».
On retrouvera cette idée de l’inachèvement de l’homme reprise dans les textes de Kant, par exemple dans Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique [1784] où Kant explique que « la nature semble s’être complue [à l’égard de l’homme] dans sa plus grande économie et elle a mesuré au plus juste, avec beaucoup de parcimonie, sa dotation animale ». De sorte que « [l’homme] doit tout tirer de lui-même. L’invention des moyens de se nourrir, de s’abriter, d’assurer sa sécurité et sa défense (pour lesquelles la nature ne lui a donné ni les cornes du taureau, ni les griffes du lion, ni les crocs du chien, mais seulement des mains), tous les divertissements qui peuvent rendre la vie agréable, même son intelligence et sa prudence et même la bonté de la volonté, tout cela devait entièrement être son propre ouvrage ».
Cette idée d’un manque originaire de l’homme est décisive puisqu’elle implique en fait que l’homme doit naître deux fois : une première fois dans la nature, mais cela ne suffit pas puisque cette nature est parcimonieuse, et une seconde fois dans la culture. C’est l’idée de Kant quand il dit que l’homme doit créer jusqu’à ses divertissements, son intelligence et sa volonté. La grande idée, c’est que la culture est à comprendre comme la seconde nature nécessaire à l’homme. Cette théorie conçoit l’homme comme un être à naissance prématurée, sujet à un très long maternage, à la fois incapable d’atteindre son développement germinal complet et cependant capable de se reproduire et de transmettre ses caractères de juvénilité, normalement transitoires chez les autres animaux. Il en résulte, pour ce qui nous intéresse, que cet animal, non fini, à la différence des autres animaux, doit se parachever ailleurs que dans la première nature, c’est-à-dire dans une seconde nature, généralement appelée culture.
Cette formulation éclairante vient du philosophe et anthropologue allemand Arnold Gehlen (1904-1976), auteur d’un livre fondamental sur ce qu’il appelle cet « être déficient », intitulé L’homme. Sa nature et sa place dans le monde, publié en 1940 et seulement traduit en français en 2021.
Gehlen s’est beaucoup appuyé sur les travaux du début du XXe siècle qui commençaient à formuler cette idée de manière scientifique. La théorie de la néoténie de l’homme est due à un anatomiste hollandais du nom de Louis Bolk[v], énoncée pour la première fois en 1926. Elle est actuellement soutenue par une partie de la recherche paléoanthropologique et notamment, pour en rester aux noms connus, au grand biologiste et anthropologue américain Stephen Jay Gould dans les années 70, puis plus près de nous, par les français Chaline, Delattre et surtout par Alain Prochiantz du Collège de France[vi].
À noter que, dès sa première formulation scientifique par Bolk, cette idée a été reprise par Freud qui parlera de la Hilflosigkeit de l’homme qui se rapporte à sa détresse originaire. Il est remarquable que ce concept scintille tout au long de la longue élaboration freudienne (la première occurrence apparaît dès 1895 et l’ultime en 1937). On trouve notamment dans le texte intitulé Inhibition, symptôme, angoisse publié en 1926, cette notation ouvertement néoténique : « Parmi les facteurs qui participent à la causation des névroses […], [il faut retenir] l’état de détresse et de dépendance [Hilflosigkeit] longuement prolongée du petit enfant d’homme. L’existence intra-utérine de l’homme apparaît face à celle de la plupart des animaux relativement raccourcie ; l’enfant d’homme est jeté dans le monde plus inachevé qu’eux »[vii]. Freud accorde une place tout à fait centrale à la néoténie de l’homme puisqu’elle crée le besoin d’amour, lequel engendre la névrose. Pour le dire autrement, la néoténie, la Hilflosigkeit, engendre un besoin d’amour, lequel peut aller jusqu’au besoin d’amour de dieu. Ce qui nous projette immédiatement dans cette seconde nature, la culture.
Ce que j’ai essayé de reformuler ainsi : il y aura remédiation si moi, être fini dans le temps, dans l’espace et si mal fini dans le réel, je parviens à supposer un être infini par rapport auquel je me mets en position de tout devoir. Or, supposer cet être, je le peux puisque je parle et que parler, c’est aussi fabuler. Rien donc ne m’empêche d’inventer dans le discours ce qui n’existe pas dans le réel, mais dont j’ai besoin pour vivre. Car, si je le suppose, Lui, le Tiers, ce il, alors je pourrai me « sous-poser » comme son sujet. Il faut et il suffit donc que je conjecture un grand Sujet supposé tout savoir, tout pouvoir et tout voir pour que je trouve enfin ma place, comme sujet de cet être.
À noter que les mammifères supérieurs sujets à la grégarité n’ont pas besoin de ce détour par le narratif, ils possèdent dans leur propre espèce naturelle des individus (les dominants) sur lesquels il leur suffit de transférer. Il se trouve que je me suis amusé à étudier ces phénomènes de transfert dans des espèces néoténisées par l’homme, comme le loup, qu’il a transformé en chien. On y observe que le chien ayant perdu son dominant pour cause de néoténisation peut alors transférer sur l’homme, lui aussi néotène, qui devient en quelque sorte le mâle dominant du chien. Bel arrangement entre néotènes. C’est pourquoi j’ai proposé cette formule : Dieu est à l’homme ce que l’homme est au chien. C’est un peu irrévérencieux, j’en conviens, mais c’est ma façon d’interroger les phénomènes de croyance observés dans cette étrange espèce.
Il résulte de ces observations que la survie de l’homme, animal néoténique, manquant comme tel de nature, passe par la création d’êtres de surnature, c’est-à-dire d’êtres de culture qui, bien que n’existant pas, se révèlent dotés d’une puissante efficacité symbolique. Tel est donc le travail de la culture : il permet tout simplement la subjectivation en passant par la supposition d’un Tiers qui, dès que posé, devient le centre de la culture d’un lieu et d’un temps donnés. En effet, dès que ce Tiers est posé, c’est-à-dire fixé dans des récits, peuvent alors se développer, autour de ce Tiers, garanties par ce Tiers, des pratiques concernant des façons de vivre, d’être-ensemble en se donnant des lois, de penser, de voir, d’imaginer, de croire, de vénérer, de raconter, de musiquer, de travailler, de se nourrir, d’aimer, de mourir, de chanter, de parler, d’inventer des objets permettant d’habiter leur monde, de construire des bribes de sciences et de grammaires plus ou moins développées codifiant ces pratiques.
J’en viens à la dernière partie de ta question, très importante et très bien formulée, ce dont je te remercie : tu me demandes si la structure trinitaire peut être considérée en dernière analyse comme étant enracinée dans les propriétés biologiques de l’être humain. Je répondrais que si c’était le cas, on serait tranquilles : la culture, trinitaire, émanerait à coup sûr de la biologie humaine marquée par la néoténie. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Car la culture qui porte un Tiers peut être détruite. C’est d’ailleurs, je crois que nous en reparlerons bientôt, ce qui est en train d’arriver aujourd’hui. Je proposerais donc une autre formulation, légèrement mais significativement différente. Tout ce qu’on peut dire, à la suite de Noam Chomsky et de Stephen Pinker, c’est qu’il y a probablement des bases génétiques à la grammaire. Mais ça ne suffit pas à faire un individu symbolisé en bonne et due forme ― il y a des fous qui parlent bien et même très bien, mieux que les « normaux » (Artaud, pour ne citer que lui). Je veux dire que, pour qu’un individu soit symbolisé, il faut un Tiers. Un Nom-du-Père, disait Lacan. Et le Tiers, on ne le trouve pas dans les gènes. Ça se transmet, en se construisant, détruisant et reconstruisant sans cesse, par la culture. La culture, trinitaire, me semble donc devoir être pensée comme épiphénomène. « Épi », c’est un préfixe grec qui, en français veut dire « sur », au sens de « dessus », « à la surface ». Ainsi, la culture serait tout d’abord quelque chose comme un phénomène second (épi) qui accompagne, qui vient sur le phénomène essentiel de la vie sans être pour rien dans son apparition. Ça se greffe dessus. C’est un supplément. Un supplément qui joue de surcroît le rôle de suppléance au sens où la culture supplée, en quelque sorte, à la débilité de la nature humaine.
Il ne faudrait pas cependant nous croire définitivement sauvés. Pour deux raisons. La première, je l’ai dite : cette (ou ces) culture(s), portant ce Tiers, peu (ven) t être détruite(s). La seconde tient à ce que la culture, comme épiphénomène, a connu un tel développement qu’elle peut, notamment avec les techno-sciences binaires qui ont été inventées au fil de l’aventure humaine (dès la Grèce Antique), intervenir désormais sur la première nature pour la modifier. La culture, aujourd’hui, a donc cessé d’être seulement un phénomène second (épi) venant sur le phénomène essentiel de la vie, car elle contient aussi des sciences et des techno-sciences binaires pouvant recréer autrement ce sur quoi elle s’est au début édifiée, la vie. Le phénomène second est en quelque sorte devenu premier. Ce qui ne laisse pas d’être inquiétant.
BR : Tu accordes beaucoup d’importance, dans tes travaux, à la transformation de la condition subjective qui touche nos sociétés en raison de l’hégémonie du néolibéralisme. La prise en compte de la néoténie t’a mené à reconnaître l’importance vitale de la sphère symbolique, et donc de la structuration ternaire des sociétés, pour l’être humain. Pourquoi et comment le capitalisme liquide-t-il notre « seconde nature » ? Est-ce par ce raisonnement que tu retrouves la décomposition des grands récits propres à la postmodernité annoncée par Jean-François Lyotard en 1979 ?
DRD : Oui, je pense que le capitalisme sous sa forme actuelle, celle du néolibéralisme financier, pilotant non seulement la finance mais toutes les activités industrielles, de recherches et de services, est en train de liquider notre seconde nature. Pourquoi et comment, me demandes-tu ?
Je commencerai par le comment. Ce nouveau capitalisme financier a changé la forme et les finalités du Tiers. Le Tiers, autrefois, au début de l’époque moderne, au XVIIIe, était une instance qui me garantissait que le pair avec lequel je co-contractais allait observer les mêmes règles que moi. Note bien que je ne parle pas de celui qui n’était pas mon pair, le prolétaire ou l’esclave ― avec qui d’autres règles prévalaient, à mon avantage bien sûr. Je parle du pair, le même que moi tel que le définit John Locke supposant des individus propriétaires d’eux-mêmes pour pouvoir se livrer aux échanges (voir le Second Traité du gouvernement civil, « chaque homme est propriétaire de sa propre personne », § 27). De deux choses l’une alors. Soit nous sommes coreligionnaires, et tout va bien. Nous pouvons co-contracter ensemble en invoquant une commune garantie divine. Mais, si nous ne sommes pas coreligionnaires, les choses se compliquent car je ne peux pas compter sur le seul bon vouloir de l’autre, pas plus d’ailleurs que lui ne peut compter assurément sur le mien. En d’autres termes, notre éventuelle bonne volonté réciproque reste aléatoire. C’est justement pourquoi, la seule issue possible reste de sceller notre accord dans une loi tierce qui nous garantisse l’un et l’autre une fois pour toutes. Bref, si l’autre est un mécréant, ou s’il n’a pas le même dieu que moi, ou encore si je suis moi-même mécréant, quel Tiers peut garantir l’un et l’autre ? La question se pose à l’époque de la modernité où toutes les populations du monde se mettent à se côtoyer sur un même territoire, de sorte que, dans les affaires, pouvaient se rencontrer un Vénitien et un Chinois, un Hollandais et un Turc… Dans ce cas, alors seule cette loi tierce peut faire l’affaire. À partir du moment où aucune loi divine ne peut garantir le bon fonctionnement de cette règle, cette loi ne peut être qu’humaine. Rousseau, que Kant avait beaucoup lu, a généralisé cette situation au point d’en faire un contrat social universel, valable aussi à l’échelle des nations. Dans ce contrat, il faut et il suffit que l’un et l’autre abdiquent d’une partie de leur puissance au profit d’un Tiers, la loi, qui devient ainsi le moi commun des co-contractants : « Au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d’association produit un corps moral et collectif […] qui reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté » (Rousseau, Le Contrat social, « Le pacte social », chapitre I, 6, 65).
De cette façon, même si nous ne partageons aucune forme de transcendance, et même si Dieu n’existe pas, même si l’un ou l’autre est voleur, nous serons l’un et l’autre garantis par le Tiers ayant force de loi que nous serons donnés par auto-transcendance[viii] ‑ ce qui nous porte l’un et l’autre dans une région que l’on peut dire sacrée, celle des pactes, mais parfaitement laïque. Ce miracle ne peut être obtenu qu’en nous déportant au-delà, c’est-à-dire au-dessus de nous-mêmes, par élévation, en nous donnant un point d’appui ailleurs que là où chacun se trouve.
Or, ce Tiers est aujourd’hui caduque. Il a été remplacé par le Marché. Ce qui change tout car, dans le Marché, on le sait depuis Mandeville, chacun, contrat ou pas, est peu ou prou voleur. Il a fallu plus de deux siècles pour que le Marché, grâce aux efforts de l’École de Chicago gagne, mais maintenant nous y sommes. C’est pourquoi, à l’heure du Marché, le droit ne garantit plus rien. Pour deux raisons. Tout d’abord parce que le droit a été investi par le Capital qui dispose d’armées d’avocats et de juristes très bien payés qui, comme Mandeville l’annonçait dans La fable des Abeilles, « épluchent les lois avec la même exactitude et dans le même but que les voleurs examinent les maisons et les boutiques, pour découvrir l’endroit faible dont ils pourront se prévaloir pour agir » ― autrement dit le Capital se sert aujourd’hui du droit pour contourner les lois. Ensuite parce que le crime ou le délit n’est plus aujourd’hui considéré comme une faute morale, mais valorisé comme un pur et simple risque pris dans un jeu, en l’occurrence le jeu économique. Je renvoie sur ce point aux travaux de Gary Becker, membre de l’école de Chicago et prix Nobel d’économie[ix]. Travaux qui ont été encensés par Foucault dans son séminaire sur le néolibéralisme : « Il n’y a aucune différence, affirmait Foucault commentant Becker, entre une infraction au code de la route et un meurtre prémédité. Ça veut dire que le criminel n’est aucunement, dans cette perspective, marqué ou interrogé à partir de traits moraux ou anthropologiques. Le criminel […] ne doit être traité que comme […] une personne qui investit dans une action, qui en attend du profit et qui accepte le risque d’une perte. Le criminel, de ce point de vue là, n’est rien d’autre et doit ne rester rien d’autre que cela »[x]. On notera les termes à connotation financière que Foucault emploie : investir, action, profit, perte…
De ce point de vue, « on n’arrête pas le progrès », puisqu’en trois siècles, le principe mandevillien (le vol est utile) s’est beaucoup enrichi. En témoigne cette longue liste de techniques nouvelles de spoliation et de captation, désormais très usitées dans le business, au vu et au su de tous : ententes et cartels, abus de position dominante, dumping et ventes forcées, délits d’initiés et spéculation, absorption et dépeçage de concurrents, faux bilans, produits financiers à haut risque (du type subprimes), titrisation de créances pourries, hedge funds permettant de spéculer à la baisse comme à la hausse, manipulations comptables et de prix de transfert, fraude et évasion fiscales par filiales offshore et sociétés écrans installées dans des « paradis fiscaux », détournements de crédits publics et marchés truqués, corruption et commissions occultes, abus de biens sociaux, surveillance et espionnage, chantage et délation, violation des réglementations en matière de droit du travail et de liberté syndicale, d’hygiène et de sécurité, de cotisations sociales, de pollution et d’environnement… Et, pour couronner le tout, poursuites-bâillons à l’encontre de ceux qui dénoncent ces pratiques.
Si on cherchait une preuve permettant d’assurer que le monde actuel est régi par le Marché où tout le monde doit être peu ou prou voleur, on pourrait la trouver dans ce simple fait : ces « scélératesses » sont désormais officiellement comptées dans le calcul du PIB des États : les nouvelles normes du SEC (Système européen des comptes), adoptées en 2014, recommandent en effet aux États d’ajouter les activités souterraines (drogue, prostitution, trafics, corruption, délits…) dans le calcul du produit intérieur brut.
J’aborde maintenant la question de savoir « pourquoi le capitalisme a-t-il liquidé l’ancien Tiers ? ». Je le ferai très brièvement en me référant à la proposition que Mandeville soutient dans la « Remarque G » sur La Fable des abeilles. Elle est tout simplement intitulée : « Les plus grands scélérats contribuent au bien commun ». Ils créent en effet des poches d’argent qu’il faudra bien dépenser ― ce qui sera bon pour les affaires et l’accroissement infini de la richesse qui est le but du capitalisme financier. Nous sommes là au cœur de l’anthropologie libérale. Il n’y a pas besoin d’aller chercher loin pour le vérifier : je viens aujourd’hui même de lire ceci dans un grand journal du soir : « Une fuite de données révèle que des dizaines de criminels, fugitifs et « kleptocrates » ont placé dans l’immobilier du petit émirat (Dubaï) leurs millions d’origine douteuse, grâce à la complaisance des autorités locales ». Bref, je ne crois pas du tout à l’existence de deux mondes, celui des « affaires vertueuses » d’un côté et celui du « crime organisé » de l’autre. C’est une légende montée par les medias dominants pour empêcher les individus de ruer dans les brancards. Car ces deux mondes sont profondément impliqués : on estime que ce que j’appellerais le « produit criminel mondial brut » représente aujourd’hui au moins 20 % du commerce mondial.
Nous voici donc avec un nouveau Tiers, pervers. Alors, évidemment, se retrouver sous la « loi » d’un tel Tiers ne peut que contribuer à la transformation profonde de la condition subjective. Le sujet idéal d’un tel système n’est plus en effet quelqu’un qui doit abdiquer d’une partie de sa puissance au profit d’un Tiers. Il est celui qui ne connaît pas de limite à ce à quoi il croit avoir droit. C’est ainsi que la loi, aujourd’hui, est priée d’admettre, de reconnaître et d’inscrire sur ses Tables quantité de singularités et d’exceptions au regard de ce qu’était l’ancien droit commun.
Il me semble significatif à cet égard que le candidat à la magistrature suprême du plus puissant pays du monde soit un menteur pathologique et un pervers narcissique. Il a de bonnes chances d’être réélu dans quelques mois. Il n’est pas le seul présentant ce profil avenant ― beaucoup sont déjà en fonction. Ça renseigne, je crois, sur ce dont s’accommode le Tiers actuel. Nous sommes pris dans une spirale sans fin de chute du Tiers telle que celui-ci, devenu menteur et manipulateur, ne peut être plus être crédible.
Or, et j’en viens à la dernière partie de ta question concernant Lyotard et la chute des grands récits, ce déclin du Tiers fut la plus excellente des nouvelles pour le développement des sciences et ses techno-sciences, d’essence binaire. Je rappelle que ce texte de Lyotard de 1979 est exactement contemporain des arrivées au pouvoir de Thatcher et, un an plus tard, de Reagan, qui signent l’entrée officielle, si je puis dire, dans l’époque néolibérale. Il s’intitule, j’insiste sur le sous-titre, La condition post-moderne – rapport sur le savoir[xi].
Lyotard mettait en lumière que, jusqu’à l’époque moderne, pour toute science, il existait deux régimes de preuve.
Le premier fonctionne à l’intérieur de la science qui énonce ou présente une proposition. Là, la preuve avancée doit être conforme aux conditions épistémologiques requises pour être admise comme preuve dans cette science, qu’elle soit expérimentale ou hypothético-déductive.
Mais, il existait un second régime car, comme le fait remarquer Lyotard, cette preuve doit être prouvée (p. 89). Ce second régime était narratif : « ce qui prouve la preuve » doit être conforme aux grands récits qui valent à une époque donnée. Il y avait donc « récurrence du narratif dans le scientifique à travers les discours de légitimation » (p. 51). Descartes y avait eu recours lorsque, dans les Méditations métaphysiques (1641, IV), il avait indiqué qu’une même question ne pouvait pas se satisfaire de preuves contradictoires : « Dieu, disait-il, n’est pas trompeur ». C’est l’argument qu’avait repris Einstein face aux incertitudes postulées dans et par la physique quantique : « Dieu ne joue pas aux dés ». Sous-entendu : devant le même phénomène, il, Dieu, le Tiers, ne peut pas dire une fois « ceci » et l’autre fois, « cela » (Lettre à Max Born, 1944, puis à Niels Bohr, 1949).
Lyotard développe longuement, non les grands récits issus de l’Antiquité impliquant le Dieu des monothéismes, juif et chrétien, mais les versions modernes de ces grands récits. Il en repère trois : 1° le grand récit kantien de l’émancipation individuelle par l’accès à la raison critique, lui-même doublé du grand récit de la loi morale (qui oblige chacun à considérer l’autre comme une fin en lui-même et non un simple moyen pour réaliser ses fins), 2° le grand récit hégélien de la dialectique historique et de la réalisation de l’Esprit absolu et 3° résultante en quelque sorte des deux, le grand récit marxien de l’émancipation sociale.
Or ― et c’est là le « scoop » de Lyotard ― l’époque post-moderne se caractérise par « l’incrédulité à l’égard des métarécits », ce qui entraîne « une désuétude du dispositif méta-narratif de légitimation » (p. 7). Il n’y a plus que des « jeux de langage différents », voire « une légitimation par la paralogie » (p. 98 et sq). La paralogie étant, comme Lyotard l’explique bien, ce qui anticipe tous les jeux de langage à venir, autrement dit tout ce qui pourrait « donner naissance à des idées, c’est-à-dire à des nouveaux énoncés » (p. 105). Bref, il n’y a plus de sémantique transcendantale, il n’y a que des espaces pragmatiques (celui des jeux de langage) où l’on doit faire des « coups » et des « contre-coups » (p. 33). C’est là ce qui signe l’entrée dans l’époque post-moderne où la science ne s’est plus définie que par la possibilité de son auto-transgression permanente.
Le résultat est imparable : les sciences de l’époque de la post-modernité font ce qu’elles veulent. Elles n’ont plus à être prouvées ailleurs que dans la science donnée, par référence aux valeurs portées par des grands récits partagés, mais seulement par des considérations pragmatiques du type « Ça marche ou non », éventuellement agrémentées de justifications lénifiantes qui n’engagent à rien, comme : de toute façon, c’est pour le bien de l’humanité. Ce à quoi on donne le nom d' »éthique ». L’éthique, c’est le bredouillage étique postmoderne prétendant venir à la place des grands récits modernes.
Plus de Tiers, cela veut dire que les techno-sciences peuvent désormais se développer sans contrôle. On parle ainsi de convergence NBIC (pour Nanotechnologies, sciences Biogénétiques, Informatique et sciences Cognitives), mais il n’est pas difficile de savoir d’où vient cette convergence : de la binarité de ces sciences ou techno-sciences. Tout cela se pilote désormais par l’AI et on sait où ca va : vers le « grand remplacement » de l’Homme par des Machines devenues, dit-on, « intelligentes ». Ce qui ouvre vers la question sur laquelle je travaille en ce moment : une méchante pulsion de mort n’est-elle pas à l’œuvre dans ces processus ?
BR : Une petite précision à ce stade de notre entretien cher Dany. Nous avons vu précédemment que la démocratie postmoderne pouvait mener à une sorte de folie structurelle en raison de la généralisation de situations unaires. Dans Les mystères de la trinité, tu parles du passage de la structure ternaire à la structure binaire des sociétés occidentales. Comment s’articulent ces deux diagnostics qui pourraient sembler à première vue contradictoires ? La fin de la trinité laisse-t-elle proliférer à la fois l’unaire et le binaire ? L’une de ces deux formes domine-t-elle actuellement l’autre, ou forment-elles système ?
DRD : Je dirais pour essayer de rire un peu, fut-ce jaune, que je connaissais autrefois un vieux médecin qui accueillait ses jeunes patients, dont moi, en leur disant qu’il n’est pas interdit d’avoir en même temps la petite vérole et la chtouille… Eh bien, je suis aujourd’hui, à ma façon, ce vieux médecin-philosophe qui dit que le déclin du trinitaire a entraîné à la fois la montée de la folie unaire et celle de la « raison » binaire, notamment sous sa forme instrumentale. Ces deux diagnostics ne me semblent nullement contradictoires, mais parfaitement complémentaires.
D’un côté, sans Tiers crédible, le sujet se trouve abandonné aux emmêlements unaires. « Je suis libre, abandonné », disait très précisément le narrateur de L’Innommable de Beckett (p. 38). « Abandonné », c’est-à-dire voué à ce que certains psychanalystes appellent la psychose sociale. Incapable d’embrayer dans le discours à partir d’un je qui n’est plus garanti par un Tiers crédible. Je renvoie aux premières lignes de L’innommable que j’ai déjà citée où les déictiques de base manquent : pas de je, pas de ici, pas de maintenant… Du coup, le discours part dans tous les sens et ouvre vers un devenir schizo (qui enthousiasmait Deleuze) que l’on ne peut réfréner, en dernier recours, qu’en bifurquant vers un devenir minoritaire (ce dont Deleuze se réjouissait aussi puisqu’il s’opposait à la notion kantienne de majorité), le tout débouchant in fine sur l’identitaire (où la motion schizo se renverse en discours parano). Ce qui donne alors toute une mosaïque sociale disparate composée de supposés suprématistes de tout poil : ceux qui sont d’un grand empire (les Russes, les Perses, les Turcs…), ceux qui sont blancs (les « français de souche »), ceux qui sont noirs (les décoloniaux), ceux qui sont mâles (les masculinistes), ceux qui sont femelles (les néo-féministes), ceux qui sont les vrais chrétiens (les créationnistes, les intégristes, les tenants de la théologie de la prospérité…), ceux qui sont les vrais juifs (les haredim), ceux qui sont les vrais musulmans (les salafistes), ceux qui sont non-binaires (les trans), ceux qui aspirent à devenir transhumanistes, ceux qui sont spécistes, ceux qui sont anti-spécistes, ceux qui sont vegans, ceux qui sont terraplanistes ― pardon à ceux que j’oublie, dont les obèses, les roux et quelques autres… Leur caractéristique : ils se présentent tous comme ayant quelque chose en plus alors qu’ils souffrent manifestement d’une case en moins puisque ces supposés suprématistes en tout genre oublient le principal : ils se retrouvent situés comme les nouveaux Untermensch (sous-hommes) des supposés Übermensch (surhommes) d’aujourd’hui, les libertariens (Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates et cinq ou six autres) dont le patrimoine est égal à celui de 3,5 milliards et demi de personnes. Tout cela n’est pas sans évoquer un monde post-nazi, comme l’avait déjà souligné Pierre Legendre, sauf qu’une bonne partie de l’espèce se trouve désormais, non dans des camps, mais dans les réseaux sociaux (des camps virtuels), vouée au tittytainment (des divertissements destinés à maintenir dans l’euphorie les individus pour qu’ils croient appartenir à des groupes supérieurs[xii]) sans rien savoir de ce que les vrais Maîtres décident effectivement pour tous (par exemple, la généralisation de l’IA pour mieux les tenir et les guider). Ce management des masses par le tittytainment est très utile aux Maîtres. Il fait notamment disparaître les divisions de classe au profit de clivages identitaires et communautaires. Il suffit de parcourir les réseaux dits sociaux pour comprendre que ces distinctions, bien qu’idiotes, constituent aujourd’hui la base des stratifications sociales utilisées par le marketing pour cibler les populations avec des objets et services marchands supposés combler leurs appétences. C’est dans ces catégories inconsistantes que chacun est désormais prié de se reconnaître tant en souscrivant à l’idéal ― plus démocratique que moi tu meurs ― de l’inclusivité.
Et, de l’autre côté, face à ces emmêlements intérieurs unaires où ce qui n’est rien devient tout, que trouve-t-on ? Une extériorité réglée par le Marché et le discours binaire du management qui quadrille désormais l’espace-temps social des individus. Ce n’est pas à toi, cher Baptiste, que je vais expliquer cela. J’ai beaucoup travaillé sur l’emprise de la production et de la consommation en régime capitaliste. La production dépossédant l’ouvrier de son œuvre et la consommation formatant le désir dudit consommateur en le prolétarisant. Tu as beaucoup travaillé sur l’emprise et les effets du discours du management. Tu as lu, si je t’ai bien compris, la société contemporaine comme étant caractérisée par une logique automate où les échanges sociaux sont désormais réglés par des algorithmes propriétaires, c’est-à-dire non open source, c’est-à-dire secrets. Tu as analysé, avec beaucoup de précision, le management comme capture de ce qu’il restait de désir dans les sujets pour l’aligner sur l’objectif du capitalisme financier : toujours plus.
Oui, cela forme système. C’est parce que nous avons été décomposés de l’intérieur (chute du Tiers et régression vers l’unaire) que nous nous retrouvons régis de l’extérieur par le management fondé sur des algorithmes binaires qui gèrent de grands flux de population dans toutes leurs composantes, y compris intimes.
BR : Le lecteur s’est très certainement rendu compte, au fur et à mesure de notre entretien, que ta pensée est difficilement assignable à une discipline puisqu’elle convoque la philosophie, la littérature, la linguistique, la psychanalyse, la biologie, l’économie, etc. Or, le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Université n’échappe pas à la crispation identitaire que tu viens de décrire, de telle sorte que les disciplines, dont les frontières sont étroitement surveillées dans les différentes sections du CNU et du CNRS, ont tendance à se replier sur elles-mêmes voire à s’émietter en une pluralité de sous-disciplines ou de paradigmes concurrents. Comment s’est donc passée la cohabitation entre le développement de ta pensée et le cadre institutionnel de l’Université ?
DRD : L’enseignement et la recherche dans les pays occidentaux sont, au cours des dernières décennies, passés du modèle humboldtien (datant des débuts du XIXe) au modèle néolibéral (à partir des années 1980). Certes, l’enseignement est resté corrélé à la recherche, mais, comme l’indépendance vis-à-vis des considérations économiques s’est transformée en dépendance de plus en plus étroite, c’est la liberté académique dans la recherche qui en a pâti. L’effet le plus manifeste est que chaque enseignant-chercheur se retrouve aujourd’hui enfermé dans son labo ou son équipe de recherche, incité à produire des résultats de pointe qui devront d’une façon ou d’un autre être valorisés ― au sens littéral du terme : produire de la valeur, y compris au sens économique du terme. Ce qui a disparu dans ce new management universitaire, c’est la production d’une pensée critique de l’ensemble, remplacée, comme Lyotard l’avait bien repéré, par une visée pragmatique (faut que ça marche pour que ça rapporte).
Comme je l’ai dit au début de notre entretien, je ne crois pas que le paradigme de « la complexité » ait jamais été une réponse sérieuse au souci de penser l’ensemble. D’une tout autre rigueur me sont apparus les concepts élaborés par le philosophe Gilbert Simondon (1924-1989). Il était pour moi une référence tout indiquée puisqu’il avait beaucoup réfléchi à la question du passage d’un milieu à un autre. Ce qui était exactement ma question puisque je travaillais sur le passage d’un milieu, disons, classique, à un milieu libéral, puis néolibéral. Un passage que je ne voyais nullement comme une « mutation » ou une « discontinuité énigmatique » entre une épistémè et une autre, à l’instar de ce que Foucault postulait dans Les mots et les choses, mais comme un processus pouvant affecter un système métastable composé de plusieurs économies en interaction. Simondon réputait comme métastable un système capable d’absorber certaines perturbations tandis que d’autres sont susceptibles de se propager jusqu’à faire basculer ce système vers un autre.
En rapportant cette analyse à ma problématique, il m’est apparu que l’acceptation morale et sociale de la pléonexie correspondait à un effet de seuil pouvant entraîner une mutation. Cette pléonexie visant à obtenir, au terme de chaque échange, plus que sa part était autrefois (depuis La République de Platon) considérée comme une folie (aphrosunè), mais en devenant la règle sociale avec Mandeville, elle a, de proche en proche, profondément altéré le fonctionnement des grandes économies humaines : non seulement l’économie marchande, mais aussi l’économie politique, l’économie symbolique, l’économie sémiotique et, last but not least, l’économie psychique. Preuve, s’il en fallait, que ces grandes économies humaines étaient articulées entre elles. Autrement dit, si un changement survient dans l’une, il se produit des effets dans les autres. J’ai, par exemple, essayé de montrer que des changements dans l’économie marchande (la dérégulation en vue de libérer le fonctionnement pléonexique) entraînaient des effets dans l’économie politique (l’obsolescence du gouvernement et l’apparition, à sa place, de la gouvernance). Ce qui, à son tour, provoquait des mutations dans l’économie symbolique (la disparition de l’autorité du pacte et l’apparition de groupes égo-grégaires) et des transformations profondes dans l’économie sémiotique (des transformations dans la grammaire, base de la logique, et des altérations sémantiques de type sophistique). Cette réaction en chaîne pouvait enfin produire des effets considérables dans une économie a priori à l’abri parce que bien enfuie en chacun de nous, l’économie psychique où le sujet névrotique de Freud se trouve progressivement remplacé par un sujet navigant dans une autre région psychique qu’on peut représenter par un triangle dont les trois pointes seraient constituées de la perversion, de l’addiction (en expansion notable) et de la dépression.
Pour décrire ce phénomène de propagation d’une économie à l’autre, c’est bien le terme de transduction, introduit par le philosophe Gilbert Simondon qui convient : « Nous entendons par transduction une opération, physique, biologique, mentale, sociale, par laquelle une activité se propage de proche en proche à l’intérieur d’un domaine, en fondant cette propagation sur une structuration du domaine opérée de place en place : chaque région de structure constituée sert à la région suivante de principe et de modèle, d’amorce de constitution, si bien qu’une modification s’étend ainsi progressivement en même temps que cette opération structurante »[xiii].
Au terme de cette réaction en chaîne où les différents changements se renforcent l’un l’autre, ce qui apparaît c’est une mutation, c’est-à-dire l’individuation, aussi bien l’individuation d’un nouveau milieu, le milieu libéral, que l’individuation du nouvel individu appelé à naître au milieu de ce milieu, l’individu libéral. Autrement dit, ce que l’on perçoit, c’est le passage d’une culture à une autre, d’une Cité à une autre, une autre que j’ai appelé « perverse » (c’est-à-dire, littéralement, « renversée »). On commence à comprendre, aujourd’hui, combien ces réactions en chaîne, passant d’une économie à l’autre, peuvent atteindre l’économie qui supporte toutes ces économies, à savoir l’économie du vivant, aujourd’hui hautement menacée.
Cette façon de penser m’a attiré de grands ennuis dans l’université. J’y suis devenu professeur, mais non sujet à la promotion, étant considéré comme « hors champ » parce que mon objet de recherche consistait, non à devenir spécialiste d’une de ces économies humaines, mais à comprendre leurs interactions. Double erreur. Premièrement, je sortais de la prescription de me spécialiser dans un champ ou dans une économie, comme si ces différentes économies étaient étanches les unes aux autres, et je me donnais comme objet d’aller d’un champ à l’autre en mettant à profit les logiques, autres que celles de la bivalente et de la binarité, que j’avais formulées. Deuxièmement, j’aggravais mon cas ― y compris auprès de gens de gauche ― en affirmant qu’il existait d’autres économies que l’économie marchande (cf. la fameuse scie de « l’économie en dernière instance »).
C’est pourtant là que j’installais ma philosophie en m’accordant le privilège de pouvoir circuler entre les différentes économies afin de tenter de penser l’ensemble. Pour moi, il ne s’agissait en rien de dénier le travail des différents spécialistes de ces économies, bien au contraire. Je voulais seulement concevoir une philosophie qui ne serait pas que spéculative, refuge usuel du philosophe, mais capable d’occuper une position transversale travaillant à l’articulation des différentes économies. Bref, je trouvais indispensable, pour mener à bien ma recherche, d’en revenir au statu quo ante, celui d’avant la division des savoirs provoquée par une révolution industrielle toute à sa volonté de développer tous les aspects possibles de la raison instrumentale. Je voulais en quelque sorte me retrouver dans la situation où Descartes ou Pascal étaient philosophes et théologiens et physiciens et mathématiciens. Soit une situation où tous ces domaines étaient en relation dans leur esprit. Infiniment plus riche celle de l’organisation moderne des savoirs qui implique leur division et leur incommensurabilité. Ce qui, au mieux, donne des savants qui savent tout de leur discipline, capables de lui faire dire tout ce qu’elle peut énoncer sur les phénomènes dont elle est supposée rendre compte, mais rien ou presque sur des phénomènes proches. Et, au pire, des savants qui savent tout sur quasiment rien, tant leurs objets deviennent pointus. Où chacun est tenu de devenir sourd et aveugle à ce qu’énonce la discipline connexe, et maintenu en position de ne saisir qu’une réalité très partielle qu’il prend pour la totalité puisqu’il se trouve constitutivement aveugle au reste.
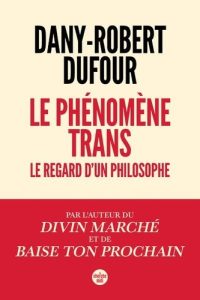 BR : La fin de l’entretien approche, et je ne peux manquer d’évoquer ton dernier livre qui d’une certaine façon, offre une illustration saisissante de la crise ternaire que nous venons d’évoquer. Dans Le phénomène trans. Le regard d’un philosophe (p. 131-132), en effet, au risque d’être taxé de « conservateur » voire de « réactionnaire »[xiv], tu donnes la recette de la transformation : « Il suffit de prendre un tiers de néo-évangélisme (celui qui affirme la possibilité d’une nouvelle naissance permettant une régénération), d’ajouter un tiers de vocabulaire managérial (celui des business schools où l’on clame qu’il faut « empower your life and your career now » pour devenir sans délai le manager efficace de sa vie et de sa carrière). Puis on fait revenir le mélange avec un tiers de foucaldisme […]. On chauffe le tout et, au moment de la fusion, au terme de cette opération alchimique, tout comme le métal, le plomb se transforme en or, l’homme sera performativement changé en femme ou la femme en homme. Ainsi, iel aura fait preuve d’une encapacitation […], d’un empowerment […], d’une agency […] pour devenir femme ou homme ». Long extrait dans lequel tu exposes un système là où beaucoup d’analystes de la société contemporaine ne voient que des éléments séparés. Comment articules-tu plus précisément transformisme, management et french theory ?
BR : La fin de l’entretien approche, et je ne peux manquer d’évoquer ton dernier livre qui d’une certaine façon, offre une illustration saisissante de la crise ternaire que nous venons d’évoquer. Dans Le phénomène trans. Le regard d’un philosophe (p. 131-132), en effet, au risque d’être taxé de « conservateur » voire de « réactionnaire »[xiv], tu donnes la recette de la transformation : « Il suffit de prendre un tiers de néo-évangélisme (celui qui affirme la possibilité d’une nouvelle naissance permettant une régénération), d’ajouter un tiers de vocabulaire managérial (celui des business schools où l’on clame qu’il faut « empower your life and your career now » pour devenir sans délai le manager efficace de sa vie et de sa carrière). Puis on fait revenir le mélange avec un tiers de foucaldisme […]. On chauffe le tout et, au moment de la fusion, au terme de cette opération alchimique, tout comme le métal, le plomb se transforme en or, l’homme sera performativement changé en femme ou la femme en homme. Ainsi, iel aura fait preuve d’une encapacitation […], d’un empowerment […], d’une agency […] pour devenir femme ou homme ». Long extrait dans lequel tu exposes un système là où beaucoup d’analystes de la société contemporaine ne voient que des éléments séparés. Comment articules-tu plus précisément transformisme, management et french theory ?
DRD : C’est là, pour moi, cher Baptiste, un parfait exemple de management borgésien, si tu me permets cette expression, dans lequel nous nous trouvons désormais plongés, visant la manipulation des perceptions et de l’intimité via les techno-sciences et une conception magique du langage. Tu te souviens, bien sûr, de ce texte intitulé Les ruines circulaires de Borges où, jour après jour, un homme fabrique par le rêve un autre homme qui prend progressivement vie, jusqu’à devenir réel à ses yeux. Sauf qu’au moment où, son rêve se réalisant, le rêveur s’aperçoit qu’il n’est lui-même que le produit du rêve d’un autre… Même schéma ici, à deux nuances près : cet homme ne rêve pas qu’il fabrique un autre homme, mais qu’il se refabrique lui-même en femme. Et, miracle, il le devient, sans toutefois s’apercevoir qu’il est le produit du rêve d’un autre, le Maître, qui lui a ordonné ce rêve.
Puisque tu m’interroges sur ma « recette » ― en fait, celle de la post-modernité ― de la transformation de l’homme en femme ou vice-versa, je vois deux temps à l’œuvre dans ce management borgésien. Premièrement, le sujet, par exemple un homme, suggestionné par les réseaux sociaux, se débrouille (c’est un des sens du verbe « to manage »), pour se désigner comme femme. Pour ce faire, il ne peut que s’en remettre à une conception magique du langage : je dis que je suis femme et hop ! je deviens femme (c’est à peu près la conception du performatif d’Austin, revu et corrigé par Butler). Deuxièmement, ma « recette » dévoile que le véritable manager (gestionnaire et ordonnateur) de cette transformation, c’est le Maître, celui de l’époque néolibérale, le Marché, qui fait croire aux sujets qu’ils peuvent tout demander et qu’ils seront exaucés dans toutes leurs appétences. On voit bien là, dans ce que tu appelles si bien un « transformisme », comment différentes économies sont en jeu et s’articulent : une économie psychique, une économie discursive, une économie politique, des économies marchandes (médicales, chirurgicales…) pour régler les « détails » (modifier les corps pour qu’ils ressemblent à l’objet de la demande).
Ce qui est fort intéressant dans ce double management est qu’il ne s’embarrasse pas des faits, en l’occurrence biologiques : être à l’origine un homme ou une femme. Il vise à créer une situation nouvelle au-delà des faits pour avérer un possible, fut-il irréalisable, la transformation d’un homme en femme. Il me semble que cette visée pour créer ce qui n’est pas est à mettre en rapport avec l’activisme de Foucault qui, quels que soient les faits, voulait créer, de façon militante, une réalité politique nouvelle. Ce n’est pas en effet la critique qui intéressait Foucault, c’est la création pragmatique ex nihilo de réalités nouvelles, conformes à ses vœux. Il ne fut pas facile à Foucault de reconnaître qu’il usait de ce procédé. Mais, parfois, rarement, il l’a fait. Ici, par exemple : « Je pratique une sorte de fiction historique. D’une certaine manière, je sais très bien que ce que je dis n’est pas vrai. Un historien pourrait très bien dire de ce que j’ai écrit : « Ce n’est pas la vérité. » Pour dire les choses autrement : j’ai beaucoup écrit sur la folie, au début des années 1960 – j’ai fait une histoire de la naissance de la psychiatrie. Je sais très bien que ce que j’ai fait est, d’un point de vue historique, partial, exagéré. Peut-être que j’ai ignoré certains éléments qui me contrediraient. Mais mon livre a eu un effet sur la manière dont les gens perçoivent la folie. Et, donc, mon livre et la thèse que j’y développe ont une vérité dans la réalité d’aujourd’hui. »[xv]
Ces propos sont à rapporter à ceux que Foucault avait tenus dans les conférences données à Berkeley en 1983[xvi]. Il y soutenait que le parrhesiastes grec était celui qui osait courageusement dire au souverain « sa » vérité personnelle et singulière, en prenant éventuellement des risques. Aussitôt ‑ et probablement était-ce là l’intention de Foucault ‑ les « minorités sexuelles » de la post-modernité ont voulu entendre qu’il fallait affirmer « leur » vérité à la face du monde jusqu’à dire, pourquoi pas… que l’homme est une femme. Le message fut entendu par Butler. Elle, pas plus que d’autres, n’ont pas perçu qu’il constituait une extrapolation fautive de la notion antique puisque la parrhesia grecque ne signifie nullement qu’il faut dire sa vérité aux autres, mais qu’il faut dire la vérité, celle qui s’oppose au faux, quel qu’en soit le prix à payer par l’énonciateur. Par ce retournement post-moderne de la signification de la parrhesia, Foucault revendiquait de pouvoir dire ce qui n’est pas vrai au motif que cela pouvait produire les effets qu’il désirait voir advenir dans le futur proche. Je ne vois pas comment le dire autrement : Foucault a consenti à la fraude scientifique en vue d’obtenir certains effets sociaux nouveaux. Je vois donc Foucault comme en avance sur son temps : il venait d’inventer ce qu’on appelle aujourd’hui les fake news. Il a devancé (et revendiqué par avance) la pratique et le règne, désormais généralisés, de la post-vérité dans la culture actuelle.
La question que l’on pourrait se poser ici est de savoir pourquoi ce renversement dans la culture a été initié par la philosophie dont on peut, a priori, penser qu’elle vise le contraire : dire la vérité. La réponse paraît évidente si on considère le passage de Foucault que je viens de citer. La philosophie post-moderne, cédant au pragmatisme (cf. Lyotard), est revenue à des pratiques sophistiques anté-philosophiques consistant à dire ce qui n’est pas pour dérouter ce qui est. Nul doute que ces procédés vont se généraliser avec le développement de l’IA fonctionnant de plus en plus comme un guide accompagnant (voire devançant, comme un GPS indiquant la route à suivre) toutes les décisions du sujet.
Alors, dans ces conditions, oui, je suis ce que tu appelles un « réactionnaire », au sens littéral du terme : je réagis à ce retournement pragmatique de la philosophie. De même, oui, je suis un « conservateur » car je veux conserver l’efficace philosophique qui consiste à penser et à agir par soi-même. Je ne vois à vrai dire nul autre moyen pour préserver aujourd’hui le potentiel révolutionnaire de la philosophie menacé par une sophistique post-moderne d’autant plus puissante qu’elle est désormais assistée par le management techno-numérique des vies.
BR : Voici donc venue la dernière question : tu n’as cessé, tout au long de ton travail, de montrer l’étendue du nihilisme du Marché. Et nous n’en avons pas abordé toutes les dimensions dans cet entretien pourtant riche. Te poser l’usuelle question : « quelles sont les solutions ? Quelles sont les alternatives ? », n’est d’aucun intérêt, puisque cela revient précisément à penser dans les catégories de notre nouveau Maître. En revanche, tu affirmes, dans le titre d’un petit livre paru en 2016, que « La situation désespérée du présent [te] remplit d’espoir », et tu te réfères, dans le sous-titre, à « l’hypothèse convivialiste ». La question finale s’énonce alors dans les termes les plus simples : de quel espoir s’agit-il ?
DRD : Dans le livre que tu mentionnes, datant de 2016, je faisais déjà état de mon profond pessimisme quant au destin prochain de l’humanité. Près de dix ans plus tard, mon dépit s’est encore aggravé. Ce pessimisme est causé par le constat, partout (du plan individuel au plan collectif), de l’effondrement du Tiers ― un symptôme massif : l’ONU est devenu un machin ingouvernable et sans effet. Plus rien (ni dans l’homme, ni entre les hommes) ne fait Loi. C’est ce qui peut arriver de pire à notre espèce. Privée de Tiers, elle se transforme aussitôt en bandes de néotènes déboussolés constituant des ghettos de mêmes (des individus présentant un trait biologique ou culturel identique, exhibant leurs « mèmes »), aujourd’hui managés par les réseaux dits sociaux ― ce qui donne quantité de ghettos prêts à en découdre en se lançant dans des luttes à mort les uns contre les autres. Le problème est que la solution à ce foutoir risque d’être pire que le mal : on entend déjà des appels à l’érection de grands semblants figurant de soi-disant Tiers forts, puissants, féroces qui rappellent ceux que le monde a connus dans la première moitié du XXe siècle. On sait comment cela s’est terminé : par les guerres, les bombes atomiques et les camps nazis ou staliniens. Et on sait comment nous sommes ensuite sortis de ces impasses. Quelques hommes sages, intellectuels ou poètes, résistants à l’abîme, s’étaient donné pour mission de reconstruire le monde selon le principe de commune humanité impliquant l’égale dignité des hommes – soit l’exact inverse de la Shoah. C’est ce qu’Alain Supiot a appelé l’Esprit de Philadelphie[xvii]. Ce principe a permis au sortir de la Seconde Guerre mondiale la reconstruction complète d’un monde mené à sa ruine à cause du chaos économique, social, financier et moral provoqué par le premier néolibéralisme d’avant-guerre, provoquant la crise de 1929, sur lequel le nazisme avait surgi. Toutes les institutions, sans lesquelles la vie des hommes tend à basculer en d’incessantes guerres, ont alors été reconstruites selon des recommandations procédant de ce solide principe. Et cela a globalement fonctionné jusqu’à ce qu’un second néolibéralisme (celui de Hayek et Friedman) se mette en place vers 1980, ce qui a entrainé la désinstitutionnalisation du monde et l’entrée progressive dans une nouvelle époque de chaos.
On ne sait si, de celle qui s’annonce, nous sortirons tant les dangers ont été décuplés avec la destruction accélérée des écosystèmes, les « progrès » dans la manipulation du vivant, les perspectives post-humanistes et la prolifération d’armes bactériologiques et atomiques toujours plus puissantes. Il se trouve que j’ai fait partie d’un petit groupe d’intellectuels, les convivialistes. C’est déjà un miracle de faire travailler ensemble plus d’une centaine d’intellectuels, chacun l’œil rivé sur son objet, sans qu’ils ne s’entretuent à plus ou moins court terme à cause d’une virgule mal placée. C’en est un autre que de les faire accoucher de textes communs. Ce double miracle est à porter au crédit d’Alain Caillé qui a su animer (très convivialement) notre collectif. Je nous ai vus comme ces « gentlemen » dont parle Borges, encore lui : ce dernier disait qu’on reconnaît facilement lesdits gentlemen au fait qu’ils ne soutiennent que les causes perdues d’avance. Ça nous allait bien. Nous avons donc rédigé un premier Manifeste convivialiste en 2013 et un second en 2020, lesquels affirment que le seul ordre social légitime universalisable est celui qui s’inspire des cinq principes suivants : commune planète, commune humanité, commune socialité, individuation et opposition maîtrisée et créatrice.
- Le principe de commune planète signifie que nous partageons cette planète avec d’autres espèces vivantes. Notre place éminente parmi ces espèces nous donne d’autant moins le droit de les détruire que leur disparition entraînerait ipso facto notre disparition (or, 50 % de ces espèces ont disparu au cours de ces trente dernières années du fait des activités humaines). Si ce principe s’impose prioritairement aujourd’hui, c’est parce que le capitalisme néolibéral actuel, mené par une finance obsédée par l’accroissement sans limite de ses gains et l’exploitation rationnelle et industrielle de toutes les ressources, est en train de détruire les bases mêmes de la vie sur terre.
- Le principe de commune humanité signifie que, par-delà les différences de couleur de peau, de nationalité, de langue, de culture, de religion, de richesse, de sexe ou d’orientation sexuelle, il n’y a qu’une seule humanité, qui doit être respectée en la personne de chacun de ses membres – ce qui s’oppose catégoriquement aux perspectives post-humanistes.
- Le principe de commune socialité veut dire que les êtres humains sont des êtres sociaux qui ne peuvent s’épanouir que dans un cadre social commun (qui n’existe plus dès lors que les 1 % les plus riches de la planète aujourd’hui possèdent deux fois plus que les richesses cumulées de 90 % de la population mondiale) et par la richesse de leurs rapports sociaux.
- Le principe d’individuation soutient que la seule politique légitime est celle qui permet à chacun de déployer au mieux toutes les potentialités de son individualité singulière, en développant sa puissance d’être, de parler, de penser, de créer et d’agir sans nuire à celle des autres.
- Le principe d’opposition maîtrisée et créatrice précise que, si chacun a vocation à manifester son individualité singulière, il est inéluctable que les humains en viennent à s’opposer. Il s’agit donc qu’ils puissent le faire, non par la guerre, mais par la mise en place d’un cadre politique qui rend ces rivalités non plus destructrices, mais fécondes.
À noter que quatre de ces cinq principes empruntent aux doctrines modernes d’émancipation issues des Lumières. Le principe de commune humanité reprend du communisme théorique de Marx ce qui peut l’être tout en récusant le « communisme réel », c’est-à-dire le « communisme de caserne » ayant existé au XXe siècle. Le principe de commune socialité vient d’un socialisme qui mise sur la richesse émancipatrice des rapports sociaux. Le principe d’individuation (sur quoi le communisme réel a tellement échoué qu’il a entrainé sa perte) procède de l’idéal anarchiste qui n’a jamais voulu que l’individu soit dissous dans une quelconque masse. Le principe d’opposition maîtrisée et créatrice s’inspire du libéralisme politique qui, sous ses meilleurs aspects, a su construire des institutions démocratiques capables de veiller au respect de la pluralité des points de vue.
C’est donc une nouvelle doctrine politique, ou plutôt métapolitique, que nous avons bricolée. Sa nouveauté tient à ce qu’il ne s’agissait pas d’adopter un principe unique risquant vite de devenir un carcan, comme cela s’est avéré avec le communisme, le socialisme ou le libéralisme, mais de poser simultanément ces cinq principes délibérément hétérogènes ― l’enjeu, c’était de tenter de corriger le communisme par l’anarchisme, l’anarchisme par le socialisme et ainsi de suite, tout en empêchant le libéralisme politique de se résorber en un libéralisme économique tendant vers la pensée unique.
Il est cependant clair qu’on ne va pas vers un tel scenario qui aurait probablement permis d’expérimenter un espace social et culturel un peu plus harmonieux. En fait, tout laisse à penser qu’il est déjà trop tard pour conjurer la catastrophe qui s’annonce. La vieille pulsion de mort diagnostiquée par Freud, autre grand pessimiste, après la Première Guerre mondiale, habite toujours notre espèce et est d’autant plus menaçante aujourd’hui que les moyens par lesquels elle s’exprime se sont enrichis, au cours de ce dernier siècle, des « progrès » considérables de la raison instrumentale, d’essence binaire.
Je dirais, pour finir, qu’aujourd’hui, on ne se retrouve pas encore en 1945, mais peut-être déjà en 1932, c’est-à-dire un an avant la prise du pouvoir des nazis. Nous verrons, si nous arrivons en 1945, s’il reste assez de forces pour qu’on se souvienne alors du projet convivialiste.
***
[i] Je renvoie sur ce point aux belles analyses développées dans le livre de Douglas Hofstadter Gödel, Escher, Bach : Les Brins d’une Guirlande Éternelle, paru en France 1985, qui explique très bien comment l’auto-référence peut se déployer en ensembles infinis.
[ii] On trouve quelques indications biographiques sur Benveniste dans J-C. Milner, Le périple structural, Seuil, Paris, 2002, « Benveniste II », p. 101 et sq. Milner lui-même se réfère à un article de Françoise Bader, « Une anamnèse littéraire d’E. Benveniste » in Incontri Luiguistici, 22, 1999, p. 11-55.
[iii] Dans presque toutes les œuvres de Hegel figure cette interprétation de la Trinité chrétienne : dans la Propédeutique (Ed. de Minuit. Paris. p. 222 et sq), dans la Phénoménologie de l’Esprit (Aubier. Paris. Tome I. p. 18 et sq. et tome II; pp. 269-273), dans l’Encyclopédie des Sciences Philosophiques (Vrin. Paris. 566-571), dans les Leçons de Philosophie de l’histoire (Vrin. p; 250 et sq.), dans les Leçons d’Histoire de la philosophie (Gallimard. Paris. p. 102. Voir aussi p. 250, une tentative pour retrouver la Trinité dans la pensée chinoise dans les Leçons sur la Philosophie de la Religion (Vrin. 3e partie « La Religion absolue »)…
[iv] L’os pénien (en langage scientifique, le baculum), évidemment fort utile pendant la copulation, est un os présent dans le pénis de la plupart des mammifères. Il n’existe pas chez les hommes.
[v] Louis Bolk, Das Problem der Menschwerdung [1926], « La genèse de l’homme » in Arguments 1960, trad. J.-C. Keppy (avec une présentation de Louis Bolk par Georges Lapassade).
[vi] De S.J. Gould, sur la néoténie de l’homme, on peut lire, outre Ontogeny and Phylogeny, publié en 1977 (non traduit), Darwin et les grandes énigmes de la vie, [1977], Paris, Pygmalion, 1979, (cf. chap. 7 et 8 sur Bolk et la néoténie) et Le pouce du Panda [1980], Paris, Grasset, 1982. Quant à Alain Prochiantz, je me suis inspiré de ses travaux en biologie sur la néoténie, cependant qu’il s’inspirait lui-même de mes réflexions philosophiques ― on trouvera les références de ces emprunts croisés dans la présentation et le texte du spectacle qu’il a eu l’audace, rare chez un scientifique, de monter avec l’homme de théâtre Jean-François Peyret, intitulé La Génisse et le Pythagoricien, présentation où ils renvoient à mes travaux (texte paru chez Odile Jacob, Paris 2002).
[vii] S. Freud, Inhibition, symptôme et angoisse [1926], PUF, Paris, 1993.
[viii] Sur le concept d' »auto-transcendance », voir Jean-Pierre Dupuy, La marque du sacré, Éditions Carnets Nord, Paris, 2009.
[ix] Gary Becker, « Crime and Punishment » in Journal of Political Economy, vol 76, 1968.
[x] Michel Foucault, Naissance de la biopolitique, Cours au Collège de France 1978-1979, Gallimard-Seuil, Paris 2004, op. cit. p. 258 et sq
[xi] Jean-François Lyotard, La condition post-moderne – rapport sur le savoir, Minuit, Paris 1979.
[xii] Terme inventé par Zbigniew Brzezinski, animateur de la « trilatérale », organisation privée créée en 1973 regroupant 300 à 400 personnalités parmi les plus influentes du monde (affaires, politiques, décideurs et intellectuels).
[xiii] G. Simondon, L’individu et sa genèse physico-biologique, PUF, Paris, 1964, p. 25.
[xiv] Ce qui est déjà le cas, et la dernière accusation en date se trouve « Le naufrage réactionnaire du mouvement anti-industriel » paru à la fin de l’année 2023 : https://iaata.info/Le-naufrage-reactionnaire-du-mouvement-anti-industriel-Histoire-de-dix-ans-6272.html.
[xv] Foucault, « Foucault étudie la raison d’État » (1979) in Dits et écrits III, Gallimard, Paris 1994, p. 805.
[xvi] Voir le séminaire de Foucault qui reprend de façon abrégée le contenu de ses conférences de Berkeley, cf. M. Foucault, Le gouvernement de soi et des autres [1982-1983], Seuil, Paris 2008.
[xvii] Alain Supiot, L’Esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total, Seuil, Paris, 2010. On peut trouver le texte de la déclaration de Philadelphie en annexe de cet ouvrage.








