Parmi les nombreux paradoxes qu’affectionne Clément Rosset, l’un de ceux qui donnent le plus à penser est certainement celui-ci : seule la joie nous permet de supporter et de connaître l’étendue de notre malheur. L’homme du malheur ne peut supporter le réel dans son entier. Il doit donc en partie se le cacher. La joie, cette force majeure, quasi-mystique, nous garantit seule que nous puissions approuver l’existence. C’est cette approbation que la philosophie peut exprimer, tout en traquant les innombrables formes de refus de la réalité. « Réjouissez-vous, tout va mal ! »
La philosophie du réel de Clément Rosset l’amène à être précis, au sens de cette précision dont Bergson accusait les philosophes de manquer. Ecrivant dans un langage clair, il décrit des phénomènes singuliers, pour en montrer l’aspect irrégulier, à la fois cocasse et cruel. Notre auteur a aussi ce goût de ne pas épargner ses sarcasmes à ceux qui se détournent du réel pour fantasmer son double. Il est rare qu’il résiste à une pique blessante, ou à une vraie vacherie, autre moyen pour atteindre au réel tout cru, en le mettant à nu.
L’école du réel1 réunit des textes écrits sur trente ans. Nous sommes partis de ce recueil pour revenir sur quelques-uns des thèmes fondamentaux de l’auteur.
Je tiens à remercier Clément Rosset pour la disponibilité et la générosité dont il a fait preuve pour cet entretien.
Propos recueillis par Nicolas Rousseau
L’école du réel
Actu-Philosophia : L’expression « l’école du réel » résume très bien votre philosophie. Que serait cette école du réel ? Qu’est-ce que l’on y apprend ? Quelle est sa spécificité ?
Clément Rosset : Ce livre est un petit peu différent des autres, dans la mesure où il est une nouvelle mouture de livres écrits sur une trentaine d’années (dont j’ai pris certains textes, remaniés et retravaillés) et qui effectivement résume un des deux thèmes sur lesquels je n’ai cessé d’écrire : le rapport entre l’illusion et le double. Disons qu’au fur et à mesure des années, il m’était apparu que l’illusion, l’utopie, le refus de voir le réel en face –l’école du réel, c’est un peu l’école de l’apprentissage de l’acceptation de la réalité –, avaient la structure du double. Quand tous les moyens sont perdus pour refuser de voir la réalité, il reste toujours le fantasme du double, qui nous porte à penser que le réel pourrait être différent, qu’il y a quelque part une autre version de la réalité, qui devrait venir à la place de celle que nous avons. C’est un problème traité d’abord dans Le réel et son double, et dont l’origine est une relecture de L’Œdipe-Roi de Sophocle, de l’impression qu’on a de pouvoir échapper à son destin, en faisant en sorte que les choses se passent autrement que selon leur cours inéluctable.
L’oracle a prédit ceci et cela : on a beau faire tout ce qu’on veut, non seulement, cela se passe bien comme l’avait dit l’oracle mais en plus, cela se passe avec la collaboration active et inconsciente du sujet, qui fait exactement tout ce qu’il ne faut pas faire pour échapper à son destin –et qui y tombe en plein. Il s’estime alors avoir été floué par cette diabolique réalisation de l’oracle. Il s’imagine que les choses auraient pu se passer autrement. C’est cela que j’appelle le double, l’illusion : l’idée que les choses auraient pu se passer de manière « normale », sans cette espèce de croche-pied du destin, qui fait que c’est la victime qui se charge elle-même de réaliser son destin.
J’ai essayé de montrer que la manière dont le destin se réalise est la plus simple. Toutes les autres versions de la réalisation de l’oracle auraient été beaucoup plus compliquées. En sorte qu’en croyant s’en prendre à un tour du destin, on s’en prend à la réalité même. C’est cela que j’appelle le fantasme d’un double protecteur qui pourrait donner une autre version, moins tragique, du destin. Il y a dans tout ceci une réflexion sur le possible et le réel…
AP : Comme chez Bergson.
CR : Exactement, comme dans La pensée et le mouvant, les deux premiers chapitres – qui sont des textes que je trouve admirables.
AP : Sur l’illusion rétrospective du possible…
CR : Il y a l’illusion rétrospective du vrai, qui vient après, mais là, c’est l’imagination d’un possible là où il n’y a que du réel. Bergson, on peut en discuter, se range certainement du côté de philosophes de l’antiquité (les Mégariques…), et dont il retrouve l’inspiration, en montrant que la notion de possible est une notion vide, une pseudo-notion, qu’on ne peut jamais remplir de quelque chose de concret. De fait, vous savez qu’un des aspects les plus remarquables de Bergson, est sa chasse aux pseudo-concepts : cet effort pour montrer que sous un mot – dont on croit qu’il a une solidité et une validité à toute épreuve– se dissimule quelque chose qui n’est pas quelque chose de pensable, qui n’est rien. Il l’a fait avec le désordre, le chaos…
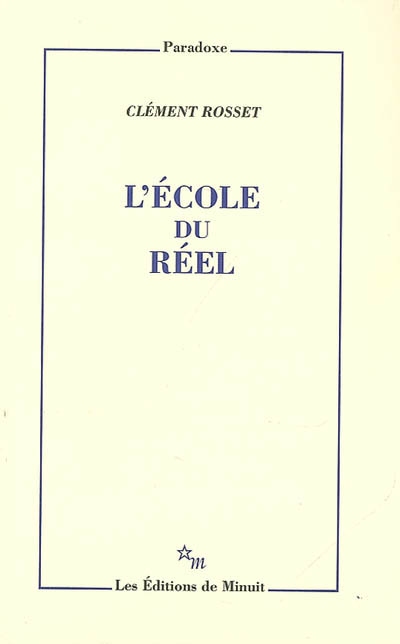
AP : Egalement avec le néant… C’est ce que Spinoza appelle le flatus vocis.
CR : Oui, vous avez tout à fait raison de l’invoquer, car cette chasse bergsonienne au pseudo-concept (qui n’est qu’un flatus vocis) Spinoza en est peut-être le premier inspirateur. Par exemple pour l’erreur : on ne peut dire d’aucune chose qu’il y ait en elle quelque manque qui puisse faire qu’on l’appelle fausse.
La chasse au pseudo-concept a commencé avec Spinoza, et ensuite, celui qui a le mieux accroché au mur des concepts, comme on accroche des têtes de cerfs avec les andouillers, c’est Bergson : c’est un chasseur de primes lui aussi ! Je me suis inspiré de sa critique du possible. En réalité, je me suis rendu compte un peu trop tard que ce que je faisais, Bergson l’avait déjà fait ! Je me suis précipité dans ce filon de la dénonciation du double pendant trente ans et j’ai écrit des livres dessus. On peut illustrer ce thème si riche dans tellement de domaines différents… C’est cela que vous trouvez dans L’école du réel.
AP : Vous êtes parti à la chasse au réel, comme pour l’attraper…
CR : Oui, mais en expulsant le double. Le réel est ce qui est sans double.
AP : Vous avez dit dans Le démon de la tautologie que le réel se laisse mettre sous la formule logique « A est A » : la tautologie serait l’expression la plus parfaite du réel. Qu’est-ce que ce démon ? Serait-ce votre daimôn propre, comme pour Socrate, qui vous permettrait de découvrir les doubles, toutes les fois qu’ils se font passer pour la réalité ? Comment distinguer un discours en prise sur le réel d’un charabia ?
CR : La question du charabia est encore une autre question. Par ailleurs, non, il n’y aucun rapport avec le démon de Socrate. Du reste, pour rendre le livre plus explicite, j’avais d’abord choisi un titre moins singulier : « Le démon de l’identité », dans la mesure où des philosophes comme Bergson et Wittgenstein, et bien d’autres, se sont heurtés à ce paradoxe de l’identité. On ne peut pas la décrire, car il faudrait un second terme. Or comme l’identité est l’identité… J’avais écrit un autre livre, L’objet singulier, objet qu’on ne peut justement pas décrire. 2
Je parle à ce sujet de la saveur indescriptible du camembert. Sur les écrans d’Internet, lorsqu’on tape « Clément Rosset », on voit d’abord apparaître, paraît-il, un énorme camembert !
AP : Le principe d’identité énonce qu’une chose n’est que ce qu’elle est. Mais dans Loin de moi, vous avez repris la critique humienne de l’identité personnelle…
CR : Oui, mais ce n’était pas dans la même voie. C’était une excursion, qui avait trait à l’identité personnelle, qui est un cas particulier du problème l’identité.
Je voulais terminer mon histoire de démon, en vous disant que j’avais renoncé au titre « Le démon de l’identité », parce que je trouvais que « le démon de la tautologie », pouvait faire penser à un titre de Jules Verne, comme le « monstre de la Patagonie ». Finalement, c’est Jérôme Lindon – qui était le directeur des éditions de Minuit – qui a approuvé ce titre.
AP : Il y a deux périodes distinctes dans votre philosophie : avant et après Le réel et son double. Avant, dans Logique du pire et L’anti-nature, vous disiez qu’il n’y avait pas de nature des choses. D’où cette conséquence que la seule façon d’approuver à ce qui est, c’est par l’approbation tragique inconditionnelle…
CR : Il y a aussi le hasard. Je réponds à Mallarmé, qui s’y résigne mais vraiment à son corps défendant.
AP : « Un coup de dé jamais n’abolira le hasard ».
CR : Oui. Dans la première partie de mon œuvre, il y a beaucoup de choses. Il y a à boire et à manger. Le thème, pour moi essentiel, qui apparaît dans un tout premier livre La philosophie tragique (que j’ai écrit à 19-20 ans –ce sont mes parents qui ont dû signer les contrats !) et surtout dans La force majeure (que j’ai écrit bien après), est le thème de l’approbation de la vie. Le miracle qu’il y a à se sentir très heureux dans un monde dont on sait l’horreur. Je pense tout à fait ce que pense Cioran, à cette différence que je ne conclus pas que la vie est un enfer, mais qu’elle est un paradis. Le problème numéro 1 était, et l’a toujours été depuis, d’expliquer la jubilation, alors que toute la réflexion la condamne.
Les deux parties sont comme deux volets d’un même édifice : avec l’idée d’affirmation inconditionnelle de la vie, je me suis intéressé beaucoup à ceux qui n’approuvaient pas la vie, et qui avaient toujours besoin d’une prothèse, d’un double, pour accepter la réalité dure et simple. Comment le manque de cette force majeure faisait qu’on inventait des choses extraordinaires, pour contourner l’affrontement direct avec l’horreur ?
Je m’intéresse non seulement au thème de l’illusion mais aussi de la non-illusion : la lucidité.
Le refus et l’approbation
AP : Il y a deux faits mystérieux auxquels vous vous confrontez : le refus du réel et son approbation inconditionnelle. Comment se fait-il que les hommes puissent refuser le réel, alors qu’il n’y a que le réel et qu’il finit toujours par revenir –et avec usure ? Vous dites qu’on paye très cher d’avoir essayé de refuser le réel…
CR : En tous les cas, cela n’arrange rien…
AP : Et comment se fait-il que l’on puisse approuver au réel entier, alors que rien dans le réel ne semble objet d’une telle approbation ?
CR : Vous avez tout à fait raison. Ce sont pour moi les deux points obscurs, les deux points noirs comme disent les occultistes. Ce sont deux choses qu’on ne s’explique pas et comme toutes les choses qu’on ne s’explique pas, elles sont passionnantes. Comme disait Nietzsche, « ce que j’ai compris ne m’intéresse plus ». Il y a un paradoxe dans la joie. De même, il y a quelque chose d’extraordinaire dans cette capacité à dire : « Non, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas un verre de vin. « Ceci n’est pas une pipe » ». J’en ai parlé très souvent.
Les premiers mots du Réel et son double sont « la faculté d’admettre la réalité apparaît comme très fragile ». Dans un appendice au Réel. Traité de l’idiotie, je parle de miracle de la faculté anti-perceptive. C’est quelque chose qui me fascine. Bien sûr, je peux m’en expliquer l’origine psychologique. « J’en veux pas, non, j’en veux pas !»
AP : C’est du dégoût.
CR : Oui, mais qui vient d’un refus intellectuel. « Ceci n’est pas ». Je pourrais donner tant d’exemples… Il y en a un que je ne cite jamais… Une histoire d’adolescent… J’allais en voyage à Rome avec un copain. C’était au retour, aux environs de Pise. Les autres membres du compartiment étaient une famille : un homme, sa femme, la belle-sœur. A cette époque, les trains italiens s’arrêtaient et repartaient sans prévenir. Voilà que dans le petit matin, l’homme et sa sœur descendent pour prendre un café. La femme dormait encore. Je me lève de ma couchette, je regarde le lever de soleil. Je les vois heureux, à savourer leur petit café. Et voilà brusquement que je les vois comme s’ils éloignaient… Le train repartait ! Ils couraient sur le quai : « Elle n’a rien !… ». Ils faisaient comme Michel Serrault dans La cage aux folles 2 : « Arrêtez !… ». J’avoue que j’avais une petite jouissance. Pas une jouissance sadique, une jouissance de cocasserie. L’épouse du malheureux, restée sans les papiers ni les tickets de train, dormait toujours, tournée vers la paroi. Je me disais « Pas la peine de réveiller un condamné à mort. Il sera toujours temps… ». Elle ne voulait pas se réveiller, car elle avait inconsciemment perçu qu’un sombre drame s’était joué… Plus tard, elle se réveille brusquement et je lui fais un discours apitoyé. Elle m’écoute attentivement et elle me dit « Non ! » – et elle se retourne ! Je la reverrai toujours…
De même, Katharine Hepburn à la fin de Soudain l’été dernier de Tennessee Williams, qui remonte dans son ascenseur… C’est une personne qui refuse l’homosexualité de son fils. Elle fait les pires monstruosités pour éviter d’être confrontée à cette réalité. Lorsqu’on arrive à la convaincre, elle fait appel, dans l’hospice dont elle est propriétaire, au médecin qui est à ses ordres (car stipendié par elle). Elle veut qu’il fasse une opération au cerveau de la fille qui a été témoin des ébats homosexuels de son fils. C’est une toquée totale. Quand elle est acculée à la réalité, elle remonte dans son ascenseur qui communique avec son appartement : c’est comme un monde d’illusions, protégé de tout contact avec la réalité. Pour elle, le réel a tort.
De même, la dame du train s’était tournée vers la paroi, comme Hepburn remonte dans son ascenseur : elles quittent le réel.
Contre la morale
AP : Cette approbation au réel s’oppose à la vision morale du monde, qui dit que ce qui est n’est pas ce qui devrait être.
CR : Puisque vous avez parcouru certains de mes livres, vous savez qu’il y a peu de choses qui me fassent monter la moutarde au nez autant que la morale. Je crois avoir en Spinoza ou en Nietzsche un appui. La tendance à établir un absolu dans ce qui est bien ou mal (qui est tout de même le péché mignon des systèmes de moral, qu’ils soient platoniciens, kantiens…) est amenée à faire bien souvent bon marché de la réalité –à tel point que Platon l’avait carrément évacuée (le sensible est trompeur, la raison se trouve dans le monde intelligible).
L’intention morale est particulièrement exposée à donner dans le panneau du double. Elle en a besoin. C’est très évident, chez Sartre par exemple, qui a inventé toutes sortes de systèmes invraisemblables pour garantir le libre-arbitre, car il en a besoin pour sa morale. Si on a ce virus, si on ne peut vivre que s’il y a de la moralité, un bien, un mal, des gens bien et des « salauds », inévitablement, on butera contre la réalité. On aura recours au double. (Je reviens du Mexique 3. J’en rapporte un petit livre qui paraîtra prochainement, où je reprends l’analyse de Sartre du garçon de café dans l’Etre et le néant).
C’était mon obsession quand j’avais 19-20 ans, dans mon premier livre : entre la réalité tragique et la morale, il faut choisir. C’est absolument incompatible. C’est d’ailleurs pourquoi mes écrits ont pu paraître très choquants, car j’ai traité de manière désinvolte de prétendus très grands auteurs.
AP : En vous lisant, je me suis posé une question sur la morale : comment pourrait-on se passer de morale pour vivre ? Ou d’un minimum de préceptes moraux ?
Ne faut-il pas déjà être quelqu’un d’assez honnête, dans le fond, pour pouvoir se passer de morale ? A l’inverse, il y a beaucoup de salauds qui font la morale aux autres… Comme le dit Pascal, « la vraie morale se moque de la morale ».
CR : Le seul fait de vouloir faire la morale est mauvais signe. Quelqu’un qui est obligé de consulter ses préceptes pour savoir s’il doit tuer ou pas, est quelqu’un de douteux. Je développe ce thème dans l’appendice au Démon de la tautologie, les « cinq petites pièces morales » (j’avais choisi un titre à la Erik Satie, comme les « trois petites pièces montées »).
Je pense que les gens qui sont bons n’ont pas besoin de morale. Ce n’est déjà pas un bon signe moralement que d’avoir besoin de morale.
AP : Vous vous opposez à la morale mais surtout aux gens qui font la morale : les importuns et aussi les tyrans, des gens assez dangereux…
CR : L’antinomie entre le tragique, auquel j’associe l’adhésion à la vie, et la morale reçoit une illustration qui me paraît très évidente : c’est le cas de Rousseau. Déjà au lycée, j’avais été choqué par ses critiques de Molière et de La Fontaine. « Monsieur Rousseau de Genève », comme dit Gobineau… Gobineau qui a écrit un livre raciste, mais qui a écrit aussi un recueil, les Nouvelles asiatiques, qui sont des chefs d’œuvre de drôlerie, de finesse.
AP : Je ne connaissais que le Gobineau raciste…
CR : Celui-là est moins intéressant… Il a tout de même une particularité que les gens ne savent pas toujours (car qui irait lire aujourd’hui l’Essai sur l’inégalité des races ?). Il y a une chose étonnante : c’est que son racisme n’est pas celui que nous connaissons depuis la fin du 19e siècle. Gobineau dit que le Blanc est infiniment supérieur, mais il est complètement en décadence et il sera anéanti par les autres races. Cela, je veux bien que ce soit raciste, mais ce qui l’est beaucoup moins, c’est qu’il n’y a aucun programme de résistance. C’est comme ça, c’est l’évolution !… Ce n’est pas du tout Le Pen ! Pas besoin de renvoyer des gens à la frontière.
AP : Cela fait un peu penser à Céline. Il y a un délire racial, dans Rigodon (qui n’est même pas son pire délire), quand il dit qu’il est pressé que les Chinois nous envahissent et arrivent jusqu’à Brest, car le Blanc n’est qu’un fond de teint qui sera mélangé aux autres couleurs… Ce n’est pas ce que je préfère chez lui…
CR : Avec Céline, on se perd en conjectures. On ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Car dans ses premiers livres, non seulement il n’est pas raciste, mais il met en boîte le racisme. Dans un de ses plus beaux livres, Mort à crédit, il y a cette terrible figure du père…
AP : Oui, qui est antisémite.
CR : …qui est antisémite et qui est complètement critiqué par le héros, Ferdinand. Pour le racisme de Céline, on croirait les séquelles d’un coup pris à la guerre, comme la blessure d’Apollinaire…
Pour en revenir à Rousseau, ce qui me mettait en rage, c’est que je ne comprenais pas qu’on ne remarquât point cette folie, à propos de ce qu’il disait de Molière, Racine, La Fontaine… Rousseau avait cette manie de réfuter tout ce qui est tragique chez eux. Or, La Fontaine est le plus cruel des auteurs. Rousseau donne mille raisons absurdes pour lesquelles le jeune Emile ne touchera pas à cette littérature empoisonnée. Autrement dit, dès qu’il est question de la réalité tragique, Rousseau la récuse en disant qu’elle est immorale.
La philosophie tragique était consacrée, dans sa deuxième partie, à prendre de revers cette position absurde. La réalité est déboutée au nom de la morale. Le tsunami qui a tué des milliers de gens est très immoral…
Philosophie et création
AP : Dans vos livres, vous parlez au moins autant des écrivains que des philosophes…
CR : Cela tient un peu à mon éducation. J’ai fait Normale Sup’ lettres et il y avait de la philo mais il y avait énormément de grec, de latin et surtout de français. Ma culture était originellement littéraire.
AP : Ensuite, vous avez fait le choix de continuer à lire les grands écrivains et à en parler dans vos livres.
CR : Et pas seulement la littérature, mais aussi la bande dessinée, le cinéma… Je fais mon miel de toutes origines. Il n’y a pas d’origine noble ou non noble.
AP : Est-ce qu’on peut dire que les écrivains et les philosophes traitent des mêmes questions – littérature et philosophie étant deux façons différentes de les aborder ?
CR : Tout à fait. Ce sont deux modes d’approches différents. J’irai jusqu’à dire : deux modes littéraires différents. Les problèmes qui hantent les grands écrivains sont des problèmes qui hantent aussi les philosophes.
Je comprends très bien que Spinoza écrive en une langue abstraite qu’il ne connaissait pas, qu’il a apprise exprès pour écrire son œuvre, langue qui n’avait pas de connotation psychologique. Mais qu’un écrit philosophique doive forcément se passer de toute référence musicale, littéraire, anecdotique, il me semble que c’est une mutilation inutile. Il me semble qu’on peut très bien faire comprendre des choses un peu subtiles avec l’aide non seulement du raisonnement mais aussi l’aide d’exemples pris dans des domaines très différents de la philosophie. Je ne reproche pas, évidemment, à Bergson, Nietzsche ou Spinoza de ne pas raconter d’anecdotes… En revanche, combien de livres rendus illisibles par le fait que pendant deux mille pages, on ne sort pas de références purement universitaires et où les nombreuses citations ne ressemblent qu’à « annales de l’université de Pittsburg » etc. ! On est dans une atmosphère raréfiée. Il faut ouvrir la fenêtre de temps en temps… Ce n’est pas le cas avec Spinoza ou Leibniz : je comprends très bien qu’on ne soit philosophe en n’utilisant qu’une seule palette. Je crois aussi qu’on peut voir les choses un peu différemment.
J’ai l’impression que mon cas est un peu particulier… C’est vrai que quand je suis arrivé à l’agreg’ de philo à Normale Sup’, Althusser m’a dit : « Mais tu ne sais rien ! Rien !… » Il avait raison. Si, je connaissais Pascal, Schopenhauer et Nietzsche. C’était déjà pas mal…
AP : Vous avez d’ailleurs dit, dans En ce temps-là, qu’Althusser lui-même ne lisait en fait pas Marx, mais Descartes et Malebranche.
CR : Althusser se faisait volontiers passer pour ce qu’il n’était pas du tout… Le seul philosophe de l’histoire de la philosophie qui ait tué sa femme… Même dans Diogène Laërce, on ne trouverait pas un tel philosophe, alors qu’il y en a des bizarres (Héraclite s’est fait ensevelir dans de la merde séchée, Empédocle s’est jeté dans l’Etna…)
AP : Dans Le choix des mots, vous faites un lien entre l’écriture et la pensée : contre Rousseau, vous dites que l’écriture n’est pas un « dangereux supplément ». Bien écrire, c’est bien penser, et réciproquement. Vous parlez de ces mauvaises copies de philosophies que vous avez corrigées, sur lesquelles vous aviez juste envie d’écrire, reprenant un titre de Beckett, « mal vu, mal dit ». C’est mal dit parce que c’est mal vu, c’est mal dit donc c’est mal vu.
Vous dites aussi – autre point commun entre philosophie et littérature – que lorsqu’on écrit une œuvre, on peut avoir ce sentiment fugace d’être comme le maître du monde, de comprendre d’un coup toute la réalité.
CR : C’est vrai de toute œuvre. L’architecte, ou le cinéaste au moment du montage, peuvent sentir cela. Je considère la philosophie comme une création parmi les autres. Elle n’est pas tellement pour moi recherche de la vérité, c’est aussi la création d’une œuvre, avec ses tics, avec ses bonheurs, ses essais… Quand j’écris (mais j’espère que cela ne m’arrivera plus trop, car c’est très fatigant…), j’ai l’impression d’être dans un atelier de peintre ou d’être un compositeur, un dramaturge… J’essaie de trouver le mot juste. C’est pourquoi je pense qu’il y a identité entre le mal vu et le mal dit. Qu’est-ce que vous voulez qu’un étudiant puisse penser, s’il ne sait pas le français ?
AP : A propos de la création, est-ce que vous seriez d’accord avec Deleuze, pour qui la philosophie est l’activité consistant à créer des concepts ?
CR : Je ne vois pas qu’on puisse faire de la philosophie sans proposer des thèses un peu nouvelles sur de vieux sujets. Si Deleuze veut dire par là qu’une certaine productivité en matière de conception intellectuelle est indispensable et constitue une partie importante de la philosophie, je suis d’accord. En revanche, s’il veut dire par là que la philosophie se réduit au concept et passe à côté de tout ce qui est matériel, sensuel, et qu’il abandonne les privilèges de l’expressivité non-conceptuelle aux arts, là, je ne le suis pas.
J’ai été longtemps très intime de Deleuze, pendant une dizaine d’années. Deleuze était une créature très sympathique, tout à fait bizarre, très théâtrale… Il était aussi extraordinairement intellectuel. Il n’avait aucune jouissance – à baiser, je ne sais pas, il n’en a jamais trop parlé – mais aucune à regarder un tableau, à écouter de la musique… Comme la plupart des philosophes, il ne connaissait pas la musique.
La jouissance qui lui vient est toujours par l’intermédiaire d’une conceptualisation. Il avait toujours une manière abstraite pour parler d’une œuvre. Il passe par des chemins intellectuels. Il n’a pas de contact avec la matérialité d’une œuvre d’art. Même l’œuvre philosophique a une matérialité, qui est la façon dont le philosophe s’exprime. Lui était vraiment l’homme des idées pures, de la raison pure – plus que Kant encore (il a d’ailleurs écrit un petit livre sur Kant, fort utile). Il a fait des choses remarquables… A partir de 68, il a commencé à déconner…
AP : Vous aviez écrit un article sur lui, pour le numéro de la revue L’Arc qui lui était consacrée. Vous aviez une formule frappante. Vous disiez que dans toute sa philosophie, il faisait preuve « d’un beau manque d’enthousiasme ». J’avais l’impression que cette formule paradoxale s’appliquait aussi à vous – si on entend par enthousiasme le sentiment d’être en charge de valeurs transcendantes. Deleuze ne faisait pas de philosophie au nom de telles valeurs. Vous disiez que sa philosophie était comme un biscuit sec, et c’était un compliment.
CR : Oui, « le beurre manque ». Deleuze avait toujours rêvé d’être professeur à la Sorbonne : il avait tout pour l’être et c’eût été le meilleur. Mais il a pris position pour les étudiants en mai 68. Il y en a eu deux : Deleuze, et Jankélévitch que j’ai également très bien connu. On ne leur a jamais pardonné. Ça a été un traumatisme épouvantable… On m’a d’ailleurs bloqué ma carrière, notamment car on m’a soupçonné de faire des cocktails Molotov, de diriger des groupes de gauchistes…
AP : Alors que vous vous êtes toujours tenus à l’écart de la politique.
CR : C’est d’ailleurs le point faible de ma philosophie : je traite de problèmes qui n’ont rien à voir avec l’actualité, ce qui n’a aucun intérêt pour personne sauf pour des gens méditatifs. Je n’ai pas de recette pour sortir de la crise financière. Je serais incapable d’en donner. Et je soupçonne les philosophes qui en parlent de se mêler de ce qu’ils ne maîtrisent guère.
Je dois vous dire que Deleuze, dans la dernière partie de sa vie, est devenu très conscient de son génie. C’était une forme de paranoïa, pas persécutée, mais triomphale : « je suis le plus grand… ». Il a une œuvre, c’est certain, autant sinon plus que bien d’autres noms du même moment. Encore qu’il restera des choses de Lacan… quand on l’aura traduit en français !
Mai 68
AP : Vous vous êtes tenu à l’écart de la « pensée 68 », cette philosophie du désir et de la révolution.
CR : Le désir est un thème très important pour moi, mais je pense l’entendre en un sens assez différent de ce qu’entendaient les gens de 68. Je vous avoue que j’ai toujours été si peu politisé que j’ai vu dans mai 68 l’occasion d’avoir un mois de vacances. Je ne l’ai jamais pris au sérieux. C’était un pseudo-événement : les gens suivaient cela à la radio, comme si c’était la Révolution, comme si on était à Fleurus ou Valmy…
AP : Oui, si on prend mai 68 comme un petit événement parisien qui concerne les problèmes d’accès des Normaliens aux dortoirs des filles… (C’est de vous que je tiens cette anecdote ! [Voir [cet entretien en ligne. [/efn_note])
CR : Sur ce point, mai 68 a eu des effets, car il y avait une crispation sociale dans certains milieux : on fermait le dortoir des filles !… Je me rappelle que lorsque je m’apprêtais à publier La philosophie tragique aux PUF, n’ayant pas eu le temps de remettre dans les temps un devoir en khâgne, j’ai eu quatre heures de colles. Ce n’était plus possible… Sur ce point, je pense que mai 68 a eu des effets bénéfiques, en France ou dans d’autres pays qui ont connu des événements similaires.
Si j’avais eu le moindre doute sur la portée possible de mai 68, j’en aurais été déçu immédiatement dès que j’ai vu que le parti communiste n’en voulait pas, et ça s’est senti très vite. Etait-ce par obédience à Moscou ? Parce qu’ils voulaient soutenir de Gaulle – comme ils l’ont toujours fait ?…
AP : Il y a eu un conflit entre les ouvriers et les étudiants…
CR : Les ouvriers n’ont jamais pu supporter les étudiants. On était pourtant dans une période de hausses importantes des salaires. Quand j’ai vu que le PC n’était pas de la fête, j’ai compris que ça sentait vraiment la blague. Il fallait vraiment avoir l’esprit de sérieux pour y avoir cru, comme Deleuze y a cru. C’était un peu de la naïveté.
AP : Est-ce que ce n’était pas une façon d’introduire de l’air frais en philosophie ? D’aborder autrement la politique… Deleuze le dit lui-même : mai 68 n’est pas qu’un événement très parisien. Ce sont aussi des bouleversements dans le monde entier.
CR : Je crois que cela a mis moins d’air frais dans la philosophie que dans la sociologie, dans les rapports sociaux, entre classes. C’était cette décrispation qui était salutaire.
La pensée contemporaine
AP : Quel regard portez-vous sur la pensée actuelle ?
CR : C’est un retour à des valeurs qui étaient déjà assez répandues avant 68. J’ai eu l’impression que l’effondrement des idéologies chrétienne et surtout marxiste avait créé une dépression qui était favorable à l’éclosion de pensées individuelles. Je ne vois pas très bien s’il y a une pensée qui ait remplacé celle de 68. J’ai l’impression que nous vivons un moment plus propice non à de grands systèmes mais à des initiatives individuelles. Mais il y a un inconvénient à cette neutralité. Je suis d’accord avec Cioran, dans la première phrase du Précis de décomposition : « En elle-même, toute idée est neutre, ou devrait l’être. Et l’homme l’investit aussitôt de ses délires, de ses démences. Le passage de la logique à l’épilepsie est consommé. » Ce n’est pas tellement le cas en ce moment. Mais je crois qu’il y a un lien entre les périodes de démission des valeurs traditionnelles et ce moment où on se remet à faire de la morale avec n’importe quoi. Une morale moins sanguinaire, mais tout aussi absurde : qui sait ce qui est bien ou mal ? C’est le médecin… Qui va décider si on doit avorter ou non ?… Empêcher le clonage, mais au nom de quoi ?… Il y a un éparpillement.
Je ne crois qu’il y ait d’esprit du 21e siècle comme on pouvait parler de l’esprit des 17e ou 18e siècles.
AP : On parle beaucoup dans l’université de phénoménologie et de philosophie analytique.
CR : La phénoménologie husserlienne est une spécialité française. En Allemagne, non. De même, Heidegger est bien plus apprécié en France qu’en Allemagne. Pour la philosophie analytique, je suis de l’avis de Deleuze : c’est un enterrement de première classe pour la philosophie… Je l’ai bien vu au Canada et aux Etats-Unis. J’ai donné des cours là-bas, dans les départements de lettres, et je suis allé voir des cours où on s’emploie à déterminer s’il est sûr, ou presque sûr, que la casquette de John est rose ou jaune. La logique formelle, ce sont quasiment des maths. Qu’on en fasse un peu, oui, mais de là à en faire un objectif philosophique…
Par contre, je ne suis pas du tout Deleuze lorsqu’il range Wittgenstein dans son rejet de la philosophie analytique. Cela prouve une chose : qu’il ne l’a jamais lu. S’il l’avait lu, il ne l’aurait lu qu’en français, car Deleuze n’avait aucune connaissance d’une langue autre que le français, qu’elle soit moderne ou ancienne. J’ai passé un oral avec lui ; j’avais un texte de Whitehead, très confus. J’ai sollicité son aide pour un ou deux mots, car je ne comprenais pas ce que ça voulait dire –d’ailleurs, c’est bien rare que ça veuille dire quelque chose, Whitehead… Et Deleuze ne savait pas !
AP : Deleuze critique surtout les wittgensteiniens pour leur réduction de la philosophie à l’étude de la logique des propositions. [cf. L’Abécédaire de Gilles Deleuze, à « W comme Wittgenstein ». [Extrait de cette séquence retranscrit sur Wikipedia.[/efn_note]
CR : Si Deleuze a lu Wittgenstein en français, il n’a eu connaissance que du Tractatus Logico-Philosophicus, dans la traduction de Klossowski, qui n’a même pas essayé de comprendre de quoi il est question (il saute parfois dix lignes quand il ne comprend pas…). Et pourtant Deleuze admirait Klossowski… Or, le logicisme de Wittgenstein n’est vrai que pour le Tractatus, pas pour les Investigations philosophiques.
Mais vous êtes très jeune, non ?
AP : Je vous remercie de me le dire ! Je viens d’avoir vingt-huit ans… Il me semblait que je n’étais plus si jeune.
CR : A trente ans, on passe un cap. Mais de trente à soixante ans, on ne vieillit pas. Platon l’a dit, d’ailleurs (il dit de trente à quarante ans…). Par contre, le cap des soixante-dix ans (pour moi, c’est dans quelques mois), là je crains le pire.
AP : Pour vous qui êtes un philosophe de l’approbation, c’est un test redoutable !
CR : Disons que c’est un test, oui, un petit obstacle.
- Clément Rosset, L’école du réel, Minuit, 2008
- Le début de L’objet singulier précise ce rapport troublant entre le réel et son double. D’une part, le double n’a d’existence que par rapport au réel dont il prétend usurper la place. Le double redouble et dédouble le réel : il nous en détourne et n’existe que par ce détournement. Mais d’autre part, le réel est en lui-même « idiot », c’est à dire sans reflet. Le réel est irreprésentable et indicible, sauf par le biais du double qui, seul, en offre une représentation. De sorte que le double rend visible le réel en le troublant : le réel resterait pour ainsi dire translucide s’il n’était pas opacifié. Ce n’est que par l’intervention de la « force majeure », la joie que l’on peut atteindre directement au réel, sans dédoublement. Mais la joie ne serait-elle pas un double singulier, qui répète le réel sans le trahir ?
- Notre auteur a confirmé ensuite qu’il y était heureusement avant le début de l’épidémie…








