Actu Philosophia : Dans votre ouvrage Le Souci contemporain 1, vous montrez que la leçon d’Aristote, qui voyait l’homme comme un animal politique et la politique elle-même comme une figure de l’existence, n’a pas été retenue, car une des tendances de la modernité est, selon vous, de souhaiter supprimer la politique. Bien plus, les deux siècles précédents ont vu se développer une volonté de supprimer la morale, l’antinomie du bien et du mal. Quelles furent les conséquences de ces choix, et sont-elles encore visibles aujourd’hui ?
Chantal Delsol : Il s’est produit ce qu’on appelle le paradoxe des conséquences. Essayez de supprimer la politique, elle revient sous une forme terrifiante, et de même pour la morale. Dites (chez les Soviets) que vous vous passez de l’État, et vous terminez avec l’État le plus oppressif qu’on n’ait jamais vu. C’est que les expressions de notre condition (ce que Freund appelait les essences) ont besoin d’être reconnues pour pouvoir être circonscrites, surveillées, cantonnées, et éviter les perversions. Si on fait comme si elles n’existaient pas, elles ne cessent pas d’exister, mais au contraire elles s’exacerbent et deviennent odieuses. Aujourd’hui il n’est plus question de supprimer la morale, elle constitue plutôt la seule catégorie indiscutable. On pourrait plutôt dire que tout est moral, y compris la politique. Le manichéisme qui règne sur le plan international en est un exemple frappant : le fait que les politiques prétendent combattre le Mal, alors que la politique ne doit rigoureusement combattre que l’adversité, si en tout cas elle veut demeurer dans son ordre. La justice internationale exprime de façon caractéristique cet appel d’un ordre moral mondial remplaçant la politique.
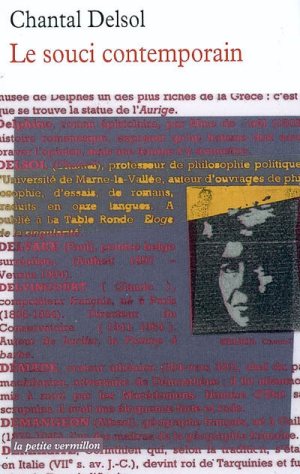
AP : Quand les Grecs parlaient de vie bonne, l’homme contemporain semble obsédé par le bien-être, et la recherche d’un bonheur immédiat et somme toute éphémère. La pensée des Grecs, et particulièrement d’Aristote, est à ce titre sans doute un recours. Quelle place tient celle-ci, dans votre œuvre ?
CD : Une place essentielle. La pensée grecque représente la véritable armature de notre culture, qui sera reprise, approfondie et sublimée par le christianisme. Il est très troublant de voir tous les aspects anthropologiques ou moraux du christianisme qui ont été pensés en avant-première par la pensée grecque, sans qu’on puisse repérer le lieu d’influence. Pour prendre un seul exemple, l’idée spécifiquement judéo-chrétienne de dignité de la personne se trouve déjà dans l’Oedipe à Colone de Sophocle.
AP : Dans L’Age du renoncement 2 , vous écrivez que la culture chrétienne fait l’objet d’un rejet en Europe, après 2000 ans d’histoire ; et qu’en la rejetant, nous en repoussons aussi tous ses fruits séculiers. Quels sont ces fruits selon vous, et ce rejet est-il inéluctable ? N’y a-t-il pas un grand danger à refuser l’irrationalité du monde ? Pourquoi est-elle aujourd’hui si vilipendée, au profit d’une raison toute-puissante ?
CD. : Ce n’est pas l’irrationalité du monde que nous refusons aujourd’hui, c’est au contraire la rationalité… La raison toute-puissante domine la modernité, c’est à dire la période qui s’étend jusqu’à la seconde guerre mondiale. Aujourd’hui nous sommes dans la post-modernité, qui d’une certaine façon poursuit la modernité et d’une autre façon la contredit – et c’est le cas en ce qui concerne la raison. En rejetant la chrétienté nous délégitimons ses fruits qui sont : la conscience et la liberté personnelles, donc la démocratie et généralement l’État de droit ; l’idée de vérité donc d’universalité ; la vision fléchée du temps donc l’espérance et le progrès. J’ai essayé de montrer dans ce livre que ces trois caractéristiques sont en train de tomber en désuétude.

AP. : La désaffection de l’homme contemporain pour la religion vient-elle seulement de sa peur du fanatisme ou peut-elle aussi s’expliquer par une organisation interne de l’Église, un peu obsolète ?
CD. : Certainement les deux. Il faut remarquer que certaines religions, comme l’évangélisme, sont en pleine progression. L’évangélisme est une religion déstructurée, ce qui peut expliquer qu’elle réponde aux deux inquiétudes légitimes de l’homme contemporain : la crainte du fanatisme et la volonté de répondre aux exigences modernes. En ce qui concerne le catholicisme, je ne me battrai pas là-dessus parce que je trouve qu’il y a des choses plus importantes, mais je pense que l’exclusion des femmes de tout ce qui est essentiel (les sacrements), représente un handicap de plus en plus important, qui pourrait assurer dans les siècles à venir la victoire complète du protestantisme.
AP. : Vous expliquez que la promotion de l’individu déraciné, hors de son espace et de son temps est un trait caractéristique de la modernité. L’homme peut-il se libérer de toute appartenance, de toute croyance, de toute coutume ?
CD. : Il ne peut pas, ces appartenances sont son tissu même, la fibre dont il est fait, il n’est rien sans elles, c’est à travers elles qu’il se façonne comme sujet. C’est la grande illusion de l’époque présente, de croire que nous pourrions devenir seulement des citoyens du monde, seulement des hybrides asexués, et, comme le disent quelques philosophes égarés, seulement des habitants des lagers, c’est à dire des nomades absolus… Privés d’appartenances, nous ne deviendrions pas plus libres, mais si vides et si assoiffés de connivence que nous serions désormais ouverts à n’importe quelle criminelle appartenance (on sait que les adhésions totalitaires naissent sur le terreau du nihilisme).
AP. : L’un des traits les plus évidents de la modernité est cette propension à nier le tragique de l’existence humaine, et à oublier ce fait qu’il est de toute façon impossible d’anéantir le Mal dans le monde. Quelles sont, à votre sens, les raisons de ces dénis aux lourdes conséquences anthropologiques ?
CD. : Cette propension à vouloir carrément sortir de notre condition, est l’aspect faustien de la culture occidentale. Il faut noter que cela n’arrive qu’ici. Pourquoi ? Parce que nous sommes structurés dans ce que j’ai appelé l’irrévérence, en raison du temps fléché (toutes les autres civilisations ont un temps circulaire) : il nous faut sans cesse nous dépasser. D’où la science, la technique etc. Mais la volonté de se dépasser doit être limitée par une réflexion anthropologique. Quand la culture religieuse qui inspirait cette réflexion n’existe plus, alors tout devient possible. C’est le totalitarisme communiste au XX° siècle, c’est le discours post-humaniste d’aujourd’hui.
AP. : Nous assistons à une technicisation de la politique, conséquence de la fin des grands récits et de la crainte ressentie par l’homme contemporain à l’endroit des conceptions du monde. Cette aseptisation de la politique, ce contrôle politiquement correct des opinions et des certitudes explique-t-elle l’émergence actuelle d’une forme d’ « américanisation » des débats, et de l’usage du droit ?
CD. : Oui l’usage du droit peut ressortir à une technicisation excessive. On peut dire qu’aujourd’hui Kelsen l’emporte sur Schmitt. Nous voudrions que tout soit encadré et nous avons peur de la décision personnelle, en raison de la responsabilité inhérente et de l’arbitraire possible. Nous cherchons à réduire la politique au droit. D’où la justice internationale, qui en vient à décréter le droit ou le non-droit de la guerre (en réalité la guerre ne peut provenir que d’une décision, parce qu’elle relève de la situation exceptionnelle – et heureusement). D’où la technocratie européenne, système de gouvernement sans décision (non pas « un tel décide » mais « ça décide »). D’où les lois dites sociétales, qui érigent les limites à partir desquelles on peut tuer ou laisser mourir, déchargeant ainsi la conscience de son poids.
AP. : Quel est selon vous le rôle des partis politiques, aujourd’hui ? Faut-il, au regard de la crise institutionnelle qui semble être la nôtre, et comme le préconisait Simone Weil dans un petit opuscule de 1940 intitulé Note sur la suppression générale des partis politiques, se débarrasser de ceux-ci, ou faut-il simplement y voir un simple élucubration, comme le pensait Raymond
CD. : Oui, il faut y voir selon moi l’élucubration d’un esprit très doué et très jeune, mais cette fois-ci incohérent. La démocratie moderne ne peut pas se passer de partis politiques, lesquels sont sa condition d’existence puisqu’ils garantissent l’expression de la diversité des opinions. En réalité je pense que Simone Weil, qui était tout à fait platonicienne, n’aimait pas la démocratie. Si elle avait vécu plus longtemps, il aurait été intéressant de voir comment elle allait résoudre ce conflit entre l’amour pour la liberté et la méfiance envers la démocratie.
AP. : Dans un monde qui sacralise les droits : droits-libertés ou droits de… ; droits-créances ou droit à… ; y a-t-il encore une place pour l’action, la grandeur, le héros ?
CD. : Beaucoup moins, et c’est logique, de toutes façons la grandeur est devenue détestable parce que nous avons souffert toutes ses perversions. Nous souhaitons nous en débarrasser. « Malheur au pays qui a besoin de héros » (Brecht).
AP. : Y a-t-il, pour vous, des limites à poser à la tolérance ?
CD. : Une société qui tolérerait tout, permettrait tous les crimes. C’est impossible. Mais je suppose que vous parlez de la liberté d’expression. Je pense que les démocraties doivent tolérer légalement la plus complète liberté d’expression, mais que celle-ci a des limites morales – les dessinateurs de Charlie qui caricaturent Mahomet sont des ordures, non pas parce qu’ils provoquent les partisans du Djihad, mais parce que c’est honteux de se moquer de ce qui est sacré pour tant de gens. Cela dit, il est tout à fait hypocrite de prétendre que chez nous la liberté d’expression est totale. On a le droit de caricaturer Mahomet mais pas le mariage gay. On encense Sade parce qu’il fait l’éloge du crime sans le mettre à exécution, mais en même temps on diabolise Céline en disant que faire l’éloge du crime c’est déjà le mettre à exécution. Autrement dit, nous prétendons tout accepter, mais nous avons nos têtes de turc comme ailleurs.
AP. : Dans l’un de vos tous derniers ouvrages, Les pierres d’angle. A quoi tenons-nous ? 3 qui constitue un prolongement des réflexions entamées dans L’Age du renoncement, vous regrettez les conséquences déshumanisantes de ce que vous appelez « la saison des Lumières ». C’est une critique que l’on retrouve à de nombreuses reprises dans toute votre œuvre. Est-ce à dire que vous vous situez dans le sillage de certains auteurs contre-révolutionnaires, tel Edmund Burke ? Penseur libéral, mais aussi traditionnel, ne réduisant pas son libéralisme à l’idéologie moderne de l’individu tout-puissant, Burke est aussi, comme vous, un aristotélicien. A-t-il fait partie de vos influences ?
CD. : Oui, je suis disciple de cette pensée libérale du XIX° qui reconnaît les bienfaits des Lumières tout en critiquant les excès révolutionnaires ou les perversions des Lumières : Tocqueville, Burke, Stuart Mill, Taine etc. Mais je ne me sens aucune affinité avec les penseurs contre-révolutionnaires traditionalistes et anti-démocrates comme de Maistre ou Bonald. Je déteste le despotisme éclairé ou soi-disant éclairé.

AP. : L’homme contemporain, expliquez-vous, dans Le Souci contemporain, est « prisonnier de sa finitude », dont il s’échappe en « parcellisant la durée de son existence ». Il vit donc de « morts successives ; car il a intégré la précarité de chaque projet ». Il s’ensuit qu’il méprise la mort, et que toute irruption de la catastrophe le laisse pétrifié. N’avons-nous pas eu la preuve, avec les attentats contre Charlie Hebdo en janvier dernier et la grande manifestation populaire qui en découla, qu’a surgi la violence dans un monde qui tant absolument à la nier ?
CD. : [Nous avons vu la brusque irruption du tragique dans une société qui croit facilement en la disparition définitive des guerres, des épidémies et de la misère en général. La réaction du Je suis Charlie a eu pour une part cette signification : on a manifesté contre l’orage, c’est à dire contre des phénomènes naturels qu’on croyait dans notre démiurgie avoir évincés pour toujours. Je connais une famille où les jeunes on pleuré pendant des jours après cet attentat, exprimant la véritable disparition d’un monde : le monde sans tragique…
AP. : Vous écrivez que nous avons renoncé à toute forme de vérité, que nous ne sommes plus capables de nous battre pour elle. Obsédé par la paix et le consensus, nous sommes pourtant dans cette culture du politiquement correct en face d’interlocuteurs qui refusent la contradiction. A votre sens cette culture du consensus mou prend sa forme la plus éclatante dans la gouvernance européenne, que vous n’hésitez pas à qualifier de « gouvernement technocratique. » Or, vous êtes fédéraliste. Quel est donc ce fédéralisme que l’UE a à ce point manqué dans sa construction pour le moins ratée, et qu’en est-il de la place des États-nations ? N’est-il pas vrai, comme l’explique Pierre Manent dans La Raison des nations 4 , que l’État-nation souverain est la version européenne de l’ « empire démocratique », qu’il est le lieu nécessaire de l’unité d’un peuple ?
CD. : Les Français ont tendance à comprendre le fédéralisme à l’envers, parce qu’ils ignorent tout à fait ce que c’est – ils sont centralisateurs et jacobins de façon génétique. Pensez que le grand auteur du fédéralisme, Althusius, auteur allemand du XVII° siècle, n’a pas encore été traduit en français… Je crois pour ma part que l’Europe n’aurait pu vivre de façon harmonieuse que par le fédéralisme, qui aurait consisté à appliquer réellement le principe de subsidiarité : ne laisser à Bruxelles que le strict régalien. Or nous avons fait tout le contraire. Pour prendre des exemples, l’Europe ne pourrait vivre que si les gouvernants européens ont les moyens de lever une armée commune pour aller au Kosovo, et si les gouvernements nationaux s’occupent de la culture et de la taille des cages à poules – tandis que Bruxelles s’occupe des cages à poules et ne peut lever une armée commune, ce qui fait qu’on doit dans les cas graves appeler les Américains. Le fédéralisme (dans son acception normale et non dans l’acception fantasmée et fausse que s’en font les Français) signifie qu’il y a plusieurs centres de souveraineté. Les Français comprennent la souveraineté à la façon de Bodin : une et absolue ; tandis que pour le fédéralisme, elle est plusieurs, partagée et morcelée.
AP. : Vous êtes une philosophe libérale. Or, en France, le libéralisme subit, à notre sens, une telle caricature, qu’il est presque impossible de trouver un homme politique s’en réclamant. Ce courant de pensée est constamment assimilé à l’hubris de grandes firmes, et l’on voit constamment fleurir, même chez les philosophes les plus intéressants à gauche (Michéa, Dufour, etc.), le qualificatif « ultra-libéral », non pour désigner cet hubris, mais pour signifier que dans la philosophie libérale elle-même est contenu le germe de la société de consommation dans laquelle nous sommes. Pour eux, sortir du « libéralisme » est un devoir, une nécessité, afin de ne pas transformer le citoyen en simple consommateur. Est-ce à dire que le prisme avec lequel la plupart des philosophes français voient le monde est encore presque exclusivement marxiste, étatiste et jacobin ?
CD. : Oui on a eu raison de dire que le dernier léniniste sera un Français… Ce qui explique qu’ici le libéralisme soit constamment compris dans son extrême, afin d’être décrédibilisé. Je crois qu’il faut limiter et contrôler le libéralisme afin que ce ne soit pas la jungle. Mais être anti-libéral c’est appeler de ses vœux quelque chose comme une soviétisation. Et je crois que beaucoup de Français en sont là. Ce qu’ils aimeraient, c’est vivre dans un pays comme l’Union Soviétique (où tous ont un travail minable et peu payé avec très peu de contraintes, où tous sont logés/eau/gaz/électricité aux frais de l’Etat). Un de mes amis dit que beaucoup de Français ne se sont jamais remis d’avoir raté la prise de pouvoir par le Parti Communiste en 47, et je crois qu’il a raison…
AP. : Dans votre récent ouvrage consacré à une analyse du populisme 5, vous expliquez que l’idéologie de l’émancipation qui est née des Lumières refuse à toute velléité de défense de l’enracinement la qualité d’opinion. Précisons qu’il ne s’agit en rien pour vous de défendre les idées populistes à tout prix et dans leur totalité, mais de souligner que la post-modernité appelle à un arasement définitif des particularismes, au mépris de ce qu’est, dans ses fondements, la condition humaine… Comment analyser le populisme ? Est-il un brusque retour, violent mais prévisible, d’une fuite générale du sens ?
CD. : Il traduit un emballement de l’idéologie émancipatrice qui, parce qu’elle n’a pas pu se mettre en place par le moyen du totalitarisme léniniste, tente à présent de se réaliser par le consensus mou et la pression ironique (c’est le thème de mon prochain livre). Pour mettre en place une idéologie, il faut évincer la démocratie, et ici c’est ce que l’on fait de façon douce, non pas en interdisant les élections, mais en excluant par l’injure les partis qui ne vont pas dans le bon sens.
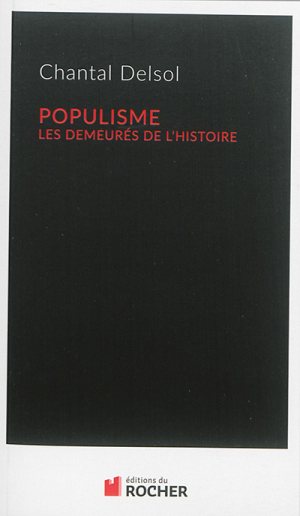
AP. : Peur du peuple, peur de la réaction, peur de la remise en cause des rentes (au sens où l’entendait Pareto), peur de l’élitisme, peur de la souveraineté, peur de l’autorité, peur de l’avis des autres que l’on transforme en maladie psychiatrique (la chasse aux -phobes, disait Philippe Muray) : comment peut-on définir cette morale-là ? D’abord, peut-on baser une réflexion d’ordre moral sur des peurs et une défiance à l’endroit de tout ce qui n’est pas calibré par ce qu’il est convenu d’appeler une forme « totalitaire » de rejet de l’opinion des autres ?
CD. : Je n’emploierais pas le mot totalitaire, même entre guillemets, parce que le malheur des sujets des totalitarismes était trop grand pour être comparé (nous n’avons pas de terreur ici). Il y a néanmoins aujourd’hui une tentative d’exclure les courants de pensée qui ne vont pas dans le sens de l’idéologie émancipatrice – prenez les réformes dites sociétales et regardez comment on traite ceux qui les récusent : d’attardés, de pauvres types, de salauds, bref de gens qui n’ont pas une opinion différente mais une maladie mentale ou des pensées criminelles. Les totalitarismes envoyaient les opposants au lager ou à l’hôpital psychiatrique. Nous empêchons que quiconque leur parle (il suffit de voir, exemple récent, les hurlements des journalistes quand ils ont subodoré qu’un élu de l’UMP avait déjeuné avec un élu du FN…) Tocqueville avait prédit cela.
AP. : Vous avez écrit quatre romans. Quelle est l’importance de la littérature dans votre œuvre ? Quel lien, s’il y en a un, faite-vous entre votre œuvre philosophique et vos œuvres littéraires ?
CD. : Il est difficile de vous répondre. J’aime écrire et les romans sont pour moi une sorte de récréation, l’expression du monde imaginaire. Si je n’avais pas pu être enseignante, j’aurais aimé être écrivain public. Le monde des romans est artistique et quête le beau, tandis que le monde de la philosophie quête le vrai. Ce sont deux parts de ma vie. Bien sûr il y a des ponts.
AP. : Vous écrivez avec un style clair, même si vos ouvrages sont denses et exigeants. Beaucoup de philosophes, issus de certains courants de pensée, se plaisent à jargonner, comme si densité et technicité ne suffisaient pas. Comme s’il y avait une forme de snobisme à mépriser la langue claire et distincte. Il est particulièrement frappant de voir à quel point Descartes par exemple, est un grand écrivain. On peut aussi citer Bergson ou les philosophes spiritualistes (Lavelle, Marcel, Blondel,…). Leurs styles sont clairs et ne sombrent pas dans un chaos conceptuel permanent. D’où vous vient le style de votre écriture philosophique ?
CD. : Cela vient de ce que je suis d’abord une mère de famille, quelqu’un qui a toujours passé une grande partie de son temps à s’occuper des lessives, des courses, de la couture, des menus, et à éduquer des enfants puisque j’en ai eu six avec un mari tout à fait absent, et ces occupations sont simples, concrètes, directes et sans snobisme. On ne triche pas avec les enfants, on ne jargonne pas, on ne complique pas la vie. Mon travail philosophique, pour lequel j’ai eu beaucoup moins de temps que mes collègues, est un miroir de ma vie.
AP. : Quelle influence a eue sur vous celui qui fut votre directeur de thèse, Julien Freund ?
CD. : Une influence énorme. Ses livres et sa pensée ont été un fil rouge. L’époque était peu ouverte à ce genre de pensée. J’étais seule en préparant ma thèse pendant dix ans, dans un petit pays où pas une personne ne connaissait les auteurs sur lesquels je travaillais. Aussi Freund et moi nous nous écrivions beaucoup. Il m’a énormément appris.
- Chantal Delsol, Le Souci contemporain, Bruxelles, Complexe, 1996. Traduit en anglais, l’ouvrage a reçu le Prix Mousquetaire.
- Chantal Delsol, L’Age du renoncement, Paris, Le Cerf, 2011.
- Chantal Delsol, Les pierres d’angle. A quoi tenons-nous ?, Le Cerf, 2014.
- Pierre Manent, La Raison des nations, Gallimard, collection « L’esprit de la cité », 2006.
- Chantal Delsol, Populisme. Les demeurés de l’Histoire, éditions du Rocher, 2015








