[…], et il m’est apparu clairement que l’« organisation » relève du cœur inapparent, non pas certes de la technique, mais bien de ce à partir de quoi elle se déploie à l’aune de l’histoire de l’être.1
Maître de Conférences HDR à l’IAE de Metz, Baptiste Rappin est l’auteur de plusieurs ouvrages philosophiques sur le management, dont Au fondement du Management. Théologie de l’Organisation, Volume 1, Nice , Éditions Ovadia, 2014 ; Heidegger et la question du Management. Cybernétique, information et organisation, Nice, Éditions Ovadia, 2015. Et aussi d’un hommage à la pensée de Jean-François Mattéi : La rame à l’épaule. Essai sur la pensée cosmique de Jean-François Mattéi, Nice, Éditions Ovadia, 2016.
A : Heidegger et la Grèce
Actu-Philosophia : Votre livre commence par une méditation métaphysique sur les sources de la pensée grecque : quelle est votre filiation intellectuelle et pourquoi ce retour à (sur) la philosophie athénienne ?
Baptiste Rappin : Pourquoi ce retour à la philosophie grecque ? Parce que la philosophie, en son essence, est retour, et n’est rien d’autre que retour ! Que l’on songe à la réminiscence platonicienne qui pétrifie Ménon et qui est retour à la contemplation des Formes célestes ; que l’on prenne en vue l’épistrophe plotinienne, qui est retour à l’Un ; que l’on projette son regard vers l’éternel retour de Nietzsche qui est chemin vers l’origine ; ou que l’on observe le geste du Tournant qui amorce chez Heidegger le retour à l’Être, les philosophes authentiques ne font que répéter l’aventure d’Ulysse qui cherche à regagner son sol natal, les rivages d’Ithaque puis l’alcôve taillé à même l’olivier, cet axis mundi. Le jeu de l’exil et du retour me semble effectivement caractériser l’entreprise philosophique.
Ce retour à la philosophie grecque est tout d’abord nécessaire pour inscrire Heidegger dans une histoire, une généalogie et une filiation : celle des Grecs, de l’aurore grecque, des matins grecs. Que les adeptes de la pensée faible et débile, espèce grégaire aux nombreux rejetons, fassent de Heidegger le bélier de la déconstruction ne témoigne que de leur incompétence et de leur veulerie face à l’exigeante hauteur de la civilisation européenne. Car c’est bien de cela qu’il s’agit : de l’identité européenne fondée en grande partie sur la philosophie grecque et son héritage.
Mais cette présentation liminaire assume en outre une seconde fonction : celle de mettre aux prises la philosophie avec son double, avec son éternel reflet. De même qu’Ulysse découvre, quand il rentre au bercail, le bal des prétendants, de même les philosophes trouvent-ils inlassablement sur leur route la litanie des prétentieux qui, ignorants, déclarent savoir. Ce furent hier les sophistes, friands d’éristique et d’antilogies, qui parviennent à faire passer les choses grandes pour petites, et les petites pour grandes ; c’est aujourd’hui le management, entreprise technoscientifique de légitimation de la domestication postmoderne. Filons donc l’analogie pour arriver à l’objet même de l’ouvrage : se pourrait-il que le management soit à Heidegger ce que la sophistique fut aux philosophes grec ? Sophistes et managers voisineraient-ils au fond de la caverne parmi les ombres et les échos, n’hésitant pas, lorsqu’il leur arrive d’en croiser un, à mettre à mort un amoureux de la sagesse ? Et, de fil en aiguille, le management ne serait-il pas la tentation suicidaire d’une civilisation qui souhaite en finir avec elle-même et ne plus respirer les odeurs de l’Origine ?
AP : Vous évoquez « l’odeur de l’origine », en faisant référence à la Grèce. Peut-on penser la cité platonicienne comme un modèle de cité organisée ? Si non, qu’est-ce qui distingue la cité platonicienne décrite dans les Lois d’une société fondée sur l’organisation ?
BR : Répondre à votre question suppose de distinguer l’organisation en ses deux sens : courant et scientifique. Prenant appui sur le premier, on ne peut qu’affirmer le truisme selon lequel tout projet de cité recourt à une forme d’organisation, de la république platonicienne au phalanstère de Fourier, de la cité augustinienne à l’utopie de More. Mais disant cela, nous n’apprenons rien, ou au mieux établissons-nous au mieux une comparaison entre les formes d’organisation. Ce qu’il faut entendre par organisation, et le rapport au monde qui y préside, reste alors dans le silence.
François Jacob, dans La logique du vivant, fait observer que le concept d’organisation apparaît en biologie à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles et remplace la structure visible comme grille d’analyse du vivant : fini les taxinomies, place à l’étude du fonctionnement ! La lecture de la Philosophie zoologique de Lamarck, publiée en 1809, le confirme puisqu’on y observe l’omniprésence du terme pour désigner ce que Claude Bernard, dans l’Introduction à la médecine expérimentale de 1865 appellera « milieu intérieur », et Walter Cannon en 1932 dans Wisdom of the body « homéostasie » : à savoir la régulation des éléments internes au système qui permette à ce dernier de conserver son équilibre malgré les contraintes extérieures. Notons au passage l’extension de ce concept sous la forme de celui de « réseau » dans la philosophie de Saint Simon qui bâtit son système à partir de la distinction lamarckienne des corps bruts, caractérisés par la prédominance des solides, et des corps organisés, marqués par l’hégémonie des fluides. L’organisation n’est donc pas un concept vraiment neuf quand se tinrent les conférences Macy, à l’origine de la cybernétique, dans les années 1940.
Le tour de force de la cybernétique fut en réalité d’articuler à l’organisation une seconde notion scientifique, celle d’information. À suivre Jérôme Segal, auteur d’une monumentale Histoire de la notion scientifique d’information, Le Zéro et le Un, la scientificité du concept d’information se forgerait dans la première partie du XXe siècle au confluent de trois disciplines :
La physique : ce sont ici principalement les travaux sur la cinétique des gaz (Szilard propose une nouvelle interprétation du démon de Maxwell en 1925) et en mécanique quantique (John von Neumann) ;
La statistique : redéfinie par Fischer dans les années 1920 comme l’extraction d’information d’une masse de données ;
Les télécommunications : avec les travaux sur les méthodes de codage menés au sein de la Bell Telephone Company.
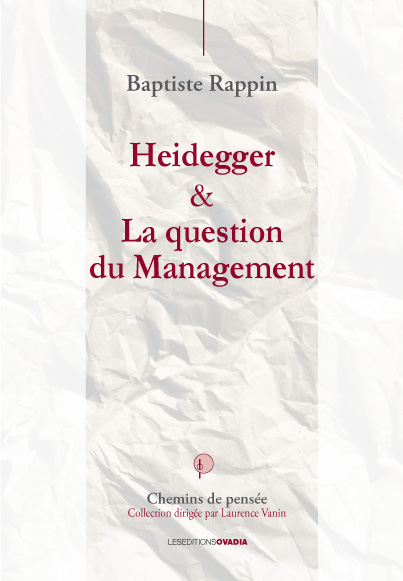
L’entropie est alors l’opérateur conceptuel qui réalise la liaison entre l’organisation et l’information. Écoutons Wiener en 1948 : « La notion de quantité d’information se rattache très naturellement à une notion classique en mécanique statistique : celle d’entropie. Tout comme la quantité d’information dans un système est la mesure de son degré d’organisation, l’entropie d’un système est la mesure de son degré de désorganisation ; l’un est simplement le négatif de l’autre ». En d’autres termes, l’organisation, parce qu’elle contient l’information adéquate, résiste à la tendance générale de l’univers, à savoir la désagrégation et l’homogénéisation. En d’autres termes, l’organisation est une exception tant statistique qu’ontologique. Rapporté au management, cela signifie que ce dernier se définit comme le « gouvernement de l’exception permanente », ainsi que nous l’avons écrit dans plusieurs articles. Le management est un ensemble de dispositifs de maintien de l’état d’exception organisationnel, d’où la centralité des thèmes de l’adaptation, de la flexibilité, de l’employabilité, du changement permanent, de l’amélioration continue, de l’apprentissage, du projet, etc. On comprend alors que le modèle de la souveraineté, fondé sur l’absolu et la stabilité de la Loi, soit périmé et totalement dépassé par la nécessité vitale de l’ajustement qui suppose une évaluation permanente des processus en cours.
Mais revenons à l’articulation des concepts scientifiques d’organisation et d’information : cela prit la forme de la boucle de rétroaction qui associe dans sa circularité, de façon négative ou positive, la finalité, l’action, l’évaluation et le contrôle, et enfin la correction née de l’analyse des écarts, dans d’éternelles et problématiques conversions d’information en énergie et d’énergie en information autorisées par le jeu de la modélisation fonctionnelle. Je nommerai cette boucle « archi-modèle » pour signifier qu’elle se trouve à l’origine de la plupart des modèles scientifiques contemporains, c’est-à-dire pour souligner son rôle de matrice.
Voilà donc ce qu’il faut entendre par « organisation » quand je dis que nous vivons aujourd’hui dans une « société d’organisations ». Et en ce sens, la cité platonicienne ne peut être approchée de l’organisation car cette dernière, précisément, se substitue au cosmos des Anciens lorsque la science moderne privilégiera l’hypothèse d’un univers infini et homogène. Prenons un simple exemple pour mieux nous faire comprendre : alors que l’éducation, dans le cadre des Lois, vise, à travers le jeu de l’analogie, à apprendre l’harmonie de l’âme, tout comme le politique vise l’accord des parties de la cité, elle devient apprentissage de l’adaptation dans une société d’organisations, c’est-à-dire aptitude à survivre dans un univers perpétuellement chaotique et en mouvement.
AP : Parlons alors de la relation entre les sophistes antiques et les managers contemporains que vous établissez en prélude de l’ouvrage. Si les deux démarches sont jumelles dans leur tentative de suppression du sens, pourquoi le management, en constituant un éternel retour de la sophistique, serait-il cette fois si dangereux pour la civilisation occidentale ? N’est-ce pas d’abord en amont, au cœur de la philosophie européenne, que le drame s’est joué avec la fin de la métaphysique ?
BR : Le management n’est pas plus dangereux, en son essence, que la sophistique : tous deux formes de la barbarie intérieure, cette vanitas que les Romains tenaient en horreur, ils mettent en péril la civilisation européenne car ils promeuvent des simulacres qui voudraient s’émanciper des Formes qui président pourtant à leur existence (le simulacre demeure, en dépit des incantations postmodernes, simulacre de quelque chose), ou même prendre leur place pour s’y substituer et imposer le règne anti-ontologique du sans-principe, l’anarchie en son sens étymologique. Sans tenue pour maintenir l’être dans sa consistance, le monde s’éparpille alors dans les fantasmes et les idoles qui peuplent les tableaux de bord, les référentiels de compétences et les procédures qualité. Il n’est alors guère surprenant que ce relâche du principe et cette vacance de la pensée forte introduisent l’hégémonie de la rhétorique, discours non plus orienté vers la Vérité, mais aimanté par l’efficacité. Cette performativité de la parole managériale s’enseigne ainsi dans les séminaires de prise de parole, de communication non verbale, d’animation de réunion, d’assertivité, de leadership, de management d’équipe, etc.
Votre question ne se limite toutefois pas à cette seule dimension car elle mentionne la « fin de la métaphysique », thème central de la pensée de Heidegger. Que doit-on entendre par cette expression ? Platon a tracé, dans le Parménide, les neufs voies que la métaphysique allait pouvoir emprunter : 2500 ans plus tard, force est de constater que l’ensemble des possibilités furent épuisées : si bien que notre époque, celle à laquelle Heidegger adjoint l’adjectif de « planétaire », possède cette insigne caractéristique d’être à la fois la fin d’une aventure de la pensée – fin de l’Histoire dans le triomphe non pas du capitalisme, mais de la Technique et du Management – et sa phase de récapitulation, ce que les théologiens nomment l’apocatastase. A qui échoit cette dernière mission ?
Précisément à la cybernétique, qui selon le philosophe de la Forêt Noire a remplacé la philosophie, et qui fournit une nouvelle modalité d’unification des sciences : une unité non plus fondationnelle, à l’image de l’arbre de Descartes, ni surplombante, à l’image de sa royauté (« la reine des sciences »), mais technique, et seulement technique. La cybernétique, comme l’a remarquablement montré Jean-Pierre Dupuy aux Origines des sciences cognitives, a infiltré l’ensemble des champs scientifiques à coups d’information, d’organisation, de rétroaction, de flux, de régulation, de modélisation fonctionnelle, etc. Le management n’a évidemment pas échappé à ce changement de paradigme.
AP : Heidegger expose pour la première fois les principaux concepts de la cybernétique dans sa conférence intitulée Langue de tradition et Langue technique. L’une des découvertes majeures de votre ouvrage est la définition qu’il propose alors de la cybernétique comme étant la théorie du management. Comment Heidegger assure-t-il ce passage du projet cybernétique d’unification des sciences par la technique au management comme « prise en main de la planification possible et de l’organisation du travail humain » ?
Baptiste Rappin : Il est vrai que Heidegger parle à cinq reprises, entre 1962 et 1967, de la cybernétique ; la première, comme vous le mentionnez à juste titre, se trouve dans cette conférence prononcée devant un public d’enseignants d’école professionnelle et qui prendra le titre de Langue de tradition et langue technique. Dans cette dernière, le philosophe définit la cybernétique comme la « technique de régulation et de guidage » qui se trouve au principe de la seconde révolution industrielle, celle de l’automation ; plus loin, il commente directement les écrits de Norbert Wiener, pour asseoir la thèse que l’information, caractérisée par l’univocité qui réduit la parole à un signe, est une menace pour la parole : c’est le monde comme tel qui risque de s’écrouler en s’écoulant dans les flux codés.
C’est deux ans plus tard, dans une conférence écrite pour le colloque de l’Unesco mais prononcée par Jean Beaufret, que Heidegger relie, de façon étonnante, cybernétique et travail. Il souligne tout d’abord que la cybernétique est le nouveau mode d’unité des sciences, car ces dernières se sont émancipées de la tutelle de la philosophie avant d’ajouter :
« Cette science correspond à la détermination de l’homme comme être dont l’essence est l’activité en milieu social. Elle est en effet la théorie qui a pour objet la prise en main de la planification possible et de l’organisation du travail humain »
et de conclure de la façon suivante :
« La cybernétique transforme le langage en moyen d’échange de messages, et avec lui, les arts en instruments eux-mêmes actionnés à des fins d’information ».
Ainsi donc, Heidegger définit la cybernétique comme la théorie de l’organisation du travail humain, c’est-à-dire du management, mais y rattache immédiatement la notion d’information : unifier le monde sous le seul registre technique a pour condition de possibilité la réduction de la parole en information, c’est-à-dire en signes univoques que l’on peut manipuler, échanger, inter-changer. La gestion des organisations s’appuie sur les mêmes ressorts, et s’effectue à l’appui des nombreux simulacres informationnels que sont les tableaux de bord, les référentiels compétences, les projets d’établissement, les grilles d’évaluation, les matrices stratégiques, les arbres de la décision, les plans d’amélioration continue, etc.
Ajoutons enfin que Heidegger eut ici une réelle intuition. Car nos propres travaux sur la généalogie du management contemporain montrent que la cybernétique constitue la matrice du management stratégique, du contrôle de gestion, de la gestion des ressources humaines, de la logistique, du management des connaissances…autant de disciplines aujourd’hui enseignées et reconnues comme étant fondamentales dans les business schools. Pourquoi ? Car elles viennent toutes s’adosser à la conceptualisation cybernétique de l’organisation comme boucle de rétroaction (en anglais : feedback) à l’origine des phénomènes d’apprentissage par la bonne maîtrise de la circulation de l’information. La cybernétique tourne en rond, ainsi que l’avait bien vu Heidegger dans La provenance de l’art et la destination de la pensée :
« […] la circularité de la régulation est le caractère fondamental du monde que projette la cybernétique ». Nous vivons désormais dans des flux permanents de régulation, l’ajustement et la réduction des écarts sont devenus notre lot quotidien.
AP : N’est-il pas paradoxal que Heidegger soit à la fois votre fil directeur pour penser une critique de ce que vous appelez le « mouvement panorganisationnel »2 et en même temps un homme qui fut politiquement proche du national-socialisme dont vous dites par ailleurs qu’il était lui-même fondé sur l’efficacité de l’organisation ?
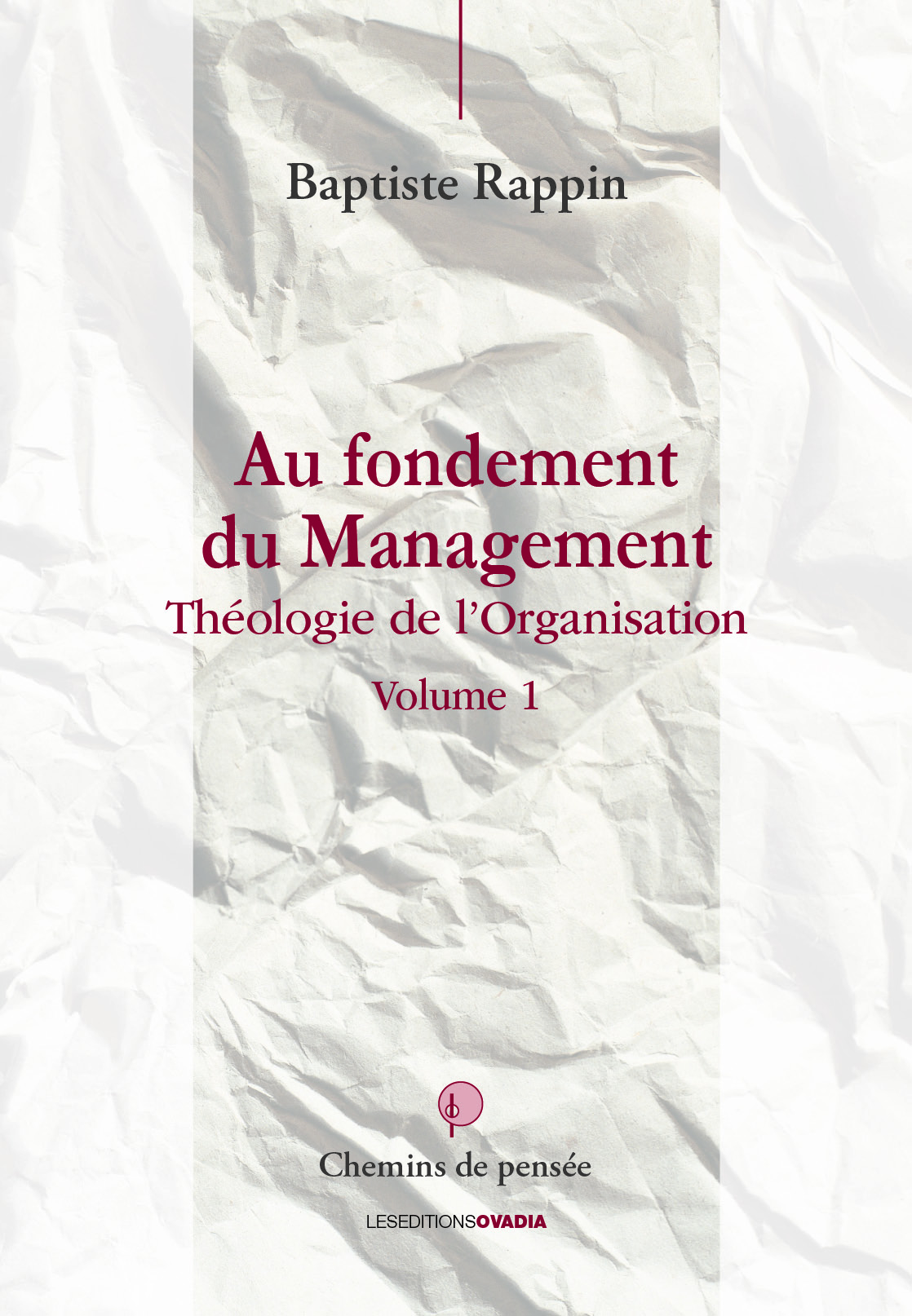
BR : Resituons donc votre question par rapport au contexte, celui du régime national-socialiste qui place les concepts d’organisme et d’organisation au cœur de son vitalisme raciste. Ainsi Klemperer souligne-t-il la distinction entre « système » et « organisation » : « Ils n’ont pas de « système », ils ont une « organisation », ils ne systématisent pas avec l’entendement, ils cherchent à entrer dans le secret de l’organique »3. N’entendons pas ici par système ce qui deviendra le synonyme d’organisation, un ensemble d’éléments en interaction orientés vers une finalité, mais le sommet de la philosophie allemande, l’idéalisme, au sein duquel les Leibniz, Kant, Fichte, Schelling et Hegel portèrent à son faîte la construction intellectuelle systématique. L’organisation ne renvoie ainsi pas à la théorie, mais au corps enraciné, à ses pulsions, à ses instincts, à son sang. L’auteur poursuit, deux pages plus loin : « Toujours est-il que, dans la LTI [la langue du IIIe Reich], « organisation » est resté un mot respectable et respecté, et qu’il a même connu une promotion à laquelle, en dehors de quelques emplois spécialisés, sporadiques et isolés, il n’avait pas eu accès avant 1933 ». Et c’est ici que le holisme biologique, qui conçoit la nation à l’image d’un corps qui comprend et articule cellules, organes et membres, et rejette les substances étrangères ou nocives, converge avec la dimension bureaucratique de l’organisation : « La volonté de totalité entraînait une prolifération d’organisations jusqu’en bas de l’échelle, au niveau des Pimpf [magazines nazis pour la jeunesse], non, jusqu’au niveau des chats […] ».
C’est bien dans ce contexte qu’il faut replacer les mentions de l’organisation dans la conférence qu’Heidegger prononça le 26 novembre 1937 et qui servit d’entame à un cycle de travaux menés avec un cercle restreint de professeurs de la faculté des sciences et de médecine de Fribourg. Le philosophe y parle tout d’abord de Robert Ley, « le directeur de l’Organisation pour le Reich »4 puis du « parti, en tant qu’organisation » 5.
Et dans l’introduction du cours du semestre d’hiver 1934-1935 portant sur les hymnes de Hölderlin, Heidegger pouvait déjà écrire : « Le grossier enrégimentement de la masse en surnombre dans ce qu’on nomme « organisation » n’est qu’une mesure de fortune, l’essence lui échappe »6. Et tout cela sans compter la prolifération du terme dans les Beiträge, dans lesquels le penseur évoque notamment « la violence de l’organisation », ou encore « l’exploitation de la nature abandonnée au calcul et à l’organisation », et rattache très clairement le terme non plus seulement à un mélange de bureaucratie weberienne et de vitalisme organiciste, mais à ce qui deviendra plus tard le Gestell. En ce sens, Heidegger considère bien le nazisme comme la pointe avancée de la métaphysique moderne fondée sur la calculabilité de l’étant, et sa pensée se révèle effectivement féconde pour appréhender ce que j’ai nommé le « mouvement panorganisationnel ».
La suite de l’entretien est disponible ici.
- Lettre adressée par Martin Heidegger à Hannah Arendt le 15 février 1950 in Hannah Arendt et Martin Heidegger, Lettres et autres documents. 1925-1975, Paris, Éditions Gallimard, « Bibliothèque de philosophie », 2001, p. 83.
- cf. Au fondement du management, op. cit., p. 31
- LTI, La langue du IIIe Reich, p. 140
- « La menace qui pèse sur la science », dans Écrits Politiques, 1933-1966, traduction par François Fédier, Paris, Gallimard, « nrf », « Bibliothèque de Philosophie », 1995, p. 172
- Ibid., p. 182.
- Les Hymnes de Hölderlin : La Germanie et le Rhin, traduit de l’allemand par François Fédier et Julien Hervier, Paris, Éditions Gallimard, « nrf », « Bibliothèque de Philosophie », 1988, p. 19.








