Alain de Libera vient d’entamer une vaste entreprise d’Archéologie du sujet qui devrait compter à terme quatre ou cinq volumes. Les deux premiers volumes, intitulés Naissance du sujet (2007) et La Quête de l’identité (2008), ont déjà paru chez Vrin. Il revient ici sur les raisons qui l’ont poussé à se lancer dans ce projet, sur la méthode archéologique et sur le renouvellement que son travail entend apporter à la question du sujet en philosophie.
Propos recueillis par Henri de Monvallier
Actu Philosophia : La première question que je souhaiterais te poser tourne autour de cette notion d’archéologie. S’agit-il là d’un concept nouveau et d’une méthode nouvelle pour toi ? Je me souviens de l’un de tes ouvrages précédents, Raison et foi (Seuil, 2003), que tu sous-intitulais déjà Archéologie d’une crise d’Albert le Grand à Jean-Paul II. Pourrais-tu nous dire comment ce concept et cette méthode se sont imposés à toi ?
Alain de Libera : La méthode de l’archéologie s’est imposée à moi du fait de la nature particulière des premiers matériaux sur lesquels j’ai travaillé : la logique médiévale. Les trois quarts du corpus des textes logiques sont, pour la période qui m’intéresse, la fin du XIIe et le XIIIe siècle, anonymes. Il s’agit ce qu’on appelle des sophismata, c’est-à-dire des puzzles logiques illustrant une difficulté particulière, par exemple dans le domaine de la sémantique ou de la syntaxe propositionnelles, le problème de la « référence vide » : comment une proposition qui ne porte sur rien peut-elle être vraie ? Par exemple : Caesar est homo, « César est un homme » (qui, pour certains, est vraie, bien que César soit mort, pour d’autres non) ou Omnis Chimaera est Chimaera, « Toute Chimère est une Chimère » (qui, pour certains, est vraie, bien qu’il n’existe aucune Chimère, pour d’autres non), etc. Objet de discussions régulières à l’université, les sophismata (qu’il ne faut pas confondre avec le français « sophisme ») ont été analysés dans toutes sortes d’ouvrages théoriques (Regulae solvendi sophismata, Distinctiones sophismatum, Abstractiones) : une grande partie des innovations de la logique médiévale est liée à cette pratique du sophisma. Quand j’ai été confronté, au début de ma carrière d’historien de la logique médiévale, à cet ensemble de textes sans auteur, sans date (autre que « le » XIIIe siècle) et sans lieu (autre que l’université de Paris), la première chose que j’ai eu à faire a donc été d’introduire de l’ordre et de l’intelligibilité, autrement dit : une chronologie relative et un essai de filiation, dans des textes qui, bien que sans auteurs assignables, répondaient à la fois les uns aux autres et les uns des autres. D’où cette idée d’archéologie.
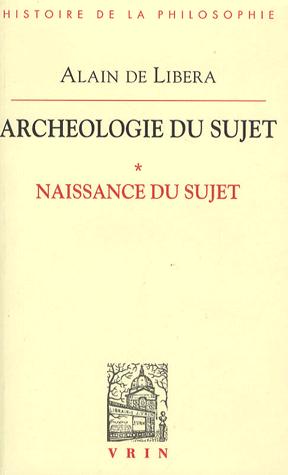
AP : Entends-tu le concept d’archéologie en son sens foucaldien ? Comment te l’es-tu approprié ou réapproprié ?
AL : Je dirai que je l’ai appliqué à un discours où s’entrecroisaient sous d’autres intitulés diverses disciplines alors en voie de constitution : sémantique philosophique, philosophie du langage, logique de la discussion, théorie des actes de langage (performatifs), et j’en passe. La question qui se pose quand on est historien (de la logique ou d’autre chose) est : « De quoi fais-je l’histoire ? » Dans mon cas, il était évident que je n’allais pas faire l’histoire de doctrines ou d’auteurs inconnus (en dehors de M. Quidam, le plus grand logicien du Moyen Âge, la guest star permanente annoncée par la phrase quidam dicunt, « certains disent que »), mais seulement de thèses et d’arguments pris en réseau : la seule réalité encore accessible. Il s’agissait donc pour moi de construire une intrigue dont les protagonistes seraient non des personnes, mais des concepts, des problèmes, des règles et des arguments (je reviendrai sur cette idée d’intrigue que j’emprunte à Paul Veyne). Pour ce faire, j’ai moins puisé dans les méthodes de l’archéologie proprement dite que dans celles de la philologie classique et de l’édition critique. Pour éditer un texte ancien ou médiéval, il faut reconstituer sa tradition manuscrite, établir un stemma – une sorte d’arbre généalogique – à partir des différences (les erreurs séparatives) et des ressemblances (les erreurs conjonctives) existant entre les divers témoins d’un « même » texte. Une fois ce classement réalisé, on peut normalement arbitrer entre les leçons divergentes et proposer une version maximalement proche de l’original. La mise en série et le classement des sophismata logiques par la mise au jour des relations de famille existant entre distinctions, règles, principes ou arguments ont été la première étape dans la constitution et la mise en pratique d’une méthode archéologique, fondée sur l’application aux concepts des techniques de la génétique textuelle 1) Genèse et Structure de l’Anthropologie’ de Kant. Un clin d’œil à Hyppolite, qui fut son maître probablement…
AL : Bien sûr : cette idée a essaimé à partir de Guéroult et Hyppolite, mais Foucault y a mis sa propre empreinte. En fait, l’historien de la philosophie est confronté à l’apparition d’objets successifs (concepts, thèses, arguments, positions, etc.) qui vont, pour lui, s’organiser d’une certaine façon. Tout énoncé est la résultante d’autres énoncés renvoyant à une profondeur historique stratifiée. Il en va de même des concepts et des termes, des réseaux de concepts et de termes. Ainsi, pour prendre l’exemple de ce qui occupe mes recherches actuellement, enquêter sur le concept de « sujet », de subiectum, renvoie à celui de « substance » puis, de fil en aiguille, à celui d’« hypostase » et de suppositum. On se rend ainsi progressivement compte qu’il y a un lien à travailler entre la problématique philosophique du sujet et la problématique théologique de l’hypostase, qu’il faut suivre les variations et les écarts dans le domaine du concept qu’induisent et masquent à la fois les changements de langue, les traductions (le latin suppositum qui traduit le grec hupostasis est et n’est pas synonyme de subiectum), les allers et retours entre disciplines. Pour mener à bien de telles recherches, je dirai, cependant, qu’on a besoin de deux outils archéo¬logiques : d’une part, des structures, on l’a vu ; mais, d’autre part, également, des schèmes théoriques : il faut voir ce qui se cherchait dans les structures que l’on a identifiées. Comme je viens de le dire, l’un des résultats de mon travail actuel est qu’avancer dans l’intelligibilité du sujet en philosophie, c’est (en partie) faire l’histoire de l’hypostase en théologie. J’ai depuis longtemps renoncé au fait que quelque chose (idée, concept, problème) « viendrait de » quelque chose d’autre ou d’antérieur : c’est là une vision, me semble-t-il, simpliste. Je pense plutôt qu’une même structure de problèmes et de questionnements (une même épistémè, au sens, pour le coup, foucaldien du terme) subsiste en se déformant petit à petit, certaines places étant investies par de nouveaux acteurs, d’autres se mettant à fonctionner ensemble, alors que ce n’était pas le cas auparavant, etc. Ces schèmes généraux constituent un horizon de questionnement à partir duquel la pensée vient à la rencontre d’un penseur à une époque donnée : c’est assez proche de ce que Bourdieu appelait un « champ ». J’ai d’ailleurs gardé du grand ouvrage théorique de Foucault, L’Archéologie du savoir (1969), la notion de « champ de présence » qui me semblait un outil conceptuel particulièrement intéressant et productif. Le « champ de présence » tel que le définit Foucault est la forme de coexistence constituée de « tous les énoncés déjà formulés ailleurs et qui sont repris dans un discours à titre de vérité admise, de description exacte ou de présupposé nécessaire », mais aussi de « ceux qui sont critiqués, discutés et jugés » et de « ceux qui sont rejetés ou exclus ». Cette forme, c’est la matière de l’histoire anonymisée. Je ne travaille pas sur « le » sujet, mais d’abord sur des réseaux de questions, par exemple le quadrangle : Qui pense ? Quel est le sujet de la pensée ? Qui sommes-nous ? Qu’est-ce que l’homme ? Ce « schème théorique » ne s’est pas mis en place de lui-même ni d’emblée. La question du sujet de la pensée a changé plusieurs fois de sens – comme la notion (les notions) désignée(s) par le terme « sujet ». La question Qui pense ? est datable : c’est celle que leurs adversaires, Thomas d’Aquin en l’occurrence, dans les années 1270, ont posée aux averroïstes, censés répondre (à leurs risques et périls) que… ce n’est pas l’homme qui pense, mais l’intellect, ou que ce n’est pas « moi » qui pense, mais l’agrégat constitué par mon corps (objet de l’intellect) et l’intellect séparé (sujet agent de la pensée). Voilà le type de structures que j’étudie et les énoncés (souvent déroutants) qu’elles articulent.
AP : Quelle distinction y a-t-il lieu d’établir, selon toi, entre archéologie et généalogie ? Peut-on dire que l’archéologie est une archéologie des structures (comme nous le disions auparavant) alors que la généalogie est (depuis Nietzsche) une généalogie des valeurs ?
AL : Oui, en gros, je pourrais reprendre cette distinction à mon compte, même si pour le moment je ne me suis guère occupé des « valeurs ». J’ajouterai plus volontiers, pour compléter ce que tu viens de dire, que l’archéologie articule l’étude des structures à une forme d’ensemble de type narratif qui induit un récit dans la longue durée, au sens de Fernand Braudel. L’une de mes ambitions avec cette méthode archéologique (et en particulier avec mon Archéologie du sujet) est d’introduire le long cours en histoire de la philosophie. Il s’agit donc de dégager des structures pour les narrativiser, d’où cette notion d’intrigue que je reprends à Paul Veyne. Comme tout autre historien, l’historien de la philosophie « raconte des intrigues », qui sont « autant d’itinéraires qu’il trace » à travers un champ événementiel objectif « divisible à l’infini » : il ne peut « décrire la totalité de ce champ, car un itinéraire doit choisir et ne peut passer partout » ; aucun des itinéraires qu’il emprunte « n’est le vrai », aucun « n’est l’Histoire ». Le champ événementiel de la philosophie « ne comprend pas des sites qu’on irait visiter et qui s’appelleraient événements » : « un événement n’est pas un être, mais un croisement d’itinéraires possibles ». Voilà ce que dit Veyne. J’essaie, sur ses pas, de croiser le maximum d’itinéraires. Dans le cas du sujet, intriguer, c’est suivre, par exemple, les avatars de l’hypostase ou de la « dénomination extrinsèque ». Cette dernière notion est difficile à saisir, mais elle est centrale. On la retrouve partout : au Moyen Âge, dans la Seconde Scolastique, et jusque dans les polémiques sur la théorie lockéenne de l’identité personnelle ou les théories du philosophe écossais Thomas Reid (1710-1796) sur la perception. La denominatio extrinseca, l’external denomination, est ce qui permet d’attribuer de l’extérieur à une entité une action dont elle n’est pas l’agent ou une propriété dont elle n’est pas le sujet : par exemple la pensée, pour les averroïstes. Reid dit dans le même sens qu’en étant perçu un objet n’agit pas sur l’esprit, qu’être perçu n’est qu’une dénomination extrinsèque : « To be perceived is what logicians call an external denomination which implies neither action nor quality in the object perceived. » En somme, à quelques siècles de distance, sujet (pensant) et objet (perçu) partagent là le même destin : ce qui leur est attribué n’est pas de leur fait. L’archéologie permet de redonner vie à ce genre de concepts devenus pour nous inertes en réactivant le réseau dans lequel ils sont, à un moment du temps, venus s’inscrire et s’insérer. Trop souvent, en histoire de la philosophie, où est censée régner la Problemgeschichte, il n’y a pas vraiment d’histoire des problèmes, dans la mesure ou ce que les historiens de la philosophie appellent « histoire des problèmes » coïncide plutôt, me semble-t-il, avec l’histoire des réponses apportées à un archiproblème supposé « permanent ». Or l’une de mes convictions est qu’il n’y a pas de problème éternel ou invariant et que chaque problème peut (et doit) faire l’objet d’une genèse. C’est ce que je disais tout à l’heure en invoquant chez Guéroult le croisement de l’évolution et de la structure. Mais il y a plus précis. En plus de Guéroult, de Foucault et de Veyne, il me faut citer un quatrième auteur (moins connu, sans doute, du public français) qui a beaucoup compté pour moi dans la conception et la mise en œuvre de ma méthodologie, je veux parler de Robin G. Collingwood (1889-1943), Waynflete Professor of Metaphysical Philosophy à Oxford de 1936 à 1941 : il fut le prédécesseur de Ryle et de Strawson à ce poste. J’ai été marqué par son autobiographie que je cite notamment dans le tome I de mon Archéologie du sujet [R.G. Collingwood, An Autobiography, Oxford University Press, 1970]. Collingwood a développé le concept de complexe constitué de questions et de réponses. L’une de ses convictions fondamentales, avec laquelle je me trouve en parfait accord, est qu’il n’y a pas d’archiproblème 2. C’est-à-dire qu’il n’y a pas, par exemple, un unique archiproblème de « l’âme » qui aurait été traité et résolu de manière différente par Platon, Aristote, Thomas ou Descartes. Cette vision de la philosophie comme réponse à de « grandes questions » que les hommes se seraient posées « de tout temps » est aussi naïve qu’improductive philosophiquement : elle dominait l’enseignement de la philosophie en classe terminale quand j’étais jeune et continue de fonctionner sur ce mode dans la philosophie journalistique. Pour y échapper, il faut entrer dans les « complexes questions-réponses » de nos prédécesseurs : on verra alors que rien ne reste ni ne change du tout au tout. Plus simplement, pendant certaines périodes que l’enquête permet de déterminer, certains complexes ont des parties communes dont il faut étudier à la fois la distribution et la récurrence. L’archéologie est une méthode holiste visant à articuler et à faire travailler ensemble continuité et discontinuité.
AP : C’est le problème des invariants. Qu’est-ce qui change ? Et qu’est-ce qui reste ? Or, le problème semble consister en ceci que rien ne change totalement, mais que rien ne reste totalement non plus.
AL : En fait, tout dépend de la durée de l’intrigue. Sur une période courte, les complexes questions-réponses ont, comme je le disais, des parties communes. Ensuite, au fur et à mesure que le temps passe et que la période étudiée gagne en ampleur, il y en a de moins en moins. On peut donc avoir l’impression que le complexe B où l’on est arrivé n’a rien à voir avec le complexe A d’où l’on est parti. Seulement, on se rend compte que, sans les déformations successives subies par le complexe A, on ne serait jamais arrivé au complexe B. Si l’on peut retrouver quatre siècles plus tard les questions d’un Averroès ou d’un Thomas d’Aquin sur l’homme comme sujet de ses pensées dans la philosophie anglaise classique (Hobbes et Locke), c’est parce que ces questions sont demeurées groupées et prises dans un dispositif : une question isolée ne demeure jamais, elle ne peut pas s’inscrire seule dans la longue durée de manière pérenne. Les puzzles suscités par la théorie lockéenne de l’identité personnelle, notamment l’hypothèse de deux personnes habitant un même corps (identité synchronique) ou d’une même personne habitant deux corps différents (identité diachronique) présentent la même structure argumentative que les questions médiévales sur le baptême des siamois. L’archéologie du sujet fouille une archive où, sur la longue durée, Martin Scribler, le roman écrit à quatre mains (au moins), par Arbuthnot, Pope et Swift contre Locke, coexiste avec les quodlibets de Jean Peckham ou d’Henri de Gand rédigés contre Thomas d’Aquin et Averroès. Un des plaisirs de l’intrigue sur la longue durée est de construire l’espace dans lequel les questions sur les « jumelles monstrueuses de Bohême » d’une gazette londonienne du XVIIIe siècle comme le British Apollo (« Whether each of the twins […] hath a distinct soul, or whether one informs them both ? », « Could a man marry the twins and not be guilty of polygamy ? », etc.) rencontrent celles des théologiens médiévaux (« Faut-il baptiser une fois ou deux fois un “monstre à deux têtes” ? » « Sont-ils – est-il – deux personnes ou une seule personne ? » « Un ou deux sujets ? », etc.) 3.
AP : Venons-en justement, après ces considérations d’ordre méthodologique, à ton sujet, c’est-à-dire au sujet. L’idée directrice de ton Archéologie du sujet est que le sujet n’est pas une invention de la modernité qui serait apparue, pour ainsi dire, miraculeusement et tombée du ciel avec Descartes. Tu dis, au contraire, que, pour émerger, cette notion de sujet a eu besoin de tout un travail conceptuel antérieur qui s’est effectué pendant les périodes antiques et médiévales, et que c’est ce travail qui a rendu possible la « naissance du sujet » (pour reprendre le titre du premier tome). Qu’en est-il de cette notion de sujet dans l’Antiquité et au Moyen Âge ?
AL : Effectivement, l’émergence de la notion de sujet passe par toute une série de figures et de dispositifs. Pour simplifier, l’Antiquité a le concept d’hupokeimenon (c’est-à-dire de « substance-sujet » au sens d’Aristote, de « présent-subsistant », Vorhandene, au sens de Heidegger), et le Moyen Âge a celui de subiectum (qui traduit l’hupokeimenon grec). Dans les deux cas, le « sujet » est lié à la passivité de ce qui supporte des accidents, des propriétés ou des qualités : le sujet est entendu comme simple substrat ou « porteur ». L’invention du sujet au sens moderne a moins à voir, comme on le croit souvent, avec l’invention de la conscience qui me permet de me penser comme sujet dans l’acte réflexif du cogito que, plus radicalement, avec la rencontre préalable, a priori tout à fait improbable, du « sujet » (en son sens antique et médiéval) avec un concept qui lui est radicalement opposé, celui d’agent. De support passif de propriétés, le sujet devient agent, c’est-à dire capacité en acte de réfléchir (pensée) et d’agir (volonté) : deux notions que tout oppose – ou plutôt les énoncés qui les articulent – produisent le sujet moderne. Puisque tu évoquais Descartes, qui est, en effet, la figure cardinale de la modernité que l’on associe à la naissance du sujet moderne, on peut ajouter un second paradoxe pour bousculer les schémas historiographiques tout faits : non seulement la naissance du sujet est issue d’une rencontre apparemment aussi fortuite que contradictoire entre deux notions opposées (la substance et l’agent), mais il faut ajouter que le sujet fait son entrée chez Descartes pour ainsi dire par effraction, sans que ce dernier ait jamais souhaité l’introduire ou l’intégrer d’une quelconque manière. C’est en effet dans ses polémiques avec Hobbes et Regius que Descartes s’est vu forcé d’introduire quelque chose comme le « sujet ». Pour ces deux penseurs, la pensée était un attribut, un « mode », du corps – thèse que rejetait naturellement Descartes. Le héros du sujet moderne s’est donc vu imposer un terme qu’il ne voulait pas, car la notion de sujet était jusque-là liée au corps et à la passivité. Pourtant, et c’est là ce qui m’intéresse, à l’époque de Descartes, on peut dire qu’en un sens le sujet était déjà tacitement devenu agent depuis bien longtemps grâce au concept théologique d’hypostase (personne, au sens où la Trinité est l’unité Tri-unité de trois hypostases ou personnes : Père, Fils et Saint-Esprit). Et, qui plus est, la théologie trinitaire était relayée sur ce point par la christologie. La figure du Christ, Dieu incarné, vrai homme et vrai Dieu, posait un problème depuis les Pères grecs : avait-il une volonté humaine et une volonté divine ? Deux volontés ou une seule ? Et, s’il avait deux volontés, cela ne revenait-il pas à dire qu’il était deux personnes à la fois ? La méthode archéologique que je propose nous montre clairement que le problème du sujet chez Descartes est un problème d’allure ou de format christologique : l’homme est-il un corps (res extensa), un esprit (res cogitans), l’union d’un corps et d’un esprit, ou bien une troisième substance, ou une personne ou ce que Descartes appelle volens nolens « un sujet composé » ? Cet arrière-plan archéologique permet de donner un autre éclairage aux discussions de Descartes avec Hobbes ou Regius, et de comprendre comment le même complexe constitué de questions et de réponses (pour reprendre le concept forgé par Collingwood) subsiste dans des contextes intellectuels différents où les préoccupations ne semblent pas identiques et semblent même fort éloignées. Le problème cartésien de l’union de l’esprit et du corps (l’actuel Mind-body problem) n’est pas celui de l’union des deux natures dans le Christ ou celui de l’unicité ou de la dualité du vouloir chez le Christ. Pourtant, les deux communiquent structurellement, conceptuellement (en plein Âge classique, Descartes fait valoir à Regius que l’homme est un ens per se et non un ens per accidens) et argumentativement (comme le montrent la Querelle d’Utrecht, la polémique de Descartes avec Voetius et le schéma antiaverroïste que ce dernier ou ses porte-plumes reprennent à mots couverts contre Descartes, sur quoi je reviendrai dans les prochains volumes de l’Archéologie du sujet). Pour simplifier, je dirai que, à l’époque de Descartes, le quadrangle Qui pense ? Quel est le sujet de la pensée ? Qui sommes-nous ? Qu’est-ce que l’homme ? est devenu : Qui pense, sent et ressent ? Quel est le sujet de la pensée, de la sensation et du sentiment ? Que sommes-nous ? L’homme est-il un ens (unum) per se ? Le problème de l’unité de l’homme s’est substitué à celui du sujet de la pensée, mais on est passé de l’un à l’autre par les parties communes aux polémiques averroïstes et aux querelles cartésiennes : l’homme est-il un être par accident ou un être par soi ? L’homme est-il un agrégat ? C’est de ce passage qu’il faut faire l’histoire pour penser les conditions de l’émergence du sujet.
AP : De manière générale, quels outils conceptuels proposes-tu pour nous permettre de nous orienter dans cette « forêt obscure » de l’histoire du sujet dans la longue durée ?
AL : J’en propose essentiellement trois.
1° La distinction entre subjectité et subjectivité, qui me semble décisive et que j’emprunte à Heidegger. La subjectité désigne le fait d’être le support d’accidents ou d’attributs : cela correspond, en gros, à l’hupokeimenon grec. La subjectivité, elle, suppose la présence d’un ego. Pour que le sujet devienne agent, il faut, comme le dit Heidegger, que subiectum et ego se rencontrent, c’est-à-dire que subjectité et égoïté (Ichheit) se rencontrent : « la « subjectivité » de la métaphysique moderne est un « mode de la subjectité ». Pour Heidegger, le passage de la « subjectité » à la « subjectivité », qui signe l’entrée dans la modernité, se laisse penser à partir de Descartes comme le moment où l’ego, devenu le « sujet insigne », acquiert le statut d’étant « le plus véritable ». C’est ce que je discute dans l’Archéologie du sujet.
2° L’attributivisme : c’est-à-dire la thèse selon laquelle l’âme ou l’esprit est un attribut du corps, une « propriété » du corps, et non une substance de plein exercice. C’est ce que D. Armstrong [A Materialist Theory of the Mind, Routledge, 1993] appelle « the Attribute-theory of the mind », une théorie que J. Barnes attribue lui-même à Aristote.
3° L’attributivisme*, qui à l’instar de la « différance » de Derrida peut se lire mais ne peut pas s’entendre, ce qui n’est pas très pratique dans le cadre de cours ou de conférences où je me vois obligé de parler d’« attributivisme étoile » ! J’entends par attributivisme* toute doctrine qui fait des actes et des états mentaux des propriétés attribués à un sujet défini comme ego. Cette position, qui fonde les idées lockéennes du sujet comme sujet d’attribution et d’(auto-)imputation d’actes (et jusqu’à l’idée de la personne comme « terme de barreau », forensic term), est donc très différente de l’attributivisme en son sens classique tel que je l’évoquais juste auparavant. Ce schème selon lequel je suis le sujet et l’auteur, le sujet-agent de mes pensées, apparaît au Moyen Âge, chez Thomas d’Aquin, mais aussi chez Pierre de Jean Olieu (dit Olivi, un franciscain de la fin du XIIIe siècle), dans l’Impugnatio quorundam articulorum, qui soutient que « nos actes ne sont perçus par nous que comme des prédicats ou des attributs (actus nostri non apprehenduntur a nobis nisi tamquam praedicata vel attributa) » et que la certitude d’en être le sujet, la certitudo de supposito, est au cœur de toute « appréhension de nos actes » (puisque « je ne puis appréhender mes actes, tel l’acte de voir ou celui de parler, qu’en appréhendant que c’est moi qui vois, entends ou cogite »). Il semble s’effacer ensuite pour réapparaître seulement avec Descartes. En fait, il se survit sous diverses formes, dont celle du principe que j’appelle « principe subjectif de l’action » : actiones sunt suppositorum, « les actions appartiennent aux suppôts », dont j’ai entrepris de faire l’archéologie, du Moyen Âge à Leibniz. Une partie essentielle du travail archéologique est l’archéologie des principes admis par les protagonistes d’un débat quel qu’il soit. Ce sont les principes qui définissent le mieux un « a priori historique », et l’on est étonné de voir à quel point certains corps de principes demeurent à l’œuvre, inaperçus, d’un âge du savoir à un autre.
AP : À l’inverse, il y a aussi toute une tradition « anti-sujet ». Cette tradition peut-elle également faire l’objet d’une archéologie dans la longue durée ?
AL : Bien sûr. Il y a, dans l’histoire du sujet, toute une tradition du Es denkt (ça pense) qui part, en gros, de Lichtenberg et va jusqu’à Wittgenstein et Strawson (qui l’attaque) en passant par Schelling et Nietzsche (que l’on songe notamment au paragraphe 17 de Par-delà bien et mal dénonçant la « superstition des logiciens » et la « routine grammaticale » qui nous font dire : « Penser est une action, toute action suppose un sujet qui l’accomplit, par conséquent il y a une chose qui pense », un « sujet je qui est la condition du prédicat pense ») – sans parler de Freud ou de Lacan ! Encore une fois, il s’agit de comprendre comment tout cela s’inscrit dans la longue durée. Et il est étonnant de voir que nous retombons sur Averroès dont nous parlions avant. En effet, tous ces penseurs du Es denkt nous disent en un sens que je ne suis pas le sujet de mes pensées. Certes, ils ne disent pas que c’est un intellect unique et séparé, commun à tous les hommes qui pense en moi quand je pense. Mais il y a une continuité entre l’averroïsme et la tradition du Es denkt in mir, que j’étudie en détail d’un volume à l’autre : la subjectité, précisément. Car, comme le montre bien Nietzsche, le Es anonyme reste conçu comme un sujet d’attribution (comme en témoigne, d’ailleurs, l’équation posée par Kant lorsqu’il définit le « sujet » de la psychologie rationnelle : « Par ce “Je”, ou cet “Il”, ou ce “Cela” (la chose) qui pense [dieses Ich, oder Er, oder Es (das Ding), welches denkt], rien d’autre n’est représenté qu’un sujet transcendantal des pensées = x, que nous connaissons seulement par les pensées qui sont ses prédicats »). L’attributivisme* est une tendance lourde de l’histoire de la philosophie.

AP : En travaillant dans la longue durée, on peut, en effet, être amené à faire des liens surprenants. Peux-tu nous rappeler par exemple, en deux mots, ton développement sur Augustin et Franz Brentano (1838-1917) dans Naissance du sujet ?
AL : C’est relativement simple. Augustin formule et rejette pour la première fois, dans le De Trinitate, à propos de Dieu, puis de l’âme, le modèle de ce que Heidegger appelle la subjectité. Pour lui, Dieu ne peut pas être sujet de ses perfections (bonté, justice, puissance, etc.) dans la mesure où un sujet, un hupokeimenon au sens aristotélicien du terme, est toujours sujet d’accidents. Or les perfections de Dieu ne peuvent naturellement en aucune façon se réduire à des accidents. En outre, un sujet d’accidents ne peut se dépasser lui-même, car un accident ne peut dépasser (excéder) son sujet d’inhérence – accidens non excedit subiectum suum : les qualités ne « migrent » pas d’un sujet à un autre. L’âme étant « image et vestige » de la Trinité, ce qui vaut pour Dieu vaut pour l’âme : les actes fondamentaux de l’âme, mémoire, intelligence, volonté, ne pourraient se pénétrer les uns les autres, être présents les uns dans les autres, s’ils étaient de simples accidents d’un sujet, de quelque nom qu’on l’appelle : anima ou ego. Je ne pourrais pas non plus à la fois connaître et aimer une chose et m’en souvenir. Or, de même que les Personnes de la Trinité sont consubstantielles les unes aux autres, coprésentes toutes en chacune et chacune en toutes, les actes ou états mentaux sont mutuellement inclus les uns dans les autres : je ne puis connaître sans aimer et me souvenir ; me souvenir sans connaître et aimer ; aimer sans connaître et me souvenir. À l’inverse, et Aristote le dit lui-même, il n’y aucun rapport d’inclusion mutuelle dans le fait d’être architecte et d’être blanc : ce n’est pas en tant que je suis blanc que je suis architecte, ni en tant qu’architecte que je suis blanc, et ce n’est pas non plus en tant que blanc que je bâtis, ni en tant qu’architecte que je blanchis. Augustin remplace donc, et pour Dieu et pour l’âme, la subjectité par cette structure d’immanence mutuelle qu’on a appelée bien après lui périchorèse (le terme apparaît au temps de Jean de Damas, au VIIe siècle) puis, au Moyen Âge, inexistentia (in-existence), inhabitatio et circumincessio. Six siècles plus tard, on retrouve chez Brentano le terme d’Inexistenz, ainsi d’ailleurs que celui d’Einwohnung qui fait écho au concept théologique d’inhabitatio, quand il définit ce qui, à ses yeux, fait la spécificité du mental ou du psychique, par opposition au physique : « Ce qui caractérise tout phénomène psychique, c’est ce que les scolastiques du Moyen Âge nommaient l’in-existence intentionnelle (ou encore mentale) d’un objet, et que nous décririons plutôt, bien que de telles expressions ne soient pas dépourvues d’ambiguïté, comme la relation à un contenu ou la direction vers un objet (sans qu’il faille entendre par là une réalité), ou encore une objectivité immanente. » Une note très importante de l’édition de 1911 de la Psychologie d’un point de vue empirique sur l’intentionnalité nous montre que les paroles fondatrices de la psychologie philosophique moderne qui rendront possibles Husserl et la phénoménologie avec le concept d’intentionnalité (concept déjà présent chez certains auteurs médiévaux et que Brentano tire de son interprétation de Thomas d’Aquin) sont, en un sens, des paroles de théologie trinitaire. Brentano explique que l’in-existence intentionnelle qui signifie non pas évidemment la non-existence, mais un mode d’immanence non réel, c’est Augustin (parlant du Verbe mental) et Thomas d’Aquin (parlant de l’inhabitation de l’Esprit saint) qui l’ont découverte en tant que théologiens, et que c’est sur cette base qu’il faut refonder la science de l’âme, la psychologie, y compris celle d’Aristote, une fois dépouillée (ce qui selon lui est possible, et même requis) de toute connotation physicaliste.
AP : Il faut peut-être rappeler ici que Brentano fut un temps prêtre catholique et qu’il avait acquis une très solide formation théologique. Mais alors, par exemple, quand tu fais une découverte du type de ce que tu viens de dire sur Einwohnung et inhabitatio, que (te) dis-tu exactement ? Que c’est la même chose ?
AL : Non, bien sûr. C’est ce que nous disions tout à l’heure : il y a des invariants mais aussi du changement. Mon but n’est pas de dire : « C’est la même chose » (ce serait d’ailleurs assez absurde, et Brentano lui-même parle d’une « analogie »), mon but est de tenter de comprendre comment nous arrivons, comment nous sommes conduits, aux questions que nous nous posons ou croyons poser. De trouver aussi par quels chemins s’effectue le transfert d’une notion d’un champ à un autre. Je remarque d’ailleurs qu’une critique qui m’a souvent été faite (et qu’on faisait déjà aux structuralistes) est de réduire l’homme à un simple jouet pris dans un faisceau de structures. Ce qui aurait pour effet de rendre sa « liberté » problématique – voire inexistante.
AP : C’est un peu le même genre de critiques qu’on adressait à Bourdieu avec son concept de champ. Le champ exerçant une pression contraignante, je subis des contraintes liées à ma position dans l’espace social, à mon éducation, au capital matériel et symbolique que j’ai accumulé, etc. De même, tu dis que les questions philosophiques n’émergent pas ex nihilo et que les problèmes s’imposent aux penseurs en quelque sorte malgré eux : ils sont tributaires de l’état du champ intellectuel au moment où ils arrivent et ne peuvent donc pas traiter n’importe quel problème prétendument « éternel »…
AL : Oui, tu as raison. J’ai, pour ma part, tendance à penser que la liberté a besoin de contraintes, sinon elle est vide. Je souhaite faire reconnaître que nous sommes amenés aux questions que nous nous posons par des réseaux et des structures qui nous précèdent et que nous n’avons pas créés. La liberté du penseur consiste à composer avec la contrainte et à affronter une certaine configuration liée à un état du champ qu’il n’a pas choisie. La tâche de l’historien est de montrer ce qui, pour parler comme Foucault, « s’impose, selon une sorte d’anonymat uniforme, à tous les individus qui entreprennent de parler » dans un certain « champ discursif ».
AP : Pourtant, les grands philosophes donnent souvent, en particulier depuis Descartes d’ailleurs, l’impression d’une volonté de recommencement radical. À les écouter, tous leurs prédécesseurs n’auraient rien compris ou bien auraient mal posé les problèmes. Qu’en penses-tu ?
AL : C’est vrai. Mais c’est ici que l’archéologie peut être utile. Elle permet de dépasser la fausse alternative dans laquelle l’historiographie a tendance à s’enfermer : continuité ou rupture. Comme tu le disais auparavant, pour qu’une structure intellectuelle qui évolue dans le temps soit intelligible, il ne faut pas que rien ne change, mais il ne faut pas non plus que tout change : il faut qu’à travers le changement quelque chose d’identique insiste et demeure – c’est le raisonnement d’Aristote dans la Physique à propos du mouvement. En fait, les grands philosophes qui se mettent en scène de la manière que tu dis fonctionnent sur le mode de la projection rétrospective : on fabrique une tradition pour s’en démarquer. C’est ce que fait Descartes avec la scolastique, Kant avec la métaphysique « dogmatique » ou bien Nietzsche avec la philosophie « ascétique » qui méprise le corps et l’individu. La liberté du penseur consiste à faire quelque chose d’un dispositif qui le précède (un certain « champ » préconstitué, comme nous le disions auparavant) : il peut soit le développer ou l’approfondir, soit s’en démarquer. Mais, même en s’en démarquant, il a besoin de le constituer sur un mode adversatif et de se définir par rapport à lui : il y a donc continuité et rupture. D’ailleurs, à bien y réfléchir, si l’on en reste aux « grands philosophes », comme tu dis, qu’est-ce que la tradition en philosophie, sinon une somme de ruptures et de grands gestes inauguraux par rapport à une « tradition » rétrospectivement projetée par ces philosophes ? Jean-Luc Marion a tout dit sur ce point.
AP : Et toi, en tant qu’historien de la philosophie, comment te situes-tu par rapport à ces dispositifs et à ces structures ? Ta position est-elle analogue à celle des philosophes ?
AL : À l’évidence, non. Le philosophe constitue « sa » tradition, et le cas échéant la motive ; l’historien propose une intrigue conceptuelle, et le cas échéant la justifie. On n’a donc pas affaire à deux types de projection rétrospective différents, l’un dur, l’autre mou : l’historien ne doit rien projeter, plus que tout autre il doit fuir ce que Bergson appelait « le mouvement rétrograde du vrai ». Une intrigue n’est pas une projection. C’est une manière d’explorer une archive. Le problème est que l’archive du médiéviste est en voie d’expansion continue. On peut dire qu’actuellement nous sommes sans doute plus éclairés qu’avant dans le choix d’une intrigue, dans la mesure où nous disposons d’un nombre croissant de bonnes éditions et où, grâce à Internet et à la révolution numérique, nous avons accès à une bibliothèque virtuelle pratiquement illimitée. Mais le choix n’en est que plus difficile. On est face à une accumulation folle de connaissances et d’informations : le problème est de maintenir une différence entre les deux, car le numérique a tendance à réduire la connaissance à l’information. Face à ce podcast qui coule, universel et ininterrompu, le rôle de l’historien-archéologue est d’identifier les bonnes structures. Il y a pour ce faire un critère d’identification heuristique : la simplicité. La force d’une hypothèse de travail se mesure au nombre d’éléments qu’elle est capable d’intégrer et d’unifier, en un mot : de « simplifier ».
AP : Pour mieux « s’orienter dans la pensée », comme dit Kant ? Reprendrais-tu à ton compte cette notion d’orientation ?
AL : Oui. Je pense que mon Archéologie du sujet est une table d’orientation sur les problématiques du sujet dans la longue durée philosophique. Rien de plus. Mais rien de moins.
AP : Il ne s’agit donc pas pour toi de proposer une nouvelle « théorie du sujet » comme Badiou 4 ou d’autres ?
AL : Non, absolument pas. Mon travail est d’ordre archéologique : on n’attend pas d’un archéologue qu’il invente quoi que ce soit, mais seulement qu’il reconstitue un dispositif. Concernant la question du sujet, il s’agit pour moi de reconstituer les grandes étapes de l’émergence de cette notion et de donner les étapes clés des différentes figures du sujet et de la subjectivité. J’ajoute que je ne suis pas soumis à la linéarité chronologique et que je m’autorise de nombreux va-et-vient en circulant dans les concepts, les thèses et les arguments que je prends, comme je l’ai dit au début, comme fonctionnant en réseau. Là aussi, mon projet se démarque de « l’histoire de la philosophie » au sens classique du terme. On ne verra la cohérence d’ensemble de l’Archéologie du sujet qu’à la fin du quatrième (ou cinquième !) tome.
AP : Un peu comme pour À la Recherche du temps perdu, en somme… Le tome II intitulé La Quête de l’identité est consacré au problème de l’identité personnelle dans la philosophie médiévale et moderne. Peux-tu nous dire, pour terminer, le contenu des tomes III et IV ?
AL : Je peux te dire qu’ils sont déjà presque écrits, mais que je dois les recomposer et peut-être faire entrer une partie du tome IV dans le III. Faire, défaire, refaire… En produisant une fresque de ce genre, on se met sous la contrainte des volumes précédents. Le tome II devait initialement s’intituler Le Sujet de l’action et être consacré aux théories de l’action de la scolastique tardive (Suarez) à l’âge classique. Or j’ai dû, comme tu viens de le rappeler, l’organiser de manière tout à fait différente en me centrant sur les théories de l’identité personnelle. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que cette thématique de l’identité était plus directement appelée par le tome I que la question de l’agent et de l’action. Mes recherches sont donc en réélaboration permanente : une fois qu’on est entré dans une intrigue, dans un certain itinéraire, il faut aller jusqu’au bout – et pas nécessairement en passant par où l’on pensait passer initialement. Je ne m’attendais pas à passer du refus de la subjectité par Augustin dans le De Trinitate (t. I) aux textes satiriques antilockéens d’un Martin Scribler (t. II). L’archéologie m’a appris à trouver des invariants là où je ne les aurais pas cherchés a priori, à composer avec des contraintes structurelles et à ne pas les éluder. Le tome III sera consacré à Descartes et à l’averroïsme, à Descartes vu sur la longue durée de l’averroïsme et de l’antiaverroïsme. Quant à en donner le titre, je ne me hasarderai plus sur ce point au pronostic. Ce sera peut-être L’Invention du sujet. Peut-être Le Sujet de l’action. Le quatrième sera centré sur Kant, Schelling et Heidegger : Le Sujet kantifié, en somme 5. Mais d’ici à sa parution, j’aurai sans doute perdu l’envie de rire.
- Un exemple de ce type de texte et du réseau auquel il appartient figure dans A. de Libera et L. Gazziero, « Le sophisma ‘Omnis homo de necessitate est animal’ du Codex Parisinus 16135, f. 99rb-103vb », Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Âge, 75 (2008), p. 323-368. Cette année paraîtra, chez Vrin, la somme de S. Ebbesen et F. Goubier, A Catalogue of 13th Century Sophismata. Par la suite, je me suis demandé si je ne pourrais pas transférer une méthode efficace pour des énoncés sans signature à des problématiques et des thématiques au contraire bien attestées, portées par de « grands noms », et déjà codées et recodées dans l’historiographie, ce qui veut dire aussi surétudiées, surinterprétées et surconstruites, comme le problème des universaux, le problème médiéval « par excellence ». Entendons-nous bien : il ne s’agissait pas d’histoire des doctrines, mais de ce qui conduit à leur formulation, disons : de leurs conditions de possibilité, de leur « a priori historique » au sens foucaldien du terme. En appliquant des procédures d’anonymisation à des pans d’histoire de la philosophie supposés « bien connus », j’espérais dépasser les schémas historiographiques prédonnés, les représentations toutes faites de la pensée médiévale avec ses courants et ses « ismes », et son stock de problèmes « typiquement médiévaux ». L’ouvrage de 2003 sur Raison et Foi d’Albert le Grand à Jean-Paul II, que tu citais, est une tentative allant en ce sens. Mais la méthode était déjà formulée et appliquée en 1999 dans L’Art des généralités, une étude du dispositif ancien et médiéval de l’abstraction (dont relève la « querelle des universaux »). Mon projet en cours d’Archéologie du sujet s’inscrit dans cette continuité.
AP : En somme, cette méthode archéologique telle que tu viens de la décrire semble faire primer les structures argumentatives sur les auteurs. Ces procédures d’anonymisation ne sont pas sans rappeler les méthodes structuralistes (notamment en critique littéraire) qui entendaient considérer le texte comme un réseau de sens autonome indépendant de toute instance externe qui pourrait ressembler de près ou de loin à un « auteur ». Peut-on donc dire de l’archéologie qu’elle est, en quelque sorte, une méthode structuraliste ou poststructuraliste ?
AL : Oui, en un sens. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles je revendique une certaine filiation avec Martial Guéroult (1891-1976), qu’on présente parfois comme un « représentant » du structuralisme en histoire de la philosophie, alors qu’à mon sens c’est bien plutôt les auteurs qu’on associe traditionnellement au structuralisme qui lui ont beaucoup emprunté et lui doivent beaucoup – mais c’est un autre problème… Quand j’étais étudiant, à la fin des années 1960, j’ai été particulièrement intéressé par l’ouvrage de Guéroult intitulé L’Évolution et la Structure de la doctrine de la science chez Fichte (il s’agit de sa thèse de doctorat de 1930). J’aime bien cette idée (qui est, au fond, l’idée directrice de la méthode archéologique) qu’il ne faut pas opposer histoire et structure, que les structures ont une histoire, qu’il est possible d’en faire une genèse, et qu’en même temps elles font l’histoire ou, plutôt, qu’elles font histoire.
AP : Si on reste sur le chapitre « Genèse et structure », il est difficile de ne pas évoquer également Jean Hyppolite et son ouvrage célèbre Genèse et Structure de la ‘Phénoménologie de l’esprit’. Michel Foucault aussi, qui a consacré sa thèse complémentaire à une traduction de l’Anthropologie de Kant, a intitulé son introduction (publiée récemment, d’ailleurs, par les Éditions Vrin [Et chroniquée à cette adresse : [https://actu-philosophia.com/spip.php?article43
- J’évoque Collingwood dans « Le relativisme historique : théorie des “complexes questions-réponses” et “traçabilité” », Les Études philosophiques, nº 4/1999, p. 479-494 et « Archéologie et reconstruction. Sur la méthode en histoire de la philosophie médiévale », in Un siècle de philosophie, 1900-2000, Paris, Gallimard-Centre Pompidou (Folio Essais), 2000, p. 552-587.
- Voir, sur ce point, La Quête de l’identité, chap. III (« Le sujet personnifié ») et IV (« Le sujet dédoublé »).
- Alain badiou, Théorie du sujet, Seuil, 1982
- J’indique quelques pistes dans « When Did the Modern Subject Emerge ? », American Catholic Philosophical Quarterly, 82/2 (2008), p. 181-220, et « Sujet insigne et Ich-Satz. Deux lectures heideggériennes de Descartes », Les Études philosophiques, n° 1/2009, p. 83-99.








