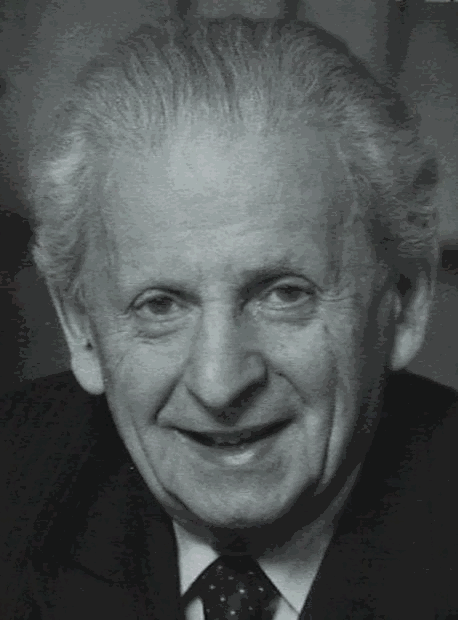Altérité et transcendance n’est pas un ouvrage démonstratif, c’est à dire une enquête méthodique qui, à partir de données premières, tâcherait de parvenir à la solution d’un problème donné. Il s’agit ici d’un recueil de textes issus de périodes et de lieux différents, et que Levinas livre comme un testament philosophique, puisque il s’agit là du dernier livre publié de son vivant. On y retrouve, à différentes échelles, l’idée selon laquelle l’altérité de l’autre est le lieu originel de la transcendance.
L’ordre de ces textes n’est pas chronologique, mais suit l’intelligence d’une exposition, comme si la vérité ne se trouvait pas à la fin, dans les dernières phrases d’un philosophe parachevant sa réflexion, mais à l’intérieur d’une pensée qui procède par détours et retours.
Un retour, tout d’abord, aux fondements. La première partie de l’ouvrage: L’autre transcendance, contient trois textes (1989) qui ont pour fonction de définir la notion de transcendance, en la rattachant à son lieu originel: l’altérité de l’autre qui se donne à voir dans l’exposition du visage, c’est à dire l’exposition de l’autre à la mort : sa fragilité.
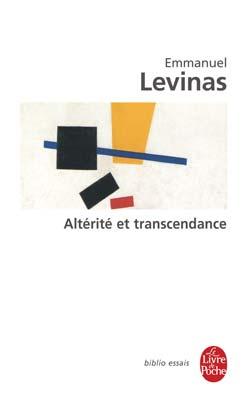
Afin d’opérer ce renversement dans la compréhension de la transcendance, il convient de montrer en quoi il s’agit d’un renversement, et en quoi il fait sens. Cela implique donc un détour par les diverses conceptions philosophiques de cette notion.
Les textes suivants montrent la fécondité de cette conception dans le champ social et politique. Comment repenser le dialogue interreligieux après l’holocauste? Comment fonder le droit ailleurs que dans une raison abstraite? Comment penser la paix autrement que comme sécurité?
Les deux entretiens qui cloturent l’ouvrage permettent de saisir en quoi la phénoménologie de Levinas, de par ses liens avec la théologie, et de par la primauté qu’elle accorde à l’éthique sur l’ontologie, se démarque de l’approche husserlienne, mais aussi de l’approche heideggerienne, dont Levinas conteste l’entente de la mort qui en est issue.
I) L’autre transcendance
Dans son premier texte, Philosophie et transcendance, Levinas va montrer que la transcendance a été conçue, au cours de l’histoire, sous deux angles (mystique et épistémologique) qui ne nous révèlent pas son origine et son sens véritables.
Phénoménologiquement définie, à une première échelle, comme “une façon pour le distant de se donner”1 la transcendance est problématiquement liée à la notion d’infini (idée “plus forte et vénérable que la totalité”2 qui est précisément ce qui se donne comme ne pouvant être donné. L’infini, autrement dit, est le distant qui se donne comme ce qui demeure distant, hors de portée. La transcendance apparaît alors dans toute sa mesure, et son problème, au sein de l’infini. Cet infini n’aurait il pas son lieu originel dans l’expérience du visage d’autrui, là même où un autre m’assigne moi, et non un autre, à une responsabilité irréductible? Cet autre ne pourrait il pas être ce par quoi Dieu même vient à l’idée? Revenons d’abord sur l’histoire de cette notion.
On a tout d’abord la transcendance extatique des grecs, dont on a une occurrence fondamentale avec l’idée platonicienne, lieu originel de toute réalité, et auquel le philosophe, mû par l’amour du vrai et guidé par les subtilités de la dialectique ascendante, tâche d’accéder. Cette transcendance extatique trouve sa plus haute expression dans le néoplatonisme, puisque l’Un de Plotin, au delà de l’être même, “manquant de tout manque”, ne peut absolument pas se saisir par les voies déterminantes du concept, ce que Platon, dans Le Parménide, exprime déjà en montrant que de L’Un, on ne peut rien dire, pas même qu’il est un. A la dialectique se substitue ainsi chez Plotin la prière, le recueillement, effort par lequel l’âme essaye de se retourner sur son origine, dans le silence pleinier de l’extase. Mais cette prière s’effectue seul, la transcendance extatique est donc méta-sociale.
Cette absence de socialité, d’humanité, dans la quête de l’Un, n’est toutefois pas ce que la modernité identifiera comme difficulté. Le problème viendra pour elle de l’arrière-monde dessiné par ces philosophies. Poussée par la nécessité d’une science fiable, cette dernière, avec Descartes, va bâtir son édifice sur le “je pense”. Le cogito est le sol premier et indubitable à partir duquel tout se pense, tout se donne. La transcendance n’est plus dans un quelconque arrière-monde, mais elle deviendra, avec la phénoménologie, la transcendance de l’objet qui se donne. “L’être dans sa présence s’offre à la prise en main, est donation”3. Le monde de la vie, ce monde de choses toujours déjà là, à portée de la main, et qui n’existe que dans l’intention par laquelle une conscience lui est liée, est il le lieu à partir duquel il faut penser la transcendance? Faut-il comme Husserl essayer de remonter à la transcendance immanente de la conscience, qui se donne un monde? Levinas ajoute alors: “C’est à la conception dominante de la philosophie selon laquelle la pensée est fondamentalement savoir, c’est à dire intentionnalité, qu’il s’agira de tracer quelques limites”.
Cela nécessite une reprise de la notion d’intentionnalité. On sait que celle ci renvoie à l’ouverture au monde d’un sujet, qui ne peut être conçu sans lui et réciproquement. La difficulté de cette notion tient dans la dimension constructive qu’elle assigne à la conscience. Celle-ci signifie son monde. Comment alors remonter à l’origine, au primat d’une conscience passive, pré-réflexive? De là la nécessité de concevoir une antériorité de l’autre pour l’être-au-monde. Etre “je”, nous dit Levinas, c’est occuper une place. Un rapport à l’autre est donc déjà là, puisque cette place est un droit que fait exister le devoir de l’autre, mais plus premièrement, à cette place se trouve jointe la crainte d’occuper la place d’un autre. La fragilité de l’être, de l’autre, se trouve alors exprimée dans l’exposition du visage, qui au delà de la plastique est “extrème exposition”, “nudité”. Le sens de la mort est ainsi entendu à partir de cette expérience de l’autre, et non, comme Heidegger le suppose, à partir de l’être-pour-la-mort du Dasein qui saisit authentiquement son possible dans sa résolution face à cette ultime possibilité. Et Levinas d’ajouter: “C’est à partir du visage de l’autre que m’est signifié le commandement par lequel Dieu me vient à l’idée”4.
Le rapport à l’autre est donc le lieu où l’infini vient à l’idée. On comprend mieux en quoi le moi est haïssable. Car ce n’est qu’en l’autre qu’il trouve magnificience, en lui même il ne trouve que vide et pauvreté. L’ego, dans sa relation à lui même, est une crise: “Le moi, c’est la crise même de l’être de l’étant dans l’humain”5
Il reste à penser le temps de cette transcendance. Pourquoi? Parce que la responsabilité à laquelle m’assigne autrui est antérieure à toute constitution. Cette antériorité ne saurait être celle d’un a priori, sinon on retourne à la vision épistémique de la transcendance. Cette antériorité est bien celle d’un passé, mais qui n’est pas le “ayant eu lieu”, mais plutôt le ce qui dans le présent est toujours déjà là. C’est un passé contemporain du présent, c’est l’ayant lieu de l’autre qui est déjà là avant moi, et qui est irréductible au concept. “Le conatus essendi naturel d’un Moi souverain est mis en question devant le visage d’autrui”6. Cette temporalité de l’autre, nous dit Levinas, n’est pas rendue accessible par l’intellection, mais par l’inspiration. Ce qui n’est pas à entendre comme l’ivresse dionysiaque, mais au sens d’une réception d’une parole qui n’est point la nôtre. La parole de Dieu. Le recueillement n’est plus, alors, l’effort de l’âme plotinienne qui se retourne vers l’Un, mais l’écoute de la parole divine donné intemporellement dans la temporalité du visage de l’autre.
A ce premier texte, certainement le plus capital pour la compréhension de l’oeuvre, s’ajoute deux textes portant sur les concepts de totalité et d’infini. La relation de la transcendance à l’altérité est ici moins thématisée. Il s’agit plutôt d’une analyse historique de ces notions, où il est parfois difficile d’identifier, dans la succession des références, un fil conducteur, et plus précisément un lien avec la problématique suggérée par le tître de l’oeuvre. Néanmoins, on peut noter plusieurs choses.
D’abord, la distinction entre totalité et totalisation. La totalité est un état. C’est, du point de vue de l’objet, l’homogénéïté des éléments formant une unité. Du point de vue de la pensée, c’est l’acte englobant qui vise l’unité. La totalisation est une opération, ayant lieu dans l’être ou la pensée, par laquelle une telle unité est obtenue.
Ensuite, la distinction entre tout sensible et tout absolu. Le tout sensible n’est encore qu’une partie. Le tout absolu est le tout sans au delà, l’Absolu auquel aspire la Raison, mais selon la critique kantienne bien connue, n’est il pas une idée vide, n’ayant qu’une fonction régulatrice? La totalité serait peut être l’essence même de l’être, en tant que marche vers l’universel concret, le réel serait “totalisation en cours”.
Enfin, il ne faut pas oublier l’homme, le sujet pensant. La totalité est ouverte, car toute totalité porte en elle son horizon, c’est ainsi qu’Husserl la définit, c’est à dire comme le donné avec son horizon. De là l’historicité du vrai, ainsi que la reconduite de l’heuristique à l’herméneutique. Car “la pensée pensant l’être dans sa totalité n’est pas un regard placé en face de l’être”7. La pensée n’est pas extérieure à la totalité, mais participe du mouvement de totalisation lui-même.
Néanmoins, la totalité serait un concept insuffisant en ce qu’il faut penser au delà d’elle. Le tout appelle un tout toujours plus grand. Le Bien chez Platon, le Sollen chez Fichte, la Durée chez Bergson, appellent un dépassement de la pensée totalisante. Ce qui se traduit négativement par l’impossibilité que l’homme a d’embrasser l’être, mais positivement par la possibilité alors ouverte de s’ouvrir à la proximité de l’autre. Cette façon pour la totalité d’exiger plus qu’elle même ouvre ainsi sur l’idée d’infini.
L’infini est, pour Levinas le lieu même de la transcendance. Comme elle, deux façons de le comprendre, une façon mystique, et une façon épistémologique. Façons appelées à être dépassées par l’éthique.
L’infini est une notion paradoxale car elle porte en elle le divin, mais aussi la marque de la finitude humaine. L’infini est tout aussi bien l’essence même de Dieu, chez Saint Thomas ou Descartes, que la marque de l’imperfection chez les grecs, raison pour laquelle Aristote rélègue celui-ci au niveau de la puissance, c’est à dire de la matérialité. La nature est forme, elle est acte, entéléchie, et l’infini lui fait horreur. Une solution se trouverait peut être ici: “L’indétermination du monde est l’imitation de l’infinité absolue de Dieu”8. Solution cartésienne, qui substitue au “mauvais infini” le concept d’indétermination, pour ne réserver l’infinité qu’au seul être en qui elle est digne, c’est à dire Dieu.
Mais c’est surtout dans le rapport à l’autre que se dessine l’infini véritable et se résoud l’ambigüité. Puisque l’autre est au delà, au delà du concept, de la prise en main, du théorique et du pratique, il est donc là où l’infini se manifeste, tout en exigeant par ailleurs de moi l’infini du devoir. Jankelevitch dit ainsi dans Le paradoxe de la morale que le devoir est une exigence infinie dans un être fini.
Cet infini est signe du divin puisque la parole de Dieu est cela même qui se donne à entendre dans l’expérience du visage de l’autre.
Que peut-on désormais penser de la relation à l’autre?
II) Philosophie du dialogue et philosophie première
Dans ce recueil de textes, Levinas part tout d’abord d’un cas concret: la relation entre les communautés juives et chrétiennes. Tout en montrant les difficultés d’un dialogue intercommunautaire, il en souligne l’espoir porté, en 1967, par le groupe: l’amitié judéo-chrétienne de Paris.
Sans donner de prescriptions, il souligne en quoi la proximité de ces deux religions rend leur contact plus difficile, mais également en quoi elle est tout à fait profitable. Il achève son propos par cette formule bien révélatrice: “Je n’ai aucune idée, mais l’idée de l’idée qu’il faudrait avoir”9.
Dans le texte suivant, Levinas reprend son thème favori en développant la relation du je au tu, pour montrer en quoi Dieu apparaît dans cette relation. On découvre ici en quoi Levinas s’est inspiré de Martin Buber, dont l’oeuvre principale s’intitule justement Je et Tu. Pour ce dernier, la relation d’un je et d’un tu ne peut aucunement se décrire comme un cas particulier d’une relation d’un je à un ça, qui est la relation d’une conscience à un “il y a” sans vie et sens, c’est à dire la relation même qu’exige la science. Autrement dit, et contre la phénoménologie, on ne peut pas partir d’un rapport unique d’une conscience au réel qu’on subdiviserait ensuite en régions, mais le rapport je-tu est un rapport unique, irréductible à une intentionnalité signifiante, et à plus forte raison irréductible à l’objectivation scientifique. En lui se découvre le rapport à Dieu.
Le texte suivant, qui est un entretien, approfondit cette idée en montrant, ce qui est capital, que l’éthique est avant l’ontologie. A la suite de Kant, Levinas affirme le primat de l’éthique sur l’ontologie. Mais d’une façon différente. Pour Kant, la métaphysique est comme telle une illusion transcendantale. Le devoir moral permet néanmoins de sauver l’idée de liberté, et fonde la foi en Dieu et l’immortalité de l’âme. Pour Levinas, c’est ontologiquement que l’éthique est première. Le primat de l’autre est une affirmation d’abord métaphysique. C’est par le biais de l’ontologie, paradoxalement, que je découvre ainsi le primat de l’éthique. “C’est parce qu’il y a vigilance avant l’éveil que le cogito est possible, de sorte que l’éthique est avant l’ontologie”10
Plus simplement, ce n’est pas pour montrer l’illusion de la métaphysique par opposition à l’exigence de l’éthique que Levinas affirme le primat de cette dernière, mais pour montrer que la véritable question de l’ontologie n’est pas : qu’est ce que l’être? Mais plutôt : qu’est ce que l’autre? La critique de l’ontologie n’est pas celle d’une science hors de portée de l’homme, mais plutôt d’une pensée qui a substitué à l’essentiel “tu”, un “ça” indifférent qu’il s’agit de construire rationnellement.
La conscience est d’abord vigilance. Avant de se saisir comme “cogito”, l’autre est présupposé par notre vigilance. Autrui est là avant toute intentionnalité, toute réflexivité. Autrui est donc le sens de l’ontologie, comprise comme recherche de la réalité première. Il est la voie d’accès à Dieu.
Cette métaphysique est éthique car elle n’aboutit pas, comme dans l’extase plotinienne, à la fusion avec l’origine, mais conserve l’autre dans sa distance infinie, distance qui m’assigne une responsabilité et m’interdit, comme avec les étants du “ça”, un rapport d’arraisonnement qui m’en rendrait maître et possesseur.
Cette intimité du rapport éthique fait en sorte que celle-ci ne se laisse pas déterminer par des lois qui fixeraient la norme du bien. Reprenant l’analyse désespérée de Grossman dans Vie et Destin, Levinas dit: “Toute tentative d’organiser l’humain échoue. La seule chose qui reste vivante, c’est la bonté de la vie courante”11. On a ici l’image d’une morale spontanée, pré-réflexive, qui n’est pas sans évoquer la pitié rousseauiste de la première partie du Second discours. Ceci pour manifester que l’éthique se joue dans l’universalité concrète de la rencontre singulière, et non dans l’élément abstrait de la loi. Ce qui, bien évidemment, interdit toute tentative politique de résoudre définitivement le problème de la condition humaine, c’est à dire, ce qui interdit tout totalitarisme. Une réflexion sur la politique devait donc suivre.
Préfaçant le livre de Buber: Utopie et Socialisme, paru en 1945, Levinas explique que le socialisme est par essence utopique: au sens où il est le désir idéal de changement, nostalgie du juste, mais capable par là même d’audaces de l’espérance.
“L’utopisme serait, du moins d’après Buber, dans un monde où, depuis le siècle des Lumières et la Révolution française, s’était perdu le sens de l’eschatologie, la seule manière de souhaiter le “tout autre” social”12.
Une utopie, cela signifie un “bel idéal”, mais qui ne se laisse pas atteindre, tout en pouvant servir de norme du juste. Le communisme représente aux yeux de Buber un tel idéal, au sens où toute forme de pouvoir coercitif est remise en cause, ce qui se manifeste dans la substitution de l’administration au gouvernement. Cette administration n’est pas une puissance anonyme, mais se réalise concrètement dans les foyers sociaux multiples ayant pour tâche d’assurer la présence réelle de l’homme pour l’homme, en lieu et place d’un pouvoir abstrait et centralisé. Mais ce qui apparaît en réalité, c’est une dialectique perpetuelle entre société et Etat, et Buber qualifie les Kibboutzim (fermes collectives sur la terre d’Israël) de “non-échecs”, ce qui montre la limite de ce qu’il est possible au socialisme utopique de réaliser. Mais ce qui est intéressant ici, c’est que cette analyse renvoit à celle de la relation “Je-Tu”, puisque: “Le modèle Je et Tu permet de penser fermement la distinction entre la société et l’état et de concevoir une collectivité sans pouvoirs”13.
III) Paix et droit
Dans un premier texte, Interdits de la représentation et droits de l’homme, Levinas se pose la question du sens de l’interdit de la représentation au sein de la religion juive14. L’idée de Levinas est la suivante: Cet interdit dénonce la pauvreté de la représentation, par rapport à d’autres modalités possibles de la pensée.
On peut faire voir cette idée de la façon suivante: la représentation est une mise à disposition du pensé, qui se donne comme objet manipulable par l’imagination. De là peut naître la tentation d’idolâtrie. L’idolâtrie est une chute au sens où l’infini n’a plus lieu en elle. L’infini, qui est ce qui se donne comme ne pouvant être donné, ne peut pas par définition être représenté. Interdire la représentation, c’est donc interdire à l’homme de s’approprier l’infini, le réduire à son propre fini par cette affirmation peremptoire: “je sais”.
Le sens ultime de cette interdiction serait de faire saisir qu’avant le représenté, la cogitatio et son cogitatum, il y a l’autre, qui se tient devant moi, un peu à la manière des affaires, de l’ustensilité, de ces objets, qui d’abord chez Husserl comme Gebrauchsobjekte, puis chez Heidegger comme Zuhandenheit, renvoie à un rapport pré-théorique avec le monde. A la différence majeure que ce rapport pratique, chez Heidegger, reste un rapport à l’objet, et non à l’autre, comme chez Levinas où par ce fait même, cette primauté n’est pas pratique mais éthique.
Cette éthique prend sens dans la : “Transcendance de l’autre homme dans son visage, dans son faire face qui, dans sa droiture extrème, est une exposition à la mort inexorable”15. Ainsi, l’autre peut être représenté, et c’est précisément dans sa représentation, comme autre, que le droit prend sens. Représenter l’autre, c’est présenter son visage. Si Dieu ne peut pas être représenté, on peut présenter le visage de l’autre où l’infini se donne.
Le droit a donc pour origine l’altérité de l’autre donné dans l’exposition de sa fragilité, qui m’assigne une responsabilité. Cette conception permet à Levinas de livrer une réflexion profonde, et riche, sur la paix. Le texte “Paix et proximité” qui suit est certainement le plus riche de tout ce recueil, par la synthèse qu’il propose de la pensée de Levinas, et l’ouverture donnée sur la relation quotidienne à l’autre.
L’Europe a conçu la paix à partir de la vérité, tirant cela de la sagesse grecque. C’est à dire la paix comme sérénité, unité réalisée dans la cité, à l’image de l’Un originel. Science, technique, et politique, ont alors une même direction. Mais l’Histoire a montré comment la théorie, élévation de l’humain, pouvait au travers du totalitarisme altérer l’humanité de l’humain. La conscience de l’européen est alors déchirée entre ses hautes aspirations et le retour lucide, et douloureux, sur les millénaires de luttes fratricides. Dés lors naît une crise, une “contestation de la centralité de l’Europe à partir de l’Europe elle-même”16. L’européen ne se reconnaît plus chez lui, et cherche à se retrouver dans des cultures toujours plus lointaines, voire même, à l’image des ethnologues, plus vierges de tout lien avec la civilisation. Avec Levi-strauss, il en vient à affirmer ainsi que les cultures se valent, que l’une n’est pas mesure de l’autre, et que l’européen est la réalisation la plus haute du barbare lorsqu’il déclare que l’étranger est, lui, le barbare.
Cette crise fait naître en l’homme une angoisse: celle de faire du mal à l’autre, celle de tuer l’autre, dans la tranquillité de la rationalité. Il y a dit Levinas, “L’angoisse de commettre des crimes même là où des concepts s’accordent”17
Au lieu de fuir dans la paix bourgeoise, dans l’ataraxie d’un seul à soi que l’autre ne vient pas troubler, la paix authentique, véritable, est dans la proximité. Irréductible à la spatialité, qui n’en est que le versant géométrique, sans vie et sens, la proximité est sympathie: porter avant soi et avec soi la fragilité de l’autre, accepté comme autre en deça de toute prosopolepsie18. Cette proximité ne saurait marquer l’échec de la coincidence, l’impossible fusion des âmes évoquée par Aristophane dans Le Banquet. Mais elle est surcroît de socialité, don que ne mesure pas la justice comptable. Levinas précise ici, ce qui est capital pour éviter toute interprétation rapide du concept de visage, que le visage n’est pas, bien évidemment, la plastique de la face, mais n’est pas non plus la face elle même. Le dos de l’autre, dans sa chair, est également exposition de sa fragilité, et donc est aussi visage. La paix, c’est ainsi “L’éveil à la précarité de l’autre”.
C’est à partir de cette entente de la paix que se dessine, dans le texte suivant, une entente des droits de l’homme qui, au delà du formalisme qui les caractérise et qui trouve sa pleine expression dans la raison pratique kantienne, sont les droits de l’autre homme. L’Homme, en effet, est sans visage, et Diogène de Sinope a beau le chercher en plein jour, à l’aide d’une lanterne, il ne le trouve pas. Seul l’autre a un visage.
IV) Entretiens
Deux entretiens cloturent cet ouvrage. Le premier est réalisé en 1982 avec Christian Chabanis. Le second en 1985 avec Angelo Bianchi. Le premier porte sur Le philosophe et la mort. La mort est d’abord envisagée par Levinas comme l’inassumable, l’inexorable. Elle est ce qui s’impose par excellence, et qui ne peut aucunement être pensé ou assumé. Contre Heidegger, qui voit dans la mort la possibilité de l’impossibilité de toute possibilité, Levinas souligne qu’une possibilité renvoie à une possibilité de l’homme, pour laquelle il y a projet. Or, la mort est “un évenement sans projet”19. La mort est donc l’impossible par excellence.
Cette critique d’Heidegger est ici périphérique, la critique centrale que Levinas livre de l’auteur de Sein und Zeit se trouve dans l’idée que la mort n’est pas un face à face solitaire, mais contient en elle même un rapport à l’autre. La mort de l’autre m’éveille à lui, en elle se joue l’humanité de l’homme. Elle m’appelle, m’interpelle, elle fait me saisir dans ma propre vacuité. Elle remet en question l’égoïté du conatus essendi. Levinas cite encore une fois, dans ce texte, “ le moi est haïssable” de Pascal. Il interprète cette pensée dans sa perspective d’un moi appauvri par l’oubli de l’autre. L’égo qui se pose dans la toute puissance de son vouloir-vivre ne voit pas la mort de l’autre, ne voit pas l’autre, et donc n’accède ni à la transcendance, ni à la véritable signification de la mort, qui est entendue à partir de l’autre.
Le second entretien porte sur la Violence du visage. Levinas articule ici éthique, théologie, phénoménologie, ontologie. Au sens strict, l’ontologie serait remise en question par Levinas, puisque l’ontologie pose la question de l’être en lieu et place de celle de l’autre. Néanmoins, le fait que l’autre soit identifié comme premier (au sens du déjà là), comme lieu de l’infini et de sa transcendance, comme lieu de la parole de Dieu, et enfin comme la manifestation de la supériorité de la diachronie sur la synchronie, du temps sur l’éternité, montre qu’il y a autre chose qu’une injonction éthique dans le visage de l’autre, mais une révélation métaphysique. Cette révélation est atteinte par une phénoménologie, c’est à dire par la tentative de discerner ce qui constitue l’essence du mode d’apparaître des choses. Cette phénoménologie est plus que la perspective trop théorique envisagée par Husserl. Quand Angelo Bianchi lui demande ce qu’est le sens, Levinas montre qu’on ne peut pas creuser à l’infini dans la recherche des conditions transcendantales. Il y a un moment où quelque chose se donne, et qui n’a pas à être reconduit encore et encore à une condition transcendantale plus première. Prenant l’image du poème, il dit ainsi : “En réflechissant sur les conditions transcendantales du poème, vous avez déjà perdu le poème”20
Le lieu de la révélation métaphysique est l’exposition de la fragilité de l’autre qui remet en question le conatus essendi du moi. “L’épiphanie du visage humain constitue une percée de la croute de l’être persévérant dans son être”. L’autre est alors un lieu de passage, il est le point de passage entre la transcendance des objets finis donnés à la conscience, et la transcendance infinie de Dieu qui lui, ne peut prendre corps. Levinas voit ainsi en l’autre un appel à la charité, au delà de la rationalité de la loi. L’autre est donc un point de passage à la fois métaphysique et éthique. Signe de l’infini, et appel à la sainteté, dont tout homme, sans en prendre le chemin, reconnaît en lui la valeur.
Levinas voit finalement, en l’autre, ce que le christianisme verra dans le christ. Pour le judaïsme, Dieu ne peut pas prendre corps. C’est donc au travers du visage de l’autre qu’une intuition de l’infini peut être donnée (sans pour autant pouvoir être représentée). C’est au travers de l’autre que le décalogue prend sens. Pour le christianisme, Dieu prend précisément un visage et un corps en la personne du Christ. Il serait intéressant de mener une recherche plus approfondie sur ce thème.
La référence fréquente de Levinas à Pascal, sur le caractère haïssable d’un moi seul à lui, ou encore le thème de la charité développée dans La proximité de l’autre, dresse un pont tout à fait intéressant entre ces deux religions, que Levinas appelle de ses propres voeux.
Pour conclure cette étude, on peut donc relever que la phénoménologie de l’autre conduit Levinas à dépasser le cadre noético-noématique de cette discipline par l’affirmation de la primauté de l’autre, qui pose par là-même la primauté de l’éthique sur l’ontologie. C’est dans cet être-à-l’autre, qui est plus originel que l’être-au-monde, que se dessine un accès au divin, dont l’exercice quotidien de la charité maintient la temporalité.
- Emmanuel Levinas, Altérité et transcendance, LGF, 2006, p.27
- Ibid, p. 28
- Ibid, p. 37
- Ibid, p.46 “tu ne tueras point”
- Ibid, p. 48
- Ibid, p. 52
- Ibid, p. 64
- Ibid, p. 80
- Ibid, p. 102
- Ibid, p. 109
- Ibid, p. 116
- Ibid, p. 120
- Ibid, p. 124
- La référence biblique se trouve en Exode 20, 4: « tu ne feras pas d’idoles, ni une quelconque image de ce qui est en haut dans le ciel, ou en bas sur la terre, ou dans les eaux au-dessous de la terre ». Il faut préciser, ce qui est essentiel, que cet interdit ne prend sens que dans l’interdiction de l’idolâterie. Ultimement, c’est Dieu qu’il s’agit de ne pas représenter.
- Altérité et transcendance, p. 132
- Ibid, p. 137
- Ibid, p.139
- La prosopolepsie, concept que Jankelevitch développe dans Le paradoxe de la morale, désigne l’attitude de celui qui ne reconnaît l’autre qu’en tant que membre d’un groupe, d’une classe, d’une culture, etc. Levinas aborde l’idée que l’altérité de l’autre se donne avant toute identification sociale et culturelle, elle se donne antérieurement.
- Ibid, p. 159
- Ibid, p. 174