De quelle nature est le petit livre qu’Emmanuel Cattin (désormais E.C) nous permet de tenir entre nos mains ? Les trois objets qu’il se donne pour titre – vérité, phénoménologie de l’esprit, Jean –, sans être d’emblée contradictoires, suffisent cependant, avant même de commencer à lire, à en dessiner l’horizon complexe.
S’agit-il de théologie ? Sans nul doute. Il est question pour l’auteur de laisser parler le texte de Jean, sans immédiatement – et peut-être sans jamais – le soumettre à une lecture purement philosophique, entendons par là purement conceptuelle, qui en neutraliserait la dimension révélée, vivante, chrétienne. Lorsqu’il se revendique, dans quelques notes, d’autres théologiens dont il reprend par moments les analyses (notamment R. Schnakenburg, J. Ratzinger, R. Bultmann, pour ne pas tous les énumérer), ce n’est pas tant pour s’inscrire, sinon discrètement, dans une tradition exégétique que pour mieux laisser s’avancer la radicalité du propos johannique, la manière dont il nous interpelle. Un livre de théologie, donc, sans nul doute.
S’agit-il cependant aussi de philosophie ? Une lecture de Jean peut-elle concerner la philosophie sans pour autant cesser d’être théologique ? Peut-elle appartenir à la dimension du questionnement sur ce qui est tout en constituant d’abord une méditation de ce que la foi a vu ? La réponse à cette question ne laisse d’être décisive. Mais elle appartient d’abord à l’auteur lui-même et à ce compte, il est clair qu’invoquer la notion de vérité, fût-ce pour en interroger la venue, qui est autre chose que la connaissance mais aussi autre chose que le dévoilement, renvoie à une question proprement philosophique : qu’est-ce que la vérité, qui et où faut-il être pour y avoir accès ? (Que la formulation de ces questions soit corrigée au fil même du livre n’en diminue pas par principe la teneur philosophique.) Jean ne fait-il pas montre d’une certaine compréhension de cette question, et partant, ne lui appartient-il pas ?
De fait, E.C s’inscrit bel et bien dans une question classique de la philosophie, celle de la vérité. Mais ici, cette question est assurément posée de manière singulière : aletheia, nom grec, mot de la philosophie, est ici mesuré à cela que Jean n’est pas grec et qu’en nommant une vérité qui est quelqu’un, qui « n’est » pas simplement mais est celle qui vient, entendons par là celle qui vient vers nous, qui nous vient, qui se destine personnellement à nous, se tient sous la lumière d’une langue et d’un domaine d’expérience essentiellement dérangeant pour la philosophie, celui du témoignage et de la foi. Dérangeante, la vérité johannique est toutefois susceptible d’être rencontrée, en sa singularité, par la philosophie qui s’en distingue puisque d’une part, elle emprunte sa langue – à moins qu’elle en soit elle-même la « langue natale » –, et que d’autre part, son expérience est aussi celle de la manifestation : que la vérité vienne veut dire qu’elle apparaît, ou plutôt que sa venue ouvre la dimension de l’apparaître, marque de son sceau ce qui se présente devant le regard – et il n’est de tâche plus philosophique que de méditer cette dimension. Si le propre de la vérité johannique, ce n’est pas seulement de constituer un article de foi mais aussi de se montrer, de régir un certain éclat du paraître, un certain ordre du voir, alors, dérangeant la philosophie, Jean ne saurait donc lui rester étranger.
Toute la question sera de mesurer cette proximité : Jean, et avec lui la vérité qui vient, parlent-ils une « langue étrangère » que la philosophie aura pour tâche d’apprendre ou bien parlent- ils la langue maternelle de la philosophie, qu’elle devra reconnaître comme sa provenance même, là où elle s’en croit détachée ? Bref, E.C. tient ici la philosophie à distance, interpelle silencieusement le lecteur : que lit-il ? Qu’est-il donné à penser, et penser peut-il encore être tenu pour une décision extérieure à celle de la foi ? Chemin faisant, il se pourrait que la philosophie s’avère de part en part déterminée par la manifestation telle qu’elle est ici décrite. Alors, Jean ne serai-il pas le mémorial de toute philosophie et son témoignage, le mémorial de toute proposition ?
Ainsi, le problème de la relation entre philosophie et théologie n’est pas seulement le problème qui précède la lecture du livre ici commenté : il est aussi le problème que ce livre lui- même ne cesse d’affronter.
Comment l’affronte-t-il ? En écrivant, très précisément, une « phénoménologie selon Jean ». Phénoménologie est alors le nom de la dimension où la relation de la philosophie à la parole de Dieu vient se nouer. Que faut-il entendre par là ? Commençons pour répondre par dire, de la langue ou du style du livre d’E.C, quelques mots liminaires. Ce style ou cette langue, méditante, parfois presque priante, fut déjà ailleurs celui de l’auteur mais sa radicalité en devient ici, et peut-être parce que l’interlocuteur du livre n’est pas un philosophe, absolument souveraine. Mais le style est encore ici au service du propos lui-même. La « religion » – si tant est qu’une catégorie de ce genre puisse encore opérer – n’est pas ici un simple document dont le concept aurait à s’emparer, ce qui est encore typiquement, nous allons y revenir, la position hégélienne. Au contraire, elle est maintenue dans ce qu’on pourrait appeler sa positivité. Le texte de Jean s’avance ici comme un véritable monument phénoménologique, et c’est pourquoi E.C peut parler une langue priante sans contredire la nature philosophique de son travail. Un monument phénoménologique, qu’est-ce à dire ? Qu’il montre. E.C donne ici à Jean une portée comparable à nulle autre : il montre, dans le secret de son écriture, la vérité s’avançant personnellement, il montre cette avancée, qui supposera don de soi, lumière, réception, refus, sacrifice, décision d’entendre et d’accueillir. Jean, par là, montre tout. Il manifeste la mesure même de la manifestation, et parce qu’il la mesure, il n’y a rien à ajouter à son texte, seulement à le rejoindre. Son texte est vrai, il est la vérité, ne requiert pas d’être repris ou dépassé par une analyse ultérieure – il requiert simplement qu’on le laisse résonner. La vérité, autrement dit, n’est pas posée comme reposant ailleurs que dans la manière dont, selon Jean et pour lui, elle se destine. Qu’un témoignage puisse être, non seulement vrai, mais toute la vérité – telle est au fond la proposition à laquelle se mesure le livre d’E.C. Mais c’est précisément cette situation d’énonciation elle-même – que la vérité se montre dans l’écriture d’un évangile, à des témoins, pour d’autres témoins ; que la vérité soit une personne s’offrant à d’autres, en les interpellant, en leur laissant la liberté de témoigner – qui sera l’objet, philosophique à présent, de la méditation.
Témoin
Tout commence en effet avec la figure du « Témoin ». Cette figure est multiforme : Jean est le témoin, mais les personnages de son évangile sont, eux aussi, des témoins – Jean-Baptiste témoigne de la venue du Christ (p.16-17), le Christ témoigne qu’il est Fils de Dieu (p.21) –, les disciples sont pris à témoin, et nous-mêmes, lecteurs tardifs, « frères » cependant car nous appartenons à ce que nous lisons, le sommes également (p.9). Multiforme, le nom de témoin est alors essentiel à l’évangile lui-même, témoignage d’un témoignage. Mais est-il essentiel au contenu de l’évangile, à cette vérité qu’il annonce ? Qu’il y ait à témoigner de la vérité, n’est-ce pas la vérité même de Jean ? Telle est, en un sens, la thèse soutenue par E.C dans ce premier chapitre. Pour le dire formellement, entre la vérité et l’acte d’en témoigner, il n’y a pas d’extériorité : dès le commencement, E.C nous amène à penser que la vérité n’est rien d’autre qu’un témoignage : ce dont on témoigne, mais aussi ce qui nous prend à témoin. La vérité même requiert des témoins, nous requiert comme témoins. Elle n’est, autrement dit, pas un contenu indifférent aux conditions dans lesquelles il est énoncé : la vérité, c’est la manifestation dont on a témoigné, la manifestant devant témoin, la manifestation accomplie dans le témoignage. La vérité n’est pas transcrite par des témoins, la vérité est qu’il y a des témoins – ce qui se manifeste, c’est la possibilité, partout ouverte, de témoigner de ce qui se manifeste. Circularité singulière, sur l’énigme de laquelle E.C ne cessera inlassablement de s’établir, et qui nous prend, à notre tour, à témoins.
Et qui est le « nous » ? La question s’impose sans nul doute, car la vérité s’inscrit dans un tel « nous », celui des disciples puis de l’auteur et de la communauté de ses lecteurs, eux-mêmes pris à témoin. Mais Jean écrit en grec, et il écrit aussi pour des païens, dans la langue païenne de la philosophie, d’un tout autre étonnement face à la manifestation que celui qui régit son propre témoignage. Si Jean témoigne de la manifestation, c’est à la philosophie, et à sa propre compréhension de ce qui est manifeste, que son témoignage s’adresse aussi. C’est aussi la philosophie qui est prise à témoin, la philosophie à laquelle Jean, en grec, dans sa « langue natale » vient personnellement s’adresser. Mais quel est le sens de cette adresse ? Jean n’est pas un penseur, il est un témoin. Il n’arpente pas, mortellement, le domaine de la vérité mais vient se placer devant la venue de la vérité, telle qu’elle est présente à lui, telle qu’elle vient, en se manifestant, l’interpeller.
Et voilà le premier trait de ce qui est à penser : la vérité n’est plus le domaine de la philosophie mais celui qui prend à témoin la philosophie de sa propre survenue. La vérité s’adresse à la pensée, elle vient devant elle et penser, ce n’est plus s’ouvrir au domaine du vrai mais comparaître personnellement devant la manifestation de la vérité.
Le témoignage, en sa structure phénoménologique : l’appel du témoin, la prise à témoin, la réponse du témoin – proprement le témoignage –, l’écho du témoin, prenant lui-même à témoin ceux qui l’entourent, est donc la structure même de la manifestation johannique – c’est-à-dire chrétienne – de la vérité. Mais par cette structure, la manifestation est circulaire : la vérité requiert le témoignage qui requiert lui-même la vérité. E.C rencontre alors par cette description inaugurale un problème classique : comment croire que Jean est véritablement témoin, comment croire le témoin sans être nous-mêmes des témoins, sans être étroitement et personnellement concernés par ce dont il témoigne (p. 12) ? Problème qui se connaît traditionnellement sous le titre de « cercle herméneutique ».
Le témoignage, à mieux voir, pourrait bien toutefois être la solution d’un tel problème et non le problème lui-même. Mais cela à une condition : que nous témoignions nous-mêmes toujours déjà pour le témoin, c’est-à-dire : que nous soyons nous aussi d’ores et déjà les témoins, que nous ayons déjà été interpellés par l’aletheia, ou plutôt que nous lui appartenions d’emblée, en sorte que ce dont Jean témoigne nous prendrait également à témoin. Si tel était le cas, alors nous n’aurions pas à authentifier le témoignage puisque son contenu même indiquerait son authenticité. À l’inverse, si la manifestation avait lieu sans nous concerner, alors il nous serait à jamais impossible de l’entendre et de la pénétrer.
Mais de fait, montre E.C : nous appartenons à cette prise à témoin. Pourquoi et en quel sens ? On ne saurait trop y insister, Jean n’est pas celui qui a vu, il est aussi celui qui a écrit, c’est-à- dire montré, nous adressant personnellement à nous, ses frères, son évangile. Or, que la vérité nous soit adressée n’est pas une dimension secondaire de la manifestation. La vérité nous demande de devenir ses défenseurs, contre le monde. La vérité, c’est que nous sommes demandés, ou plutôt, envoyés. C’est cela qui se manifeste, et c’est en répondant qu’alors, ce qui se manifeste, devient véritablement manifeste, est susceptible d’être gardé et de demeurer auprès de nous. Dit autrement, la vérité nous envoie la défendre, c’est-à-dire en témoigner, et c’est de cet envoi que nous sommes témoins autant que de la vérité elle-même puisque cet envoi est la vérité même. Or, cet envoi n’est très précisément rien d’autre que le message johannique, et dès lors il ne saurait être question de « prouver » ce que Jean dit puisque le fait même qu’il le dise, ou plutôt qu’il l’écrive, est la vérité même de son propos : Jean ne fait qu’indiquer que « nous » sommes pris à témoin. À travers lui, c’est la manifestation même qui vient nous convoquer. Mais si la vérité a besoin d’envoyés, nous en répondons autant que nous y répondons et plus précisément, si la vérité vient, c’est pour requérir de « nous » que nous la gardions – et la garder, c’est « aimer » le Christ, l’amour étant ici entendu à la lumière de la garde, par l’entremise de laquelle la vérité qui nous est envoyée « restera » auprès de nous, rassemblant ceux qui, dans le monde, en sont séparés par leur mondanité (p.12). (Le monde restera en effet séparation : il ne s’agit pas seulement de le quitter mais aussi de le combattre – les chapitres suivants y reviendront en profondeur.)
À son tour et de son côté, Jean « reste » pour autant qu’il témoigne. Mais son témoignage ne « restera » lui-même que pour autant qu’il trouvera des défenseurs. On pourra dire que ces derniers auront été « inspirés » par le témoin ; mais aussi et plus radicalement encore que ce n’est que par ces défenseurs que le témoin reste témoin. Un témoin que plus personne ne croit ne peut plus témoigner. Ainsi se forme le « cercle des défenseurs » qui est l’unique mode de présence de la vérité. Et à mesure que les défenseurs « aiment » le témoignage, ce dernier les « envoie » toujours davantage l’aimer, de lui ils reçoivent l’amour : cercle, en effet, qui n’est autre que la dimension relationnelle, ouverte, de la vérité, qui est essentiellement don d’elle-même, envoi, et donc, témoignage ou exposition de soi à d’autres – dans une dimension adverse, le monde, comme s’y attardera le chapitre suivant.
Cercle qui est au fond retour à soi mais aussi distance de soi à soi, et donc, impossible réconciliation du témoignage : on ne témoigne pas de soi, on ne s’annonce pas ; on est annoncé. Le témoin ne s’avance pas de lui-même, il est toujours attendu, et son témoignage lui-même consiste à attendre de s’effacer de celui qui vient (p.16) Jean-Baptiste, Jean, Jésus eux-même sont des témoins sur ce mode, des témoins qui s’effacent, qui ne sont venus que pour témoigner, et par conséquent, ne « restent » qu’en prenant à témoin. Il n’y a là rien de contingent : c’est la vérité elle-même qui est témoignage, c’est-à-dire effacement et offrande de soi, attente et promesse, espérant être reprise par d’autres témoins. La manifestation, s’adressant, se risque et s’humilie, jusqu’à son retrait radical, par lequel seuls ses témoins, qui lui répondront, pourront continuer à vivre en elle et, ce faisant, à l’inspirer à d’autres. La manifestation a besoin d’inspirer des témoins pour ne pas disparaître. Mais les témoins devront disparaître dans la vérité même qui les inspire. Pour le témoin, vivre voudra dire s’absenter, mourir à lui-même en prenant vie dans le « cercle des défenseurs ».
Cet effacement du témoin se dégage d’un autre trait, souligné par E.C : Jean témoigne de celui qu’il n’a pas vu (p.17). Il témoigne au fond seulement du fait qu’il est envoyé annoncer quelque chose de plus haut que lui, quelque chose à la mesure de quoi il ne peut se tenir. Cela renverse la signification juridique du témoignage (avoir vu). On ne témoigne plus d’un état de certitude mais d’un état de confiance et d’attente, c’est-à-dire d’appartenance à une manifestation qui est moins présente que passée – toujours déjà annoncée – et future – toujours encore à venir. Plus encore que la vision, qui peut, par principe, être indifférente à ce qu’elle voit, la confiance suppose l’appartenance à ce qui est confié. La vérité n’est pas vue par le témoin, elle est confiée au témoin, elle ne vit qu’en lui. E.C le formule ainsi : « Jean ne témoignera pas de la manifestation, mais pour la manifestation » (p.17). Mais « que veut dire témoigner pour la manifestation sinon être envoyé pour elle ? » Le témoignage n’est pas la preuve mais « le mot qui fraye un chemin », « annonce plutôt qu’il ne rappelle, attestant ce qui vient », ou plutôt peut-être, que quelque chose vient. Mais s’il annonce, c’est qu’il est inspiré, c’est-à-dire à nouveau, envoyé dans le monde : c’est là d’où il vient, et c’est exactement la mesure de la présence de pneuma, de l’esprit, sur lequel le troisième chapitre s’arrêtera. L’esprit, cependant, est déjà là, demeure. L’esprit est la maison qui accueille le témoignage, mais c’est le témoignage qui ouvre sa maison. Le témoignage est donc l’attente de celui qui est déjà, mais qui cependant est à venir. Le témoignage n’est inspiré qu’en inspirant. C’est alors de ce nouveau cercle, de cette nouvelle version du cercle, qu’il faut tirer le sens propre de la Révélation : elle ne vient pas « d’ailleurs » – à moins que « l’ailleurs » ne se mesure au monde – mais elle vient de ce qui est toujours ici, de ce qui nous précède ici même, pour nous envoyer le défendre, c’est-à-dire élargir le cercle des défenseurs, des frères. La manifestation ne surprend pas le regard, elle le reprend, le restitue à soi.
Le témoin est donc second, vient toujours après celui qu’il annonce et qui, déjà, l’aura envoyé l’annoncer. À cet instant de la méditation s’ouvre un horizon sur la signification dialectique de la Trinité, comprise exclusivement à la lumière du témoignage : le Père envoie le Fils annoncer le Père, le Père sera du témoin du Fils comme le Fils est témoin du père. Cette secondarité est dynamique : le témoin engendre le témoignage, et il est essentiel au témoignage d’être une réponse, et au témoin d’être un disciple – et non un simple observateur. Même le Maître est un témoin, lui aussi a été envoyé (p.21).
Le propre du témoin, c’est alors un « croire radical » (p.22) : il doit s’élever jusqu’à ce qui est insaisissable au monde. Croire, cela veut dire : accueillir. C’est un « tournant de l’être », un « se- tourner vers » et un « se-détourner-de », comme le montre E.C en citant J. Ratzinger et en glosant sur le concept de « conversion » (p.22, n.1). Croire, c’est recevoir, se laisser faire, « laisser » qui n’était toutefois pas une passivité mais la plus haute activité, la conversion, Be-kehrung, exigence absolue, dont le « non », le refus, est la possibilité la plus propre, en sorte que le témoin annonce aussi le « non » que lui opposera le monde. Mais derechef, qu’est-il donné à croire sinon, précisément, que la parole témoigne de quelque chose, dont nous sommes à notre tour pris à témoins, ou mieux encore, témoigne que nous sommes pris à témoins ?
Ainsi, témoignage et réception – ou non-réception, et ce « ou » est maintenant déterminant -ne sont rien d’autre que la structure dialectique de la vérité, ce qu’E.C appelle son « accomplissement » (p.23). La vérité a besoin de témoins, elle s’offre, au risque d’être jugée et non attestée. Cet accomplissement propre à la vérité, Jean l’appelle aussi : la Vie. La vérité donne vie en s’accomplissant, et pour qui ne la reçoit pas, donne le jugement. Celui qui ne veut pas vivre sera jugé, au même sens où il juge lui-même : par lui, le cercle aura été rompu. Quel sens juger reçoit-il ici sinon celui de séparer, de rompre ce qui est un, et d’abord en s’en séparant ? Inversement, le témoin est envoyé pour donner la vie. Quel est encore le sens du « vivre », sinon « laisser apparaître le manifeste de la manifestation » (p.23) ? Vivre, c’est voir et appartenir à ce qu’on voit, en un sens toutefois très précis et très biblique du voir ou du connaître : il est ici entendu que « voir », ce n’est jamais rester extérieur à ce qu’on voit mais au contraire être « touché », « converti » par ce qu’on voit, et en ressortir transformé. Mais ce que l’on voit transforme aussi ce qui est vu : témoigner de la vérité n’est pas indifférent à la vérité, c’est l’accroître, l’augmenter, l’accomplir. Telle est sans doute la relation entre « vivre » et « témoigner », certes laissée dans l’implicite par E.C, mais qu’il s’avérera de proche en proche nécessaire de confronter aux analyses de la vie proposées par Michel Henry. Car si pour Henry, la vie est hors du monde, chez E.C, vivre, c’est recevoir la vérité dans le monde et s’en séparer sans le quitter, c’est-à-dire précisément témoigner et croire.
Inversement, ne pas recevoir la vérité, c’est à la fois refuser de témoigner et refus la lumière du témoignage, c’est la haine de la lumière et le refus d’aller dans la lumière (p.23). Aller dans la lumière, c’est, encore à l’inverse, « faire la vérité », c’est-à-dire s’établir « dans le theos ». Dans le Dieu : Dieu n’est plus l’absolument transcendant mais la maison que nous habitons dès lors que nous rejoignons le foyer de l’appel, qui est l’appel à inviter de nouveaux habitants, à « faire » la vérité. « Faire la vérité est oeuvrer dans le theos que personne n’a jamais vu », oeuvrer, c’est-à-dire y venir et y être éclairci. Le témoin participe alors à la vie de Dieu, contribue à le glorifier, mais cela parce qu’il choisit la manifestation : « la décision est décision pour la manifestation, le tournant vers la manifestation » (p.25). Ainsi faut-il comprendre la vie, qui n’est pas dans le monde mais bien, cependant, témoignage devant le monde.
À ce titre, le témoin est roi, règne sur la vérité. Mais non par un pouvoir : sa royauté n’est pas mondaine. Le roi, précisément, est témoin, c’est-à-dire serviteur. Sa royauté est de servir. Mais servir, cela veut dire : prendre à témoin et ainsi à la fois enlever les témoins du monde et envoyer les témoins dans le monde, afin qu’ils témoignent pour la vie. La royauté consiste à engendrer le témoignage, à le libérer. C’est-à-dire à l’envoyer au combat : à nouveau, la dimension polémique de la vérité en est un moment essentiel.
Les analyses d’E.C retrouvent sans les répéter celles que mène J.L. Chrétien sur l’interprétation augustinienne du témoignage. J.L. Chrétien montrait dans Saint Augustin et les actes de la parole (PUF, « Epiméthée », Paris, 2002, p.138), non seulement que le témoignage se fonde sur le tiers, qui donne à croire l’autre, à se recevoir respectivement pour témoins, mais aussi que témoigner, c’est montrer par tout son être la lumière dont on provient, sans l’obscurcir (p.139). Il s’agit d’être les témoins de Dieu en nous puisqu’il n’y a pas d’autre manière de témoigner de lui (p.140). Mais témoigner de lui, c’est témoigner qu’on se déplaît à soi (p.140), c’est gémir et se confesser, c’est-à-dire au fond, s’effacer, se manifester comme néant, et par cette manifestation de plus haut que soi en soi, « le témoignage humain fait partie de l’économie de la Révélation » (p.141). Pourtant, Chrétien souligne à cet instant un paradoxe : la vérité prend à témoin, mais n’a pourtant besoin que son propre témoignage – « la lumière montre les autres choses et se montre elle- même » (p.144). Augustin, lui, explique ce paradoxe par la finitude : trop aveugles pour ne pas être éblouis par la lumière, nous avons besoin d’une lampe, d’un intermédiaire qui habitue nos yeux à voir ; il l’explique aussi par la grâce : être pris à témoin, c’est recevoir l’esprit (p.145), et ainsi pouvoir écouter le témoignage suprême, celui de l’amour du Christ pour les ennemis. On peut alors penser qu’E.C., avec Jean, va plus loin que Chrétien avec Augustin. Finitude et grâce sont certes du moment du témoignage, mais est-ce suffisant pour comprendre pourquoi, envoyés dans le monde, nous collaborons à la vérité ? Pour comprendre que la manifestation de la vérité a besoin de nous autant que nous avons besoin d’elle ? Chrétien va toutefois jusqu’à remarquer qu’envoyés dans le monde, nous le sommes à en mourir (p.146-7), le martyre constituant l’extrême témoignage, la parole soutenue jusqu’au bout, c’est-à-dire la parole qui atteste et authentifie le témoin. Cette dimension tragique de la manifestation qui requiert le sacrifice de ses témoins, les chapitres suivants du livre d’E.C ne cesseront de s’en approcher.

Revenons encore pour l’heure au propos initial. La coappartenance de la vérité et du témoignage, montre E.C., prive alors la question « qu’est-ce que la vérité ? » de son sens. Car la vérité est un « qui », elle est le roi, c’est-à-dire aussi et en même temps le témoin lui-même. La vérité n’a pas de contenu autre que sa propre survenue interpellante : le message, c’est le messager.
Survenue interpellante, la vérité suppose l’altérité. Nul n’est la vérité lui-même. La vérité suppose en effet qu’on lui rende témoignage, qu’on l’authentifie. Elle ne s’auto-atteste pas. Le Fils atteste du Père, et retour, par les œuvres et les écritures ; le Christ ne vient que dans l’ouverture d’un témoignage : le témoignage passé, immémorial – imprépensable, à utiliser un terme schellingien – du Père ; le témoignage futur, historique de ses frères. Certes, le Christ atteste bien de lui-même : « moi, je suis le chemin… ». Mais, chemin, vie à venir, il témoigne par là du Père qui l’a envoyé. La vérité est chemin vers elle-même.
L’ensemble de ces traits se rassemble finalement dans l’idée que le témoignage, seul, est la mesure de la manifestation de la vérité. Mais cette idée donne alors une indication sur le sens même du livre que le lecteur tient dans ses mains. Si la vérité est un témoignage, elle n’est pas un simple jugement adéquat, une représentation droite ou une conception correcte. Aussi est-il clair qu’E.C ne prétend pas, en lisant Jean, décrire ou résumer la « conception chrétienne de la vérité », fût-ce sous son versant johannique, qu’il faudrait associer à d’autres sources, à des représentations ou à des thèses complémentaires. Il prétend, plus simplement et plus radicalement, déployer la question suivante : comment la vérité peut-elle susciter un témoignage relatif à sa venue, qu’est-ce que sa venue pour susciter un tel témoignage ; et qu’est-ce que le témoignage de la vérité, au double sens du génitif ? Dès lors, en écrivant, il s’agira de montrer, (et non de démontrer), mais de montrer depuis un centre dérobé, celui de l’appartenance à ce que l’on montre, à ce que l’on voit. La phénoménologie est donc ici replacée devant son principe directeur : rejoindre l’appartenance même du narrateur à ce qu’il a devant lui. E.C écrit à ce titre, et tel est le centre dérobé de ce premier chapitre, un véritable jalon de la phénoménologie en tant que telle.
Que la vérité se montre est une chose, que la philosophie puisse à son tour en remémorer la manifestation en est une autre. Si Jean est le témoin de la vérité, E.C adopte ici la posture du témoin de Jean, le témoin du témoin, et en cela il n’est plus le narrateur d’une révélation mais son penseur. Et que voudra dire alors penser la manifestation sinon la laisser à elle-même, et en la laissant, s’y ouvrir, appartenir décisivement à sa survenue ? La langue du livre est à ce titre, on ne saurait trop y insister, une langue authentiquement phénoménologique, qui laisse l’apparaître s’avancer en sa manifesteté essentielle, et plus encore qui tente d’y appartenir, c’est-à-dire d’appartenir à ce qu’il décrit : manière, aussi, de mettre en question la relation singulière de l’écriture philosophique à la théologie elle-même. Mais alors, à suivre ce chemin, et c’est une première réponse à la question formulée plus haut, le johannisme ne peut qu’être la langue natale de la philosophie, le grec de la philosophie le laissant survenir, ou plutôt le laissant se révéler comme sa provenance même. Difficulté majeure, sans doute, si le grec philosophique n’est pas une langue inspirée. La philosophie, toutefois, échappe-t-elle à toute inspiration ?
La question est d’autant plus centrale qu’en invoquant une « phénoménologie de l’esprit selon Jean », en assignant à Jean la dignité d’un phénoménologue, l’auteur se tourne et nous tourne inévitablement vers la phénoménologie de Hegel, avec laquelle le texte johannique sera, de proche en proche, mis en relation. Mais quelle relation ? Hegel a bien été, lui aussi, un penseur de la venue de la vérité, de sa parousie spirituelle, et le savoir absolu vient chez lui se confondre avec le contenu de la religion manifeste. S’agira-t-il alors, soumettant alors le texte saint à la philosophie, de lire Jean à partir de Hegel ? S’agira-t-il au contraire, dans le mouvement inverse, de retrouver, dans Jean, les prémisses ou les conditions de possibilité de la compréhension hégélienne de la vérité comme savoir absolu et du savoir absolu comme terme d’une phénoménologie de l’esprit ? Bref, est- ce Hegel qui est johanniste, qui introduit en philosophie la compréhension johannique de la vérité, ou au contraire Jean qui, en auteur religieux, ouvre déjà la dimension dans laquelle la pensée hégélienne se sera ultérieurement établie ? À moins qu’aucun des deux auteurs n’ait véritablement antécédence sur l’autre, que l’un et l’autre puissent être placés dans la synchronie d’un cercle.
Derechef, c’est la place respective de la théologie et de la philosophie, de l’écriture du témoignage et de l’écriture de la pensée, qui est ici en cause. Entre le système et le témoignage, quel est le commencement qui a déjà commencé, à qui la parole revient-elle originairement ?
Quoi qu’il soit, il est clair que l’effort singulier d’E.C pour rejoindre ce dont Jean témoigne et qui est, sans nul doute, un effort personnel, se rapporte à la tentative du même auteur pour rejoindre Hegel. La dimension personnelle de l’apparaître est en effet la clef de voûte de l’interprétation de la « simplicité » hégélienne dans le livre que l’auteur avait publié sur la Phénoménologie en 2010. Que l’apparaître soit venue au jour hors de soi, c’est-à-dire offrande de l’esprit, don de soi, revenait en effet à soutenir qu’il était personnel, que la dimension personnelle de la vérité était pour Hegel – et il en va aussi pour Jean, dans une écriture différente – son essence même. Alors, la vérité est phénoméno-logie, verbe de l’apparaître et apparaître du verbe, et la phénoménologie, loin d’indiquer seulement le style d’écriture, descriptive et monstrative, à laquelle se livre l’auteur, est l’essence même de la vérité, la mesure de ce cercle reliant l’apparaître et le verbe étant le mouvement absolument personnel du don de soi s’abandonnant et se promettant au monde. Bref, Jean rejoindrait, tel qu’il est lu ici, la tautologie hégélienne d’une vérité qui se manifeste, d’une manifestation manifestant sa propre vérité.
Esprit
Ce chemin circulaire est celui de la manifestation. Tel est ce que décrit le troisième chapitre, c’est-à-dire le centre du livre. Son sujet est l’esprit : mot hégélien par excellence. Que dit Jean de l’esprit et qu’en retient E.C ? « Esprit » : ce troisième texte pose derechef une question, celle d’une « présence déconcertante », déconcertante parce qu’elle précède, inspire le témoignage, et en même temps qu’elle en dérive. Qui est l’esprit ? Non pas tant celui qui est vu que celui qui montre, attestant l’authenticité d’une autre présence, celle du témoin lui-même. « L’esprit est le témoin témoignant pour le témoin » (p. 64), plus spécialement celui qui « ouvre le domaine d’apparaître du fils en tant que Fils », « la lumière dans laquelle le Fils apparaît en tant que lui-même » (p.65). Mais si l’esprit ouvre la manifestation, il « demeure », est « celui qui reste » (p.66). Il n’est pas seulement « signe de reconnaissance » mais aussi « signe d’attente » ; à nouveau, mais autrement, « sa présence renvoie à une autre » (p.67), à une présence à venir, celle du Christ qui revient. Spirituelle est la présence qui laisse apparaître l’attente, la présence qui envoie attendre. Cela veut dire que l’esprit est, véritablement, « le domaine dans lequel les disciples sont envoyés dans le monde, la dimension ou la présence qui les entoure, dans laquelle, se tenant dans le monde, ils se tiennent cependant en tant que témoins qui ne sont plus du monde » (p.69). Mais ce domaine est une présence qui leur est d’abord elle-même transmise et envoyée ».
Qui est alors l’esprit ? Celui qui se montre, qui « souffle s’il veut » (p.70-71). L’esprit se déploie comme esprit, « une activité qui n’est pas différente de son être, de celui qu’il est, qui est le pur déploiement libre de lui-même » (p.71). Est-ce dire que l’esprit n’est pas substance mais sujet ? Sans nul doute et ce déploiement libre s’appelle « manifestation », ou « libre donation » : l’esprit est « provenance pour toi », même si tu ne sais rien de sa provenance ni de son départ. L’esprit serait à ce titre la liberté même de Dieu, « la manifestation elle-même » (et il n’est pas fortuit qu’E.C renvoie très précisément à cet endroit à Hegel). Et ce faisant, il donne, il est reçu (p.72) ; mais puisqu’il manifeste en donnant, il est la dimension où tout don se manifeste, il est « ainsi la donation elle- même, la dimension de la donation en laquelle se tient tout don d’en haut » (p.75). Bref, « esprit est le nom de la source qui se donne elle-même : il donne ce qu’il est lui-même. Si Dieu est esprit, c’est selon cette dimension du don qu n’a pas de mesure sur la terre ni de la terre » (p.76). Don qui vient, derechef, renverser la chronologie puisqu’il donne la présence propre du « rester » de l’esprit et du « venir » du Christ (p.77).
Don de la manifestation, l’esprit qui reste donne à voir : précisément à voir le Christ, « à voir que le Christ vit, et le voir en cette mesure est lui-même un vivre » (p.79). La mesure de la vie, à nouveau, n’est pas la chair mais l’esprit, c’est-à-dire l’ouverture au manifeste. Ainsi, l’esprit « conduit » au Christ, « sera le guide dans l’aletheia, et cela veut dire : guidera dans la manifestation toute entière » (p.80). Mais, guide, l’esprit répond à l’absence de Jésus, à son adieu, qu’il laisse attendre, espérer, et revenir : « il faut qu’il parte pour venir » (p.82). Dialectique : « la séparation seule ouvrira la proximité qui s’appelle to pneuma ». Par là l’esprit est défenseur, confondra le monde et rétablira la justice dans l’injustice mondaine. Cette dialectique est la mesure du futur : la réconciliation est à venir, suppose le déchirement présent, en sorte qu’il « y a une retenue essentielle dans l’aletheia » avant « l’accomplissement final, l’événement vers lequel elle est elle-même en chemin » (p.84) et qui est l’envoi de l’esprit. L’esprit vient après et pourtant il vient attendre. Par là encore, l’esprit est la « volonté de theos d’être auprès de nous », cet « être-auprès-de-nous » déjà évoqué, encore, par Hegel (p.85) – volonté répondant à une autre volonté, la requérant sans doute.
Bref, à la question de savoir qui est, au fond, la vérité ? Jean répond : pneuma, Esprit. L’Esprit est à la fois ce qui se montre et ce qui est montré. L’Esprit est la manifestation du manifeste, est toujours hors de lui, sans réconciliation. Il est double, toujours irréductible à lui- même. Il est ainsi envoi de la vérité, il la destine à son autre, c’est-à-dire qu’il s’abaisse jusqu’à lui, se sacrifice, s’abandonnant à nous comme l’un des nôtres, signe, à ce titre, de ce qui se manifeste et dont nous témoignons.
La proximité entre Jean et Hegel s’éclaire autrement, et plus profondément encore. La structure du livre est au fond, fidèlement à son titre, celle de la venue de la vérité. La vérité vient. Elle vient à quelqu’un, et elle vient de quelqu’un. Cela veut dire qu’elle se manifeste, qu’elle se donne et se risque à ne pas être reçue. Sa lumière n’éclaire que dans l’obscurité et c’est l’obscurité qu’elle éclaire. La vérité ne s’éclaire que dans la mort et la négation. Ce commencement place Jean sous le sceau de la dialectique. Mais c’est la théologie même qui est, en son essence, dialectique dès lors qu’elle envisage – et tel est bien le propos johannique – la grande confrontation de la vérité et du monde. Le monde est le destinataire de la vérité. Il est, lui aussi, quelqu’un, celui qui est à l’encontre de l’apparaître, qui apparaît lui-même dès lors comme encontre, comme contrée ou comme contre-champ de la manifestation. Cette apparition du monde est celle d’un refus : le monde est celui qui n’accueille pas le vrai. La manifestation de la vérité se confronte ainsi radicalement à la possibilité de sa ruine, à l’énigme du mal. Mais cela veut dire aussi que le monde est le terme au regard duquel la vérité se recueille comme sacrifice de soi, comme risque et offrande. La vérité témoigne d’elle-même dans un monde qui ne la voit pas. À ce titre, elle est logos, et telle est son histoire.
Monde
Tel est l’esprit du deuxième chapitre, « Monde ». C’est alors une toute autre dimension qui est abordée. « Monde » est le nom d’un domaine : celui où se produit le témoignage. Le monde n’est donc pas, en lui-même, une provenance, il est un domaine à venir. Mais c’est toujours pour quelqu’un que se produit le témoignage. Le monde est donc le domaine de quelqu’un, ou plutôt il est lui-même quelqu’un, s’il est le « qui », habitant ce domaine. Il faut demander : qui est le monde ?, et répondre : celui à qui la vérité vient, brille et paraît. Le monde est à ce quoi la vérité se destine. Mais il est aussi celui qui ne l’a pas saisie, qui l’a refusée, obscurcie. Par là, il est le domaine des ténèbres, de l’obscurcissement de la lumière.
E.C commence ici par creuser cette ambivalence, au titre de laquelle il est impossible d’exclure le monde de la Révélation, de l’y opposer simplement. Précisément, le monde n’est pas étranger au logos, au contraire le logos « était chez lui » dans le monde (p.39). Le monde n’avait pas à lui devenir étranger : il était originairement le domaine de la manifestation ; et il s’est rebellé, précisément rebellé contre ce qu’il était lui-même, à savoir domaine de la vie, si vie veut dire « advenir de ce qui est dans le logos ». Le monde n’a pas voulu admettre cette survenue. Mais c’est peut-être parce qu’il n’accepte pas d’être lui-même survenu à son encontre, d’être un domaine second, celui de l’obscurité nécessaire pour que s’avance la lumière. Le monde n’admet pas sa propre provenance. Le monde ne veut pas être ce qu’il est, ne veut pas appartenir à ce qui lui survient, ne veut pas de sa propre vie, ne veut pas vivre. (C’est à l’occasion de cette remarque qu’E.C s’oppose très explicitement à Michel Henry. Si, en effet, le monde ne veut pas de ce qu’il est, c’est qu’il est vivant et lumineux avant de préférer les ténèbres et pour les préférer. Il n’y a, autrement dit, aucun motif légitime de séparer la Vie et le monde, a fortiori pour les opposer. La vie est originairement vie du monde. Mais cette vie du monde, c’est le logos, puisque le monde est le nom du déploiement primordial du Verbe, de la manifestation, où tout se rassemble. Ainsi, là où Henry fonde l’ensemble de sa phénoménologie sur la dichotomie de la vie et du monde, « l’immanence de
la vie au logos », et par là « le sens d’être du monde » atteints par E.C privent à eux seuls cette fondation de sa légitimité. Henry aurait au fond manqué radicalement le phénomène de monde, ou mieux, la dimension révélée, manifeste, dans laquelle ce phénomène prend place et qui ne doit pas être compris comme extérieure à la dimension de la vérité.)
Ce n’est donc pas le monde qui est étrange mais sa révolte qui est étrange, tant le monde et le logos avaient à se coappartenir. La séparation ne prévalait pas. Elle n’était pas donnée, ni prévisible. Et pourtant elle eut lieu : le monde a porté en lui un « non » radical. Qu’en est-il alors de cette négation ? Elle est négation de la vie, dénégation du logos en tant que c’est lui qui fait vivre, ou plus simplement, en tant que c’est lui. Le logos est venu et n’a pas été reconnu. Dès lors, par cette non- reconnaissance, la manifestation a lieu, mais elle est ruinée, ce qui se manifeste n’apparaîtra pas. De ce « non » qui délite l’éclat du paraître, il faut alors trouver la mesure. Or, s’ouvre ici l’espace d’une difficulté, qui va s’avérer, de proche en proche, comme la plus décisive.
Dans le « non » opposé par le monde, E.C reconnaît un écho du « tragique » (p.42). Il faut interroger cette association. Le monde lui-même aurait dit « non » aux phénomènes, ne les aurait pas laissés. « Ne pas laisser », « refuser » sont les mots du tragique. Ici, c’est par les siens, chez lui, que le logos est nié, qu’il n’est pas laissé être. Or, et telle est la difficulté, la question la plus exigeante serait alors de demander quelle est la mesure de ce « non ». Est-il encore de l’ordre de la volonté ? Est-ce la volonté de révolte qui est, par sa seule apparition, tragique ? ou le « non » n’est pas plus profond encore, comme un mouvement qui appartiendrait à la vérité lui-même, à son retrait qui ouvre la possibilité de son refus ? E.C donne à ce sujet de discrètes mais importantes indications. Si la volonté est mauvaise, l’absence, elle, est funeste. Or, c’est bien elle pourtant qui appartient à la manifestation : si le logos peut « ne pas être accueilli », c’est à partir de son absence, de son retrait, c’est-à-dire à partir de la manière dont il se manifeste – et il se manifeste en se risquant, il se manifeste de manière à s’effacer devant ses témoins à venir, ou à s’effacer derrière ceux qui le refusent. Il y a donc une dynamique de la manifestation, à laquelle appartient, en propre, un tel retrait.
La mesure de ce retrait, du congé propre au logos, est-elle alors seulement sa non- reconnaissance ? Telle est l’interprétation proposée par J.L. Marion dans son ouvrage D’ailleurs, la révélation (Paris, PUF, 2021, pp. 241-246). Rappelons-la brièvement pour montrer en quoi E.C s’en écarte radicalement. Marion soutient que le propre de la Révélation tient à ce que la donation qui joue en elle ne se déploie en vérité que dans le donné auquel elle s’abandonne : le don, c’est-à-dire le Fils, n’occulte pas sa provenance, le Père, mais la glorifie puisqu’il en montre toujours l’éclat en lui-même et comme lui-même. Autrement dit, la donation ne se replie pas et se déploie au contraire dans ce qu’elle donne, et ce, de manière infinie, puisque le don se donne sans fin. D’où vient alors son retrait ? De ceci qu’il n’y a de don manifeste sans réception ; or, nous qui recevons l’infinité du don ne sommes cependant pas infinis, ne sommes pas à sa mesure, en sorte que ce dont témoigne le Christ, phénomène phénoménologique en lequel la provenance de l’apparaître se donne à voir en étant parfaitement reçue, nous ne le voyons qu’insuffisamment, nous le voyons mal, et ce défaut d’acuité vient que nous ne savons pas le don de Dieu, que nous ne savons pas ce que nous avons sous les yeux. Le retrait et l’invisibilité de la donation prouvent alors selon Marion que la vérité se tient essentiellement « ailleurs » que dans le champ de nos représentations, en sorte que notre finitude est l’unique mesure du retrait de la manifestation, c’est-à-dire de son refus et partant, du mal lui-même. Le mal propre au monde tiendrait à sa manière d’entendre, c’est-à-dire de rester sourd.
Mais les analyses menées par E.C ne témoignent-elles pas de tout autre chose, et n’excèdent- elles pas le champ de la finitude circonscrit par Marion ? N’est-ce pas, au contraire, l’absence même du logos, sa retenue au sein même de ce qu’il montre et de ce qu’il ouvre, qui donne la mesure, tragique, du mal ? L’amour de l’obscurité, qui n’est autre que l’obscurcissement, par le monde, de sa propre source, n’est-il pas précédé par l’obscurité même dans laquelle cette source se réserve et se trouve alors susceptible d’être tenue ? Seul, en effet, le retrait de la source laisse le monde en mesure de se penser comme sa propre source, de vouloir se suffire – et il ne le veut que parce que tout lui est laissé. Le mal serait moins, alors, le propre de l’imperfection mondaine que la funeste aventure de la manifestation elle-même, qui prépare et accueille le refus que les ténèbres lui opposeront.
E.C ne pose pas la difficulté ainsi. Il souligne cependant très clairement que l’ignorance du don de Dieu n’est pas la mesure de sa négation mondiale. Au contraire, dans Jean tel qu’il est lu ici, le mal est plus radical. En montrant (p.48) que le monde, parce qu’il est obscur, parce que « l’obscurité est l’élément de son paraître », « se retire plus profondément dans l’obscurité » à cause des « actions viles » qui s’y produisent, E.C trace à nouveau un cercle – le mal conduit à l’enténébrement du monde qui est lui-même le mal – soulève une question : quelle est la mesure de l’action vile, c’est-à-dire de ce cercle lui-même ? Peut-elle être autre que le « refus de la manifestation », refus « qu’il n’est pas impossible de penser en tant que volonté, puisqu’il s’appelle amour, et qu’il provient du même domaine que ses actes » (p.48) ? En sorte que la volonté d’obscurcir, de ruiner la manifestation, serait la racine même du mal – hypothèse qu’E.C rapporte à Schelling (p.48, n.1) : le monde serait l’acte du « non » à l’apparaître, parce que « le monde hait ce qui ne vient pas de lui », parce qu’il veut « être une provenance » (p.50). Le monde est alors « tentative de devenir lui-même provenance » (p.51), et ainsi, « haine sans raison », sans raison, car « provenance, il ne le fut jamais ». C’est à ce titre que le monde est « révolte » (p.51). Nous en sommes alors revenus à la volonté. Le mal est volonté, la volonté est la mesure du mal. Seulement ? Non, car la volonté appartient elle-même à l’amour, à l’amour de l’obscur, à un amour obscur : la haine. De fait, le monde n’est pas seulement débordé par la bonté du don, il la hait, c’est-à-dire qu’il aime qu’elle soit ruinée : malignité suprême. Mais cette malignité mondiale n’est autre que le désir de rayonner : et celui-ci n’est-il pas aussi, comme le pensait Schelling, le propre de la manifestation véritable ? La haine que le monde voue à la lumière, ne prolonge-t-elle pas la haine de la lumière pour l’obscurité, qui la pousse à aimer se révéler ? En sorte qu’en ayant lieu, en ouvrant un monde, la vérité aurait fatalement introduit le refus dans l’être, car pour elle, être, c’est refuser d’abdiquer. Partant, elle aurait ouvert le lieu de la révolte, aurait laissé la sécession mondiale advenir : tragédie de la vérité, devenir funeste du don, qui seront personnellement trahis, parce qu’ils se seront personnellement abandonnés à la trahison. Et dans cette singulière compréhension du mal vers laquelle le texte d’E.C vient nous acheminer, c’est peut-être toute la nuance avec celle qu’approche Marion, ce n’est plus le mal qui appartient au monde mais le monde qui appartient au mal. N’est-ce pas à ce titre que le monde accueille un prince, le prince de ce monde, adversaire radical du Christ, qu’il laisse toujours régner sur lui, dans un combat spirituel irréductible à un événement de l’histoire ou à un épisode de la dialectique ?
Cependant, l’évangile n’est pas tragique, « laissera la tragédie », en un sens précis : la solitude du témoin abandonné de tous glorifiera encore le Père et sauvera le monde (p. 43). Le temps futur n’est pas employé fortuitement par E.C : le dépassement du tragique n’est pas présent, n’est pas toujours déjà advenu, comme un combat gagné d’avance ; il est à venir ; il faut endurer le présent et l’attendre. Mais le présent lui-même n’est pas seulement tragique, le tragique y est déjà « renversé », sans être encore vaincu, car le sacrifice du Fils envoie des témoins, leur laisse quelque chose dans le monde, au sein même de celui qui refuse le témoignage. Quelque chose est donc toujours laissé, et ce faisant, le témoignage n’est jamais refermé, n’est jamais simplement refusé. Le « non » n’est donc pas le dernier mot, même s’il est le mot, élégiaque, de la plainte. Ce qui reste n’est pas seulement la mort et l’effondrement de toute présence – ce qui contredirait exactement les descriptions de Reiner Schürmann dont la mémoire détermine ce qu’E.C entend ici par « tragique ». Il reste, après la mort et pour elle, une présence apaisante qui a été laissée et que Jean appellera pneuma, l’esprit. La paix survit donc à la révolte, elle s’en nourrit même, puisque l’esprit est renouvellement de la manifestation, relève, dans les ténèbres, l’absence la plus radicale, celle du témoin venu annoncer le Père.
Dès lors – et enfin sur ce point –, la seigneurie de Dieu est à la mesure de cette révolte : la seigneurie de Dieu consiste à venir pour le monde, à servir, ou plus clairement encore : à aimer – et non à juger, car juger, c’est séparer, et seul le monde veut la séparation, c’est-à-dire le jugement (et le jugement est alors ce que le monde reçoit pour lui-même, p. 52). Jésus ne condamne pas le monde ni ne veut pas l’asservir ; il veut littéralement que nous soyons ses amis et non ses serviteurs (car le serviteur ne sait pas ce que fait son seigneur, p.53) : il veut que nous ne le refusions pas, que nous prenions part à son paraître, ou encore : que nous obéissions à ce qu’en vérité, nous sommes, ce qui supposera de cesser d’obéir à ce que nous voulons, pour notre part, être, et à témoigner de ce qui a été voulu pour nous et malgré nous. Or, cela qui a été voulu, c’est cela : la manifestation veut demeurer chez elle dans ce monde, parmi ses amis. Amis, c’est-à-dire : aimés et aimants – mais aussi : témoins de l’amour, et on ne saurait l’être qu’en étant dans l’amour, sous l’amour, c’est-à-dire dans la dimension de la lumière et non laissés dans l’obscurité. L’apparaître de la manifestation est donc l’apparaître de l’amour. Mais plus encore, la manifestation est un acte d’amour, celui par lequel Dieu se montre, s’offre à ceux qu’il prend à témoin. Témoins, nous le sommes toujours de son amour : la vérité, c’est l’amour lui-même, c’est que l’amour soit survenu et avec lui, la lumière. Ainsi, « la manifestation est l’auto-institution de l’amour » (p.54), l’événement par lequel amour il y a, mais aussi l’événement du paraître, face à la révolte du monde : le Christ nous a choisis pour cela, c’est-à-dire pris à témoins. Or c’est cela qui est premier, le monde était au Seigneur, et le refus vient ensuite (p.55). À nouveau cela soulève une difficulté ou plutôt cela soulève à nouveau la même difficulté : l’amour n’est-il pas la « réponse » à la révolte du monde ? N’est-ce pas la révolte qui « précède » le salut offert aux pécheurs ? À moins que l’antériorité évoquée par E.C (« le monde était à toi ») soit immémoriale, ou encore une fois, « imprépensable », antérieure même à l’histoire sainte, histoire dont la révolte serait alors le véritablement commencement mais non l’origine. La manifestation, derechef, est première, est « auto-institution de l’amour », et c’est pourquoi les « frères » peuvent être envoyés et pris à témoin, parce qu’ils ne sont pas, par essence, des révoltés ou des obscurs, mais des enfants de lumière.
L’amour est, en ce sens, l’institution d’un combat, qui se termine par une victoire. L’apparaître est polémique et, tragiquement, avait à l’être mais la paix de la manifestation est d’avoir enduré ce combat sans avoir cessé de laisser l’amour en héritage. L’amour – mais cela veut dire : le témoignage – survit au funeste danger de sa ruine, et ce faisant, il demeure, en sorte que « celui qui devait être sauvé » – le monde – « est, à la fin, vaincu » (p. 56), car il n’a pas fait œuvre de mort et de négation. Mais, vaincu, le monde ne disparaît pas, son refus continue, l’énigme du mal n’est pas refermée : c’est précisément alors que le monde fait allégeance à un prince, le prince de ce monde, qui fait face au Seigneur, qui viendra dès lors que le témoin s’en ira – à nouveau, et cette fois plus nettement, le témoignage ne va pas sans retrait et c’est ce retrait qui, au fond, est ici la mesure, funeste, du mal. Le tragique, si étroitement noué à l’amour et à la manifestation, n’a pas disparu, n’est pas effacé.
En somme, dans le chapitre intitulé «Monde», E.C se livre à un exercice phénoménologique tout à fait remarquable : décrire le monde comme domaine de la révolte, du repli dans l’obscurité. Le monde nomme ce domaine essentiellement négatif sur lequel vient trancher la présence, personnelle, de la vérité, le domaine dont se séparent les témoins – ceux que la vérité prend à témoin, convoque devant elle pour en répondre –, un domaine, par conséquent, qui n’est ici pas rencontré comme nature ni comme création mais comme ténèbres.
Ces ténèbres, E.C va, à la suite de Jean, les rencontrer une seconde fois et par ailleurs, dans une toute autre figure que celle du monde : celle des Juifs. Dans le quatrième chapitre, il s’agira d’évoquer un autre refus, une autre incompréhension que celle du monde. Le « monde », en tant que domaine ouvert par la révélation à son encontre, renvoie aussi à un autre domaine, tout autant à l’encontre mais sur un mode différent, un domaine qui n’est pas mondain : le domaine de ce qui est juif. Pour le Christ, les Juifs sont les siens, mais « les siens ne l’ont pas accueilli ». En quel sens le Christ est-il juif ? Au sens où il est le roi d’Israël, et où sa présence pousse donc Israël à mettre en question son propre horizon. Les Juifs sont, dans Jean, le peuple inquiet, demandant : « toi qui es- tu ? ». c’est pourquoi ils sont essentiellement ouverts au témoignage (p.90). Les Juifs sont ainsi « le peuple de la lumière, appartenant à la lumière en tant qu’ils l’attendent » (p.92). Leur possibilité est celle de la reconnaissance, homologein (p.94), et Nicodème voit, à ce titre, en Jésus des « signes » de sa provenance divine (p.95). Mais ce faisant, il montre qu’il « cherche à savoir » plus qu’il n’a vraiment « vu » (p.96). Il voit, et ne voit rien (p.97). Nathanaël, lui, voit : il accepte, dans cette « rencontre soudaine » avec Jésus, « le renversement de toute cette vie d’étude et d’attente dans l’instant de l’accomplissement » (p.100) : renversement qui atteste de sa fidélité à « la vérité d’Israël ». Mais ici il n’est plus question d’Israël, c’est-à-dire d’un lieu : l’Esprit, lui, est en tout lieu, c’est-à-dire sans lieu (p.110), il est une présence, celle de la vérité, qui est précisément la vérité d’Isräel (c’est pourquoi Jésus est Juif, dit que « le salut vient des Juifs », p. 111), mais une vérité qui, par sa présence, est essentiellement étrange pour Israël et cependant comprise par Israël comme étrange (p.113).
Qu’en retenir ? L’évangile, souligne E.C dans une analyse profonde, est pour les Juifs, les prend à témoin et cependant n’en sera pas reconnu. Jésus place en effet les Juifs devant leur question : sont-ils le terme de la lumière de Dieu ? Peuvent-ils, en l’écoutant, aller au-delà d’eux- mêmes ? Poser cette question, montrer que cette question est celle que Jésus pose, est ici le contraire radical, le plus radical qui soit, de l’antisémitisme : la vérité est, en effet, pour les Juifs, elle leur appartient et ce n’est qu’à ce titre qu’ils en assument le refus. La vérité, autrement dit, n’est pas « ailleurs », elle s’offre à une langue qu’elle prend à témoin et dont elle se propose au fond de devenir la langue natale ; mais alors, la réflexion dépasse le simple cadre d’Israël puisque la grande thèse rejointe ici, c’est que la « philosophie chrétienne » n’est pas un cercle carré, n’est pas une impossibilité logique – c’est-à-dire fondée sur le logos – mais qu’elle est au contraire la mesure même de la philosophie.
Toutefois, la vérité n’est pas entendue par ses propres destinataires. Il ne s’agit plus seulement alors de la ruine de la manifestation mais de son brouillage, qui la laisse dans une énigmatique obscurité. Derechef, les conditions de la manifestation sont celles de la coopération, c’est-à-dire de la volonté et du témoignage de ses envoyés.
Mais s’il y a, au regard de la structure dialectique de la vérité, proximité entre Jean et Hegel, si l’auteur a pu passer de celui-ci à celui-là, proximité suppose distance et il nous est loisible de nous demander ce que le commentaire de Jean, de « sa » phénoménologie de l’esprit ou de la phénoménologie de l’esprit telle qu’elle est à dire « selon » lui, ajoute à la lecture de Hegel. Avec Jean, si on est près de Hegel, est-on pour autant dans Hegel ? Jean et Hegel se situent-ils tout à fait sur la même dimension ? En aucune façon car Hegel considère le contenu de la religion manifeste comme devant être relevé. Telle la différence qui sépare les deux « phénoménologies de l’esprit », celle de Hegel, dans laquelle la conscience religieuse est limitée et doit être reprise et donc supprimée par le concept ; et celle de Jean, dans laquelle la « conscience religieuse » s’ajuste à la manifestation elle-même et au témoignage qu’en se montrant, elle suscite.
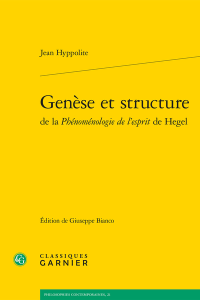 Hegel, la religion manifeste
Hegel, la religion manifeste
Rappelons rapidement l’analyse hégélienne de la religion manifeste telle que nous la trouvons dans la Phénoménologie de l’esprit. Après avoir souligné que le Christ conceptualise l’union du divin et du sensible, c’est-à-dire de proche en proche l’union de la substance et du sujet, et donc que le christianisme voit l’esprit, c’est-à-dire l’essence suprême, qui est en s’aliénant, qui est joie de se contempler, Hegel englobe la différence – bien comprise – entre le Fils et l’Esprit dans l’histoire du concept, le second signifiant la vérité de l’apparition du premier, dans l’histoire du concept plutôt que dans l’histoire sainte qui demeure, en sa temporalité – l’histoire sainte est une chronologie – une représentation plutôt qu’un concept de la vérité. Précisément, aux yeux de Hegel, la conscience religieuse, fût-elle, sous la forme de l’Eglise, universelle, demeure une conscience représentative, où Père, Fils, Esprit – Logos, Fini, Universel – se succèdent comme des moments historiques. Pour la religion manifeste, la révélation est un pur donné que la conscience de soi devra intégrer. Or, l’intégrer, ce sera substituer à la Trinité divine une économie philosophique de la Trinité conceptuelle. Ce sera aussi ne pas en rester au témoignage : certes, Hegel s’y arrête, croire « en esprit », c’est croire « en communauté », en sorte que la communauté est elle-même la vérité, est son propre contenu, la foi cessant alors d’être immédiate pour devenir « pour soi » ; il n’en reste pas moins que pour Hegel, le témoignage est un forme imparfaite de la conscience de soi, car il repose sur un « ici et maintenant » sensible : le Christ reste, même dans l’intériorité spirituelle, un souvenir sensible, dans un « retour du passé », qui reste « présent » (ici au sens temporel) dans la vie de la communauté, sous la forme une « répétition » – la tradition liturgique – qui « confond l’immédiateté première avec l’exigence du concept », ou plus précisément qui « confond l’origine, l’être-là immédiat de la première manifestation, avec la simplicité du concept » (J. Hippolyte, Genèse et structure de la Phénoménologie de l’esprit, Paris, Aubier, 1947, p.542). La religion manifeste demeurerait ainsi prisonnière de l’historicité, mais aussi d’une vision non-spirituelle du monde, confondue avec la nature – le concept de « création » représenterait l’altérité dont le logos a besoin pour se manifester, la négation du Verbe, et le « monde » serait alors le processus de « sortie de soi » de l’esprit, représentée religieusement comme chute et perte de l’innocence (op. cit., p.545), tandis que le mal serait l’altérité pure dans laquelle Dieu s’aliène, et donc une pure et simple négation, relevant certes de la vie divine. Alors, le sacrifice, consenti par Dieu en son Fils, de sa propre incarnation, serait sa résurrection, la mort de la mort, mais cela veut dire : la représentation de la réconciliation . De la sorte, le tragique meurt dans le savoir, l’universalité transparaît dans la mort : « la manifestation est le mouvement de naître et de périr, mouvement qui lui-même ne naît ni ne périt, mais qui est en soi et constitue l’effectivité et le mouvement de la vérité et de la vie » (Hegel, Phénoménologie de l’esprit, Préface, tr. Bourgeois, Vrin, 2006, p.14). Mais voilà une proposition que la communauté religieuse ne peut pas, selon Hegel, rejoindre, car elle ne conçoit pas la réconciliation qu’elle incarne comme son œuvre propre ; elle la pose hors d’elle, se posant elle-même en une « nostalgie du passé, attente fervente de l’avenir » (J. Hippolyte, op.cit., p.548). Hegel dénie en somme toute portée proprement philosophique, c’est-à-dire toute vérité absolue, à Jean.
De tels rappels, aussi sommaires soient-ils, suffisent à problématiser à nouveau le livre qu’E.C consacre à Jean, dans la mesure où ce livre est aussi tourné vers Hegel. Pourquoi s’attacher à une parole qui doit être relevée, sinon parce qu’elle ne le doit pas seulement ? La tâche du livre et celle de son lecteur se déterminent ainsi : comment voir dans le johannisme autre chose qu’une simple esquisse du savoir absolu ? Le dernier chapitre, intitulé « L’heure », dans lequel il revient à la dramaturgie de la Passion, non pas comme un simple récit illustrant une vérité mais comme le drame même de la manifestation, permettra-t-il de répondre ?
L’heure du dévoilement
La Passion est comprise par E.C comme l’heure du dévoilement. C’est en partant, dans l’adieu, que le Christ, laissant l’Esprit, laisse voir la gloire de Dieu. L’heure est ainsi la dernière heure, l’heure incontournable. L’heure est d’abord celle où le Christ confie sa mère à son disciple et retour (p.125) : s’éloignant, il n’abandonne personne, « leur laissant, alors, la nouvelle présence de l’esprit, le nouveau sens de toute présence, qui porte ce nom » (p.125). Sens qui est, il faut y insister, dialectique : « l’heure n’est celle de la séparation que pour autant qu’elle accomplit une telle union ».
L’heure est ensuite celle de « sa volonté, comme volonté de manifestation » : « lui seul décide de l’heure » (p.126). Mais de quoi décide-t-il ? De venir ; mais partant, il est déjà là : « l’heure est la dimension à la fois de ce qui vient et de ce qui a déjà commencé » (p.127). Et qu’est- ce qui a commencé, avec l’arrivée du Christ, annoncée dans et par son adieu ? Rien d’autre que la vie. « La dernière heure de sa vie sera aussi l’heure des morts, mais par un renversement décisif, la dernière heure de la mort, leur résurrection à la vie » (p.127). Cela supposera toutefois d’entendre. Entendre la parole, c’est déjà revenir à la vie, ce qui prépare l’heure à venir, celle de la résurrection des corps (p.128). Entendre, en effet, c’est obéir – c’est-à-dire témoigner et aimer, ou encore : appartenir à ce que l’on voit, et nous avons vu que telle était la détermination johannique de la vie. Entendre suppose pour cela d’acquiescer, de s’ouvrir, et équivaut finalement à cet acquiescement : « celui qui écoute la parole et ‘a foi’ dans le Père et celui qui ‘a fait le bien’ sont un seul » (p.130).
L’heure, encore, est celle de l’adieu, du détachement de soi. Jésus doit entrer dans l’abandon de lui-même, se séparer de sa propre présence, de la « dimension toute entière dans laquelle… l’homme s’est tenu jusqu’à présent, le monde » (p.130-1). Jésus doit perdre son âme, se détacher de soi, « du monde qui est le domaine de son être ». En quoi le monde est-il, pour l’âme, domaine de l’être, sinon parce qu’elle y apparaît, pour témoigner ou pour juger ? Et en se détachant, Jésus laisse apparaître un autre que lui : il accomplit le témoignage, il glorifie le Père (p.133), ou plus précisément, le Fils qui reçoit du Père d’être Fils, donne aussi au Père d’être Père. « La manifestation a pour source et destination le Père, et…pour chemin unique le Fils » (p.134). Ainsi, l’heure est l’heure de la vérité, le dernier chapitre bouclant ainsi le chemin parcouru depuis le premier.
Elle est aussi l’heure de l’amour. Jésus « les aima jusqu’à la fin ». L’amour délimite la communauté des « siens », qui ne sera plus seulement celle d’Israël ; il délimite aussi la fidélité de Jésus, sa volonté de sauver le monde. Mais le sauver sera y envoyer des disciples. L’amour est ainsi à venir, il dépasse les seuls présents disciples ; il est envoi de l’esprit (p.137). Les siens sont la communauté à venir, qui a charge de la parole à faire advenir. L’amour extrême consiste pour Jésus à remettre l’esprit, à le laisser venir, en partant, lui (p.138). « L’heure mortelle est l’heure spirituelle ». L’heure de l’amour est l’heure du service : celle du lavement des pieds, où « le seigneur se manifeste comme un serviteur » (p.139), « entre dans le service pur » (p.140). Le seigneur se donne aux autres, donne la mesure du nouveau commandement : « ‘les uns les autres’ est la dimension de l’amour » (p.141). Le serviteur n’est pas l’asservi, c’est l’ami, celui qui sait ce que fait son seigneur (p.142), qui est personnellement interpellé.
Mais elle est enfin, l’heure du mal. Le service rend possible la trahison : « l’unité et la séparation sont unies dans le même instant, dans une tension extraordinaire » (p.144). Mais la trahison, selon Jean, « réaffirme la souveraineté du savoir et de l’amour du Christ » : « le mal est lui aussi le chemin », « chemin royal » (p.145). L’heure recueille ainsi « l’intimité du mal et de l’amour » (p.146), le fait que l’heure advient dans un monde qui fait le mal, mais aussi qu’elle a besoin du mal, qu’elle advient par lui, sans qu’on sache d’ailleurs, mystère extrême, ce qui advient de la malignité de Judas après la Passion (p.147) : y-aura-t-il eu, ou non, disparition du mal dans l’amour ?
Ainsi la mort de Jésus donne-t-elle, en vérité et pour finir, son sens au maintenant lui-même (p.150). La Passion est cet événement unique par lequel s’ouvre le chemin, et qui est, pour les mortels, un chemin de mort, c’est-à-dire un chemin où l’on reprend vie : l’événement où se décide, au fond, la manifestation de la vérité et la vérité de la manifestation, où se noue ce cercle unique, singulare tantum, dans le diamètre duquel la philosophie est johannique, natalement johannique.
Ces éléments permettent-ils plus spécialement de mesurer en quoi la philosophie serait plus johannique qu’hégélienne, ou du moins, johannique en un sens autre que celui en lequel elle est hégélienne ? Peut-être. Car si « l’esprit », présence singulière, présence de la présence elle-même, présence mesurant toute manifestation, est le centre du cercle tracé par Jean, ses rayons demeurent habités par toute la distance qui sépare la manifestation d’elle-même, distance entre la vérité et le monde, distance entre Jésus et les Juifs, et ce, jusqu’à la dernière heure. Cette dernière remarque n’est pas secondaire car elle permet de soutenir que si la réconciliation des séparés, qui est le véritable sens de la présence de l’esprit, de son advenue, donne la mesure de l’amour, que si par là Jean est le témoin de l’apparaître au monde de la vérité, le témoin de sa venue, il est aussi et ne sera rien d’autre que le témoin du combat, d’une sorte de tragique habitant l’évangile et dont la manifestation portera pour toujours la trace parce qu’elle en est marquée dans son instant décisif. Le tragique, la proximité de la mort et de l’adieu, la pesanteur de la séparation et du refus, autrement dit l’expérience la plus radicale du mal lui-même, ne constituent-ils pas le véritable apport phénoménologique de Jean, sa singularité au regard de la pensée hégélienne où tout est réconcilié ?
Ainsi, Jean ramène-t-il à Hegel ? E.C écrit-il, finalement, une annexe du livre de 1807, un appendice de la section « religion manifeste » ? Non. Car, ce qui pour Hegel est moment est pour E.C la vérité elle-même en son mode d’apparaître. Quelque chose chez Jean s’avance qui n’est pas qu’hégélien, et qui est peut-être de l’ordre d’une phénoménologie qui n’est plus celle du concept mais celle de la mort, une phénoménologie finalement plus tragique et plus événementielle que la surinterprétation métaphysique retenue par Hegel, qui voit dans la « religion manifeste » une simple étape de soi vers soi. On trouverait alors ici la mesure de ce qui, en ce petit livre, intéresse la philosophie: une véritable méditation de la posture de celui qui est pris à témoin par la manifestation personnelle ; posture non conceptuelle, non récapitulative, posture originaire en vérité, inscrite dans ce qu’elle voit et dans ce qui l’appelle. Plus étroitement : posture « natalement » grecque, « étonnée » de la manifestation, avant de l’avoir rassemblée et assise sur un fondement métaphysique – la subjectivité absolue. La radicalité du propos ici tenu, quelle est-elle alors sinon de soutenir que l’étonnement, grec, est peut-être natalement l’émerveillement d’être pris personnellement à témoin ?
Cette singularité tragique de l’évangile de Jean implique alors de se retourner vers cette toute autre dimension du tragique, toute aussi familière à notre auteur : celle qui se dessine dans la constellation de Heidegger et de Reiner Schürmann. Comme y a insisté longuement E.C dans des études antérieures, la manifestation, selon Heidegger, est tragique, puisqu’elle prépare son propre recouvrement, et selon Schürmann, est plus tragique encore, puisque toute tentative de la recueillir et de la nommer aboutit à la fissuration puis à l’effondrement des thèses que la pensée peut avancer au sujet de ce qui est. Au contraire, ou plutôt bien différemment, chez Jean, la vérité se laissant être est bonté, amour et sacrifice de soi, ouvrant la possibilité du refus, de la haine et de la trahison, impliquant l’adieu et la séparation. Mais si elle est tout cela, elle n’est pas, en revanche, un Gelassen anonyme et sans principe, susceptible d’être remémoré ou d’être ruiné par son oubli ou sa mortalité, mais qui ne se donne pas personnellement comme salutaire. Ainsi, si le Jean d’E.C est proche, sans peut-être se confondre avec lui, de son Hegel, son Hegel et son Jean sont l’un et l’autre clairement construits à l’encontre d’une autre dimension de la vérité, sa dimension heideggerienne et tragique, qu’E.C a souvent méditée et qui s’élève ici pour lui au rang d’adversaire par contumace. Qu’il y ait manifestation – de l’esprit – et non décèlement – de l’être – ; que le tragique de la manifestation soit le mal et non l’oubli de l’être ; que ce soit une révélation personnelle et non une présence sans principe qui abrite en elle-même et pour elle-même un destin funeste ; ce triple « et non » donne au fond la mesure même de l’écriture, est peut-être l’affaire la plus propre quoique la plus cachée, de cet ouvrage et de son auteur.
Pourquoi la plus cachée ? Il est vrai que Heidegger ne s’avance pas dans ce livre. Mais cela tient à l’objet même de ce livre, tel que nous l’avons rencontré. Nous avons demandé : la foi est-elle finalement un exercice appartenant à la dialectique, c’est-à-dire une partie de la philosophie ? Ou bien n’est-ce pas elle-même et elle seule qui amène la philosophie devant la dialectique propre à la vérité ? C’est-à-dire, autrement formulé : la singularité de la parole de Jean est-elle maintenue ou relevée ? Maintenue, certainement. Mais à ce prix : la philosophie, telle qu’elle est comprise ici – comme pensée de ce qui se manifeste – ne peut qu’être johannique ; la confrontation d’une philosophie radicalement étrangère au johannisme est, ici, laissée en arrière – à moins qu’une telle philosophie, qu’une telle méditation de l’apparaître, ne soit, à son tour, qu’une simple « nuit », voire une figure du « mal », au sens du refus de reconnaître celui qui vient, d’accueillir le caractère personnel et adressé de la manifestation. La philosophie deviendrait alors figure mondaine, c’est-à- dire désir vil d’être sa propre provenance. N’est-ce pas cette fureur qui pousse la philosophie à prétendre rechercher, de l’étant, le fondement, que ce soit pour revendiquer l’appui ou pour en affirmer l’absence radicale ? Toutefois, la volonté, l’amour des ténèbres, le désir de soi, l’orgueil, sont-ils la mesure de la pensée, surtout lorsqu’elle laisse derrière elle la recherche furieuse ou la dénégation thétique du fondement ?
Rien n’est moins sûr, et l’analyse johannique de l’appel et de la réponse, du témoignage et de l’accueil, du tragique et de la séparation, est-elle si éloignée de la langue heideggerienne, dût-elle ne jamais la rejoindre ? Le grec johannique, étrange pour la philosophie, est peut-être en vérité radicalement plus proche du grec initial tel qu’il est rejoint par la phénoménologie heideggerienne, que la métaphysique de Hegel – plus proche sans toutefois pouvoir jamais être rencontré, ni rencontrer en retour ce grec mortel. La distance ambiguë entre une heure et une autre, entre l’heure de l’amour et celle de l’être-pour-la-mort serait ainsi mesurée plus finement et peut-être plus profondément que par la distance entre le savoir absolu et la pensée.
Telle fut, un temps du moins, la position d’E.C lui-même. En 2012, commentant la signification heideggerienne de la mort comme « plus haut témoignage de l’être », il la tournait très précisément vers la Passion elle-même. La mesure de ce renvoi était, déjà, le tragique. La mort, chez Heidegger tel que le lisait E.C., c’est ce depuis quoi « les mortels laissent » : « seule la mort… leur donne de laisser » (Sérénité. Eckhart, Schelling, Heidegger, Paris, Vrin, 2012, p.140). Et E.C demandait alors, sans répondre : « un tel témoignage, ne fut-il pas celui qui s’avançait aussi dans un autre, un tout autre abandon, dans les mots de Marc et Mathieu ? », précisant toutefois : « »quelque chose » s’est montré là, dans le témoignage de la mort, qui ne fut peut-être pas recouvert par ce qui suivit, la résurrection », à savoir « le chemin sans apparence, le chemin sans éclat de l’adieu, le chemin de la Gelassenheit » qui est alors la vérité de la Verlassenheit, de l’abandon qu’E.C opposait alors à la volonté. Dans la pensée comme dans la passion, c’est à l’adieu, à la mort que revient la possibilité d’endurer la manifestation, de la laisser être. Toutefois, si dans les évangiles, l’abandon laisse l’esprit, dans l’éclat du paraître, il laisse un événement anonyme, impersonnel, celui de l’éclat du paraître, il ne laisse ainsi que la mort ; et plus encore, si dans les évangiles, l’esprit laissé sera celui du combat et du tragique personnels, dans le paraître, le tragique sera celui, funeste, de l’oubli, de la Seinverlassenheit, que personne ne vient défendre. À moins que « quelqu’un » s’avance, là aussi – et l’esprit habiterait secrètement la « phénoménologie de l’inapparent » à laquelle s’est consacré Heidegger – mais ce n’est pas ce que soutient ce dernier et E.C lui-même ne va pas jusque là.
Ces remarques permettent de poser une autre question encore. De Hegel à Jean, de la vie absolue de la vérité à la mémoire de son unique venue, est-il possible de maintenir intactes les conclusions bien connues sur l’incompatibilité réciproque de la « pensée chrétienne » et de la « pensée de l’être », telles qu’elles sont par exemple rassemblées par D. Franck dans Nietzsche et l’ombre de Dieu (PUF, Paris, 1998, cf Deuxième partie, ch. IV-VI) ? Un amendement de ces conclusions ne s’avère pas inutile. Depuis Jean, il ne s’agit plus d’opposer une pensée de l’être fondée sur la mort à une philosophie de la vie spirituelle. Il s’agit précisément de les rassembler, car l’esprit et la mort ne sont pas opposés. De les rassembler : de les laisser appartenir à une seule et même dimension, celle de l’essence de la manifestation. La présence de ce qui est aura en effet été comprise et dite comme la présence de quelqu’un qui est venu et qui nous a laissé l’esprit. Il ne s’agit plus là de la souveraineté du concept mais de l’ouverture énigmatique d’un donné face auquel nous n’avons, habitants du monde, qu’à témoigner de notre écoute, de notre attention à ce qui, à nous, mortels, nous est destiné. De fait, la vie de l’absolu et l’habitation du monde en tant que sphère finie cessent de relever de dimensions différentes, et il cesse du même coup d’être suffisant d’opposer une « métaphysique chrétienne » dont Hegel serait l’accomplissement à un « dépassement de la métaphysique » qui aurait redécouvert, par delà Hegel, la mortalité du regard qui pense.
Toutefois, si, dans la dimension de cette « phénoménologie selon Jean », venue de la vérité et ouverture de la présence sont rassemblées, c’est toujours à un prix : non plus, certes, la mécompréhension radicale de la philosophie et de la pensée ; mais l’inconciliable opposition de deux déterminations du tragique : le risque funeste de la révolte ne rejoindra pas le danger du recouvrement de l’être. La manifestation serait en quelque sorte menacée de deux périls différents, de deux « non » étrangers l’un à l’autre et dont l’un n’est sans doute en aucune façon la traduction de l’autre. La langue funeste de l’adikia, de l’injustice envers l’être dont Heidegger retraça inlassablement l’expérience présocratique, n’est pas, ne sera pas la langue johannique du péché et de la haine. Et non seulement leur rencontre n’a pas lieu, mais la confrontation de ces deux langues, leur dialogue, a-t-elle ailleurs un lieu ?
En conclusion
Récapitulons le chemin parcouru. Lisant Jean comme un phénoménologue, E.C privilégie une détermination de la phénoménologie plus spirituelle que mortelle, et récuse silencieusement du même coup que la pensée de Heidegger, celle de l’événement appropriant liant sans raison l’homme à l’être et déterminant l’essence de la vérité, soit l’accomplissement de la phénoménologie. Mais cette critique implicite exercée à l’encontre d’une phénoménologie qui aurait refusé ou contourné la parole de Dieu, critique prolongée dans la conjonction de ces deux disciplines, phénoménologie et théologie, ou plutôt de ces deux langues, la langue de Dieu et la langue de l’apparaître et de sa réception, ne concernent pas seulement la pensée de Hegel. Elle est aussi celle que déploie la phénoménologie contemporaine lorsqu’elle se tourne, avec Marion ou Henry, vers un originaire absolu dont il s’agirait de rejoindre l’expérience pure, présidant à toute autre. Les recherches menées par l’auteur sur une « phénoménologie selon saint Jean » s’inscrivent ainsi dans l’actualité même de la phénoménologie et de ce qui a pu être nommé son « tournant théologique » – mais la question se pose à l’évidence de savoir si tournant y-a-t-il eu, ou bien si la phénoménologie, discours portant sur l’apparaître et cherchant à rejoindre la situation même qui lui donne lieu, ne porte pas originairement, dès le départ, la marque de sa source théologique – si la manifestation n’est pas toujours personnelle et adressée personnellement. Cependant, on sait que Marion et Henry ont l’un et l’autre tourné la phénoménologie vers la théologie sans prétendre par là se tourner vers Hegel et même en prétendant sans nul doute se détourner de lui. De plus, chez Marion comme chez Henry, la manifestation de l’absolu est essentiellement comprise comme hors du monde, comme opposant l’originaire – la « vie », le « don » – au dérivé – le monde, la représentation, la saisie –, alors que tout l’effort d’E.C, et c’est le sens de sa filiation hégélienne, est de soutenir que ces deux dimensions, la vérité et le monde, n’ont pas à être dissociées mais liées dans le mouvement même de la manifestation. Si la vérité est là, pour le monde, pour les Juifs, si c’est en eux qu’elle s’avance, qu’elle s’offre, alors nul besoin, dès lors, d’opposer la Vie à l’illusion du monde, comme la plénitude au néant, ou « l’ailleurs » de la Révélation à la quotidienneté des phénomènes donnés : il y a relation dialectique, c’est-à-dire personnelle de l’un à l’autre.
La voie empruntée par E.C est ainsi bien différente de celle d’Henry et de Marion, et lire son livre de Jean, c’est aussi se donner les moyens d’en mesurer l’originalité voire l’originarité, de réinscrire cette étude dans des tentatives contemporaines de lier théologie et phénoménologie. Les acquis principaux de la comparaison de ces tentatives porteront d’une part sur l’interprétation du concept chrétien de « monde », commandée chez Henry par l’idée d’apparence, chez Marion par l’idée de finitude et chez E.C par l’idée, schellingienne plutôt qu’hégélienne d’ailleurs, de révolte. Alors que chez Marion, le monde est aveugle, ne voit pas ce qui est « d’ailleurs », pour E.C, il est diaboliquement lucide, il voit, et ne veut pas ; même si pour l’un et pour l’autre, aveuglement ou lucidité tirent leur mesure respective du même étalon, à savoir, « l’absence » ou le « retrait » du Verbe dans le monde, la conclusion établie demeure bien différente puisque si la finitude n’est, en elle-même, pas tragique pour la vérité puisqu’elle en dissimule localement l’essence sans l’obérer, la révolte, dans la mesure où elle est inévitable et même portée par la personnalité même dont relève la Révélation, est bel et bien le témoignage d’une fissuration de la vérité constitutive de sa donation même.
Ainsi, et pour conclure, si E.C ne reçoit sa phénoménologie que de Jean, des traits qu’il rassemble dans son livre et qui ne sont rien d’autre que des traits de l’évangile, cette réception du johannisme ne doit pas dissimuler une véritable décision philosophique, tournée simultanément vers Hegel, Heidegger, Marion et Henry. C’est dans cette actualité de la théologie et de la phénoménologie que s’inscrit le travail d’E.C., et à ce titre, faut-il le redire, il ne manque pas de concerner étroitement la philosophie elle-même.








