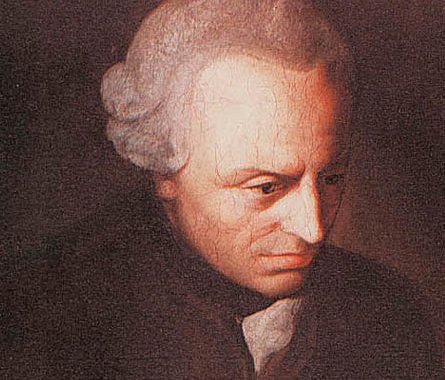Le geste de pensée amorcé par Quentin Meillassoux et d’abord désigné sous le nom de réalisme spéculatif a rendu visible une vaste constellation réaliste qui s’étend bien au-delà de son ancrage initial. Il s’avère difficile d’identifier au sein de cette diversité et par-delà les divergences qu’elles recouvrent des objets ou des postulats partagés : le terme réalisme qualifie plutôt une aspiration commune qui, à son tour, incite à développer des passerelles et à élaborer un langage commun. La face la plus visible de cette émergence est un certain retour de la métaphysique. Un certain retour, car celle-ci, malgré la supposée fin de la métaphysique, est en réalité restée vivace sur les deux bords de l’Atlantique ; au sein de la tradition analytique, qui de la théorie de l’objet et des mondes possibles, a toujours considéré ouvert le chantier de la métaphysique, mais aussi bien dans la tradition continentale, alimentée par les pensées du multiple d’auteurs comme Deleuze puis Badiou.
Ce premier abord est peut-être pourtant à mitiger. Souvent opposé à la tradition transcendantale, le réalisme se trouve aussi parfois proche d’elle, jusqu’à retrouver ses principaux postulats. La revendication réaliste, trop partagée, peut paraître formelle : il est peu probable de trouver consensus sur la définition du réalisme à donner, et tout aussi peu probable que les différents protagonistes de cette nouvelle scène se l’attribuent volontiers les uns les autres. Pour certains, le fait significatif est bien plutôt la revendication elle-même. Qu’est-ce qui pousse tant de philosophes à se dire réalistes ? Que recouvre – ou trahit – l’aspiration réaliste ? Quelle disposition de la pensée, quelle évolution dans la réalité elle-même ?
Rompre avec un sentiment d’impuissance pour certains, rendre justice à la prolifération d’objets et de nouvelles formes objectives avec la révolution numérique, adapter la pensée à des sociétés de plus en plus fluides et mouvantes, ou au contraire, rappeler la résistance toujours plus difficile à masquer, au-delà des paroles, des concepts, de l’histoire même, de ce que nous ne pouvons même plus appeler nature mais qui néanmoins pèse encore, plus que jamais peut-être – d’un poids d’autant plus oppressant qu’il se dérobe aux catégories de la pensée.
Plus qu’à la mise en ordre, le temps est peut-être à la mise à plat ou à nu – au partage de certaines résistances et de certaines perplexités. De fait, deux colloques organisés presque coup sur coup à la fin de l’automne 2016 se sont structurés dans une telle perspective. Participant au colloque The New Faces of Realism organisé par N. Garrera et G. Ferrer du 24 au 26 novembre 2016 à l’Université de Wuppertal, l’auteur de ces lignes se risque à recenser le bilan de Choses en soi, métaphysiques et réalisme aujourd’hui1, organisé les 16-19 novembre 2016, à Paris par l’Université Paris Nanterre, l’École normale supérieure et Columbia Reid Hall, par E. Alloa et É. During.
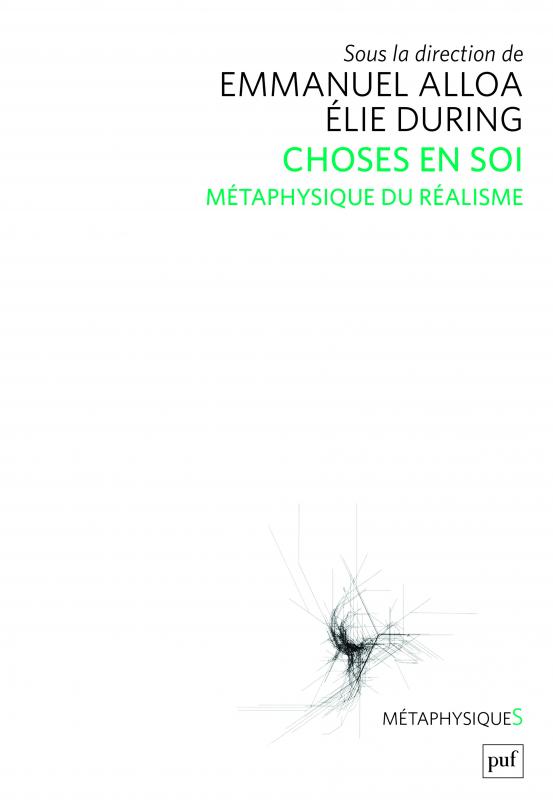
La chose plurielle
Le pluriel « choses » ouvre plusieurs pistes : pluralité des approches, des conceptions de ce qu’il faut penser, pluralité du réel… Paradoxalement, la conception kantienne fournit le point d’Archimède, le seul point d’identification (fût-il négatif) de ce qui est en jeu. Dès l’introduction, les modalités de ce rapport à Kant font question – la chose en soi représente-t-elle une conception à refouler, à perfectionner, une énigme ? A même l’idée de chose en soi, contre elle, mais rarement sans elle.
Plurielle, celle-ci l’est dans la pensée kantienne elle-même (au sein de la Critique de la raison pure, entre l’esthétique et la logique transcendantale, et tout autant entre la Critique de la Raison pure et l’Opus Postumum). L’héritage kantien pour sa part (Fichte, Schelling, Hegel, Schophenhauer, d’une autre façon Nietzsche, Husserl et l’Ecole de Marbourg) n’a cessé de remettre en question cette chose dont les traits structuraux n’ont eux-mêmes cessé de sur-exister à la contestation. D’une certaine façon, cette sur-existence devient le thème même de l’interrogation, comme si un des objets du réalisme était le retour de cette chose « increvable » qui, sous le nom d’indéconstructible, de facticité, d’événement, de matière, ou simplement de chose, réapparait chaque fois qu’on affirme « la possibilité de parler d’un réel qui ne soit pas d’emblée conditionné par les formes de notre accès à lui », comme si le réel ne pouvait être pensé que comme impensable ou imprépensable, dans sa fuite.
D’une certaine façon cependant, l’enjeu du nouveau réalisme est aussi de dépasser cette entente négative ou soustractive dont la pensée française des années 60-70, ensuite relayée par la nouvelle phénoménologie, a fait son objet insigne. La chose en soi, même repoussée à l’infini, est trop vague ; elle ne répond pas au cahier des charges d’un véritable réalisme ; elle ne dit pas ce qu’elle est, ne donne pas de normes, ne tranche pas. Il s’agit autrement dit d’opérer un basculement plus général et de modifier le lieu architectonique de la question du réel, qui ne doit plus seulement être posée par rapport à la connaissance, donc le sujet.
Les fils problématiques de ce basculement sont nombreux. Pour certains (Meillassoux), c’est la forme de la choséité qui doit être contestée. Pour d’autres, l’enjeu est de penser le réel en lui-même, autrement dit, dans les rapports de choses eux-mêmes, ce qui fait qu’une chose est une chose pour une autre chose. Il est intéressant de noter que, dans les deux cas, les motivations de ce réalisme (penser un réel qui soit hors de la pensée) reconduisent à des schémas idéalistes et impliquent un retour assumé à la métaphysique.

Je classe donc je fais être
Fidèle à son usage des nomenclatures, Tristan Garcia propose une grille de lecture d’ensemble des différentes orientations réalistes, de leurs points de rencontre et de torsions. Le réalisme recouvre selon lui deux orientations majeures :
• La première, épistémique, englobe une vaste constellation allant du post-quinisme au réalisme spéculatif de Meillassoux et interroge le rapport du réel à la pensée, la façon dont celui-ci l’affecte ou au contraire lui échappe. Il est alors possible d’y distinguer plus finement des orientations que Garcia qualifie de nominales (qui s’intéressent la façon dont le réel s’impose à la pensée), adjectivales (qui questionnent les critères auxquels la pensée doit se soumettre pour accéder au réel), adverbiales (qui décrivent différents types d’attitudes réalistes), et paradoxales (questionnant le réel à partir du possible). Tous ces auteurs partagent le souci commun de penser ou d’appréhender un réel ou une nature détachés de l’humain et à décentrer la pensée pour la mettre en capacité d’en toucher quelque chose, fut-ce dans l’éloignement ;
• La deuxième orientation est ontologique et s’inscrit dans l’héritage des pensées de l’objet de Meinong, et d’une certaine façon Husserl. Le trait commun en est une conception extensive du réel, un libéralisme ontologique qui ne conditionne plus la réalité à un critère ou une norme, mais veut au contraire faire droit à toutes les formes de réalité. Cette orientation n’entend pas seulement renverser ou outrepasser la corrélation, mais en abandonner pour de bon le terrain afin de se placer directement au sein des choses. Toute la question alors est de trouver un point commun à ces deux élans en apparence adverses. Pour Garcia, celui-ci est à chercher dans l’ambition partagée de restituer au réel et aux différentes choses réelles leur réalité : penser, c’est réaliser.
Doutes
Isabelle Thomas Fogiel reprend de son côté la thèse forte développée dans Le lieu de l’universeldont on peut lire la recension ici et montre qu’il est possible de repérer au sein de la poussée réaliste une constellation conceptuelle et des gestes structuraux identiques : la volonté de penser le réel comme indépendant, de sortir hors du dispositif de la perspective, mais formulé dans une terminologie qui rend ce dépassement difficile et menace, par sa généralité, les catégories fondamentales de la philosophie. Là contre, il est important de distinguer la problématique de la réalité de celle de la généralité afin de préserver le vrai lieu conceptuel de la philosophie qui est celui de l’universel.
S’il apprécie pour sa part le retour en force du motif réaliste, Jocelyn Benoist doute cependant de la capacité d’une philosophie de style purement continental à être jamais totalement réaliste. Celle-ci tend en effet actuellement à rendre le réalisme à tel point baroque et contre intuitif qu’elle en vient à en brouiller le sens : à quoi sert la notion du réel si elle n’a pas de valeur discriminante ? Le problème n’est pas le caractère baroque : il y a peut-être bien dans le réel lui-même une tendance à la prolifération et au baroque dont il faut rendre compte et dont les ontologies et philosophies du web sont le signe. Le problème vient plutôt de la revendication à inventer un « nouveau » réalisme et à le formuler de manière négative par rapport au tournant kantien, dans un mouvement de révolution copernicienne inversé. C’est toute l’ambiguïté d’une volonté d’en finir avec « le motif de la finitude et son escorte herméneutique » (Badiou) qui s’est aussitôt transmuée en un pathos du dépassement de la finitude très symétrique finalement du pathos de la finitude. Tout l’enjeu aurait été de sortir de l’autolimitation kantienne sans en maintenir les termes ni chercher un infini qui n’en soit que l’envers, en prenant bien plutôt acte de ce que le thème de la finitude n’est lui-même défini que sur fond d’une préconception métaphysique dont il faudrait véritablement s’affranchir. Pour Benoist, c’est au prix de l’abandon effectif de l’armature métaphysique du concept d’objet, de chose et de réalité, et non de leur reconduction sous couvert de déconstruction ou de plastification, qu’une position effectivement réaliste peut-être élaborée. Celle-ci est introuvable dans les termes choisis par les nouveaux réalistes.
De façon plus interne, en interrogeant ce que les ontologies qui se veulent plates empruntent sans le savoir à Spinoza, David Rabouin met en question la revendication d’horizontalité des nouvelles ontologies. Les ontologies plates s’inscrivent en effet dans une généalogie complexe cherchant de manière paradoxale à allier expression et signification, univocité et exhaustivité. Or la partition et l’articulation spinoziste de la pensée et de l’étendue, dont les traces semblent rémanentes dans les théorisations de Harman ou de Garcia, ébranle cette platitude. On peut dès-lors douter avec Deleuze de la possibilité d’élaborer une ontologie à la fois plate et univoque : pour Deleuze, une ontologie univoque n’est justement jamais plate et advient au contraire à l’articulation des différentes faces du plan d’immanence.
L’Increvable de Königsberg
Sur un même constat d’intrication des motifs réalistes et idéalistes, Jean-Michel Salanskis fonde au contraire un éclaircissement autant qu’une défense de l’idéalisme auquel les motifs majeurs du réalisme semblent en dernier recours reconduire :
• Le premier motif du réalisme, épistémologique, est en effet celui de l’ouverture de la pensée à l’impératif de connaissance ou encore de la décorrélation. Or celui-ci correspond précisément au projet kantien dont le motif de la finitude rend de ce fait mal compte. Pour Salanskis, c’est bien plutôt la pensée de Levinas qui fournit sa véritable intelligibilité au projet transcendantal kantien : celui-ci ne signifie pas un assujettissement de la pensée à la facticité, mais son ouverture au service de l’infinité d’un sens décorrélé de toute assignation ontologique ;
• De la même façon, la pensée modale analytique ne parvient en dernier ressort pas à être totalement réaliste. Armstrong lui-même ainsi est finalement amené à accorder aux mathématiques un statut a priori qui les place en position fondationnelle pour la description des possibles : or, un tel modèle mathématique du possible remet justement en cause les principes de description réalistes des mondes possibles dégagés par Armstrong ;
• Le troisième motif est illustré par une tradition qui court de Bergson à Deleuze et Lyotard et cherche à rapatrier le possible dans le réel. Pour Salanskis, cependant, celui-ci s’inscrit en fin de compte d’abord dans l’horizon politique de la révolution, finalement plus normatif qu’ontologique.
En définitive ainsi, l’idéalisme kantien surclasse les réalismes sur leur terrain de prédilection. De cette façon, un des nœuds essentiels de l’ensemble du débat devient apparent : contre le réaliste contextualiste ou le pragmatiste, le transcendantaliste estime que la conception rationaliste du réel pensé dans sa transcendance est essentielle pour rendre compte des dimensions fondamentales de notre existence que sont la science ou la politique ; contrairement le réaliste spéculatif, le transcendantaliste ne pose pas cette transcendance comme réalité mais la pense à partir de noms de commandement de portée infinie qui l’ouvre et la rend vivace. C’est peut-être alors du miracle que constitue la physique mathématique, et des liens profonds qu’entretient sa méthode avec la perspective transcendantal, qu’il faudrait repartir : en effet, celle-ci ne constitue justement pas un langage référentiel et descriptif, mais relève d’un procédé de légalisation a priori du sens par la constitution de structures objectives.
Dans la même perspective, Michel Bitbol entend montrer que c’est la perspective corrélationniste qui permet au scientifique d’assurer le plus de consistance entre sa conception de son activité, de ses objets et de son mode opératoire (ou procédure de décision)[Pour en savoir plus, on peut consulter la recension de [Maintenant la finitude [/efn_note]:
• Selon l’interprétation non-corrélationniste, la science a par principe pour objet les choses telles qu’elles sont en elles-mêmes et avance vers une image aboutie du monde en recueillant des données à partir desquelles elle formule des hypothèses élaborées rationnellement sur la base des informations fournies par les données. Cette conception cependant correspond peu au travail réel du chercheur, sujet incarné et social, dont les postulats ne sont jamais fixes, et dont l’activité mobilise un ensemble fluctuant de préconceptions, de postulats, d’hypothèses et de données dont les réagencements peuvent être profonds et globaux ;
• Au contraire, l’épistémologie corrélationniste implique de son côté de ne prédonner ni les structures transcendantales ni le format du réel Son modèle est donné par la théorie énactive de co-adaptation et de co-formation des catégories du sujet et des objets. Le modèle du travail du chercheur est la mise en suspend des préconceptions. Sa procédure de décision n’est pas décrite par un modèle de décision rationnelle sur la base de faits objectifs donnés puisque ni les préférences des agents ni les objets entre lesquels ils optent ne sont déterminés d’avance.
Paul Clavier enfin renvoie à l’ambiguïté de la conception kantienne elle-même en ce qui concerne le « hors de soi ». Kant distingue en effet l’extériorité empirique de l’objet effectivement rencontré dans l’espace de son extériorité transcendantale, qui relève de l’espace considéré comme forme du sens externe. Etre une réalité extérieure empirique veut dire transcendantalement être représenté dans le sens externe, ce qui introduit d’emblée une tension qui menace par moment le kantisme d’absorption dans un idéalisme subjectif à la Berkeley. A d’autres moments cependant, Kant semble adopter un réalisme de la chose en soi plus robuste. En fin de compte, cette différence de perspective permet de penser une forme de réalisme sectoriel, qui ne soumet au modulateur transcendantal que certaines interprétations, cherchant à faire entrer le réel dans le régime de l’objectivité ou menaçant la raison d’hétéronomie, et admet d’autres interprétations plus réalistes lorsqu’elles semblent impliquées par la logique du domaine concerné (par exemple la théorie physique).
La phénoménologie seule peut-elle encore nous sauver ?
Une première tentation est de penser le réel à partir de son excès et de son surgissement. Pour Jean-Luc Marion, le concept de réel caractérise aussi bien ce qui peut se penser que ce qui ne peut pas se penser. Toute la difficulté est alors d’échapper à une telle aporie, de permettre au réel d’échapper aux catégories de l’objectivité, de ne pas le considérer comme un contenu de pensée sans en faire non plus, à l’instar du matérialisme dialectique de Lénine, une matière qui ne se définirait que par sa résistance ou sa différence d’avec la pensée. La solution est ouverte par la phénoménologie, qui permet de distinguer le sens de l’objectivité, et d’en penser la positivité propre au-delà des structures de l’objectivité (permanence, définition, universalisation, répétabilité) qui ne peuvent que la recouvrir. Pour Marion, l’événement est la catégorie la plus à même de nous guider dans l’élucidation de l’advenir des phénomènes : il en explicite en quelque sorte les caractères intrinsèques (irrépétable, excédant, irréductible, sans condition).
Pour Claude Romano également, la phénoménologie permet seule de sortir d’une compréhension représentationnelle (s’attachant à comprendre les conditions auxquelles nos représentations sont susceptibles de nous donner accès au réel). Elle récuse en particulier en effet l’approche représentationnaliste de la perception, qui doit au contraire être comprise comme dévoilement, attestation de l’indépendance ontologique du perçu à même sa phénoménalisation. Pour Romano, cette perspective implique cependant corrélativement un tournant réaliste de la phénoménologie de la perception. Celui-ci passe par un holisme de la perception reconnaissant le caractère structurel de cohésion de l’expérience du monde, qui fait de celle-ci quelque chose de non révisable. Il s’agit ainsi de montrer comment la certitude du monde est indissociable de l’existence de la conscience.
Structures
Reprenant la thèse exposée dans L’objet quadruple (recensé ici), Graham Harman justifie la nécessité d’une investigation ontologique par la double défaillance amont et aval des descriptions phénoménologiques et scientifiques à rendre compte de la choséité. La table n’est pas réductible à ce qui la constitue et la caractérise, ni d’avantage à la façon dont elle m’apparaît et à ce que je fais avec elle. L’enjeu d’une métaphysique post-phénoménologique est ainsi de penser les choses « sans la pensée qu’on en a » tout en rendant compte de leur phénoménalité autant que de leur constitution matérielle (il faut comprendre la chose à l’entrecroisement de quatre pôles : l’objet réel d’une part, l’objet sensuel ensuite, les qualités réelles de l’objet, ses qualités sensuelles enfin). Un point d’entrée dans cette problématique est la thématique heideggérienne de l’objet qui cesse d’être disponible et manifeste ainsi par sa résistance sa choséité par laquelle il peut être outil. L’art constitue peut-être par excellence une telle pratique de re-choséification, et la philosophie pourrait alors se penser comme variété intellectuelle de l’art.
Ray Brassier prolonge de son côté l’argumentation proposée dans Le néant déchainé. S’il n’est pas raisonnable de maintenir la distinction des images scientifiques et manifestes du monde, et s’il est important pour la philosophie de ne pas se mettre en porte-à-faux avec l’image scientifique, il n’est pas question d’abolir purement et simplement l’image manifeste. Bien plutôt, il s’agit de déterminer le principe d’une explicitation progressive permettant d’assimiler l’image manifeste à l’image scientifique.
Dans une perspective assez proche Gabriel Catren entend articuler le transcendantal et le spéculatif. Contre Kant, il faut considérer le transcendantal comme un prisme temporaire, évolutif, accessible à une forme de manifestation, donc à une forme de variation. L’enjeu devient alors l’élargissement et la transformation de ce transcendantal. En effet, la nature excède et résiste à un transcendantal donné et invite toujours à son élargissement.
Dans un exposé plus technique, Frédéric Nef expose les motivations du tournant structural du réalisme scientifique. Celui-ci entend répondre aux difficultés posées par les variations des théories scientifiques et de leurs objets qui ne peuvent directement servir de support à une métaphysique réaliste soucieuse de proximité avec les sciences. L’enjeu est alors d’abord de donner une définition de la structure qui soit valide pour la science et la métaphysique ; en toute rigueur ici, on définit moins la structure que le fait de « discerner la structure »). Le réalisme structurel doit par ailleurs penser les structures de façon à ne pas faire disparaître les termes au profit des relations, ce qui implique d’en penser la complexité, par exemple en y incluant des relations de fondation. Il s’agit également de déterminer les constituants des structures permettant de rendre compte de caractéristiques métaphysiques des choses qui semblent antagonistes (consistance ontologique de l’objet, entre cohésion et diversité), en y articulant différents types de constituants (substrats, faisceaux, tropes, etc.) Il s’agit enfin de distinguer des grands types de structures : microstructures rendant compte des objets, macrostructures causales (pour rendre compte des régularités observables dans les événements et le devenir du monde), macrostructures profondes (élucidant les constituants derniers).
Trop tard depuis toujours
Meillassoux pour sa part justifie son intérêt pour la position inaugurée par Brassier, qu’il rattache à la tradition nihiliste originelle du matérialisme chimique du XIXe, illustrée par des auteurs comme Bazarov. Très populaire et intellectuellement dominant, ce nihilisme qui n’impliquait ni désespoir, ni mélancolie, a été destitué par l’émergence du matérialiste dialectique (réintroduction de la pensée spéculative dans le matérialisme) autant que par la « greffe » nietzschéenne de la protestation romantique contre la réduction scientisme et du nihilisme. En revivifiant cette pensée en l’infusant des meilleurs acquis de la pensée spéculative des XIXe et XXe siècles, Brassier en réactive la part créative et la puissance : il s’agit de déprendre notre pensée de notre existence immédiate en faisant de l’extinction future de notre espèce et de notre absence un véritable transcendantal.
Ubériser le transcendantal par la nature
Pour Maurizio Ferraris, il est urgent de renverser l’articulation kantienne de l’épistémologie et de l’ontologie et de revenir à une philosophie aux attendus plus conformes à ceux de l’attitude naturelle, toujours réaliste : avant d’avoir affaire à des objets, nous avons affaires à des affordances / potentialités qui ont une valeur vitale pour nous. Il s’agit de concevoir une matrice transcendantale rendant intelligible le passage de l’ontologie (les choses et leur structure) à l’épistémologie (l’expérience qui peut en être faite). Ce passage implique une conception du schématisme ancrée dans une pensée de l’enregistrement et la technique. Le savoir se constitue à partir de la nature par des structures d’enregistrement et de répétition que sont le rite et la technologie et émerge toujours d’une compétence sans compréhension.
Dans une perspective similaire, Louis Morelle souligne l’intérêt la lecture de Schelling que fait I. Grant. Selon cet auteur en effet, les difficultés contemporaines du réalisme viennent en grande partie du refus postkantien de penser la nature dans sa consistance propre. La nature ne doit pas être comprise comme résidu ou matière inerte mais se révéler comme puissance d’autoconstitution illimitée, ce qui implique de redéfinir au sein de la pensée de Schelling la relation entre physique et métaphysique afin d’inscrire la compréhension du vivant et de la pensée dans un physicalisme ininterrompu.
Fabrice Colonna en appelle de son côté à Ruyer et Chambon pour dépasser l’idéalisme de principe sur lequel est bâtie la phénoménologie, et que Husserl aurait pu partiellement conjurer en développant une phénoménologie hylétique ne considérant pas la hyle comme simple face vécue inerte de la passivité. Comme le souligne Chambon, il faut au contraire partir du punctum caecum de la réceptivité sensorielle pour en élucider les dimensions phénoménologiques. En attestent les nombreux indice permettant d’établir des liens directe entre les structures de l’expérience visuelle et ses supports matériels (transformation des figures à certains seuils, etc.) Une piste pour cela est d’adopter la métaphysique de Ruyer et de considérer le cerveau lui-même comme une chose en soi afin de rétablir homogénéité ontologique entre chose perçue et conscience. Le cerveau est un exemple de domaine absolu « domaine d’espace-temps» ou un «ici-maintenant absolu» caractérisé par présence à soi sans distance d’une réalité étendue. Cette métaphysique pose cependant des difficultés :
• elle considère l’expérience comme interaction de deux choses en soi, le cerveau et le perçu, mais ne peut décrire celle-ci qu’à partir des catégories causales et relationnelles de l’expérience courante ;
• le concept de domaine absolu est ambigu : tout domaine absolu n’est pas nécessairement conscient et il faut éviter et le panpsychisme tout en lui gardant une capacité explicative.
Dans la même perspective, Daniel Smith rappelle les enjeux du développement par Ruyer du concept de formes absolues : il s’agit en particulier de ne pas interpréter la nature des êtres en important des modèles perceptifs ou techniques dans leur description et ne plus penser la nature à partir de ses briques constituantes. La conception de Ruyer laisse alors trois tâches pour la métaphysique :
• élaborer une nouvelle philosophie de la nature ;
• différentier les formes absolues elles-mêmes afin d’en comprendre les expressions diversifiées (la cellule, l’organisme) ;
• inversement, penser la forme en soi, afin de déterminer ce qu’il y a de schématiquement commun à l’organisme, la molécule, etc.
Elie During enfin questionne différentes stratégies permettant de penser un devenir en soi. Pour ce faire en effet, l’appel à la diversité des temps et des échelles ne suffira pas : le monde sans moi est une antienne connue, depuis le romantisme, que l’idéalisme sait d’autant mieux conjurer qu’il en est à l’origine. De fait, la démarche de Meillassoux est plus offensive et vise à pousser la philosophie transcendantale dans ses retranchements en lui faisant admettre qu’il est nécessaire de penser un sens absolu au temps si on ne veut pas être amené à assumer un idéalisme subjectif. Ce projet peut alors être mené de plusieurs façons : en pensant un temps émancipé des catégories de l’objectivation (événement, etc.), ou en pensant au fond de la temporalité une base non chronologique, non temporelle du temps, comme c’est le cas chez Bergson, chez Deleuze, chez Richir, et aussi, autrement, dans la neuropsychologie. A ces pistes, During ajoute une troisième option, celle de l’ailleurs maintenant inaccessible à toute connexion causale, qui brise la corrélation par une effraction plus irréductible et insaisissable que celle de la contingence ou de la chose : celle de l’altérité.
Ma voix
Selon Francis Wolff, il faut plutôt faire du réalisme une implication de la parole. Le réalisme ne peut en effet être fondé par la seule rationalité dont le fonctionnement est fatalement idéaliste au point de porter larvé en lui la possibilité de la folie comme sa propre exacerbation. C’est au contraire le logos qui impose structurellement le réalisme et présuppose par la forme même du langage et de l’échange dialogique l’extériorité et la fixité de ce dont nous parlons.
Dans la même perspective, Etienne Bimbenet s’intéresse à la genèse autant transcendantale que biologique et socio-historique de cette structure dialogique et de visée de l’universel. Contre l’approche hégélienne ou heideggérienne faisant de l’interruption et du suspend la condition de possibilité du sens et de l’abstraction, Bimbenet en situe la genèse dans une interlocution elle-même transcendentalement inscrite dans une pulsion quasi-vitale à l’universalisation, à l’objectivation et à la fixation déictique. De ce fait, idéalisme transcendantal et réalisme ne s’opposent pas : l’idéalisme transcendantal élargi à l’empirico-transcendantal explicite bien plutôt les conditions de possibilité de l’attitude réaliste car « nous allons au réel par le rêve éveillé de l’universel ».

Point de départ plutôt que d’arrivée
Raphael Milliere souligne à son tour les faiblesses d’une approche démonstrative du réalisme : il est périlleux de vouloir démontrer l’existence du réel en soi des seules forces de la raison, et plus efficace de proposer une défense abductive du réalisme. Le réalisme apparaît alors comme la meilleure explication des régularités observées dans l’expérience.
Dans le même esprit, Paul Boghossian nous met en garde de ne pas glisser de la relativité sociale et contextuelle des définitions au constructivisme des faits. Qu’il puisse y avoir plusieurs descriptions pertinentes d’un fait n’empêche pas que certaines sont moins pertinentes que d’autres : tout nous invite à postuler, à supposer que quelque nouveau philosophe se soit jamais avisé de le nier, qu’il y a bien quelque chose comme la réalité telle qu’elle est en soi.
Gestes de pensée
Selon Pierre Cassou-Noges, les arguments de Meillassoux, lorsqu’il en appelle aux énoncés ancestraux aussi bien que lorsqu’il met en question la possibilité de penser la possibilité de penser son propre anéantissement, présupposent un « principe de présence ». Celui-ci peut être énoncé de la façon suivante : « ce qui est donné est contemporain à la donation ». Or, de nombreuse conception philosophiques nous appellent justement à remettre au cause ce principe. Dans Matière et mémoire ainsi, Bergson propose précisément une conception ontologique de la mémoire comme donation du passé comme passé. De la même façon, la phénoménologie a depuis longtemps voulu élucider la co-originarité de l’existence et du néant : rien ne m’empêche d’avoir l’évidence de la possibilité de mon anéantissement, qui n’est pas forcement donnée sous la forme d’une représentation ou d’un contenu de pensée. Avec Derrida plus généralement, il est possible de remettre en question le vocabulaire de la présence lui-même et d’envisager un dépassement latéral du corrélationnisme. La fiction apparaît alors comme le moyen privilégié d’établir une intuition différante et de donner sens a des énoncés dont le contenu n’est pas non représentable ou donnable au sens classique.
Arkady Plotnitsky de son côté montre à partir de l’exemple de la mécanique quantique comment la collaboration avec la physique ouvre des voies nouvelles à la philosophie. Ainsi, la construction du concept de causalité quantique élargit la compréhension de la causalité : tout événement quantique qui se produit et est enregistré comme tel définit un ensemble possible de résultats prévisibles en termes probabilistes ou statistiques relatifs à des événements futurs tout en excluant de façon irrévocable certaines prédictions à propos d’autres événements.
Pour Anna Longo enfin, de manière fichtéenne, c’est l’effort de la pensée dans l’acte de spéculation cherchant à dépasser la finitude sans pouvoir cependant s’appuyer sur aucun contenu dogmatique qu’il s’agit de considérer. Cette pensée spéculative ne peut recourir qu’à des jugements réfléchissants pour s’autofonder. La pensée spéculative s’apparente ainsi l’art : de fait, ce serait dans les performances de l’art contemporain que l’effort d’autofondation du transcendantal trouverait sa meilleure réalisation.
Le perspectivisme comme réalisme
Camille Chamois nous invite à distinguer deux usages du terme perspectivisme, qui peut désigner aussi bien un mode de compréhension qu’un mode d’individuation. Selon la première orientation, la réflexion interroge ce sur quoi porte la perspective, selon la seconde, elle constitue un mode d’individuation et de développement à comprendre comme tel.
Par son examen de l’idée de perspectivisme, Emmanuel Alloa conteste l’alternative artificiellement durcie du relativisme ou du scientisme et explore ce faisant plus précisément la première des options précédemment distinguée. Loin de mener au relativisme, le perspectivisme lie indéfectiblement le processus de généralisation et de construction de la connaissance à son ancrage contingent et local. Il n’y a pas de spectateur impartial ni de point de vue de nulle part mais un travail d’objectivation toujours ancré dans une perspective qui, en se reconnaissant et s’assumant, est au contraire la condition sous laquelle apparaît au sujet la vérité d’une variation, un véritable horizon d’amplification de la rationalité et d’enrichissement du sens.
Viveiros De Castro résume pour sa part ses travaux sur la qualité perspective de la pensée amérindienne. Ce perspectivisme, explique-t-il, est irréductible au concept courant de relativisme et suppose une unité de l’esprit et une diversité des corps. Les humains, dans des conditions normales, voient les humains en tant qu’humains et les animaux en tant qu’animaux ; les animaux prédateurs perçoivent les humains comme des pécaris, les pécaris voient les humains comme des jaguars. Ce qui est commun à tous les êtres est l’humain en tant que condition, en d’autres termes le fait d’être une personne. Tous les êtres voient le monde de la même manière, mais ils ne voient pas le même monde.
La réflexion de Baptiste Gilles de son côté nous permet de mieux appréhender le sens du tournant ontologique de l’anthropologie. Y a-t-il en effet un sens à parler de différentes ontologies ? Le terme ontologie ici n’est pas synonyme de culture et vise une dimension plus profonde, préréflexive, enracinée dans des schèmes moteurs et conceptuels : le langage ontologique vise à ne pas déréaliser ces différentes perspectives, mais il ne s’agit pas d’une ontologie au sens classique, mais plutôt d’une manière de faire monde, de découper le monde.
Dans un horizon plus général, Patrice Maniglier examine les conditions auxquelles ce perspectivisme peut fournir une véritable méthode d’enquête métaphysique pensée comme perspectivisme agissant. Celle-ci présuppose des concepts directeurs (monde, équivoque, variante structure), des procédures de liaison (requalifications de concept, ontologie provisoire) et implique surtout un changement de sens du mot être ; celui-ci ne désigne plus ce qui m’attend de l’autre cote des apparences mais ce dont je me découvre être une variante précise qui s’ignore, selon un processus de remise en perspective sans cesse relancé.
Cthulhu fhtagn ou le réveil du sans-fond qui semblait à jamais dormir
Didier Debaise nous appelle à abandonner le concept de nature des modernes, développé dans le but de ménager une certaine façon d’habiter la terre et réduisant le réel à ses a qualités manipulables isolables en laboratoire. Avec Latour, Debaise assume notre entrée dans un nouveau régime climatique et historique, dans lequel il n’est plus possible de distinguer l’histoire socio-politique et l’histoire géologique, ni de maintenir notre conception d’une nature stable, dont l’extériorité ouvrait le champ de notre action politique, qui se trouve mise à mal. Dans l’entremêlement des terres et des climats, il s’agit maintenant de faire place à la diversité des êtres et des relations : le perspectivisme apparaît alors comme un moyen pour opérer cette diversité maximale et développer une philosophie dont l’objet ne soit plus l’être mais les manières dont les sujets s’approprient et s’entre-traduisent les uns les autres.
Pierre Montebello rappelle pareillement que le réel est d’abord ce qui oblige la pensée : la fonction du concept de vérité est de permettre une prise de consistance des choses qui nous font face. La question des-lors se déplace, car l’enjeu du réalisme est de trouver de nouveaux moyens de penser la consistance des choses au-delà des assignations ontologiques que nous leurs donnions. En effet, le problème est précisément que nous ne parvenons plus à penser le poids des choses qui pourtant et c’est le paradoxe pèsent encore plus que jamais, peut-être. Les alertes écologiques et environnementales témoignent de cette prise de conscience du poids des choses après l’illusion théorique de leur infinie disponibilité à nos capacités manipulatoires et reconfiguratrices, etc. Les invocations de la terre, de Gaia, de l’anthropocène, du chtulhucène, etc., signifient d’abord cette quête d’un nouvel horizon de consistance qui appelle à une véritable réinstitution de nos modes d’existence (en particulier, avec la définition de nouveaux objets de droits comme la terre).
Quel nom pour l’absolu ?
En ramenant l’absolu à sa teneur logique, Halimi invite à un réalisme dégrisé : il faut en effet déprendre le concept d’absolu de la réalité et adopter un réalisme des vérités plutôt que des choses. L’horizon de l’absolu est pour nous celui des normes et des raisonnements, non celui du réel : les principes logiques ne sont ni des lois ni des formes, mais sont absolus parce qu’ils ne sont relativisables à aucun cadre.
Badiou adopte une perspective quelque peu moins déflationniste. Résumant la thèse fondamentale de L’immanence des vérités, il demande comment l’absolu peut être inscrit dans le fini. Il s’agit en effet pour lui de trouver un équivalent conceptuel de la pensée spinoziste des attributs à partir d’une ontologie du multiple, afin de déduire la possibilité d’avoir accès à de l’absolu « localisé ». Le concept mathématique d’ultrafiltre permet de concevoir la dialectique entre localité et absolu, en d’autres termes de construire le concept d’une approximation d’absolu qui, dans l’ontologie ensembliste de Badiou est paradoxalement à la fois contradictoire et irreprésentable. Il faut à la fois montrer la consistance d’un presque absolu (ensemble exprimer véritablement quelque chose de la structure de l’absolu) et la possibilité de le construire depuis le fini. Dans les termes de Badiou, il s’agit de « construire un attribut qui, en tant que forme possible du multiple, approxime l’absolu avant de pouvoir par la suite construire un mode infini qui témoigne d’une relation localement différenciée de l’absolu à lui-même ».
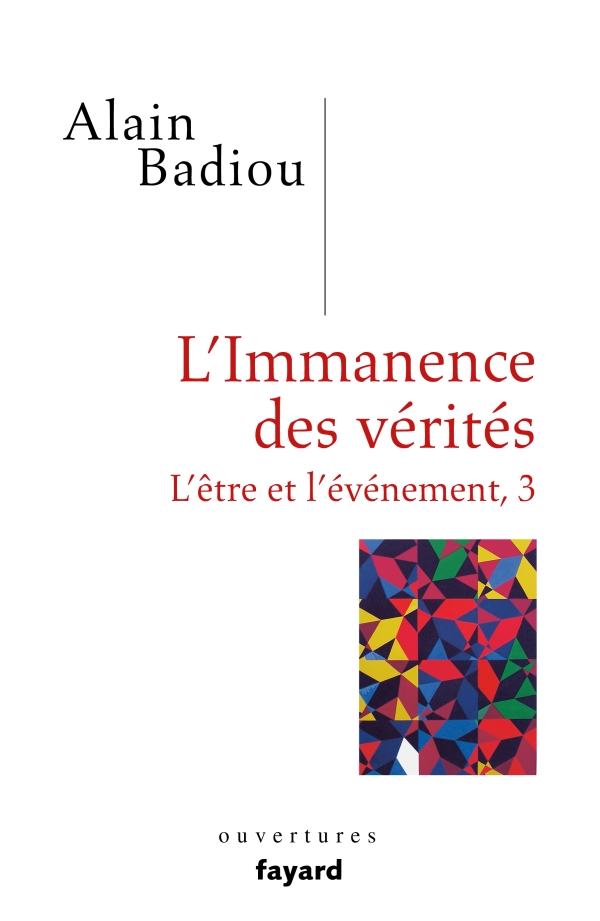
Dieu ou la vie
A ces méditations sur le concept d’absolu répondent les réflexions sur les absolus inscrits. Dieu tout d’abord, qui n’est pas indemne de la controverse du réalisme. Yann Schmitt distingue clairement les deux chemins d’une approche métaphysique du religieux. Donner des raisons de croire et de ne pas croire, et distinguer le débat sur la nature et l’existence de Dieu (réalisme) de celui sur les différentes traditions religieuses (fictionnalisme theologique).
Pour Camille Riquier, à l’inverse, l’alternative entre réalisme et fictionnalisme est biaisée. Il faut revenir à l’essence de la foi qui ne recouvre pas les préceptes d’un réalisme du religieux. Croire est une confiance pas une connaissance, pas besoin de justification. Le religieux est en quête de l’effraction d’un réel qui n’est pas la réalité des réalistes, une entende plus concrète. L’exemple, le catholicisme que Péguy a réappris de la philosophie de Bergson – chemin d’un retour au concret qui a permis un retour au concret de la foi.
Frédéric Worms esquisse enfin les principes d’un vitalisme critique visant à inclure la critique dans la vie elle-même au risque d’en changer la définition, en pensant celle-ci à partir de la pluralité des vivants et en y incluant la critique sociale.
Advengers : assemble ! (un succès de l’en-même-temps)
L’exercice est finalement une réussite : l’extrême diversité des perspectives et des positions n’occulte pas l’air de famille qui les rassemble, que ce soit par les préoccupations exprimées, des problèmes rencontrés, des arguments formulés. L’impulsion réaliste semble même accomplir le miracle de laisser miroiter quelques armistices. Entre métaphysiciens analytiques et continentaux, bien sûr, mais aussi entrer phénoménologues et tenants de la philosophie française contemporaine, voire entre philosophes rationalistes et anthropologues perspectivistes. La plus remarquable des rencontres est peut-être ici celle de la tradition classique, historique et herméneutique traditionnellement dominante dans l’université française et d’une métaphysique expérimentale parfois moins « propre » et souvent plus « disruptive ». On ne peut en tout cas qu’admirer le tour de force historique réalisé par les organisateurs d’un colloque ayant ainsi réuni les principaux représentants internationaux de ces différents courants.