Si, aux yeux des chercheurs en danse, l’articulation entre le geste dansé et la pensée fait évidence, elle ne va pas de soi pour les chercheurs en philosophie de tradition académique. On observe depuis une décennie un foisonnement de la réflexion autour de la danse, émanant de chercheurs en provenance de disciplines variées. Néanmoins, la nécessité de créer un champ disciplinaire intitulé « Recherche en danse » manifeste la marginalité de l’objet « danse » par rapport à d’autres arts : peinture ou musique n’ont jamais posé problème à la philosophie, même s’il s’est parfois agi de réprouver l’art pictural chez Platon notamment.
L’objet d’Elsa Ballanfat dans son ouvrage La Traversée du corps1 est précisément de récuser l’apparent antagonisme de la pensée philosophique, visant à penser le sens de l’existence, et de la danse. Admettant la difficulté de réfléchir le mouvement dansé au présent – il faut suspendre le geste pour pouvoir en (d)écrire l’expérience –, la danseuse et professeur de philosophie tient cependant le pari d’affirmer en philosophe la pensée par et au travers du corps. Le corps pense : cela va de soi pour les danseurs et les danseuses, mais bien moins pour l’Histoire de la pensée philosophique. Pourtant, et c’est la thèse d’Elsa Ballanfat, il faut cesser de taxer les philosophes d’un « mépris du corps » : ne pas en avoir parlé jusque-là ne signifie pas que Descartes par exemple l’a répudié. Aux yeux de l’auteur, il suffit désormais d’ouvrir cette page de la philosophie, et d’enrichir la philosophie par la réflexion sur la danse. Cela correspond à une attente de la part des philosophes contemporains, lesquels cependant ne sont pas toujours en mesure d’en réfléchir l’expérience pratique.
De fait, il faut attribuer aux instigatrices de la danse moderne du début du XXe siècle et à Nijinski les premières tentatives frontales de légitimation de l’intelligence du corps dansant. Aussi Elsa Ballanfat puise-t-elle chez eux la matière d’une pensée qui s’articule étrangement bien avec la philosophie, aussi bien contemporaine que moderne ou antique. Quant à la pratique de la danse qui permet de « traverser le corps2 » de manière philosophique, elle n’a de « moderne » ou de « contemporain » que le nom, puisqu’elle s’est initialement positionnée comme impulsion naturelle au mouvement. Aussi ne retrouve-t-on pas chez Elsa Ballanfat la traditionnelle tension entre danse classique et danse contemporaine : historiquement antérieure à cette dernière, le ballet classique lui est, selon elle, postérieur en termes de sophistication, rien de plus. Il n’y a donc pas vraiment de rupture d’une pratique à l’autre, mais plutôt une complémentarité et une coïncidence : à travers ces gestes, le corps (se) pense. L’ouvrage est d’ailleurs préfacé par Nicolas Leriche, ancien danseur étoile de l’Opéra de Paris. Ce dernier expose l’évidence que représente, pour un danseur, l’idée que le corps pense, et la frustration de n’avoir pas toujours la possibilité de mettre des mots sur son expérience. En même temps, « la danse est un langage en soi3 » selon lui, qui pourrait peut-être se suffire à lui-même, si elle ne revêtait pas un enjeu relationnel au spectateur. Vocabulaire expressif, la danse est porteuse d’une narration possible, d’un discours, et en cela, d’une pensée.
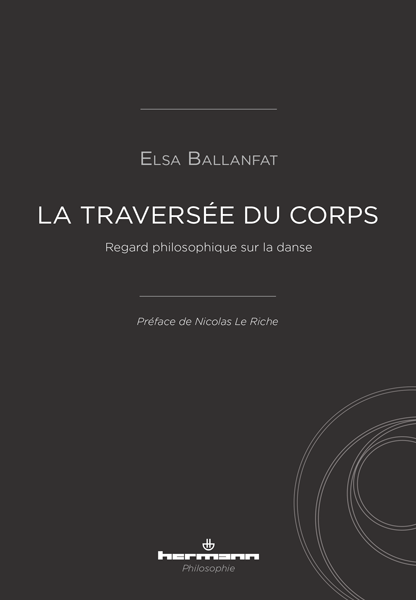
L’introduction de l’auteur balise la réflexion qui suivra et ses enjeux en philosophie. Son « ambition » est de « soutenir que la danse est philosophique » en soi et qu’il est temps de « faire place à une philosophie de la danse4 » au sein de la philosophie elle-même. Deux problèmes se posent : d’une part, la danse semble être une « terre impropre à la réflexion5 » car elle mobilise le corps, par opposition à la pensée ; d’autre part, le terrain de la danse semble « d’un accès difficile au public6 ». Hantise du philosophe à l’égard de la danse, avant tout.
Mais selon Elsa Ballanfat, il est essentiel de « penser dans la continuité de l’expérience du corps. […] il s’agit de mesurer la nouveauté de la danse pour la philosophie. La danse fait découvrir l’intelligence sensible, elle ouvre une pensée qui se développe à même le corps 7 ». Vectrice d’une « nouveauté » pour la philosophie, la danse est l’occasion de développer une pensée. Elle fait ainsi « du corps le sujet du discours philosophique8 ». Ce renversement ne consiste donc pas simplement à parler du corps, mais à mobiliser la danse comme méthode d’exercice philosophique. Le questionnement philosophique est permis par l’entremise du mouvement, lequel « sème l’interrogation9 » caractéristique de la philosophie : la danse « procure […], ce qui n’est pas négligeable pour qui s’engage en philosophie, une manière de vivre ces problèmes, de les incarner, c’est-à-dire aussi d’en trouver l’ancrage dans l’existence. À exister en pratiquant la danse, c’est la philosophie qui se retrouve comme à sa naissance : elle se redécouvre en train de se faire, à l’aube des questions qui l’ont le plus occupée. Parce que la danse refait jaillir des questions par sa pratique, elle redonne à la philosophie sa source incarnée, et peut-être aussi, sa voix : loin de parler dans un discours technique à l’excès, la philosophie, lorsqu’elle devient philosophie de la danse, rencontre une épreuve de l’existence, ou plus exactement thématise l’existence dans l’épreuve d’elle-même10 . » C’est l’expérience philosophique qui semble se jouer dans l’expérience du danser. Il se pourrait même que la danse soit une manière de retrouver l’ancrage et l’amarrage corporel de tout problème philosophique. Ainsi, la danse « redonne à la philosophie sa source incarnée11 ». Certes, en philosophie, on a affaire à des concepts, lesquels résultent de l’abstraction mentale. Ce processus résulte néanmoins, selon Elsa Ballanfat, d’un ancrage incarné dans le monde. Mais réciproquement, la danse permet de faire l’expérience desdits concepts fondamentaux de l’existence, à tel point que ce peut être de la danse elle-même que surgit l’envie de faire de la philosophie : « Éprouver des problèmes, c’est-à-dire découvrir que le rapport entre deux notions, comme celles d’âme et de corps, suscite une question, défait l’évidence dans laquelle une opinion semblait le comprendre ; cela revient encore, plus loin, à découvrir les grands concepts de l’existence12. » La danse pose les questions et suscite l’interrogation philosophique.
Il va s’agir dans l’ouvrage de la danse comme art, par opposition à une pratique universelle et spontanée. C’est pourquoi Elsa Ballanfat n’évacue pas, il s’en faut de beaucoup, la technique de la danse et ne distingue pas fondamentalement la danse moderne ou contemporaine de la danse classique. Dans tous les cas, le corps dont il est question en danse n’est pas un corps spontané mais bel est bien un corps que la pratique modifie. Aussi la philosophie de la danse proposée par l’auteur part-elle d’un corps qui pratique ou a pratiqué la danse ; cela ne signifie pas pour autant qu’un corps qui n’a jamais dansé ne peut pas « se » penser comme dansant. D’autre part, l’auteur souhaite initier une méthode qui mêle pratique et réflexion : Elsa Ballanfat souhaite inaugurer, ou du moins promouvoir, avec la philosophie de la danse, un champ nouveau de la philosophie elle-même. Il s’agit bien de penser, mais penser une pratique qui « procède du corps danseur13 » lui-même parce que cette pensée « se veut la pensée d’une pratique14 ». Et cependant, la philosophie de la danse s’adresse à tous ; elle apparaît à ce titre comme une nécessité : « c’est le moment, pour la philosophie de la danse, d’advenir15 ». Cette formulation lance un véritable manifeste : « En effet, parce que les danseurs, pendant plusieurs générations, n’ont pas eu accès à des études générales, ou simplement aussi poussées que d’autres, leur parole est restée prisonnière d’une forme de complexe. La pratique d’un art dit du corps ne pouvait inciter à prendre confiance en ses propres mots, ni à y chercher le début d’une réflexion possible. L’expression d’une philosophie du corps danseur, venue du corps lui-même, veut ainsi éviter que les paroles de la danse ne lui soient volées16. » Parler la danse, à partir du vécu du danseur, devrait permettre de réfléchir autrement les problèmes de la philosophie et en cela, répondre paradoxalement à une attente de la part de ceux qui l’ont jusque-là refusé de la prendre en considération : « La philosophie, prise pour fin de la pensée, vise son propre développement en se nourrissant de la danse comme d’une nouvelle source. La philosophie de la danse est donc une nouvelle manière de réfléchir aux problèmes philosophiques, mais elle répond aussi à la volonté de révéler la danse à un public qui l’ignore ou ne l’a pas prise au sérieux jusqu’alors17. » Dans deux notes toutefois, l’auteur mentionne d’autres instigateurs de la philosophie de la danse, aussi essentiels à ses yeux qu’à ceux de la Recherche en danse : Paule Gioffredi, Katharina Van Dyk, Véronique Fabbri puis Frédéric Pouillaude18. Mais le texte de l’ouvrage lui-même passe sous silence la teneur de leurs travaux, comme pour sous-entendre leur caractère insuffisant ; ou plutôt, pour récuser implicitement la minimisation d’un tel geste par ces penseurs eux-mêmes, comme s’ils validaient l’opprobre et la marginalisation de ce qui paraît pourtant essentiel : philosopher à partir de la danse.
Elsa Ballanfat prend le parti de faire se rencontrer analyses chorégraphiques et œuvres philosophiques tout au long de son ouvrage. Cette « mise en dialogue de l’expérience dansée avec le corpus philosophique19 » est fécond, en ceci qu’il souligne à quel point l’engagement physique du corps dans le mouvement amène à penser différemment et à renouveler la réflexion. L’affinement de la sensibilité s’accompagne d’une plus grande subtilité dans le raisonnement. Car cette sensibilité « se travaille » tout autant qu’une argumentation : plus exactement, la sensibilité est tendue entre émotion et intellect, ce qui justifie la mobilisation du corps pour la précision de la pensée. Le mot d’ordre est le suivant : « penser dans la continuité de la sensibilité20 », et surtout pas en rupture avec elle : « au contraire […] il existe un lien entre ce que le sujet pense rationnellement et ce qui l’affecte, aussi bien dans le contenu de ce qui l’affecte que dans la manière dont il est affecté. Penser est une activité propre, mais qui se trouve liée à ce qui meut et émeut21. »
L’introduction inaugure le découpage de l’ouvrage en trois parties : dans la première, il s’agit de décrire comment le corps dote le sujet d’une conscience de lui-même ; la seconde questionne la tension du corps dansant entre matérialité terrestre et spiritualité céleste ; enfin, le dernier temps est celui du retour au monde et du questionnement sur l’appartenance politique du sujet dansant. Elsa Ballanfat y revient également sur le thème du « corps glorieux », propre à la théologie, et éclairant dans le cadre d’une philosophie de la danse.
Dans le premier chapitre : « La conscience du corps[Page 29.[/efn_note] », l’auteur postule l’idée que la danse est à la motricité ce que la réflexion est à la pensée : un redoublement sur elle-même. Dans la danse en effet, la motricité se réfléchit. L’auteur s’appuie sur Erwin Straus pour affirmer que la danse est un « sentir du sentir lui-même22 » et que « le mouvement dansé23 » opère « la réflexivité du sentir : le danseur se sent sentir, il sent son propre corps en mouvement qui résulte lui-même d’une relation sensible au monde24 ». Il faut noter ici, si l’on en croit Katharina Van Dyk25, qu’il s’agit d’une lecture biaisée d’Erwin Straus, assumée par Renaud Barbaras, et reprise telle quelle par Elsa Ballanfat. Renaud Barbaras propose en effet une telle hypothèse d’une réflexivité du sentir ; mais il y a écart vis-à-vis d’Erwin Straus. Au contraire, il semble bien chez ce dernier que le sentir ne soit pas conçu comme réflexif, au sens habituel de « spéculaire », en miroir, c’est-à-dire distancé. En réalité, chez Straus, la motricité se présente plutôt comme un sentir immanent26. Partant donc de l’hypothèse faiblement straussienne d’une réflexivité du sentir propre à la motricité, Elsa Ballanfat en déduit l’idée que ce mouvement résulte lui-même d’une relation au monde. Aussi la danse réalise-t-elle, selon sa lecture biaisée de Straus, « l’unité du sentir et du se mouvoir27 ». Il lui semble dès lors possible d’affirmer que la danse « entraîne une nouvelle forme de conscience de soi28 ». La danse « fait découvrir le ‘je’ comme corps29 » : je suis celui que le monde extérieur affecte. Je ne suis donc pas simplement une substance pensante : je pense parce que je suis ce corps affecté, ce pôle unitaire de toutes mes affections. Avec la danse, le corps prend un début de dignité morale, ce qui présente des vertus thérapeutiques utilisées aujourd’hui dans le domaine du soin (nous pensons à la danse-thérapie).
C’est de Descartes et des Méditations métaphysiques dont il est alors question. Car c’est aussi avec son corps que Descartes écrit, un corps qui s’est réfugié aux Pays-Bas, un corps qui a froid, un corps qui n’est pas absent des propos du philosophe. Plus exactement, c’est du corps lui-même que surgit la nécessité de la réflexion. Il en est la cause, mais aussi le moteur, selon Elsa Ballanfat. Cette affirmation surprend à l’endroit d’un philosophe dont on a coutume de penser qu’il accordait le primat à la seule pensée. Selon l’auteur, il y a erreur : Descartes mentionne tout au long de ses ouvrages la prégnance de son corps, comme point de départ de sa pensée. Il est toujours là, selon Elsa Ballanfat, même s’il ne s’exprime pas. S’il est absent, c’est aux yeux du lecteur, mais pas aux sens de Descartes.
Le deuxième chapitre : « La subtilité du corps », revient sur la genèse de la danse moderne. Si du corps surgit la conscience, restent à déterminer les modalités sous lesquelles il pense. En rupture avec l’idée d’une prostitution du corps par la danse, les danseuses modernes ont « libéré » le corps des femmes en promouvant son expressivité naturelle. Peut-être y aurait-il eu lieu d’introduire quelques nuances, car la référence à ces pionnières peut paraître idéologiquement gênante : elles n’ont pas tu leur racisme, et leur mépris des danses « nègres » ¬— danses d’esclaves —, tandis que la danse moderne n’avait vocation à affranchir que des femmes bien plus « libres » politiquement 30. En tout cas, la plupart des chercheurs en historiographie de la danse réprouvent l’emploi du terme de « libération » associé, à tort selon eux, aux instigatrices de la danse moderne. Une posture philosophique critique et non-phénoménologique — différente par conséquent de celle d’Elsa Ballanfat — aurait questionné ce credo, en mobilisant des philosophes déconstructivistes, très en vogue dans le domaine de la recherche en danse : Jean Baudrillard, Michel Bernard ou encore Michel Foucault pour ne citer qu’eux. Or, Elsa Ballanfat écrit en métaphysicienne d’inspiration phénoménologique ; dès lors, en recourant aux pionnières de la danse moderne et en reprenant un discours partiel à leur sujet, l’auteur de l’ouvrage prête le flanc aux critiques qui se porteront sur « la phénoménologie » pour masquer le reproche d’ordre idéologique. C’est donc à regret que l’on voit l’auteur reprendre l’idée, aujourd’hui dénoncée par les spécialistes de la recherche en danse, d’une « libération » des femmes de leur carcan par l’entremise d’une « nouvelle » danse : ce faisant, elle s’expose à la critique d’une partie du public jusque-là acquis à la cause d’une philosophie de la danse.
Reste qu’une telle hypothèse, si elle est historiquement erronée, n’en demeure pas moins un postulat philosophiquement fécond : une telle promotion de la « libération » du corps, malgré les réserves que l’on peut émettre à l’endroit des instigatrices de la danse moderne, donne au corps l’occasion de se dire, de se penser. Plutôt que de copier un modèle esthétique, il s’agit d’écouter ce que le corps sujet ressent ou a à dire. L’affinement de cette écoute se travaille vers toujours davantage de subtilité. C’est à Leibniz et au concept de « petites perceptions » qu’il faut penser, comme y invite Elsa Ballanfat : chez Leibniz en effet, une perception peut se fragmenter en une infinité de « petites perceptions » qui se cumulent en une même temporalité. De la même manière, l’écoute du corps peut se faire infiniment subtile par dissociation infinitésimale de chaque sensation.
Un « autre langage31 » se fait jour : c’est l’objet du troisième chapitre. Il se fonde sur une introspection perceptive, mais il met en dialogue les corps. Elsa Ballanfat illustre son propos par le théâtre dansé de Pina Bausch : le premier mode de communication, un mode universel, est l’émotion. Le corps dansant manifeste l’émotion, et met en rapport idées et ressenti. Apparaît avec Delsarte, théoricien français de l’émotion scénique du XIXe, la distinction entre trois niveaux de langage : « le langage affectif dont l’expression est la voix, le langage elliptique qui s’exprime par le geste, enfin le langage philosophique qui se traduit par la parole articulée32. ». Le geste dansé basé sur l’émotion apparaît comme premier, et son langage universel : il s’adresse au cœur.
Le quatrième chapitre interroge la coïncidence à l’œuvre en danse entre « L’âme et le corps33 ». Il est ici essentiellement question d’Isadora Duncan. L’auteur le répète : « Le corps dansant n’est pas un corps naturel. La danse moderne s’avère d’autant plus intéressante sur ce point : tout en acceptant les lois de la gravitation, tout en reliant le corps à son environnement naturel comme à un espace de liberté, elle n’en découvre pas moins des besoins, des aspirations, irréductibles au corps réduit à sa définition physique34. » Certes, la danse moderne a voulu permettre aux danseurs de revenir à l’élan naturel, mais il ne s’est pas agi de réduire le corps au pulsionnel : plutôt de faire surgir du corps lui-même son aspiration à la spiritualité. On danse avec son âme : « Mes imitateurs caricaturent mon art. Ils dansent avec les bras et les jambes, mais pas avec leur âme. » soutient Isadora Duncan35. Cette dernière se réfère elle-même à la philosophie de Platon qui, dans La République, souligne selon elle le lien de l’âme à la musique et de l’âme au corps. Consciente de l’étonnement que peut susciter la référence d’Isadora Duncan à Platon, Elsa Ballanfat souligne que c’est l’insistance platonicienne sur « l’harmonie » qui séduit la danseuse moderne. C’est également dans Les Lois, du même Platon, qu’il est question de danse ; mais c’est surtout au Phèdre que Duncan peut effectivement se référer, tant sa danse se veut celle d’une âme ailée, le corps étant lui-même paré de voiles. Il apparaît ainsi comme le lieu d’où naît paradoxalement un désir d’envol et de transcendance. De nouveau, on peut reprocher à l’auteur de n’avoir mobilisé qu’une image d’Épinal de l’Histoire de la danse moderne. La danse d’Isadora Duncan n’est pas unifiée et se donna plutôt comme recherche stylistique perpétuellement renouvelée. Si le début de sa carrière est bel et bien marqué par le néo-platonisme, Isadora Duncan s’essaie à partir de 1911 et surtout durant les années 1920 à des danses beaucoup plus disharmonieuses. Ce n’est plus alors l’élévation qui fait l’objet de sa recherche. Peut-être aurait-il été judicieux, donc, de préciser que la nouvelle danse de Duncan n’était pas soluble dans le néo-platonisme, et qu’au contraire elle tendait, à terme, vers la réfutation d’une telle assignation36.
C’est l’envol lui-même qui fait l’objet du chapitre V : « S’évader de la matérialité ou la redéfinition de l’âme comme aspiration du corps37 ». Cette section entrelace en particulier la réflexion phénoménologique d’Emmanuel Levinas et son texte De l’évasion au témoignage de danseurs, notamment Israel Galvan – chorégraphe de flamenco. L’objectif de l’auteur est de signifier à quel point le terme même d’ « âme » ne désigne peut-être rien d’autre que l’aspiration du corps à la transcendance, à l’envol et à la fuite de ses propres limites.
Aussi le chapitre VI souligne-t-il notre « appartenance contradictoire au monde38 », en particulier à partir de la figure de Nijinski et de la méthode de Pina Bausch. Il s’agit pour l’auteur de rappeler que la faillibilité du danseur, sa solitude, son manque de stabilité, constituent la matière même de son désir de motricité. Danser soulage, apaise, comme le signifie l’extrait du livre VII des Lois. Il y aurait lieu de nuancer, ce que l’auteur omet de faire : il semble bien que cet extrait exclue toutes sortes de danses plus licencieuses, et néanmoins utiles au maintien de l’ordre social. Ne devrait-on pas pourtant penser que le déchaînement bien encadré des passions, au sein de rituels organisés et menant à la transe, présentent autant sinon davantage de vertus cathartiques que les danses pacifiques et bien policées ? Qu’on la réduise au seul mouvement autorisé, ou qu’on entende aussi par « danse » l’ensemble des pratiques licencieuses, le mouvement dansé permet bien de dépasser une souffrance, parce qu’à l’instar de Nijinski auquel l’auteur arrime ici son propos, le danseur devient autre-que-lui-même lorsqu’il danse, il se métamorphose et transcende son quotidien.
C’est précisément le « concept d’espace » et son expérience chez Cunningham qui font l’objet du chapitre VII. La danse de Cunningham en effet résulte d’un long processus de maturation, en particulier en lien avec le musicien John Cage, mais elle rencontre pleinement la philosophie dans l’abstraction de l’espace à laquelle elle procède ultimement. Il ne s’agit plus de vouloir remplir l’espace par le mouvement, mais au contraire de souligner le vide, autour des corps et entre les corps, par leur rencontre hasardeuse et une disposition spatiale non décidée d’avance. La chorégraphie n’est plus dessin du geste, mais expérience du concept d’espace.
Le huitième chapitre établit un parallèle entre Nijinski et René Girard autour du concept de « sacrifice ». La conviction de René Girard est que tout sacrifice a une fonction sociale : sa violence permet de rétablir l’ordre. Or, Nijinski est précisément celui à partir duquel est née toute une descendance chorégraphique autour du Sacre du printemps, pièce inaugurale de la danse moderne. La mort sacrificielle mise en scène revêt une fonction rédemptrice : c’est parce qu’elle est montrée que la violence s’éloigne.
Le neuvième et dernier chapitre clôt la réflexion avec le concept de « corps glorieux ». Après avoir souligné dans un premier temps, via Bergson, la nécessité de l’humour en danse, parce que le danseur doit savoir rire de lui-même, Elsa Ballanfat rappelle la proximité entre le danseur et les dieux, par l’aspiration du corps à la spiritualité. Elle relève la coïncidence entre ce que la tradition théologique judéo-chrétienne désigne par « corps glorieux », et le corps du danseur qui se donne en spectacle. C’est de l’expérience de l’existence elle-même dont son corps témoigne et dont il se fait la métaphore vive.
En conclusion, l’auteur rappelle, tout en se référant à Bergson et à Nietzsche, à quel point la danse dépeint « l’Humanité en mouvement ». En cela, la danse présente des dimensions philosophiques indubitables ; en particulier, l’âme est le nom que de nombreuses cultures ont donné à l’élan du corps : « La notion d’âme apparaît […] sans doute comme l’enjeu majeur de cette écriture, dans la mesure où, à l’aune de cette expérience inédite du corps qu’est la danse, elle apparaît comme le nom posé sur les aspirations les plus hautes de notre matérialité. Envol, immatérialité, légèreté, ne viennent pas d’une substance distincte du corps, différente, par sa nature immatérielle, du corps matériel. L’âme est le nom que les cultures, religions, pensées, ont donné à l’élan libérateur du corps, venant du corps lui-même, lequel ne s’exprime pas seulement par la quête de hauteur, mais davantage par celle d’un évitement-résurrection, d’une vie retrouvée dans la dépense même d’un mouvement se prenant lui-même pour fin 39. » En quelque sorte, le geste philosophique d’Elsa Ballanfat apparaît comme une revendication moniste, posant non une réversibilité de l’âme et du corps, mais fondant dans le corps la spiritualité elle-même — sans la récuser pour autant. Mu par une quête spirituelle, c’est en son corps que l’individu trouve la source essentielle d’une telle motion. Aussi Elsa Ballanfat invite-t-elle les « danseurs-philosophes » à « écrire à partir du corps ».
L’ouvrage se présente ainsi comme un objet enthousiasmant par son projet, mais quelque peu déconcertant par son contenu.
Sur le plan des références philosophiques, il exclut toute la pensée critique contemporaine, que les chercheurs en danse apprécient particulièrement — outre les auteurs mentionnés précédemment, nous pensons notamment à Gilles Deleuze. L’ouvrage a ainsi déplu à bon nombre de lecteurs pourtant acquis à la cause d’une philosophie de la danse, parce qu’Elsa Ballanfat s’amarre à un essentialisme déconstruit par la pensée critique, à laquelle s’abreuvent maints danseurs s’improvisant philosophes. Notre réserve à l’égard de l’ouvrage est en cela nuancée : s’il peut déplaire, c’est notamment parce qu’il ne mobilise pas les auteurs qui séduisent l’actuelle recherche en danse. Mais la déception des chercheurs en danse arrimés à la pensée déconstructiviste et rétifs à tout essentialisme métaphysique n’est pas injustifiée pour autant : l’inclination métaphysique d’Elsa Ballanfat tend à réduire la démarche phénoménologique, dont elle met en évidence toute la fécondité pour une philosophie de la danse, à une démarche métaphysique. Or, précisément, un tel amarrage de la philosophie au corps du danseur nous semble particulièrement puissant, et en cela la démarche de l’auteur hautement légitime et féconde ; il nous semble donc dommage qu’elle ne se soit pas tant emparée de la démarche phénoménologique en propre, que des discours de philosophes sur la phénoménologie – discours si ce n’est erronés, du moins fortement déconnectés d’une réalité corporelle.
Le danseur quant à lui peut ne pas se reconnaître pleinement dans ces propos, s’il pratique une technique évincée par les références mentionnées. En effet, nous avons souligné le fait que les danses carnavalesques, tribales, etc. semblaient ne pas entrer dans l’acception ici entendue du mot « danse » ; mais quoi qu’en dise l’auteur, la danse classique elle-même semble ne pas y répondre davantage dans la mesure où elle serait ce dont la danse moderne aurait prétendu s’affranchir. On peut en venir à se demander de quelle danse, en définitive, il est question, à partir du moment où l’on constate que la danse ici décrite ne correspond pas à celle observée par la recherche en « historiographie de la danse moderne ».
Quant au lecteur simplement curieux, il y a fort à croire qu’il ne tire de l’ouvrage que la confirmation d’a priori relatifs à la danse (une « mystique » inaccessible) et à la philosophie (totalement déconnectée du réel, bien trop métaphysique).
C’est vraiment dommage, car la motivation initiale de l’auteur reste particulièrement louable : il est difficile de publier sur la danse dans le domaine de la philosophie, il est difficile de faire tomber chez les philosophes un a priori excessivement négatif sur « la » danse sous toutes ses formes et des stéréotypes ridicules à l’égard de la danse telle qu’elle se pratique. Il est difficile également de mobiliser des philosophes autres que ceux issus de la tradition critique des années 1960 dans le domaine de la recherche en danse, et difficile enfin de faire sortir les publications en philosophie de la danse du sérail des seuls philosophes ou des seuls chercheurs en danse.
Ici, Elsa Ballanfat se mettait au défi, d’une part, de convaincre les philosophes du bienfondé de la philosophie de la danse, et d’autre part, de revaloriser une tradition philosophique métaphysique pour montrer sa fécondité en termes de pensée de la danse contemporaine. Aussi la démarche apparaît-elle comme riche de potentiel, mais le résultat n’est peut-être pas encore à la hauteur de son ambition.
Nous ajouterons ici une dernière remarque : cette recension a fait l’objet d’une première écriture dès lecture de l’ouvrage, en 2015, puis a nécessité une relecture du même ouvrage en vue de la publication d’une recension en 2018. La relecture s’avère particulièrement féconde et, en cela, surprenante : le texte d’Elsa Ballanfat présente une subtilité qui ne nous était pas apparue en première lecture. Autrement dit, nous invitons le lecteur à laisser le texte lui-même faire son œuvre, comme si le temps qui s’inscrit dans le corps permettait à la pensée elle-même de mûrir ; comme si le propos d’Elsa Ballanfat ne déployait tout son sens qu’après un premier moment lui-même critique. Ce sera notre dernière critique : il est dommage que la subtilité de la réflexion de l’auteur se donne plutôt, à première lecture, comme simplisme. Aussi serions-nous tentés d’encourager l’auteur de l’ouvrage à déployer au-delà d’un public de spécialistes une pensée riche et profonde, mais nécessitant l’explicitation de cette richesse elle-même.
- Elsa Ballanfat, La Traversée du corps, Regard philosophique sur la danse, Paris, Hermann Editeurs, Octobre 2015, 188 pages
- Nous reprenons ici le titre de l’ouvrage
- Page 6.
- Page 9.
- Page 10.
- Page 10.
- Page 13.
- Page 13.
- Page 15.
- Page 15.
- Page 15.
- Page 15.
- Page 22.
- Page 22.
- Page 23.
- Page 24.
- Page 24.
- Note 1 page 9 et note 3 page 10.
- Page 25.
- Page 26.
- Page 26.
- Page 30.
- Page 30.
- Page 30.
- Voir Katharina Van Dyk, « Sentir, s’extasier, danser. L’Implication chorégraphique selon Erwin Straus », Implications Philosophiques, 19 juin 2010 et 21 juin 2010, consultable à [cette adresse et à cette adresse
- À ce sujet, voir Erwin Straus, Du sens des sens : Contribution à l’étude des fondements de la psychologie, Paris, Éditions Jérôme Million, 2000 ; Erwin Straus, « Les formes du spatial. Leur signification pour la motricité et la perception » in Courtine (dir.), Figures de la subjectivité, Paris, CNRS Éditions, 1992, pp. 15-49. Voir également Katharina Van Dyk, op. cit. ; voir enfin Henri Maldiney, « Le Dévoilement de la dimension esthétique dans la phénoménologie d’Erwin Straus » in Regard, Parole, Espace, Lausanne, Éditions l’Âge d’homme, 1994.
- Page 30.
- Page 30.
- Page 31.
- ¬Toutes proportions gardées, bien sûr ; nous ne sommes pas certains de partager cette idée, tant il nous semble illusoire de penser « la liberté politique » des femmes au début du XXe siècle sur le modèle de celle des hommes de la même époque ; reste que rien n’est comparable à la condition d’une femme esclave ou même « noire » du début du XXe siècle
- Page 57.
- Page 70.
- Page 73.
- Page 73.
- Page 73.
- À ce sujet, voir Peter Kurth, Isadora Duncan. A Sensational Life, Back Bay Books, 2002.
- Page 89
- Page 107.
- Page 72.








