- Édition, titre et contenu
L’ouvrage dont nous faisons la recension aujourd’hui est un essai dont la réception souffre nécessairement d’une surestimation de son contenu à cause d’une maison d’édition prestigieuse et d’un titre engageant ; mais ces deux promesses ne sont pas tenues et la visée générale du titre aurait gagnée à être reconsidérée selon le strict point de vue du geste de Thomas d’Aquin dans l’histoire d’une idée : la « loi naturelle ». Son ambition ainsi amputée, son objet ainsi précisé, le texte en serait sorti plus homogène qu’il ne l’est, et son projet bien plus clair. Définissons-le maintenant, avant que nous ne précisions les trois motifs principaux[1] de la sévérité de cette recension. Élisabeth Dufourcq tente d’investir la notion de « loi naturelle » d’un rôle prépondérant dans l’histoire des modes de contrôle développés par l’espèce humaine, essentiellement occidentale, à partir du phénomène religieux tel qu’il se manifeste, au moins depuis le monothéisme chrétien que déploie l’Empire Romain, c’est-à-dire à partir du VIe siècle de notre ère. Un programme absolument passionnant : comment et pourquoi les autorités politiques dites du « spirituel », ainsi que leurs satellites, ont-elles employé le concept d’une « loi naturelle » dans le monothéisme chrétien ? Intuitions et pièges de la loi naturelle est un livre qui proposerait de réfléchir aux implications des rapports, dans les sociétés humaines, entre la nature (au sens le plus large possible) et la société, en tant que la nature sert de modèle ou insuffle un principe de nécessité juridique à une communauté donnée. À cheval entre différentes disciplines, Élisabeth Dufourcq voudrait suivre différents auteurs et tenter de démontrer que l’intervention de Thomas d’Aquin dans cette généalogie serait décisive ; et conditionnerait grandement la forme actuelle que nous en avons, découlant, selon elle, du bilan d’un affrontement entre croyants et non croyants, entre garants de la loi du Ciel (religieux) et agents pragmatiques du fonctionnement terrestre (laïcs, ou politiques).
Notons d’ailleurs que Pierre Manent, directeur d’étude à l’EHESS, animait le séminaire « La question des formes politiques » dans le prolongement de ses travaux personnels sur la genèse de la pensée politique moderne. Ce séminaire tentait de proposer des pistes qui sont presque exactement celles que soulève Élisabeth Dufourcq dans son texte, exception faite de la place donnée à Thomas : des formes de la philosophie politique en Grèce antique, dans la Rome républicaine et impériale et les transformations dues au christianisme de saint Augustin, ainsi que les problématiques d’adéquation entre pragmatisme, droit naturel et droit positif, introduites par Machiavel, Montesquieu et Rousseau. Du reste, elle le cite parmi ses sources, et Pierre Manent publie un livre prochainement aux Presses Universitaires de France : La loi naturelle et les droits de l’homme[2].
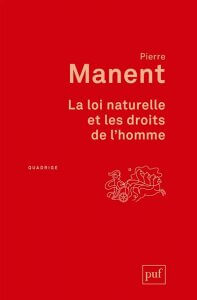
L’ambition d’Élisabeth Dufourcq est hélas fort vite déçue. L’auteure installe très vite Thomas d’Aquin comme horizon dialectique de la forme d’une « loi naturelle » polémique dans une scolastique qui commence déjà à se fragmenter. Les apports croisés des savants musulmans, des interactions avec l’extrême-orient par la route de la soie, c’est-à-dire la diversité et l’originalité de la démarche du livre, ne servent bien souvent que de prétextes pour affirmer des conclusions qui ne sont, en l’espèce, ni démontrables ni réfutables. Pour toute brillante que soit l’intuition d’un tel ouvrage, elle aurait nécessité un travail de bien plus longue haleine, et notamment une recherche bibliographique autrement plus complète, pour que sa conclusion soit possible.
De plus, et même si le concept central d’une « loi naturelle » (ou « loi universelle ») est bien investi de toute la problématique qui peut le caractériser, certaines disciplines sont tenues à l’écart et, disons-le, arbitrairement désignées comme impuissantes à apporter le moindre cheminement de réponse possible[3]. Enfin, nous pourrions nous dire que le programme du livre aurait pu être traité d’une façon qui n’est pas celle qui correspond au titre, et nous contenter, par exemple, de l’adjonction d’un sous-titre comme « Autour de la problématisation par Thomas d’Aquin », mais alors l’usage des textes du dominicain auraient gagné à jouir d’un approfondissement et d’une assiduité plus constants.
Précisons enfin la fonction d’une recension, selon l’usage le plus intègre possible. La recension d’un ouvrage doit suivre, de quelques années tout au plus, la parution de cet ouvrage, et faire le bilan de sa pertinence dans l’horizon temporel immédiat de la recherche. Autrement dit, une recension est un accusé de réception, qu’émet la communauté scientifique concernée par l’objet du livre, et la parole singulière de l’un de ces membres à propos de ses apports et de ses apories. Ainsi faut-il envisager deux cas de figures, pour la recension spécifique de Intuitions et pièges de la loi naturelle : dans un premier cas, le livre revendique une visée scientifique et la recension est à ce titre pertinente en ce qu’elle la lui refuse catégoriquement ; dans un second cas, le livre revendique une visée divertissante et notre recension est à ce titre moins pertinente (puisqu’une recension se doit d’être rigoureuse, et ne saurait en aucun cas être un article de vulgarisation, une campagne marketing ou une fiche de lecture pour étudiants). Dès lors, et c’est le sens de notre nota bene, la lecture de cette recension est parfaitement inutile pour peu que l’on décide de considérer que cet ouvrage n’a jamais eu pour ambition de s’inscrire dans l’horizon contemporain du savoir sur la réception d’un concept qui s’appellerait la « loi naturelle », et sa problématisation vis-à-vis d’une métamorphose qui, d’après l’auteure, proviendrait du numérique mais qui, d’après nous, ne serait que la conséquence des modifications des paradigmes fondamentaux la société de contrôle[4] (les multinationales comme nouveaux pôles de pouvoir politique non théoriques ou non symboliques). Avant cela, que l’on nous permette d’exposer le plan du livre, qui souligne le caractère extrêmement agréable de la promenade historique à laquelle il nous invite avec une certaine liberté. Dès lors, tout lecteur constatera qu’il joue, sur le plan du détail et des sinuosité de l’histoire traversée, le rôle d’un guide formidable ; on traverse tout, certes, mais trop peu de choses sont véritablement arpentées. Or voilà bien le problème : trop souvent, le chemin tire du côté de la narration arrangée, et trop rarement il verse du côté d’un examen rigoureux de sources que l’on organiserait en vue d’une expositio pour une demonstratio.
Prologue I – Aujourd’hui l’Apocalypse ?
Prologue II – Pourquoi le socle intellectuel du XIIIe siècle et lequel ?
Chapitre I
Fraternité originelle et souci d’ordre. Deux lignées de lois naturelles antiques
- Aristote et Cicéron. Un malentendu politique millénaire et encore actuel
- La grande métaphore de la loi inscrite dans le cœur. Jérémie, Platon et les stoïciens
- Loi naturelle, loi d’Empire. Marc Aurèle, empereur de l’ordre naturel et son médecin Galien
Chapitre II
Dans un Occident bouleversé. L’infirmité originelle de la nature humaine, la tentation de l’émancipation et le sauvetage des savoirs antiques
- La rédemption du péché originel et la gratitude envers Dieu, mais les Béatitudes et les élites disciplinées
- Boèce, la culture du patriarcat tardif et sa mise en forme scolastique
Chapitre III
Itinéraire de la loi naturelle en terres musulmanes
Fondements et limites philosophiques d’un dialogue islamo-chrétien
- Une scolastique byzantine greffée en islam
- La métaphysique, reine des cités musulmanes
- Nature mystique et responsabilité des élites
- Qui définit le bien public dans une nation « naturellement cultivée » ?
Chapitre IV
Dieu et l’impossible par nature chez Maïmonide. L’échec pédagogique et l’allégorie à double sens
Chapitre V
Qui, en Occident, détiendra le mandat du Ciel ?
L’Empereur ou le pape ? La loi naturelle instrumentalisée par les puissants
Première manche – Avantage à l’Empereur arabisant
Deuxième manche – L’habileté d’un vieux pape
Chapitre VI
Jeunesse de Thomas d’Aquin : l’équilibre bénédictin, l’héritage d’Augustin, revisité et l’avant-garde impériale
- Dans l’aura de saint Benoît, le temps des psaumes et de la bienveillance
- Augustin revisité
- L’avant-garde de Naples
Chapitre VII
Dans le Paris du jeune saint Louis. La pesanteur scolastique, la sympathie naturelle d’Assise et l’étincelle venue d’on ne sait où
- Les paradoxes du quartier latin
- La lumière franciscaine
Chapitre VIII
À Paris, deux savants et un artiste s’autorisent à penser par eux-mêmes et replacent à son juste niveau l’idée de loi naturelle
- Albert le Grand primauté à l’expérience et refus des faux-semblants
- Roger Bacon. L’exaspération de l’incompris et l’ouverture sur le monde
- Le regard naturellement artiste de saint Bonaventure
Chapitre IX
Vingt ans dans la vie de Thomas. De l’excellence dogmatique parisienne aux dialogues italiens avec la synagogue, l’orthodoxie et l’islam
- Les conditions pas si naturelles de l’excellence parisienne
- Les lumières d’Italie et les controverses avec les sages des trois religions
- La souffrance du juste
Chapitre X
Comment relire aujourd’hui la Somme qui inspira Dante et la Contre-Réforme ?
Chapitre XI
Questions intemporelles sur la nature humaine
Chapitre XII
À quelle loi se fier ? Le trio loi éternelle, loi naturelle, loi humaine peut-il être un modèle actuel ?
- Qu’est-ce que la loi ?
- Question 91 : Différents types de lois
- Question 93 : La loi éternelle, clé de voûte du traité
Chapitre XIII
Loi naturelle selon Thomas d’Aquin. Principes et pièges.
Chapitre XIV
Loi civile et spiritualité chrétienne
- Thomas, Jean-Jacques et Isodore. Invocation de la loi naturelle, ou laïcité instruite par l’expérience ?
- Fraternité, citoyenneté, raisons d’État et connaissance du prochain
Conclusion Place au témoin plus qu’au concept
Index
Note Bene
Les nota bene figurent ordinairement en fin de contenu ; au bas d’une page, en fin d’un courrier, par exemple, et permettent de donner une précision déterminante sur l’ensemble des informations du texte auxquelles elles se rapportent. Cela étant, il nous a paru essentiel de continuer par une telle note, et nous pourrions parler d’une note bene a priori, ce qui n’aurait pas été dénué d’une certain ironie, eu égard aux défauts structurels du livre. Cette note introductive nous permet d’épargner au lecteur le parcours d’une recension qui peut paraître âpre et peu engageante, en ce qu’elle nous donne l’occasion d’écrire (et « d’assumer ») que la plupart des reproches qui suivent relèvent sans doute d’une erreur d’appréciation a priori, et non d’ambitions qu’auraient eu l’auteure et qu’elle aurait conséquemment déçues. Autrement dit, la déception relève sans doute de ce que nous en attendions, eu égard au titre et à l’homogénéité ordinaire des contenus éditoriaux du Cerf.
En aucun cas, l’auteure ne se présente comme une historienne, une philosophe ou une philosophe de l’histoire, et les problèmes dont nous avons fait un relevé ne sont, au fond, que le résultat de l’exigence avec laquelle nous souhaitions apprécier son propos. Intuitions et pièges de la loi naturelle n’est en effet pas un texte scientifique mais une conversation qui est aussi cultivée qu’elle se dispense de méthode démonstrative.
Le livre explore une piste étonnante et d’un abord intrigant, celle de l’usage politique, par une minorité, des relations avec la « nature » et ce qu’elle permet de supposer, et de présupposer comme contraintes à l’humanité. En un langage monothéiste : pourquoi le décalogue et qui peut sanctionner son respect (c’est-à-dire le quid legit de Kant). La focalisation historique est à cheval sur une double visée, aujourd’hui et avant-hier — le numérique et la scolastique. Les comparaisons en sortent enrichies de liens que la rigueur n’aurait pas permis, mais qui éclairent de manière passionnante des perspectives autrement inenvisageables. L’idée d’une « loi » qui serait naturelle, mais instituée par des hommes, nous renseigne sur une certaine intelligibilité des procédés de médiation en vigueur aux époques ciblées. Il n’est pas du tout inintéressant de situer l’auteure, femme de grande culture plusieurs fois investie de rôles politiques de premier plan[5], haute fonctionnaire, auteure de plusieurs livres sur l’histoire religieuse de la chrétienté, notamment féminine. Il faut donc reconnaître la stature intellectuelle de l’auteure dont nous il incombe aujourd’hui de rédiger la recension. Or donc, c’est aussi à ce titre que nous tenons particulièrement à souligner encore que nous avons jugé l’ouvrage selon les prérequis d’une lecture scientifique. Qu’il s’agisse d’histoire des idées, de philosophie ou de la philosophie des théories de la connaissance[6], le livre ne tient pas les promesses qu’une lecture scientifique en attendrait.
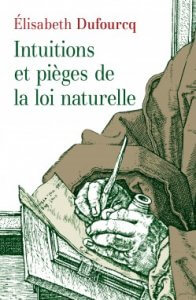
Dès lors les pages suivantes de notre compte-rendu s’attacheront désormais à considérer le livre selon l’exigence universitaire et seront absconses pour quiconque aurait les privilège de ne lire ce livre qu’au titre d’une excellente initiation à l’importance du rôle de Thomas d’Aquin dans le transfert des principes fondamentaux qui régissent le droit canon vers une pragmatique du droit laïc.
Les conditions nécessaires pour une approche de l’idée de « loi naturelle »
L’auteure propose de réfléchir à la définition d’une « loi naturelle », et à aux implications de sa confiscation par une élite politico-religieuse. Partant de Marc Aurèle et par le cheminement de penseurs musulmans et chrétiens, de l’Université parisienne (fondée au tout début du XIIIe siècle[7]), de Dante, même, de la « contre-Réforme » (c’est-à-dire la compagnie de Jésus, autrement nommée ordre des jésuites), elle installe Thomas d’Aquin au centre de cette constellation du rapport entre loi divine et loi humaine, et culmine enfin (Chap. XIII, pp. 383-422) avec une réflexion pénétrante sur le rapport du dominicain à « question 93 » (Chap. XII, pp. 353-380). Il faut adjoindre à ces deux chapitres celui qui les précède (Chap. XI, pp. 329-350) pour réunir le cœur de l’ouvrage. Ainsi, ces cent pages contiennent l’originalité propre à la réflexion d’Élisabeth Dufourcq sur la saisine, par Thomas d’Aquin, d’une conformité du droit humain à une « loi éternelle ». Le dominicain en emprunte littéralement l’idée à Saint Augustin, Père latin de l’Église déjà impériale, pour l’actualiser dans le contexte de l’Université de Paris qu’une Europe morcelée place au centre de l’activité scolastique — dans des royaumes que rien n’unit sinon le réseau d’évêques (dont s’inspirent d’ailleurs à la même époque les rois de France pour songer à une méthode d’unification d’un royaume aussi vaste et divers qu’il est riche et disputé : l’administration cléricale). La loi des hommes peut-elle, et si oui, comment, être en conformité avec une « loi éternelle », c’est-à-dire divine ?
Une absence rédhibitoire
Cela étant dit, la faute majeure de l’ouvrage ressort plus caractéristique encore de la précision minutieuse de son objet. Nous allons simplement prendre un exemple qui met peut-être en exergue les élisions problématiques dans le maillage historique. En effet, le tourbillon des évocations, des modes de problématisation soulevés, sans qu’aucun ne soit pourtant examiné quand ils pourraient, absolument tous, être en soi pertinents, le va-et-vient incessant d’un bout à l’autre de la frise de l’histoire, mais aussi de la géographie, des doctrines, de l’épistémologie, tendent à noyer le lecteur dans un brouhaha contre-productif. Peut-être aurait-il mieux valu justifier l’œuvre de Thomas vis-à-vis de ce qui en est fait après (par Rousseau ou Kant, puisque celui-ci travaille sur la question du « contrat social » à partir de celui-là), ou de ce qui en demeure problématique aujourd’hui, dans un monde pour lequel la lecture critique de la Bible, le nazisme ou Vatican II sont des données de l’histoire. Précisons que l’auteure propose d’interroger le rapport entre l’expérience et l’idéal, c’est-à-dire, pour résumer cela à une question qui traverse l’histoire des idées, à ce que Leibniz tente de résoudre avec son œuvre majeure, la Théodicée[8]. L’expérience du monde devrait faire mentir l’énoncé des Écritures, alors comment concilier la bonté et l’omnipotence infinies de Dieu avec une réalité pourtant empreinte du mal ? Si Dieu est infiniment bon, alors il exclura le mal du créé et s’il est omnipotent il le peut. Si le mal existe, c’est alors que Dieu n’est pas infiniment bon, ou qu’il n’est pas infiniment puissant ; et l’expérience du mal s’impose aux hommes. Il faut donc une explication qui permît d’épargner le double impératif divin d’une part, et le constat bien prégnant du mal d’autre part.
« Trente ans plus tôt, pourtant, dans son traité De bono, Albert le Grand avait expliqué avec rigueur que de simples préjugés et même des idées fausses pouvaient être érigés au rang de principes premiers. Et avec plus de véhémence, Roger Bacon avait dénoncé au pape ce travers ou cette facilité.
Il fallait attendre bien des siècles encore pour qu’au moment de la Renaissance, et de la Réforme, le couvercle de ces principes intellectuels à l’ancienne soit violemment soulevé avant d’être réajusté par la Contre-Réforme. Entre-temps, dans son Apologie de Raimon Sebond, Michel de Montaigne, catholique mais juif d’origine avait, par un feu d’artifice d’érudition, montré que les chrétiens n’avaient rien à gagner à la loi naturelle. Au XXe siècle enfin, à l’époque de la montée du nazisme et à une époque où les préceptes du Concile de Trente inspirés du thomisme et renforcés par l’infaillibilité pontificale ne pouvaient encore être discutés, Bergson écrivait : « Les Deux sources de la morale et de la religion ». Fort de ses prémonitions, il observait en 1932 : « Une morale qui croit fonder l’obligation sur des considérations rationnelles réintroduit toujours à son insu des forces d’un ordre différent. » Et que dire des diktats de l’inconscient qu’exploraient alors Freud et Young ? Que dire des archétypes des cultures que le courage de l’aventure incarnée par Lévi-Strauss eut le génie de faire apparaître ?
Ici, la conclusion de Thomas n’est plus nuancée par le débroussaillage entre le bien et le mal qu’il a entrepris dans ses traités sur les vices et les vertus ni par l’apport de cultures lointaines auxquelles s’intéressait Roger Bacon. Elle émane d’une prééminence de principe, celle du Bien, sorte de joker conceptuel don saint Bonaventure contestait déjà l’abus d’usage.
Au cours de l’histoire, il arriva parfois que pour réveiller nos consciences assoupies, le diable en personne nous rendît service en se moquant d’expressions vidées de substance. Bien des siècles plus tard en 1795, à une époque de réaction où un nouveau bain de sang noyait les utopies naturelles et les fêtes de la déesse raison, Fouché, ancien orateur frotté de thomisme, écrivait ceci pour mieux condamner ses anciens comparses : « Donnez donc un sentiment de justice aux brigands et une conscience aux assassins ! » »[9]
La citation de Bergson appelle a minima l’évocation de Kant ; comme le statut des « bains de sang » qui noya « les utopies naturelles et les fêtes de la déesse raison » est précisément l’un des objets saisis par Kant pour défendre la Révolution française avec Rousseau ou, tout au moins, une perspective analytique sur laquelle se précipita le philosophe allemand. Comment peut-on parler du problème d’une « éthique », d’une loi qui soit universalisable sans parler de Kant ou, si l’on préfère ne pas verser dans la métaphysique (geste de refus aujourd’hui très à la mode), tout au moins sans parler de la querelle du « pacte social » qui, en philosophie politique, opposa Locke, Hobbes et Rousseau ? Il serait délicat d’affirmer que les échanges entre ces trois grandes théories ont été dépassées au XXIe siècle, de sorte que les différentes factions politiques, selon les traditions historiques, rejouent indéfiniment le débat, sous des titres qui changent selon les régions du globe. En un sens s’agit-il de savoir simultanément comment accéder au sens de la loi naturelle, et comment mettre en place l’adéquation entre cette loi naturelle (inspirée, démontrée ou affirmée) et une loi positive, ou humaine. Ces questions sont d’une actualité brûlante, bien évidemment, encore que le triomphe des multinationales implique peut-être de repenser les paradigmes dans lesquelles elles doivent s’inscrire — peut-être, contre tout attente, sans changer de motif premier car le numérique est une extension du domaine de la lutte.
Au XVIIIe siècle, Kant trancha, peut-être radicalement, le nœud gordien de la « loi naturelle »[10] dans un texte paru en 1793, c’est-à-dire après la Révolution Française. Celle-ci soulève un paradoxe de taille dans la position de Kant, pour qui le peuple, en tant qu’il est à la fois le législateur et l’exécuteur du pacte social, ne peut pas se rebeller contre le représentant de sa souveraineté, et donc contester la loi humaine nécessairement conforme à la loi naturelle. Le sous titre de ce texte est d’ailleurs intitulé Contre Hobbes. Nous y revenons par la suite car il nous apparaît fermement que l’on ne peut employer un tel titre avec une perspective aussi généraliste en se passant du philosophe allemand — surtout lorsque le dernier chapitre de l’ouvrage donne une place significative à Jean-Jacques Rousseau. Les principes du Contrat Social de Rousseau peuvent être étendus, par Kant, à la nécessité métaphysique ; et donner, dans son texte du Vers la paix perpétuelle[11], une idée de l’application politique valable pour une approche de la transformation rousseauiste de la « loi naturelle » vers la loi des hommes. Nous devons parler longuement du rôle de Kant dans la métamorphose de la question d’une « loi naturelle », qui eût sans doute gagné à être mis en face de Thomas d’Aquin, sauf à nous contenter d’un ouvrage sur la problématisation, par Thomas, de la loi naturelle.
Car même si l’on songe à demeurer dans la seule scolastique, toute impasse sur Jean Duns Scot[12] se révélerait problématique, dont voici d’ailleurs ce qu’écrit Hannah Arendt : « Autant que je puisse en juger, dans l’histoire de la philosophie il n’y a que Kant à égaler Duns Scot dans son attachement inconditionnel à la liberté », cité sur la 4e de couverture. Liberté de l’homme, donc, tant vis-à-vis de l’homme lui-même mais aussi et surtout vis-à-vis de l’instance naturelle ou métaphysique pour ne pas dire théologique. C’est là, au fond, toute la question du libre-arbitre, posée par Saint Augustin que s’est appropriée Thomas d’Aquin. À ces titres, certains passages de cette recension sont-ils tournés vers une restitution, de ce qui manque cruellement au déploiement scientifique du projet tel que l’annonce le programme contenu par le titre. Certes, Thomas d’Aquin compte pour l’un des penseurs essentiels de la question du libre-arbitre (en tant qu’il a longuement réfléchi, dans le sillage de Jean Chrysostome[13], Père grec de l’Église du IVe siècle, à la question du bien et du mal), et donc de la liberté de l’homme vis-à-vis de l’injonction structurelle contenue dans et par le décalogue, c’est-à-dire dans la forme d’une « loi naturelle » conforme à la « loi éternelle ». Mais comment évoquer le numérique sans évoquer ce qui se trouve entre le numérique et Thomas ? Comment évoquer la forme contemporaine d’une idée, ou d’une relation, en se contentant de ne parler que de la forme que lui donna un auteur particulier, du reste mort il y a sept siècles ? Cela nous paraît très compliqué. Et si l’ouvrage de madame Dufourcq s’était « contenté » de ne considérer que la perspective thomasienne[14], alors peut-être aurions-nous eu la chance de bénéficier d’un texte plus resserré, plus précis et à juste titre passionnant.
2. Essai, travail scientifique et conversation
Fracture irréparable entre contenant et contenu
Le titre du livre d’Élisabeth Dufourcq est donc extrêmement alléchant : Intuitions et pièges de la loi naturelle. Il se trouverait donc une analyse possible qui renvoie dos à dos les intuitions (ce que Kant, prolongeant les catégories aristotéliciennes des lois de la raison, associe à la « raison sensible » du sujet) et les erreurs de conclusions trop hâtives à partir de ces intuitions, résultantes d’une erreur du caractère synthétique a priori de l’entendement[15]. Il y aurait donc eu la possibilité, à partir d’une relecture de la scolastique (Kant était un lecteur averti de scolastique, de sorte qu’à plus d’un titre l’on y a vu l’empreinte de la singularité de son style d’écriture), d’une confrontation interne à la terminologie kantienne. Il nous a paru tout à fait impossible de faire une lecture suivie de son contenu tant nous n’y avons trouvé aucune structure cohérente ni aucune méthode à suivre qui permît de comprendre le sens de la démarche envisagée. Parfois historienne, souvent péremptoire, rarement méthodique, la démarche du texte et en tout cas trop légère pour être reçue avec le sérieux qu’un tel titre aurait pu supposer.
Associant des rafales d’idées sans organisation logique, dont les contenus sont souvent météoriques quand ils ne sont pas insulaires, avec des notes de bas de page déroutantes qui n’étoffent pas le propos et se contentent volontiers de paraphrases, un effet d’accumulations nominales sans justification démonstrative (on trouve ainsi dans une même page, voire un même paragraphe, l’évocation d’auteurs qu’aucun territoire, aucune doctrine, aucune école ni même la moindre opposition ne relieraient les uns aux autres) à des liens historiques plus que surprenants[16]. Enfin, le corps du récit est généralement fautif d’une absence de cohérence, même séquencée. Ainsi apprend-on que certaines anecdotes prodigieuses ont joué des rôles absolument déterminants dans des aspects capitaux de l’histoire moderne. Cela passerait encore, si la démonstration n’en profitait pas pour affirmer ou défendre des principes idéologiques qui ne reposent plus sur aucun argumentaire, et seulement sur une approximation généralisée de faits historiques opportunément agencés.
L’ambitieux projet du titre rend donc la chute d’Icare plus rude encore qu’elle n’est — et s’il faut donner une défense au texte, précisons que le titre nous avait mené à en réclamer le privilège de la recension.
Le livre est certes un essai, mais il semble ne pas même être en mesure d’accomplir le programme pourtant habituel de toute démarche intellectuelle minutieuse : commencer par un tour d’horizon (un « état de l’ars ») des notions que l’on se propose de considérer. Nous allons voir au cours du rapide inventaire de citations que nous avons fait, des citations longues et complètes pour ne pas laisser croire que nous aurions isolé des assertions, sorties de leur contexte et dès lors dénaturées, que le concept de loi naturelle, pourtant très riche en histoire, est arbitrairement assigné à une place étonnante, et sans la moindre considération ni pour la métaphysique, ni pour la philosophie politique. Le procédé de tabula rasa auquel s’adonne l’auteure est certes pratique pour établir la légitimité de l’angle qui est le sien pour approcher Thomas d’Aquin. Se déploie une lecture transversale de quelques auteurs majeurs de l’islam et du christianisme médiévaux, animée par l’obsession d’une actualisation/analogie maladroite vis-à-vis des enjeux numériques. L’acuité est poussée jusqu’au cœur des conditions de la crise entre faibles et puissants, crise constitutive, au moins depuis l’Antiquité, des ferments des effondrements structurels démocratiques et républicains[17]. La « loi naturelle » serait alors l’argument d’une première forme marketing du phénomène politique qui se sait : le pouvoir en place, par exemple impérial (chez les chinois) ou papal (chez les catholiques), en usurperait les principes afin d’imposer aux classes dominées la nécessité de leur règne. Le pouvoir politique comme émanation de la « loi naturelle » aurait donc permis de piétiner le pacte social en le perçant d’exceptions. L’ouvrage soumet donc d’une enquête sur l’usage politique d’un tel argument cosmologique, qu’il fonde sur l’ordre monothéiste médiéval[18].
Plutôt que d’interroger les principes causaux d’une telle usurpation dialectique (sur la pertinence de laquelle nous ne nous prononçons pas), il paraît plus souvent que l’auteure calque sur des épisodes extrêmement complexes de l’évolution de la pensée monothéiste des préjugés et des déductions faites a priori de toute enquête bibliographique assidue. La réflexion mêle trop de textes, d’horizons trop divers, et ne parvient pas à soutenir une entreprise aussi ambitieuse par une cohérence dialectique qui fût suffisante. En outre, beaucoup de doctrines sont traités avec rapidité, souvent par des biais très étonnants, comme la légèreté de ce rapprochement étymologique dont la méthode ferait bondir n’importe quel latiniste :
« La question était alors et restée aujourd’hui de savoir si une loi dite « naturelle » pouvait être universelle et prévaloir sur une loi conçue et promulguée par des hommes. Mais d’entrée de jeu, ce problème fut biaisé par les mots. En soi, le terme de loi naturelle est une oxymore. En latin, le mot lex suppose quelque chose d’objectif, d’inflexible et de stable auquel chacun devrait se sentir lié. Au contraire, dans le mot féminin natura, l’essentiel vient de la fin du mot : le suffixe ur, signifie « ce qui va venir, qui va arriver », ce qui va advenir en longtemps ou survenir tout à coup. »[19]
La forme rhétorique de l’oxymore suppose une contradiction interne absolument évidente et intrinsèque aux définitions, comme l’illustre le célèbre vers du Cid de Corneille : « Cette obscure clarté qui tombe des étoiles »[20]. L’obscurité et la clarté s’opposent sur le plan sémantique et leur usage simultané apporte une contradiction interne, une expression dont on pourrait dire qu’elle est contre-intuitive mais qui fait fonctionner l’imaginaire avec plus d’efficacité qu’un énoncé dont la représentation est intuitive. Ce procédé de contradiction entre signifiant et signifié s’associe généralement à l’usage poétique. Ce n’est pas le cas d’une « loi naturelle » : la nature a des lois, est faite de règles, cosmologiques, biologiques, physiques et certains parleraient même de loi symboliques. En outre la nature a des lois que la science s’évertue à décrypter, dès lors que l’on considère la nature comme l’ensemble des phénomènes dont la raison sensible peut avoir conscience. La loi naturelle, nous le verrons, est aussi un principe fondateur de la métaphysique qui voit s’opposer idéalistes (le monde est le produit de l’esprit) et empiristes (le monde est le produit de la sensation). Avant Kant, David Hume proposait une réponse qui permettait d’entendre comme la « loi naturelle » était avant tout l’enjeu d’un travail épistémologique.
Une note de bas de page visant à corroborer la fonction de ce « suffixe ur » plonge tout latiniste amateur dans une perplexité qui rend le suivi du fil démonstratif plus que difficile :
« On connaît la phrase : « Ave Cesar, morituri te salutant. Ceux qui vont mourir te saluent. »[21]
Il eût été possible d’accepter une telle filiation, puisque le terme latin de « natura » avait un sens plutôt univoque avant que Cicéron (Ier siècle avant J.-C.), philosophe du politique, ne l’étende et ne le rapproche de la φύσις, phúsis grecque, « nature » au sens du κόσμος, kósmos, cette fois. La nature comme totalité qui constitue le monde — nous parlerons en philosophie moderne, à partir de Descartes, Hume puis Leibniz et Kant, d’une nature comme ensemble du donné phénoménal et, avec la philosophie des formes symboliques de Cassirer, d’une hyperstructure phénoménologique. Or de cette multiplicité des sensations, la faculté dite a priori synthétique de l’entendement, extraie des lois, des règles, si bien qu’il nous mène jusqu’à l’intelligibilité du phénoménal sensible, selon des normes et des principes qui méritent vite le titre d’une « loi naturelle ». Le chaos du phénoménal s’ordonne en monde intelligible dès lors que les lois de la nature sont trouvées. Alors même que la première acception archaïque du mot « natura » donne une définition qui soutient l’affirmation de l’auteure[22], le rôle du suffixe « ur » dans la forme nominale de natura accepte difficilement son rapprochement avec le participe futur du verbe latin « morior, eris, mori, mortuss sum ». Autrement dit : un tel rapprochement, s’il doit être fait, nous paraît exiger une démonstration plutôt qu’une assertion rapide au détour d’un paragraphe (et d’une note) qui propose de démontrer autre chose, et un « autre chose » qui participe du sédiment affirmatif sur lequel reposera le reste de l’ouvrage. Nous prenons cet exemple parce qu’il cumule trois types de difficultés : la généralisation, la péremption et l’approximation.
Une pelote déliée
Le maillage de l’argumentaire souffre à la fois du trop grand empressement du discours et d’un rythme saccadé, prompt à faire des analogies au caractère étonnamment superficiel. Cela ouvre le champ à des énoncés qui nous ont paru tout à fait incompréhensibles, et qui manquent à la fois de connecteurs logiques, de liants, d’indications quant au motif et à la direction de la démonstration. De sorte que nous avons parfois le sentiment de nous trouver en présence d’une construction orale. Tirons un exemple du premier chapitre du prologue Aujourd’hui l’Apocalypse (pp. 13-26) :
« Depuis les années 1980, des penseurs d’outre-Atlantique s’interrogent sur les vertus objectivantes et universelles d’une « nouvelle loi naturelle ». À l’époque où l’Empire américain paraissait encore triomphant, comme l’Empire romain du sage Marc Aurèle, cette école philosophique du droit se cristallisa autour de l’évidence implicite d’un ordre naturel et inclusif. Elle se décline aujourd’hui en langue anglaise et en droit anglo-saxon, à partir de deux livres devenus des classiques et signés de John Finnis. Le premier, intitulé La Loi naturelle et les droits naturels se veut à la fois pratique et systématisable. Le second analyse La Théorie morale, sociale et politique de Thomas d’acquis. Comme dans un problème posé à la manière d’Euclide, on démontre que, dans un Moyen Âge de musée, la loi naturelle aurait pris une dimension normative qui pourrait être actualisée sans impliquer de croyance en Dieu. Pour définir les critères d’une nouvelle loi naturelle, il serait excellent de revisiter la logique d’une scolastique millénaire. Les questions et les réponses devaient se succéder selon la méthode que, voici plus de sept siècles, Thomas d’Aquin aurait sanctuarisé dans le sillage d’un Aristote passé au crible de l’Antiquité tardive et plus tard, de l’islam. Toujours fidèle au principe de non-contradiction et au syllogisme, cette logique permettrait de faire l’économie du christianisme et dans la foulée, de son précepte que l’informatique ne sait décidément pas saisir : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». En contrepartie, elle pourrait être facilement déclinée en langage binaire. À chaque étape de sa construction, le résultat serait irréversible, comme dans un jeu d’échecs ou comme dans les anciens ordinateurs qu’on disait jadis « non récessifs ». L’acquiescement créerait une norme imposable et programmable. Ok ! Amen ! Au total, des myriades de résultats permettraient d’identifier une sorte de « corbeille de biens » d’où pourraient découler pour demain des droits naturels, tenus comme assimilateurs de cultures différentes.
Comment les philosophes de tradition hyper logique n’auraient-ils pas été séduits par cette école refondée sur la stabilité de méthodes qui, en pays chrétien comme en terre d’islam, exhumèrent jadis une philosophie grecque passée par les écoles de Rome, de Bagdad, de Cordoue puis du Paris médiéval. Et ce n’est peut-être pas un hasard si cette scolastique renaissante à l’heure du pétrole et du voile ne fait pas si mauvais ménage avec un libéralisme commercial qui, lui aussi, trouve sa justification dans une nécessité attribuée à la nature des choses. »[23]
Cet extrait montre comme le lecteur est parfois écartelé, et son endurance mise à mal, tant les référentiels historiques et les cadres disciplinaires se chevauchent à l’envie, sans que le moindre fil conducteur ne permette de justifier ces va-et-vient ou de les rendre homogène. Notons encore une remarque qui ferait bondir, cette fois, n’importe quel étudiant de philosophie, que celle-ci soit antique, avec toute la tradition platonicienne et néoplatonicienne[24], ou bien moderne, celle-là même qui pose la question du sens de l’esprit, du monde et de la place de Dieu dans un monde, ou une nature, que la science décrypte et vide de mystère. Nous avons déjà largement évoqué Kant, voyons désormais pourquoi il est plus que surprenant, outre le titre qui rendait vraisemblable son invocation, que l’auteure s’en soit pourtant abstenue.
L’étonnante évacuation d’une historiographie pourtant prolixe
L’auteure interroge l’issue d’un « guerre mondiale des normes » sous le régime de laquelle, peut-être, l’informatique (entre autre principe normatif) pourrait venir à régir toutes nos interactions et toutes nos réponses aux grandes questions humaines, dont celle de la légitimité d’une loi naturelle et de sa forme.
« Le danger serait imminent si, aux heures les plus intenses de nos vies, l’outil logique nous imposait l’artificiel. À ces heures-là, nos interrogations mettent en jeu notre rapport au destin. Les engagements que nous prenons alors ne sont plus codés mais intuitifs. Dans notre langue de jadis, le latin, in-tuieri signifie regarder, voir de l’intérieur. En un éclair, les décisions se présentent sous forme de visions. Elles surgissent en nous. Elles rassemblent ce que nous sommes et ressemblent à qui nous sommes. Elles sont la réponse immédiate aux énigmes que nous posons dès l’âge de cinq ans et qui laissent muet les maîtres en métaphysique. « Où étais-je quand je n’étais pas ? Où serai-je quand je ne serai plus ? » Le « où », la « place » et la dignité vont de pair. « Pourquoi vivre ou ne plus vivre ? »
La question que chacun pose « au-delà de la nature » marque notre rapport au mystère, à ses cérémonies, à ses rites. Son silence fait taire les foules. Il éteint les écrans. D’une façon ou d’une autre, il enterre les morts et baptise les vivants. Depuis la nuit des temps, il répugne à ce que les corps de nos proches soient livrés aux bêtes. C’est là une affaire d’honneur. »[25]
Passons sur le caractère à la fois emphatique et « formuliste » (nous pourrions même dire « marketing » si la réception de ce terme n’était pas aussi péjorative qu’elle ne l’est devenue) et contentons-nous de remarquer le silence prêté par l’auteure aux « maîtres en métaphysique ». La succession vertigineuse de clichés ne suffit pas à noyer le poisson : les « maîtres en métaphysique » sont bien des choses vis-à-vis de la question de la mort et, partant, de la question de la substance de l’esprit, ou âme, mais certainement pas muets. Ils sont parfois pesants, très obstinés, jargonnants, stratosphériques, parfois même hermétiques, mais on les aime quand même ; mais ils ne sont certainement pas muets.
On peut tout à fait admettre que leurs réponses ne satisfont pas l’enfant de cinq ans, ni l’adulte en pleine passion d’un athéisme anti-métaphysicien du XXIe siècle — mais lire qu’ils sont muets nous plonge dans un abîme de perplexité. Car non seulement ne sont-ils pas muets, mais sont -ils en outre incroyablement féconds ! Qu’il s’agisse de la philosophique panhellénistique grecque, de Parménide à Aristote en passant par les présocratiques de Milet, d’Éphèse, ou même Pythagore, Platon, les stoïciens ; toute la philosophie grecque antique, avant même de porter le terme de « métaphysique » (=« au-delà de la nature ») suite à l’édition des œuvres d’Aristote par Andronicos de Rhodes ; toute la philosophie grecque antique, déjà métaphysique au sens où nous l’entendons désormais, spéculait sur et s’intéressait au fonctionnement de l’âme et de son lien au corps. En somme, les grecs spéculaient déjà sur les rapports entre l’être et l’Être, sur les rapports entre les règles de l’être et les édits de l’Être sous un régime cosmogonique : c’est-à-dire à ce que l’on peut recevoir comme prolégomènes à une métaphysique de la « loi naturelle ». La Patristique prit le relais dès le IIe siècle après Jésus-Christ, absorbant le platonisme critiqué par Aristote, et concomitamment au néoplatonisme, jusqu’à ce que l’on appelle l’exégèse scolastique médiévale, à partir des IXe ou Xe siècles en Europe occidentale. Les préoccupations téléologiques[26] des êtres humains de ces différentes époques n’étaient peut-être pas si différentes des nôtres ; il y a en revanche fort à parier que les réponses qui y étaient données différaient par la sincérité d’une relation à un monde dont l’accessibilité à son intelligibilité dépendait de formules toutes différentes des nôtres. L’exégèse scolastique elle-même, dont Élisabeth Dufourcq semble faire son axe principal, et jusqu’à Saint Thomas d’Aquin, s’est longuement penchée sur cette question et a proposé un certain nombre de réponses, conformément aux principes de la loi divine. Du reste, l’auteure fait précisément le bilan d’un premier épuisement téléologique pour fonder la pertinence d’une relecture de Thomas d’Aquin, dialoguant avec des sources islamiques à cette aune précise (Chap. II, pp. 55-84). L’ouvrage se constitue comme un voyage le long des routes de la soie, axe de communication entre deux mondes fermés, le christianisme à l’ouest, l’Empire du Milieu à l’est. L’ouvrage poursuit les motifs et les raisons d’une confiscation politique du primat d’une « loi naturelle » ou, disons-le pour l’épurer des conséquences de l’Aufklärung, de la prévalence politique d’un « messie », du médiateur entre le spirituel et le temporel. Nous sommes forcés de replacer cette médiation dans l’étape décisive de l’œuvre kantienne, tant il nous paraît étonnant de transposer les problématiques de la « loi naturelle » dans un siècle numérisé (normé et régi par les processus de ces normes), le nôtre, en ignorant tout à fait les questions soulevées par cette œuvre. La « loi naturelle » que Kant tire peut-être de la doctrine de Leibniz, contre Descartes[27], subit en effet un processus de métamorphose qui ne laisse pas indemne l’économie des rapports verticaux, allant, au choix, du ciel à la terre ou de la terre au ciel. Les peuples domptés, ou bornés, par la violence de la pax romana pouvaient certes trouver là le motif d’une « loi naturelle » qui ne fût pas d’ordre divin, pour la compréhension qu’ils en avaient (contrairement au sens que lui donnait Marc Aurèle, pages 45 et 46), mais l’équilibre du monde reposait pourtant sur une telle loi.
3. De part et d’autre de Kant : métamorphose moderne de la « loi naturelle »
L’universalité de la loi naturelle et les impératifs catégoriques
N’importe que lecteur — même lointain — de Kant, aura entendu, sinon lu, l’opposition qu’il fit graver sur sa tombe dans la cathédrale de Königsberg, ville où il passa l’essentiel de sa vie : « Deux choses remplissent mon âme avec émerveillement et une admiration nouvelle et croissante ; surtout penser à elles : le ciel étoilé au-dessus de moi et la loi morale en moi ». N’importe quel lecteur — même lointain — de Kant connaît le rapport de celui-ci à la métaphysique à la charnière entre XVIIIe et XIXe siècle, ainsi que l’impact de son œuvre sur ce que l’on a coutume d’appeler « l’idéalisme allemand ». À la charnière entre deux siècles, certes, mais entre deux méthodes : entre les surgeons de la scolastique et ce que Kant lègue à la modernité.
Au titre du développement que donne Kant dans les Fondements de la Métaphysique des Mœurs[29], l’auteur définit très explicitement la nécessité de la « loi naturelle » : c’est, conformément à la formule du premier des impératifs catégoriques, le résultat de la faculté législatrice de l’autonomie de la volonté de chaque sujet : « Agis uniquement d’après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu’elle devienne une loi universelle. » Autrement dit, agis en chaque chose conformément à la « loi naturelle », qui est à la fois le produit de ce que tu observes et le sens de ce que tu défends par l’universalisation de ton agir. Nous n’évoquons pas cela pour parler de Kant puisque l’auteure elle-même n’en parle pas, mais pour montrer la béance laissée par le silence de l’auteure à ce sujet. Tout sujet, toute discipline implique des auteurs incontournables si l’on veut adopter une perspective générale le ou la concernant, sauf à préciser délibérément un point de focalisation particulier qui justifie de telles évictions.
Un cadre médiéviste inadéquat
Il serait coupable de faire un procès au livre à ce titre, puisque la quatrième de couverture annonce ouvertement que
« pour enrichir [l]e débat [de la transgression de la loi naturelle eu égard à l’usage qu’en firent les puissants], Élisabeth Dufourcq en explore les origines antiques et les reconstructions médiévales, en terre d’islam comme en chrétienté. Elle retraduit du latin des textes oubliés qui, dès les origines, plaidaient en faveur d’un esprit de recherche plus que de certitude. »
Autrement dit, pensera-t-on, le livre ne prétend pas parler de métaphysique et préfère se pencher sur les rapports de force entre faibles et puissants, sous le couvert duquel eurent lieu les usages et, possiblement, mésusages de la formule d’une « loi naturelle », et notamment au Moyen-âge. Selon une telle perspective, nous pourrions nous étonner de ce que la scolastique fasse à plusieurs reprises les frais d’agressions féroces, dirigées tour à tour contre son dogmatisme, son manque de méthode historique, voire même sa pratique elliptique de la métaphysique. Des auteurs contemporains comme Philippe Cappelle-Dumont[30] ou Alain Boureau[31] trouveraient très surprenantes la plupart des affirmations qui parcourent le texte, de même qu’un lecteur assidu de textes comme La Ruine de la civilisation antique[32], de Guglielmo Ferrero, le matériel critique bibliographique des trois volumes de l’édition de La République de Cicéron[33], qui propose le contexte de l’exercice politique de l’orateur romain, ou encore le matériel critique bibliographique des œuvres complètes d’Aristote[34]. Même en ne parlant pas de Kant, d’autres auteurs et d’autres perspectives demeuraient incontournables.
Ni philosophique, ni théologique, ni historiographique, donc, la démarche du livre enchaîne les affirmations péremptoires et lapidaires. Elle réduit par exemple l’activité de l’Université de Paris du XIIIe siècle à des lectures malhonnêtes et fautives d’Aristote et Cicéron qui, bien embarrassés par les rapports que ces deux auteurs auraient eu avec les contextes spécifiques des Républiques dans lesquelles ils ont vécu, se contentaient de les citer sans les interpréter. Selon l’auteure, Aristote vivait, par exemple, dans une « République athénienne, brillante et encore solide du temps de sa jeunesse » vieillissante (p. 30) ; rappelons à toute fin utile que Solon, passant pour le fondateur de la démocratie athénienne vivait au VIIe siècle avant Jésus-Christ, et l’on parle de « l’âge d’or d’Athènes » souss Périclès[35], au Ve siècle avant notre ère ; Aristote vit au IVe siècle. En outre, le statut de la définition structurale de l’Athènes antique, entre république et tyrannie, est extrêmement délicat et le site d’une recherche active[36].
De très graves problèmes de méthode
Le livre d’Élisabeth Dufourcq, dont nous ne connaissons pas par ailleurs l’œuvre écrite, pose assez vite, une fois les stades de l’étonnement puis de la perplexité dépassés, la question du rôle des maisons d’édition dans le processus de publication d’un ouvrage. Il paraît en effet très étonnant, et nous allons le montrer par de nombreuses citations, qu’une maison d’édition d’envergure scientifique (car, n’en déplaise à l’auteure, la métaphysique est une science tout à fait connue, historicisée et documentée, de même que la philosophie ou la scolastique) accueille au sein de son catalogue un texte qui accumule avec une telle complaisance une telle quantité de fautes intellectuelles graves. Nous allons justifier tout ce que nous affirmons ici, en nous appuyant sur le texte lui-même, adoptant en cela un principe méthodologique fondamental que n’applique pas l’auteure elle-même pour étayer des affirmations péremptoires aux caractères plus que surprenant.
« Au XIIIe siècle, les étudiants et les maîtres européens qui se retrouvaient à Paris se faisaient un devoir de parler comme Cicéron et de citer Aristote. Mais, par respect pour les textes antiques, ils juxtaposaient souvent les citations, comme on le ferait de puzzles, sans les évaluer à l’aune d’une histoire qu’ils ignoraient du reste largement, ce qui simplifiait les choses. »[37]
Ces quelques lignes illustrent deux des problèmes les plus graves de la démarche de ce livre, et nous terminerons en forme de conclusion à partir d’elles. Tout d’abord sont manifestement confondus la méconnaissance par l’auteure d’une « histoire » et le rapport des gens dont elle parle à cette « histoire ». Ensuite le principe performatif et le caractère démonstratif des énoncés sont confondus : il ne suffit pas de dire que les scolastiques faisaient une chose pour le faire valoir. Par ailleurs nous assistons trop souvent à l’usage de cautions qui paraissent autoriser l’auteure à se dispenser de démonstration.
Conclusion
Ainsi donc la ligne générale de l’ouvrage part d’une excellente idée : réfléchir au sens, à ce télos, qui a invité les hommes des époques considérées à penser leurs rapports avec une « loi naturelle », qu’elle fût d’ordre divin, d’ordre politique ou, aujourd’hui, d’ordre écologique et numérique. Il y aurait eu des tours passionnants à faire du côté des sociétés de contrôle telles que les méditèrent Foucault et Deleuze, faire appel à certaines fictions contemporaines ou légèrement antérieures, alliant discours utopistes et contextes d’une sorte d’ « Annonciation » d’un pragmatisme de la dystopie, de la régulation par les normes ; réfléchissant aux modes de constitution de ces normes à partir de ce que l’on peut en observer dans la scolastique et la renaissance cartésienne ; il y aurait pu y avoir une pensée pénétrante sur l’interstice encore indéterminé, précisément entre l’épuisement scolastique et le jaillissement proto-scientifique. Voici une tâche digne de l’historienne qui semble ardente derrière la plume, et cependant aurait-il fallu se prémunir de réflexes égotistes. Certains partis pris ruinent toute hélas l’ambition historiciste du texte. Ainsi par exemple en va-t-il de cette affirmation, guère plus étayée qu’au moyen d’une note vague renvoyant le lecteur à faire sa propre expérience de deux ouvrages de Cicéron, selon laquelle l’orateur puis philosophe romain aurait exercé « un temps les fonctions d’augure sans y croire » (p. 34). C’est là encore un long débat entre spécialistes, dont il paraît surprenant que l’on puisse se permettre de trancher sans au moins renvoyer à la riche documentation qui en traite, et aux diverses implications que l’auteure fixe comme horizon.
[1] — Précisions importantes constituées par les sous-parties nota bene ; les conditions de nécessité d’une approche de l’idée de « loi naturelle » ; une absence rédhibitoire, c’est-à-dire tout notre premier point.
[2] — Manent, P., La loi naturelle et les droits de l’homme, éd. PUF, coll. « Quadrige », Paris, mars 2020.
[3] — C’est le cas par exemple de la métaphysique, voir plus bas.
[4] — Pour aller plus loin sur une « société de contrôle » telle qu’elle était encore intelligible il y a vingt ans, c’est-à-dire avant le XXIe siècle, lire le travail « de prolongement » donné par Gilles Deleuze aux théories foucaldiennes dans deux livres rapides et percutants : Foucault, éd. de Minuit, Paris, 1986 ; Pourparlers, éd. de Minuit, Paris, 1990.
[5] — Secrétaire d’État à la Recherche en 1995, succédant à François Fillon sous le premier gouvernement d’Alain Juppé, alors que Jacques Chirac était Président de la République — il n’est pas question pour nous de situer Élisabeth Dufourcq par rapport à des hommes, mais de la situer dans le maillage politique de son époque. De 1996 à 2006, elle assumera la charge d’inspectrice générale des affaires sociales (IGAS). Dans la même période, elle est chargée de cours à l’Institut Catholique de Paris (Histoire des Missions) sur lesquelles elle a écrit un livre.
[6] — Domaine que l’auteur allemand Ernst Cassirer poursuivit et permit le déploiement dans les trois tomes de sa Philosophie des formes symboliques. Toute l’œuvre de Cassirer s’illustre par la perspective néokantienne mais la philosophie des formes symboliques se scinde de la stricte obédience initiée par le maître de Cassirer, Hermann Cohen, fondateur de l’école dite « de Marbourg », c’est-à-dire l’un des deux courants dits « néokantiens ». Hermann Cohen a en effet préparé le terrain de Ernst Cassirer dans un ouvrage dont nous n’avons qu’une traduction partielle en français, parue dans Néokantisme et théorie de la connaissance, Paris, Vrin, 2002 : Logik der reinen Erkenntnis. Ernst Cassirer paraît conclure dans le troisième tome de sa philosophie des formes symboliques que l’horizon nouménal (dans le strict prolongement de la tradition critique de la Critique de la raison pure, et notamment dans le lignage de l’auteur Salomon Maïmon qui publie, en 1790, un Essai sur la philosophie transcendantale, paru en français chez Vrin en 1989 (et dont Cohen souligne l’importance de sa « théorie des différentielles » par un ouvrage paru en français en 2000 chez Vrin : Le principe de la méthode infinitésimale et son histoire).
[7] — Pour une lecture passionnante sur la fondation de l’Université de Paris, ses enjeux politiques, entre laïcs et réguliers, et sa relation même à la monarchie française s’affirmant, puisque Philippe II (Auguste) est le premier roi, capétien direct, à se proclamer « roi de France », voir l’excellent ouvrage de Pascale Bermon, La Fondation de l’Université de Paris (1200-1260), éd. Les Belles Lettres, coll. « Sagesses médiévales », 2017, Paris, et notamment la partie 11 du chapitre II, pp. 139-162, puisqu’il s’agissait d’une véritable lutte politique pour la démonstration de l’accès conforme à l’enseignement de Dieu.
[8] — S’il est le titre de l’ouvrage de Leibniz, le concept de théodicée est aussi fondamental dans l’appréciation de la nécessité d’une médiation entre la loi divine et la loi humaine. Il consiste en l’interrogation théologique à partir de laquelle il faut et on peut penser la place de l’homme et celle de son libre-arbitre. La question de la théodicée s’inscrit donc comme ramification directe de celle d’une « loi naturelle ». Accepte-t-on l’existence du diable ? Qu’est-ce que le péché originel et comment accède-t-on au salut ? La simple existence du mal n’exclue-t-elle pas la possibilité de Dieu ? Et si non, pourquoi et comment ? Autant de questions passionnantes
[9] — Dufourcq, É., Intuitions et pièges de la loi naturelle, éd. du Cerf, pp. 390-391.
[10] — Lire sur ce point sa tentative d’extension (ou d’aboutissement) juridique des principes des fondements de la métaphysique des mœurs, Sur l’expression courante : il se peut que ce soit juste en théorie, mais en pratique, cela ne vaut rien.
[11] — Paru en 1795, ce texte tente d’étendre aux nations les impératifs catégoriques et hypothétiques par lesquels les fondements de la métaphysique des mœurs affirmaient la doctrine de l’autonomie des volonté et de liberté du sujet. C’est-à-dire que Kant cherchait à affirmer le fondement juridique de l’émergence d’une « loi pour soi » qui soit à la fois universalisable à tous et conforme à la « loi naturelle ».
[12] — Ne serait-ce que pour son ouvrage explicitement tourné vers la question de ce que Kant appelle plus tard « l’agir de l’homme », La cause du Vouloir suivi de L’objet de la jouissance, traduction de François Loiret, éd. Les Belles Lettres, coll. « Sagesses médiévales », Paris, 2009.
[13] — Auteur notamment d’une homélie sur L’impuissance du Diable, éd. du Cerf, coll. « Sources chrétiennes », n°560, traduction par Adina Peleanu, Paris, 2013.
[14] — Nous évitons à dessein de parler du thomisme qui se tient assez éloigné du cas particulier de la loi naturelle, même si le thomisme suppose une doctrine de la liberté (ou théodicée) bien spécifique.
[15] — Emmanuel Kant développe cette première distinction, au cœur de la « double-nature » de la raison humaine, dans les Fondements de la Métaphysique des Mœurs, qui paraît en 1785, c’est à dire quatre ans après la première édition de la Critique de la raison pure, mais deux ans avant la deuxième édition. Cette précision est importante en ce que toute l’activité des postkantiens, de Jacobi à Fichte en passant par Reinhold, Beck ou, finalement Maïmon, accompagne les réactions de Kant à la réception de la première édition de la Critique de la raison pure, au travers de trois textes de Kant : le quatrième paralogisme (in la première édition de la Critique ; Le texte des Prolégomènes à toute métaphysique future qui voudra se présenter comme science qui paraissent en 1783 ; puis, enfin, dans la deuxième édition de la Critique, un texte jusque là inédit : la Réfutation de l’idéalisme, qui répond spécifiquement à Jacobi. Cette querelle très fertile qui s’évertue à définir le statut de l’idéalisme transcendantal sert soixante-dix ans plus tard au « retour à Kant » qui, dans les 1860-70, ouvrent voie au néokantisme, lequel s’attache à définir, entre autres, les modes de compréhension des modes de compréhension et de connaissance de l’homme en tant qu’il est sujet dans la nature. Ce survol de la problématique idéalisme-réalisme dans la Critique de la raison pure nous permet de voir, à partir de ce qui est précisé dans les Fondements de la Métaphysiques des Mœurs, que le statut de la « loi naturelle » détermine la façon dont peut être envisagé le sujet les formes de ses représentations et modes de connaissance.
[16] — L’Ancien Régime aurait par exemple été attaqué sur la base des découvertes jésuites de l’ordre confucéen, page 15.
[17] — Ce que l’on appelle avec Aristote la στάσις, stásis, c’est-à-dire la crise interne à une structure politique. Lire à ce sujet l’excellent état de l’ars établi par Esther Rogan, La Stásis dans la politique d’Aristote, La cité sous tension Classique Garnier, Paris, 2018.
[18] — Il faudrait songer aux textes des actes du colloques, Hamidović, D. (dir.), Aux origines des messianismes juifs qui auraient préparé une telle enquête sur les fondements religieux, déjà presque métaphysiques, de la méditation entre les peuples et les dieux, entre le terrestre et le céleste, mais à partir du processus proto-monothéiste ou, tout au moins, selon le régime d’une centralisation de la confiscation du pouvoir politique et militaire. Mais également à plusieurs auteurs de la Patristique et, surtout, au formidable travail préparatoire en faveur de la concentration du pouvoir temporel dans les mains du pouvoir spirituel entrepris par Irénée de Lyon, Adversus Hæreses. Irénée est en effet l’un des premiers auteurs chrétiens à constituer. ou réfléchir à une théologie qui soit systématique et qui, en cela, songe aux interactions entre ce qu’il semble qu’Élisabeth Dufourcq entende par une économie de la « loi naturelle ».
[19] — Ibid., page 21
[20] — Corneille, P., Le Cid (1636), IV, 3.
[21] — Op. cit., page 21.
[22] — Du latin natura (« le fait de la naissance, état naturel et constitutif des choses, caractère, cours des choses, ensemble des êtres et des choses »), venant lui même de nascor (« naître, provenir »).
[23] — Ibid., pages 16 et 17.
[24] — Traditions qui travaillent la problématisation du Poème de Parménide, sur l’Être et le non-Être. Cf à ce propos l’édition de Jean Beaufret, éd. PUF, Paris, 1954, coll. « Quadrige ».
[25] — Ibid., page 18.
[26] — Du grec ancien τέλος, télos, « fin première », en anglais « purpose », c’est-à-dire du « sens », du « but » qui donne à l’existence la justification de sa trajectoire (principe ou quête qui fonde dans la trilogie cinématographique Matrix l’antagonisme opposant Néo et son adversaire, l’Agent Smith).
[27] — C’est tout l’objet, à grands renforts de « l’empirisme sensualisme » de David Hume, du texte de Jacobi, David Hume et la croyance, autrement appelé Dialogue, paru accompagné de deux autres textes dans une traduction en français, éd. Vrin, Paris, 2000. Il y exhume l’aporie, selon lui fondamentale, de la Critique de la raison pure de Kant, qui est celle, dans l’économie du rapport sujet-objet, c’est-à-dire de la perception du monde, et se traduit par la quiddité de la « chose en soi ». La question de la croyance étant centrale comme médiation possible entre le monde de l’esprit et le monde matérielle, il y réfléchit longuement aux postures de Spinoza, Leibniz et Mendhelsson, en plus de défendre une lecture plus radicale de Kant que Kant ne paraît la défendre lui-même, selon Jacobi, dans la première édition de la Critique.
[28] — Lettre à Marcus Herz du 21 février 1772, Œuvres complètes I, Gallimard, Pléiade, page 693, Paris, 1980.
[29] — Très principalement lors de la première section.
[30] — Entre autres titres, professeur de la faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg, doyen honoraire de la Faculté de philosophie de l’Institut catholique de Paris, dont il fut doyen pendant dix ans, directeur de la collection « Philosophie & Théologie » des éditions du Cerf, et notamment directeur des deux premiers tomes (Tome 1 : Période antique et patristique ; Tome 2 : Période médiévale) de Philosophie et théologie : Anthologie, parus en 2009 aux éditions du Cerf également.
[31] — Traducteur de scolastique médiévale, et notamment Richard de Mediavilla et Pierre de Jean Olivi, directeur de la prestigieuse collection « Bibliothèque scolastique », aux éditions des Belles Lettres, également auteur de Satan hérétique : histoire de la démonologie, 1280-1330 qui est aussi une vaste enquête sur les conditions de formation et de délimitation des modes d’accès au savoir et à sa représentation dans la conscience collective médiévale tardive, se constituant autour de l’activité marchande.
[32] — Livre passionnant, paru aux éditions des Belles Lettres, collection « le goût de l’histoire », Paris, 2020.
[33] — Texte établi et traduit par Esther Bréguet, 1921, 2002, paru aux Belles Lettres, collection « Guillaume Budé ».
[34] — Parues aux éditions Flammarion, Paris, 2014, dirigées par Pierre Pellegrin.
[35] — Voir à ce sujet, quoique romancé, Warner, R., Périclès l’Athénien, éd. Belles Lettres, coll. « Domaine étranger », traduit par Geneviève Hurel, Paris, 2019.
[36] — La société athénienne pouvait, par certains aspects, échapper aux formes actuelles de l’intelligibilité du phénomène politique et les principes d’une société de contrôle pouvaient, à certains égards, déjà s’y exprimer. Voir à ce très spécifique sujet la parution du compte-rendu de l’édition d’octobre 2018 du colloque de Saarbrücken, tenu à l’Université de la Sarre et organisé par H.-J. Lüsebrink, H. Schlange-Schöningen et J.-M. Narbonne : Foucault. Repenser les rapports entre les Grecs et les Modernes, éd. PUF-VRIN, collection « Zêtêsis », Paris, 2020.
[37] — Ibid., page 29








