Faut-il penser comme un sauvage ?
La civilisation occidentale est depuis longtemps fascinée par la figure du sauvage, ce double qui hante sa pensée.
Depuis Montaigne, le sauvage est autant le cannibale que l’homme qui n’a en réalité rien à envier à notre civilisation en termes de mœurs : ce n’est que par un effet de croyance collective, nous dit Montaigne, que nous voulons voir en lui un primitif, une brute. Dans son second discours, Rousseau avait besoin de la figure du bon sauvage pour faire apparaître, par contraste, la dénaturation et la corruption de l’homme de son temps.
C’est à partir de l’étude des Indiens d’Amazonie qui vivent sans pouvoir institué que Pierre Clastres pouvait critiquer l’évolutionnisme des études ethnologiques et historiographiques – y compris marxistes – évolutionnisme pour qui il était entendu qu’il y avait des stades du progrès humain. Comme si des sociétés qui vivaient sans Etat n’en étaient pas encore arrivé à cette étape d’évolution. Clastres montrait que ces sociétés avaient volontairement empêché le développer d’un Etat, en particulier de l’institution d’un chef doté du pouvoir de commander 1.
Le très beau film de John Boorman, The Emerald Forest (1985), nous montrait la vie de ces mêmes Indiens, qui voient les frontières de leur monde se rétrécir à mesure qu’avançaient les entreprises de déforestation. Dans The New World (2006), Terrence Malick mettait en scène les premiers colons européens d’Amérique, vivant misérablement dans leur fortin boueux, obligés d’accepter les vivres donnés par les Indiens qui vivent juste à côté, dans la forêt, dans l’abondance.
A l’inverse, un film comme Cannibal Holocaust (1981) jouait sur cette fascination / répulsion pour le sauvage : le film se présente comme un documentaire tourné chez des Indiens anthropophages, et met crûment en scène tortures, émasculations, viols et meurtres. Plusieurs animaux ont même été tués pour les besoins de l’histoire ; le film a fait scandale et son réalisateur a été traîné devant les tribunaux, avant de pouvoir prouver qu’aucun acteur n’avait été dévoré sur le tournage…
Qu’il soit représenté comme un modèle pour nous ou comme l’incarnation de la barbarie primitive 2, le sauvage incarne l’altérité absolue.
Le cannibale métaphysicien
Avec son dernier livre, Métaphysiques cannibales 3, l’anthropologue Eduardo Viveiros de Castro prolonge cette rencontre avec le sauvage et avec les limites de l’anthropologie : jusqu’où devons-nous rencontrer le sauvage et nous identifier à lui ? Qu’est-ce que la pensée sauvage, ici nommée « métaphysique cannibale » peut apporter à l’anthropologue ?
Le livre fait à la fois état de recherches sur le perspectivisme amérindien et sur les limites de l’anthropologie. La démarche de l’auteur consiste à ne plus prendre le sauvage comme un objet d’étude, que nos catégories « domestiques » nous permettraient d’appréhender avec plus ou moins de pertinence. Il faut, par une inflexion du sens de l’étude anthropologique, apprendre à penser avec eux –même si cela revient à penser non avec un ami mais un ennemi.
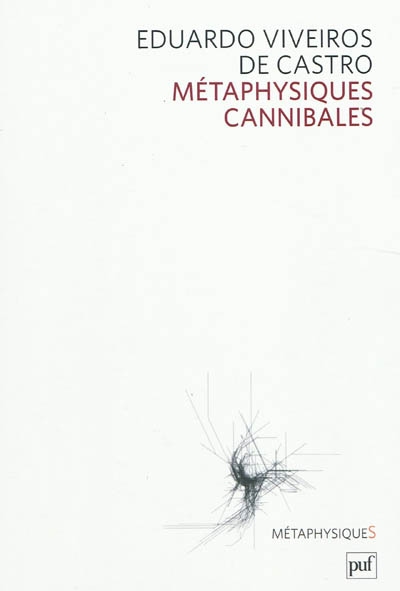
Les Indiens ont développé un mode de penser perspectiviste (l’auteur reprend le terme à Nietzsche), dans lequel le chasseur doit s’identifier avec son ennemi : l’animal qu’il chasse ou le prisonnier qui sera tué et mangé cérémoniellement. La « métaphysique » des Indiens apparaît alors comme opposée à la nôtre : pour eux, l’homme ne descend pas de l’animal, mais tous les animaux ont, un jour, été humains, avant de se différencier.
Il y a donc pour les Indiens non rupture mais continuité de la nature à la culture : le chasseur doit apprendre à voir comme ceux qu’il combat. Il apprend à être en affinité avec eux : l’ennemi, humain ou animal, devient donc un affin. Il n’est ni moi ni un autre, ni le même ni l’autre, il entre dans un régime d’échange et de différenciation avec moi, sachant que la ressemblance n’est qu’un cas particulier de la différence. Il en résulte une pensée qui peut circuler entre différentes « interprétations » (là encore au sens nietzschéen de perspective résultant d’un effort de maîtrise sur soi et son environnement).
Viveiros de Castro veut prolonger le travail de Levi-Strauss, en relisant l’œuvre de ce dernier, et le « structuralisme » en général, à la lumière des deux tomes de Capitalisme et schizophrénie de Deleuze et Guattari (L’Anti-Œdipe et Mille Plateaux). L’enjeu est de « décoloniser » la pensée, c’est-à-dire d’arrêter d’en faire le prolongement, sur le plan théorique, de la conquête et de la domination effective de l’Occident sur les autres civilisations et, sur le plan économique, d’en faire une pensée qui soutienne le besoin d’augmentation des rendements. Ce que cette lecture permet de mettre en évidence, c’est que le structuralisme n’est pas seulement une méthode permettant de rendre raison de l’ensemble des pratiques d’une culture, en leur assignant une fonction dans l’organisation sociale. Ce premier aspect était certes indispensable à Levi-Strauss pour montrer que la « pensée sauvage » n’est en rien inférieure à la pensée scientifique.
Le mythe amérindien est alors à comprendre comme une façon de traduire la nature dans notre langage ; le mythe devient alors une « anthropologie inversée ». Il n’y a plus un seul fonds commun de monde sur lequel différentes représentations auront prise, représentations que l’anthropologue va pouvoir comparer en se mettant au-dessus des comparés et en les rapportant à ce qu’il sait, lui, du monde. L’indigène et l’anthropologue deviennent à ce moment des affins, des perspectives en joute et non des représentations d’une même chose.
Mais un second aspect, explicitement développé par Deleuze – Guattari, et que Viveiros de Castro repère déjà chez Levi-Strauss, est le déséquilibre perpétuel des sociétés, déséquilibre que le structuralisme rencontre comme une limite de sa propre méthode, comme une limite interne qui dynamise sans cesse ses recherches. Les sociétés vivent selon un ensemble de conflits qu’elles régulent, mais qui les « travaillent » de l’intérieur. Ainsi dans Tristes tropiques, la légère dissymétrie de peintures corporelles dans une tribu amazonienne, n’est-elle pas gratuite, mais révèle un déséquilibre entre les différents clans du village. L’artistique exprime et révèle un déséquilibre politique. Viveiros de Castro étudie donc, à la suite de Deleuze, comment les sociétés sauvages se définissent non par des contradictions à surmonter (méthode marxiste) mais par leurs lignes de fuite ; comment la « métaphysique cannibale » construit un plan vivable qui puisse intégrer cette ligne de fuite 4.
Les Indiens, Levi-Strauss et Deleuze
C’est notamment la notion d’échange qui s’en trouve modifiée : celle-ci n’est plus simplement (théorie libérale) rencontre de deux partis recherchant leur intérêt bien compris ni (théorie marxiste) exploitation du travail d’autrui mais moment où se noue une alliance intensive, un devenir qui appelle alors une prudence propre, pour que je puisse supporter ce devenir, qu’il ne devienne pas mortifère.
Viveiros de Castro rappelle à raison que pour Deleuze et Guattari, intensif est synonyme de virtuel : avant leur actualisation dans des états de choses, les processus sont de pures virtualités de vie qui traversent les choses, et ces virtualités accompagnent sans cesse l’actualisation. Une vie, à la limite, n’est faite que de virtualités, dit Deleuze. Je ne cesse jamais d’être parcouru d’intensités et l’échange est une telle production de flux virtuels que je « coupe » pour les actualiser dans des actes sociaux.
Plusieurs passages du livre sont consacrés à l’explication de notions et concepts deleuziens tels que le devenir, les multiplicités, les lignes de fuite, autrui comme monde possible. Il faut dire que ce livre est luxuriant comme une jungle, analysant à la fois Levi-Strauss, Deleuze et les Indiens –et chacun des trois grâce aux deux autres : les concepts deleuziens permettent de mieux comprendre les Indiens et de relire Levi-Strauss à partir des dernières conséquences de ses études, tandis que la pensée des sauvages permet à l’anthropologue de modifier de l’intérieur sa manière d’aborder autrui.
Viveiros de Castro prolonge les analyses levi-straussiennes élaborées dans Le totémisme aujourd’hui (1962), qui déconstruisaient le totémisme comme institution : cette interprétation, qui datait du positivisme, était la simple projection de notre propre fonctionnement mental sur les sauvages. Puisqu’il était entendu qu’il y a pour nous une rupture entre la nature et la culture, une autre pensée de leurs relations ne pouvait passer que pour une mise en parallèle de deux séries, animale et humaine (alliance entre un homme et son totem d’aigle ou de jaguar), comme si la distinction des deux était absolue. Levi-Strauss réinterprétait le totémisme comme un mode de classification. Le totémisme n’était plus le symbole de la mentalité primitive et devenait une méthode systématique de compréhension du monde –d’où sa continuité avec la science.
L’effort proposé par Viveiros de Castro est de faire de même avec le cannibalisme. Ne plus y voir une institution barbare, inhumaine, mais en faire une théorie d’ensemble sur le monde : une métaphysique. La consommation en commun du corps de l’ennemi capturé et tué n’a pas pour cause la disette ; c’est une pratique ritualisée, qui prend sens dans ce perspectivisme, qui veut intégrer en lui le point de vue de l’ennemi. Les frontières de l’identité sont ainsi poreuses pour les Indiens : celui qui tue l’ennemi et le dévore devient son propre ennemi. L’ennemi n’est plus l’autre absolu.
Par transposition, suggère l’auteur, le sauvage n’est pas l’autre absolu. Nous sommes en continuité avec le cannibale : l’identité n’est que le degré zéro de la différence, la civilisation n’est que la limite inférieure de la prédation. 5
En croisant Montesquieu avec un Indien, on pourrait s’exclamer : « Ah! ah! Monsieur n’est pas cannibale ? C’est une chose bien extraordinaire! Comment peut-on n’être pas cannibale ? »
Le jeu des perspectives
Viveiros de Castro dit que son livre provient d’un livre qui n’a pas été écrit, L’Anti-Narcisse, qui serait à l’anthropologie ce que l’Anti-Œdipe était à la philosophie et à la psychanalyse. Le sauvage ne peut plus être le double inversé dans lequel nous nous contemplons narcissiquement. « L’Anti-Narcisse » est alors le mythe de ce livre lui-même, son mythe fondateur, ce récit virtuel pur qui reste sans cesse contemporain du livre actuellement écrit.
« L’histoire que nous voulons raconter est, de fait, un conte d’horreur : une anthropologie cognitive altermondialiste ou (comme je l’ai un jour entendu de la bouche de Patrice Maniglier) un « altercognitivisme »… » 6
L’effort propre de Viveiros de Castro est de soustraire méthodiquement la pensée sauvage à toute interprétation qui la considérerait comme inférieure et insuffisante. C’était déjà le projet de Levi-Strauss ou de Clastres. Viveiros de Castro prolonge et amplifie cette intention, par un jeu dynamique d’intensification des virtualités des pensées qu’il étudie (par des alliances et des croisements tournant autour de Deleuze – Guattari).
Ne pas seulement penser autrui à partir, mais nous penser à partir d’autrui : apprendre à penser ce que pensent les « sauvages ». Toutefois, penser avec autrui n’est pas forcément penser ce que pense autrui. Ce que nous avons à apprendre des Indiens, c’est leur façon d’intégrer la pensée de l’autre : perspectivisme. Ainsi, même celui qu’on rejetait dans la plus complète altérité, le cannibale, ne nous est plus si étranger… Nous aussi, hommes civilisés, nous jouons avec des choses du monde, avec des êtres et des récits, et nous les assemblons en essayant de les faire fonctionner ensemble. Nous aussi, quand nous marchons, nous nous retenons perpétuellement de tomber. En somme, nous bricolons, nous tentons de faire tenir le monde debout.
Cela ne revient pas à affirmer à l’inverse que les sauvages auraient une « métaphysique » meilleure que la nôtre. Disons qu’il ne faut pas croire, contre une tradition d’arrogance occidentale, que le sauvage serait en fait meilleur que nous (intellectuellement ou moralement), que nous serions en manque par rapport à lui.
Cette confrontation avec le Sauvage appelle une prudence, un souci de soi : jusqu’où veut-on penser autrui ? Jusqu’où aller dans le vertige de ce jeu des perspectives ? Il n’y a donc pas d’alternative massive, qui voudrait que soit nous dominions autrui en pensée, soit nous nous laissions « cannibaliser » par sa métaphysique. Comme le montre Viveiros de Castro dans ce livre, nous avions d’une certaine façon besoin des Indiens pour le comprendre.
- La société contre l’Etat, Minuit, 1974. Marshall Sahlins a étudié l’économie des sociétés dites « primitives », dans son livre fascinant, Age de pierre, âge d’abondance, Gallimard, 1976. Loin de vivre selon une économie de subsistance, à la merci du moindre aléa naturel, les sauvages ne manquent de rien : ils sont peu attachés aux biens matériels et ne veulent tout simplement pas faire de provisions. Ils se caractérisent en somme par cette philosophie, qu’on pourrait méditer, de ne pas travailler plus qu’ils n’en ont besoin…
- Dans Heart of Darkness de Joseph Conrad, la remontée du fleuve du Congo devient symboliquement une remontée vers les âges primitifs de l’humanité, jusqu’à la tribu cannibale fascinée par M. Kurtz.
C’est en quelque sorte le « voyage au bout de la nuit » de Conrad. - Eduardo Viveiros de Castro, Métaphysiques cannibales, PUF, MétaphysiqueS, 2009
- On pourrait au passage se demander quelle a été l’influence réelle de Deleuze et Guattari sur Levi-Strauss : l’auteur de l’Anthropologie structurale les a-t-il lus ? A-t-il été aidé ou influencé par leurs concepts ?
- Nietzsche avait à ce sujet une remarque choquante au premier abord, mais somme toute en affinité avec la pensée sauvage : dominer, réduire en esclavage, c’est encore un adoucissement du rapport à l’autre par rapport à la destruction pure et simple…
- Page 55.








