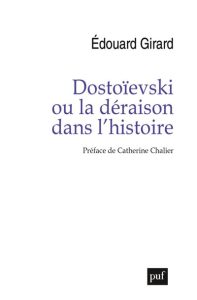 Peut-on lire l’œuvre de Dostoïevski en philosophe ? Celle-ci, essentiellement littéraire et journalistique, contient-elle une authentique philosophie ? Édouard Girard répond par l’affirmative, en mettant en œuvre une telle lecture philosophique de Dostoïevski.
Peut-on lire l’œuvre de Dostoïevski en philosophe ? Celle-ci, essentiellement littéraire et journalistique, contient-elle une authentique philosophie ? Édouard Girard répond par l’affirmative, en mettant en œuvre une telle lecture philosophique de Dostoïevski.
L’angle sous lequel la question de la philosophie de Dostoïevski est celle de sa philosophie de l’histoire. L’hypothèse de l’auteur est que Dostoïevski a bien bâti une philosophie de l’histoire, qui répond et critique la philosophie de l’histoire de Hegel. Dostoïevski, comme Marx, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Rosenzweig, Lévinas et tant d’autres, chercherait une nouvelle voie « après Hegel[1]», contre Hegel.
Pour étayer sa démonstration, Édouard Girard commence par restituer le contexte intellectuel de la Russie du XIXème siècle, pour attester de l’hégélianisme ambiant qui s’y était répandu et que Dostoïevski n’a pu ignorer[2]. La modernité occidentale frappe de plein fouet la Russie, et les intellectuels russes ne peuvent éluder la brûlante question de la place et du rôle de leur patrie dans l’histoire du monde. Certains de continuer l’empire byzantin et d’être la « Troisième Rome », le centre du monde et le cœur de la chrétienté, ils perçoivent avec peine l’archaïsme de leur pays, en marge et arriéré par rapport à l’Occident lancé dans l’histoire et en marche vers le progrès. « Si l’histoire du monde était en devenir, il était inconcevable que la Russie ne soit pas son centre. » (p.42). « C’est dans cette réalité intellectuelle et politique que s’enracine le roman dostoïveskien, celle d’un pays buvant le calice amer d’une modernité qui rebattait les cartes de la représentation de son monde et de son histoire » (p.43), remarque Édouard Girard.
La première réaction de l’intelligentsia russe fut ce que l’auteur appelle « l’ultramoralisme », manifeste chez un Tolstoï autant que dans le premier roman de Dostoïevski, Les Pauvres gens. L’aristocratie a alors mauvaise conscience du servage sur lequel repose sa fortune et se sent investie de la mission morale de sauver le peuple. « Tous les acteurs ne sont pas également dépositaires de la même capacité morale, cette faculté d’agir moralement est réservée à une élite, à une aristocratie morale » (p.53).
D’abord adepte de cet ultramoralisme, Dostoïevski fait volte-face à l’occasion de son expérience du bagne, où il découvre la vérité du peuple russe, sa dignité et sa fierté, bien loin de la conception paternaliste et ultramorale d’un peuple souffrant, misérable, moralement irresponsable. Cette crise intellectuelle et morale conduit Dostoïevski à rejeter et critiquer radicalement l’ultramoralisme occidentaliste de ses anciens camarades. C’est de ce retournement que naît sa critique de la philosophie hégélienne. Voyons-en le contenu.
Conscience
Si la Phénoménologie de l’esprit est « la science de l’expérience de la conscience », où la conscience sort victorieuse des apories du chemin du doute et du désespoir, et rejoint le savoir absolu où elle se connaît elle-même et toute chose, et est parfaitement réconciliée, Dostoïevski met en place ce qu’on pourrait qualifier d’une « contre-Phénoménologie de l’esprit ». Sa pensée se situe également sur le terrain de la conscience, elle est « centrée sur l’activité de la conscience, et tous ses grands romans exposent le travail conflictuel de l’individu aux prises avec cette dernière » (p.18). Comme chez Hegel, on assiste à la succession des expériences de la conscience aux prises avec la réalité, mais cette odyssée de la conscience ne conduit pas à leur réconciliation et à leur identification dialectique. « Toute l’originalité du roman dostoïveskien, note Édouard Girard, tient dans ce va-et-vient entre la conscience percevante et une réalité qui, dans son existence temporelle, excède tout ce que la conscience peut connaître sur un mode objectal, faisant de la connaissance un champ cosmique, infiniment vaste » (p.32).
 Girard montre la quasi-reprise et la subversion de la Phénoménologie de l’esprit à l’œuvre chez Dostoïevski, d’abord dans les Carnets du sous-sol, dont le discours « par contre-phrase, déconstruit toute possibilité de philosophie spéculative comme succession dialectique des expériences de la conscience » (p.76). La conscience malade de l’homme du sous-sol se présente comme aussi lucide que « froide, consciente d’elle-même dans les limites de sa condition anthropologique, et [qui] perçoit, dans la tristesse de cette finitude, l’impossibilité d’un dépassement de son être immédiat » (p.76). « Avoir une conscience très développée, c’est une maladie », écrit Dostoïevski (cité p.79), et la vie quotidienne n’exige pas une telle conscience. S’esquisse une rupture entre la conscience et la vie. Être conscient de soi, c’est être conscient de sa médiocrité indépassable. « L’homme du sous-sol fait de son activité hyperconsciente le socle de la certitude de son abaissement » (p.83), et non de sa transcendance dialectique, comme chez Hegel. De plus, là où selon le philosophe allemand, la conscience se réunit avec la nature, qui n’est son autre qu’avant d’être réintégré dans l’identité supérieure de l’esprit, l’homme du sous-sol raille « les désillusions de la conscience face à la nécessité naturelle, outrageusement triviale au regard du bel idéal philosophique » (p.88) et « la résistance indépassable d’un élément extérieur à elle comme être-autre insurmontable » (p.89). La conscience n’a donc guère de puissance, et Édouard Girard propose de nommer « Vorstellungslosigkeit », l’échec de la conscience à se reconnaître et à s’unir à l’objet, au contraire de la « Vorstellung » hégélienne, qui crée des représentations et les amende elle-même. La conscience dostoïveskienne échoue et défaille devant la nature qui n’a rien de l’idéal qu’elle espérait. Devant cette désillusion de l’idéal, la conscience plonge dans le ressentiment et la complainte. « La bassesse peut prendre sa source, contre l’aspiration idéaliste, dans les contingences pauvrement anecdotiques de la vie vécue » (p.93). La conscience perd son idéal, au contact de la vie. L’idéal et la vie sont exclusifs l’un de l’autre, et l’idéal sans vie laisse place à la vie sans idéal, nue et laide. « Ce constat de l’échec de la conscience à trouver son bien constitue en ce sens la condition finale de laquelle la conscience ne peut se départir, son résidu excédentaire se réduisant au constat de sa simple inanité » (p.97).
Girard montre la quasi-reprise et la subversion de la Phénoménologie de l’esprit à l’œuvre chez Dostoïevski, d’abord dans les Carnets du sous-sol, dont le discours « par contre-phrase, déconstruit toute possibilité de philosophie spéculative comme succession dialectique des expériences de la conscience » (p.76). La conscience malade de l’homme du sous-sol se présente comme aussi lucide que « froide, consciente d’elle-même dans les limites de sa condition anthropologique, et [qui] perçoit, dans la tristesse de cette finitude, l’impossibilité d’un dépassement de son être immédiat » (p.76). « Avoir une conscience très développée, c’est une maladie », écrit Dostoïevski (cité p.79), et la vie quotidienne n’exige pas une telle conscience. S’esquisse une rupture entre la conscience et la vie. Être conscient de soi, c’est être conscient de sa médiocrité indépassable. « L’homme du sous-sol fait de son activité hyperconsciente le socle de la certitude de son abaissement » (p.83), et non de sa transcendance dialectique, comme chez Hegel. De plus, là où selon le philosophe allemand, la conscience se réunit avec la nature, qui n’est son autre qu’avant d’être réintégré dans l’identité supérieure de l’esprit, l’homme du sous-sol raille « les désillusions de la conscience face à la nécessité naturelle, outrageusement triviale au regard du bel idéal philosophique » (p.88) et « la résistance indépassable d’un élément extérieur à elle comme être-autre insurmontable » (p.89). La conscience n’a donc guère de puissance, et Édouard Girard propose de nommer « Vorstellungslosigkeit », l’échec de la conscience à se reconnaître et à s’unir à l’objet, au contraire de la « Vorstellung » hégélienne, qui crée des représentations et les amende elle-même. La conscience dostoïveskienne échoue et défaille devant la nature qui n’a rien de l’idéal qu’elle espérait. Devant cette désillusion de l’idéal, la conscience plonge dans le ressentiment et la complainte. « La bassesse peut prendre sa source, contre l’aspiration idéaliste, dans les contingences pauvrement anecdotiques de la vie vécue » (p.93). La conscience perd son idéal, au contact de la vie. L’idéal et la vie sont exclusifs l’un de l’autre, et l’idéal sans vie laisse place à la vie sans idéal, nue et laide. « Ce constat de l’échec de la conscience à trouver son bien constitue en ce sens la condition finale de laquelle la conscience ne peut se départir, son résidu excédentaire se réduisant au constat de sa simple inanité » (p.97).
La seconde étape de cette déconstruction de la conscience hégélienne, de « la critique dostoïevskienne de l’idéalisme dans sa confrontation à la vie » (p.130), a lieu dans Crime et châtiment. « Raskolnikov incarne cette nouvelle hyperconscience, cette fois jetée dans les tourments de l’existence et qui effectue, par-delà le discours, l’expérience de l’incapacité de « réaliser son idée » dans le monde » (p.129). On se rappelle de la possession de Raskolnikov par son « idée » aussi folle que rationnelle : tuer la vieille usurière pour distribuer son argent aux pauvres – ce qui est, note Girard, un « crime ultramoral » (p.135) ! L’idée jaillit dans l’esprit malade de Raskolnikov, qui la pare d’atours philosophiques la justifiant : « Pour une seule vie – des milliers de vies sauvées de la pourriture et de la décomposition » (cité p.139). Après le meurtre, la culpabilité écrase le jeune homme, incapable d’assumer son idée qu’il a pourtant rationnellement justifiée. Il fait « l’expérience de la domination écrasante de son idée sur sa conscience » (p.148) et de « l’impossibilité de survivre au poids de ses propres idées, à l’auto-emprisonnement de la conscience dans les geôles de ses édifices spéculatifs » (p.150), remarque très justement le commentateur.
Mais apparaît bientôt ce qui se cache derrière ou sous l’idée philosophique : la vie, le désir de vivre. « Les idées philanthropiques et humanitaristes se révèlent sous le jour trompeur de leur habillage théorique destiné à masquer à soi et au monde l’hypertrophie de sa volonté d’être […]. Les idées ne sont qu’une manifestation pulsionnelle de la volonté de vivre. » (p.156). Le génie du psychologue qu’est Dostoïevski est de pratiquer une sorte d’archéologie, c’est-à-dire de creuser sous le discours de la conscience, d’explorer les bas-fonds du psychisme humain et d’exhumer les raisons dernières cachées des apparences. Nous sommes en présence de ce que Marx appelle idéologie : un discours superficiel qui habille et masque des intentions plus profondes, cachées voire inconscientes.
De là, Dostoïevski peut critiquer la conception hégélienne des « grands hommes historiques », dont se revendique théoriquement Raskolnikov. Celui-ci affirme que certains individus ont le droit d’outrepasser la moralité commune et de commettre certains actes répréhensibles pour le bien supérieur de l’humanité. Pour eux, la fin justifierait les moyens, le bien à venir exigerait les crimes présents. Mais cette idée est celle d’un névrosé, fou, malade, incapable de s’élever au-dessus de la culpabilité que son crime implique. Aussi Dostoïevski présente-t-il le double fonds, si l’on peut dire, de l’idée, ou son dédoublement. L’idée « apparaît successivement comme ce qu’elle prétend être mais qu’elle n’est pas : une réflexion philosophique profonde sur l’histoire et la nature humaine ; puis comme ce qu’elle prétend ne pas être mais qu’elle est effectivement : l’expression délirante d’une conscience malade qui, refusant la petitesse de sa condition, cherche un alibi à sa boursouflure » (p.172).
Au contraire, le salut de Raskolnikov suppose de se délivrer de son obsession par cette idée, de l’exorciser, pourrait-on même dire. C’est ce que Dostoïevski peint à la fin de son roman, lorsque, grâce à l’amour de Sonia, il s’en libère : « La dialectique était partie, la vie était venue, et, dans sa raison, quelque chose de tout autre allait devoir s’élaborer » (cité p.280). Dostoïevski joue l’idée contre la vie, la conscience se trouve déchirée entre ces deux pôles. Et le choix de la vie contre l’idée est le salut de la conscience.
Édouard Girard montre enfin comment, dans les Démons, Dostoïevski pense l’hégélianisme et ses « idées nouvelles » comme nihilisme. Plus exactement, le romancier russe présente « la prolifération du nihilisme sous le paravent philosophique d’une théorie générale du monde conjuguant ultramoralisme et histoire » (p.181), selon le dispositif idéologique, que nous avons déjà identifié. Les conjurés des Démons sont d’abord des socialistes, dont le nihilisme semble être le moyen privilégié. Ils optent pour « la destruction universelle pour le triomphe du bonheur à venir ». La destruction nihiliste, le renversement des valeurs traditionnelles, l’outrance et la violence ne semblent – à première vue, selon leur discours – des moyens d’action pour raser avant de reconstruire une société enfin morale et juste, comme l’espèrent les ultramoralistes, dont nous avons déjà parlé. Dostoïevski peint ironiquement la complaisance de la noblesse libérale, ainsi que des intellectuels occidentalistes, qui soutiennent les jeunes socialistes sans mesurer la portée de leur idéologie nihiliste. Il se moque aussi des théories incohérentes et absurdes d’un Chigaliev, qui se veut le penseur d’un système de pensée – « glose théoriciste enfermée dans ses postulats aussi insensés qu’arbitraires » (p.204), « pastiche d’une pensée spéculative » (p.205), qui caricature sans doute l’hégélianisme.
Mais le romancier russe ne se contente pas de moquer, il veut analyser et comprendre les ressorts profonds de cette conjuration nihiliste. Les conjurés, obsédés par leur idée, sont en fait mus par un désir de servitude, ils sont soumis à Verkhovenski, leur chef, lequel n’a que faire de l’idée mais désire simplement dominer. Son mobile, commente Girard, « n’est en rien le remplacement de l’ordre existant par un socialisme utopiste, mais la simple affirmation de son être dans la satisfaction de la servitude d’autrui » (p.212). Là encore, l’idée se dédouble : pour les conjurés naïfs et soumis, elle est essentielle ; pour Verkhovenski, elle est inessentielle, insubstantielle, fausse, simple masque et moyen de sa libido dominandi. Derrière l’idéalisme, la volonté de puissance. L’auteur le montre en particulier avec Kirilov, obsédé par son idée que la seule liberté absolue, qui nous égalerait à Dieu, serait le suicide. Alors qu’il hésite à réaliser son idée, Verkhovenski parvient « à restituer la subordination névrotique de Kirilov à son idée », qui n’est qu’une « pulsion pré-philosophique prenant la forme la plus éthérée et conceptuelle dans le nihilisme » (p.226). L’idée, apparemment conceptuelle, profondément délirante, est le levier par lequel Verkhovenski domine et se soumet Kirilov.
Mais Verkhovenski lui-même a besoin de se soumettre à l’énigmatique Stavroguine, personnage qui rôde à l’arrière-plan du roman et en fournit la clé d’intelligibilité ultime. Il est la création romanesque la plus fascinante de Dostoïevski, dont le récit de son viol d’une petite fille qui la pousse au suicide fait frémir le lecteur. Lui n’est absolument pas idéaliste, il se caractérise plutôt « par un désir de destruction de l’idéal, par une persévérance toujours plus âpre dans les expériences du nihilisme », par « la recherche de la conscience de la souillure morale dans la tromperie, le mensonge, l’indifférence aux sentiments d’autrui » (p.243), « pure conscience de la dépravation de l’existence dans la conscience de l’action immorale et de la destruction » (p.243)[3]. Figure assurément démoniaque, pure volonté d’annihilation et de rien d’autre. Les théories des personnages se révèlent n’être que des idéologies, produits cachés de pulsions souterraines de volonté de puissance, sinon de destruction universelle.
Édouard Girard ne s’appesantit pas sur le traitement réservé aux idées dans Les Frères Karamazov, par manque de place, si ce n’est à propos d’Ivan. On connaît sa grande démonstration apparemment rigoureuse de l’athéisme qu’impose l’injustice radicale et injustifiable de la souffrance des enfants. Mais tirer les conséquences de cet athéisme implique de rejeter toute morale : « si Dieu n’existe pas, tout est permis ». Peut-on vivre réellement selon une telle idée ? Dostoïevski montre que cette idée est littéralement impraticable. Lorsqu’à la fin du roman, Smerdiakov avoue à Ivan le meurtre de son père, il le justifie par les idées mêmes d’Ivan. Or, « l’aveu du parricide génère concomitamment la validation et l’invalidation de la thèse » (p.303), remarque à juste titre l’auteur. Ivan ne peut accepter une telle conséquence de sa propre théorie. « L’idée la plus aboutie d’Ivan se heurte à son incohérence, ou plutôt à son insupportabilité morale » (p.304). Les remords ressentis par Ivan invalide la logique conçue. La déraison de sa logique éclate d’ailleurs dans l’hallucination d’Ivan, qui suit, lorsque le diable semble lui apparaître et qu’il s’enfonce dans la folie. Telle est la grande leçon dostoïveskienne : la raison logicienne athée est indiscernable de la folie.
Histoire
Après cette contre-phénoménologie de l’esprit, il nous semble que Girard manifeste une « contre-Philosophie de l’histoire » que Dostoïevski pense contre Hegel. Il faut reconnaître que le lien entre cette longue et brillante considération de la logique de la conscience chez Dostoïevski avec l’examen de sa conception de l’histoire n’est pas suffisamment explicité. Qu’est-ce qui relie les théories dostoïevskiennes de la conscience et de l’histoire, sinon leur commun anti-hégélianisme ?
 Il reste que c’est une thèse forte de l’auteur : « la contribution du romancier russe à la question de l’être et à la conception philosophique de l’histoire constitue un apport majeur à la philosophie moderne » (p.25). Dans sa conclusion, il résume en ces termes l’apport anti-hégélien de Dostoïevski : « L’angoisse de l’homme moderne face à l’incompréhension du sens de son existence ne saurait être satisfaite par les moyens qu’il pense pourtant les plus à même de lui venir en aide : la science, le positivisme, l’action politique. » (p.343). Autrement dit, tout ce en quoi l’homme moderne croit, et par quoi il espère le salut, tout cela est dénoncé comme illusoire, si ce n’est pervers, par le romancier russe. Rien ne permet de dominer, comprendre et maîtriser le devenir de l’être, et l’infini excède toute totalité, pourrait-on dire en empruntant à la terminologie de Lévinas. « La contingence de l’existence face à une immensité qui déborde d’être ne saurait s’appréhender de manière satisfaisante sur le modèle d’un système de pensée conceptuel, échappant de ce fait à toutes les tentatives de totalisation dans un système positif. Là réside la source de la déraison dans l’histoire » (p.343). C’est dire que « la raison dans l’histoire » qu’affirmait Hegel, est retournée par Dostoïevski, en déraison de l’histoire, ou plutôt en excès de l’histoire sur la raison, de l’objet sur le sujet. Rien, ni théoriquement ni pratiquement, n’est capable de comprendre, d’embrasser l’histoire, et d’en épuiser le sens.
Il reste que c’est une thèse forte de l’auteur : « la contribution du romancier russe à la question de l’être et à la conception philosophique de l’histoire constitue un apport majeur à la philosophie moderne » (p.25). Dans sa conclusion, il résume en ces termes l’apport anti-hégélien de Dostoïevski : « L’angoisse de l’homme moderne face à l’incompréhension du sens de son existence ne saurait être satisfaite par les moyens qu’il pense pourtant les plus à même de lui venir en aide : la science, le positivisme, l’action politique. » (p.343). Autrement dit, tout ce en quoi l’homme moderne croit, et par quoi il espère le salut, tout cela est dénoncé comme illusoire, si ce n’est pervers, par le romancier russe. Rien ne permet de dominer, comprendre et maîtriser le devenir de l’être, et l’infini excède toute totalité, pourrait-on dire en empruntant à la terminologie de Lévinas. « La contingence de l’existence face à une immensité qui déborde d’être ne saurait s’appréhender de manière satisfaisante sur le modèle d’un système de pensée conceptuel, échappant de ce fait à toutes les tentatives de totalisation dans un système positif. Là réside la source de la déraison dans l’histoire » (p.343). C’est dire que « la raison dans l’histoire » qu’affirmait Hegel, est retournée par Dostoïevski, en déraison de l’histoire, ou plutôt en excès de l’histoire sur la raison, de l’objet sur le sujet. Rien, ni théoriquement ni pratiquement, n’est capable de comprendre, d’embrasser l’histoire, et d’en épuiser le sens.
Quel est dès lors le contenu de cette (anti-)philosophie de l’histoire ? Quelle conception Dostoïveski se fait-il de l’histoire mondiale ? Puisant dans les écrits proprement théoriques de Dostoïevski consacrés à l’histoire, Édouard Girard montre comment il présente la voie russe comme l’alternative au double universalisme occidental, qu’il soit catholique romain ou protestant. « Luthéranisme et catholicisme seraient deux modalités de l’aporie de l’universalité du christianisme ; leur point commun est d’avoir pensé réaliser l’universalité divine dans le monde et par le monde. » (p.262-263). Or, Dostoïevski bataille pour préserver la Russie de cette double influence occidentale. Quelle est alors l’« autre voie à la sauvegarde de l’universalité du christianisme qu’il voit courir à sa propre perte en Europe occidentale ? » (p.264).
La réponse du commentateur est brièvement esquissée, plutôt que développée. Elle consiste à dire que Dostoïevski a su offrir des ouvertures métaphysiques hors de l’immanence rationaliste. S’il refuse que l’histoire soit la réalisation de la raison et le progrès de la conscience vers le savoir absolu, il prétend rouvrir le temps à l’éternité, comme il l’esquisse dans quelques moments de ses romans. Le premier, déjà mentionné, est le salut de Raskolnikov, à la fin de Crime et châtiment. Sonia lui lit le passage de l’Évangile narrant la résurrection de Lazare par Jésus. Or, son amour sacrificiel accomplit pour ainsi dire cette même résurrection pour Raskolnikov, « imprimant à la perspective du salut la vérité de la temporalité de l’éternité » (p.280). Peut-être l’analyse de l’auteur est-elle trop brève, mais elle est suggère bien la voie de l’amour que Dostoïevski ouvre vers l’éternité par-delà l’histoire.
Mais la principale « ouverture métaphysique » étudiée par l’auteur se trouve à la fin des Frères Karamazov, alors que le jeune Ilioucha est mort. Sommet de détresse, d’injustice injustifiable et de désespoir, cet événement est pourtant l’occasion d’une plus grande espérance. « Comment une situation tragique et sans consolation peut-elle constituer une ouverture vers l’espoir et le salut alors même que sa simple existence apparaît comme une réfutation de l’existence de Dieu ? » (p.311). Aliocha Karamazov prend la parole devant les enfants et les enseigne dans ce qui semble à l’auteur l’équivalent du sermon sur la montagne de Jésus (Mt 5 sq.), qui jaillit de son cœur blessé par la douleur de la perte d’Ilioucha. « Le Dieu d’Aliocha s’esquisse en filigrane d’une révolte contre le monde, contre une souffrance injustement ressentie » (p.316). Quel salut est encore possible ? « Le salut de l’homme se laisse entrevoir dans l’expérience de cette injustice, le sentiment confraternel qui aura uni Aliocha et les « gamins », signe d’un authentique amour, sincère et désintéressé. » (p.318). Face à la souffrance et à l’injustice, deux positions sont possibles : la révolte, qui conduit à l’accusation et bientôt au nihilisme et à la violence, ou l’unité vécue dans l’amour fraternel, née de « la conscience du sentiment élevé de l’unité fraternelle, si intensément ressentie dans la douleur de la perte » (p.321). Édouard Girard remarque à juste titre que c’est une espérance, et non d’un optimisme, qu’il s’agit alors. Nulle théorie explicative et justificative de l’histoire du monde, mais l’espérance fondée sur la charité, toujours fragile, car menacée, tentée par l’accusation et la révolte nihiliste. Aliocha, mû par cet amour et cette espérance, peut affirmer sa foi en la Résurrection à venir. Affirmation eschatologique, improuvable rationnellement, mais espérée dans le sillage de l’amour vécu sur terre. « A la question de l’origine de l’amour, de l’autorité, de la souffrance […], Dostoïevski répond par une série de mystères qui […] trouvent leur vérité cardinale dans la réalité sensible de l’expérience vécue de l’existence, dernièrement anthropologique » (p.326). Le christianisme n’est pas théorique, mais vécue existentiellement. « C’est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c’est que la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison[4]» : l’expression pascalienne convient au christianisme dostoïveskien. « L’authentique expérience de la transcendance de Dieu se vit dans cet amour vécu » (p.328), affirme Édouard Girard. Par cette espérance de la résurrection, le temps historique, si blessé et hanté par le mal, se trouve troué par un rayon d’éternité, qui est comme anticipé dans l’amour vécu et enseigné par Aliocha. Des profondeurs, Dostoïevski crie donc vers Dieu. « C’est là certainement l’une des singularités extrêmes du christianisme de Dostoïevski : faire du désespoir, traditionnel signe de désunion radicale entre l’homme et Dieu, le moment d’un possible recouvrement de la confiance en la vie » (p.342).
Le mal n’est pas résolu par un système qui le justifierait en y voyant un moyen du progrès – part anti-hégélienne de Dostoïveski –, mais il est le point de départ d’un chemin d’espérance et d’amour qui s’efforce vers l’éternité – c’en est la part chrétienne.
Modernité ?
Une question qu’ouvre la lecture de ce grand livre sur Dostoïevski est celle de sa modernité, sur laquelle nous aimerions terminer. En quel sens Dostoïevski est-il moderne, et en quel sens ne l’est-il pas ? Édouard Girard, nous l’avons dit, restitue avec beaucoup de pertinence le contexte d’émergence de l’anti-hégélianisme dostoïevskien. L’ultramoralisme est la première forme de pensée moderne russe, suscitée par l’influence des idées nouvelles occidentales, notamment hégéliennes, et en rupture avec le modèle théologico-politique antérieur. Or, Dostoïevski a très bien connu cet ultramoralisme et en a même été partisan, si l’on peut dire, avant son expérience au bagne qui bouleverse sa pensée. On peut donc dire que Dostoïevski part de Hegel, au double sens du terme : il en provient et cherche à s’en émanciper. Sa critique de Hegel, que nous avons résumée, l’apparente même à une forme de post-modernité, contestataire de la toute-puissance de la rationalité moderne, et qui creuse archéologiquement en-deçà du discours de la conscience pour exhumer ses déterminants souterrains, comme le firent Marx, Nietzsche ou Freud.
En outre, Girard montre aussi que l’athéisme théorique est un point de départ fondamental des intrigues dostoïevskiennes. Cet athéisme, parfaitement moderne, se fonde sur une certaine logique, que Dostoïevski reconnaît et dont, là encore, il part. Son exégète reconnaît ainsi que ses romans sont « une œuvre parfaitement athée, dans la mesure où jamais l’on n’y observe l’intercession de Dieu ; Dieu est absent du monde » (p.268). En cela, Dostoïevski paraît fort moderne. Il concède cette prémisse moderne d’athéisme et toute son œuvre vise à chercher une voie pour en sortir. C’est « depuis les postulats philosophiques du rationalisme », « depuis l’immanentisme du rationalisme » qu’il travaille à une « réouverture de la métaphysique » (p.269). Pour l’auteur, « l’apologétique de Dostoïevski est en ce sens incomparablement plus tributaire de la philosophie moderne que de la théologie » (p.333).
De cela, j’avoue n’être pas si certain. Sans doute l’auteur russe puise-t-il dans la conceptualité philosophique moderne, notamment hégélienne, ce qu’Édouard Girard démontre de manière convaincante par ses analyses au plus proche de la lettre dostoïevskienne. Néanmoins, nombre de ses réponses sont traditionnelles, le prince Muichkine par exemple emprunte au motif chrétien du fou, ou encore le starets Zosyme est l’incarnation de la tradition monastique russe, figure profondément traditionnelle, dont la description est conçue comme une réplique aux accusations athées d’Ivan Karamazov. Moderne, voire post-moderne, sous un certain angle, Dostoïevski n’en reste pas moins fort traditionnel, d’une autre manière. Il prend en compte des problématiques nouvelles, issues de l’irruption de la modernité en Russie au XIXème, mais sa réponse, laborieuse, profonde et géniale, emprunte à la grande tradition chrétienne, sous sa forme russe.
Cela n’enlève certes rien à l’impressionnant travail d’Édouard Girard qui restitue l’anti-hégélianisme de Dostoïevski et atteint donc vraisemblablement son but, qui était d’attester que le génial romancier russe est aussi, à sa manière, un authentique philosophe.
***
[1] Voir « Après Hegel (1) » et « Après Hegel (2) », Les Études philosophiques, 2021/4 et 2022/1.
[2] Il n’est pas absolument certain que Dostoïevski ait lu Hegel, du moins est-ce invérifiable, mais il a demandé à son frère de lui envoyer certains livres (voir p.63-64), et la mode était très clairement à l’idéalisme hégélien (voir p.65, n.3).
[3] On pourrait prolonger philosophiquement l’interrogation, et s’enquérir d’une cause encore plus profonde d’une telle volonté d’annihilation. Celle-ci est irréductible, ou bien se peut-elle ramener à une indifférence à tout, un ennui radical, un désœuvrement, comme le suggère parfois Dostoïevski dans sa figuration de Stavroguine ? Et le théologien aurait alors aussi la charge de se demander s’il n’y a pas là une figure spirituelle du démoniaque et du damné, dont le ressort ultime relève du niveau surnaturel.
[4] Pascal, Pensées, éd. Lafuma, §424.








