Les éditions l’Age d’Homme viennent de mettre à disposition des études henryennes un dossier précieux conçu et dirigé par Jean-Marie Brohm et Jean Leclercq 1. L’ouvrage, d’une taille importante (format 27×21, 542 pp.), se subdivise en quatre parties : un long entretien avec Anne Henry ; un recueil de textes de Michel Henry ; une importante série de contributions ; enfin, plus anecdotique, quelques évocations de l’homme qu’était le philosophe. On y trouvera également une utile bibliographie exhaustive de l’œuvre.
Un tel dossier ne se prête évidemment pas à un compte-rendu qui suivrait le fil d’un développement philosophique. Je passerai donc ici en revue les différentes parties de l’ouvrage pour en souligner les mérites et les intérêts.
Entretien en manière de biographie
L’ouvrage s’ouvre sur un entretien entre Anne Henry, elle-même Professeur de littérature et spécialiste reconnue de Proust, et Jean Leclercq, directeur scientifique du Fonds Michel Henry déposé à l’Université catholique de Louvain. Un enchaînement subtil de questions permet à Anne Henry de partager sa maîtrise de la pensée de son époux. Ce long entretien (50 pages) apporte des renseignements appréciables sur le contexte du développement de l’œuvre. Par ailleurs, il fournit certainement une introduction solide et raisonnée pour un étudiant désireux d’en avoir une vue d’ensemble. Faute de temps, je ne m’arrêterai que sur les premières pages qui offrent des informations philosophiques inédites.
L’entretien prend en effet pour point de départ un Journal de jeunesse récemment découvert par Anne Henry. Ce Journal couvre une période allant de 1942 à 1948 et laisse entendre l’existence de notes antérieures sans doute à jamais perdues. Ecrit sur « le mauvais papier de la guerre et de l’après guerre », ils se composent de réflexions philosophiques rapides et denses, souvent jetées sur le papier dans l’urgence. Parfois interrompu, il témoigne de la naissance d’une pensée précoce, originale avant même de s’exposer. On a régulièrement souligné la remarquable continuité de l’œuvre henryenne en-deça de ses moments de radicalisation ou d’applications thématiques concrètes (économie, culture, art, psychanalyse…). Cette continuité devient proprement saisissante lorsque l’on prend connaissance de ces notes. La révélation de ce Journal – on espère sa publication prochaine – est donc un outil précieux pour tracer avec davantage de précision la genèse de la philosophie henryenne.
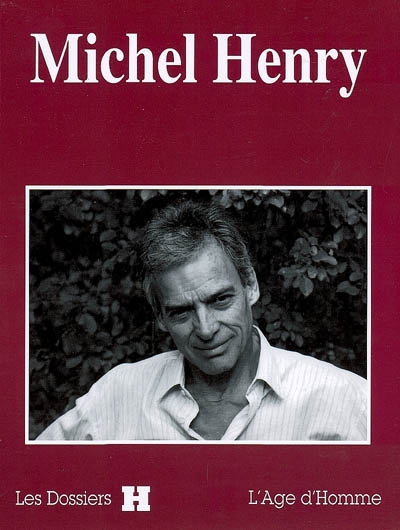
Henry n’appréciait guère les épanchements biographiques. Son « entretien biographique » avec Roland Vaschalde – en marge du colloque de Cerisy en 1996 – débute par cette réplique mémorable : « Permettez-moi une remarque philosophique au seuil de cet entretien. Je voudrais dire combien je me sens démuni devant l’idée même d’une biographie. Pour celui qui pense que le Soi véritable, celui de chacun, est un Soi non mondain, étranger à toute détermination objective ou empirique, la tentative de venir à lui à partir de repères de ce genre paraît problématique. L’histoire d’un homme, les circonstances qui l’entourent, est-elle autre chose qu’une sorte de masque, plus ou moins flatteur, que lui-même et les autres s’accordent à poser sur son visage – lui qui, au fond, n’a aucun visage » 2. François-Xavier Ajavon, qui publie régulièrement sur ce site des chroniques sur le rapport de la philosophie et des philosophes à la sphère médiatique, ne manquera certainement pas d’intérêt pour une telle entrée en matière. Quoi qu’il en soit, le contexte vaut ici au moins d’être rappelé minimalement pour prendre la mesure de la densité des propositions philosophiques d’un jeune homme de vingt ans. Le frère de Henry fut l’un des vingt premiers free-french à rejoindre De Gaule à Londres. Henry, son mémoire sur Spinoza à peine soutenu en Sorbonne, rejoint lui-même le maquis du Haut Jura en juin 1943. N’emportant dans son bagage que la Critique de la Raison pure, il recevra pour nom de code celui de « Kant » ; la vie a parfois de douces ironies… Il sera ensuite commis au renseignement. Il vit sous une fausse identité à Paris, à Lyon où il se cache dans une mansarde pour échapper au sinistre Barbie et à la milice. Quand il le peut, il entre dans une bibliothèque pour découvrir fugitivement Husserl, Boehme… C’est dans ce contexte fait de clandestinité, de faim, de peur objective, mais également de compagnonnage, de geste gratuit, qu’il prend des notes qui, pour n’être pas déjà échafaudées en système, constituent néanmoins la source décisive et la direction de l’œuvre en gestation.
Dans ce même entretien de 1996, Henry avait déjà pudiquement confié combien le maquis avait profondément influencé sa conception de la vie. « La clandestinité m’a donné quotidiennement et de manière aigüe le sens de l’incognito. Pendant toute cette période, il a fallu dissimuler ce que l’on pensait et, plus encore, ce que l’on faisait. Grâce à cette hypocrisie permanente, l’essence de la vie se révélait en moi, à savoir qu’elle est invisible. Dans les pires moments, quand le monde se faisait atroce, je l’éprouvais en moi comme un secret à protéger et qui me protégeait. Une manifestation plus profonde, plus ancienne que celle du monde déterminait notre condition d’homme » 3. Voici en regard un texte d’époque qui marque la fidélité jamais démentie à cette expérience : « Malgré ce temps de guerre, [mes compagnons] faisaient la découverte de la vie pas seulement de la réalité politique. Il arrive qu’une époque s’identifie à une attitude spirituelle et alors elle existe ; ce qui arrive n’a plus le goût fade de l’actualité et de ce qui recommence indéfiniment. Le monde devenait un théâtre dont nous étions les acteurs. Quelle est cette attitude ? Résistance ? Autre chose peut-être. Un moment où la vie s’est retrouvée, a coïncidé avec la vie au lieu de s’évanouir dans les choses : solitude, silence, peur, dévouement. Tout vous rappelait à vous-mêmes, tout vous recommandait d’être. En même temps, notre tâche à nous, homme de vingt à trente ans, est effrayante ; car il ne nous a été demandé rien d’autre que ceci : détruire l’amour en nous – tuer aussi des ennemis – les idéologies de la haine. Nous sommes d’éternels célibataires […] nous n’avons pas eu de jeunesse. Jankélévitch ne disait-il pas dans son Schelling, ‘‘Toute liberté porte sa tragédie intérieure’’ ? Nous n’étions ni préparés, ni préservés, on nous faisait croire n’importe quoi. Mais il y avait en nous une sorte d’instinct qui était encore une parole de vie et qui, même sur le plan de l’habileté, fut plus efficace que des leçons prises dans les camps d’entraînements » 4.
Au milieu de pages franchement émouvantes (l’effroi métaphysique devant un cadavre de soldat gisant dans un ruisseau 5 ; un carnage opéré par les Allemands un petit matin calme et ensoleillé 6 ; la faim sublimée à partir de Eckart 7 …), un rapide florilège de petites propositions théoriques montre la fixation immédiate de sa détermination philosophique et l’intérêt de ce Journal pour saisir la genèse de l’œuvre. Leur sens explicite pour tous ceux qui connaissent la philosophie de Henry n’appelle pas de commentaire : « Nous ne voyons pas les choses, nous ne voyons que notre propre regard » ; « Le sentiment maintient la pensée en continuité avec la vie – ou plutôt fait qu’elles sont une même chose » ; « Pourquoi ce paysage m’émeut-il, sinon parce qu’il est ma chair » ; « Spinoza est moins perspicace que Schopenhauer qui a vu que le désir n’est pas seulement de persévérer dans son être mais d’être plus, d’être toujours plus » ; « Ecrire une thèse sur les prémisses de l’existence » ; « La structure du monde est la subjectivité » ; « La subjectivité est le sens du monde » ; « Une philosophie de l’immanence n’est possible que si elle est une philosophie de la transcendance ».
Textes de Michel Henry
La deuxième partie de l’ouvrage recueille onze textes qui n’avaient pas encore été édités ou réédités. L’effort d’édition est louable et s’inscrit dans une démarche initiée peu après la mort de Henry par la collection Epiméthée des Presses Universitaires de France 8. En termes de compréhension de l’œuvre, disons-le, le gain est évidemment faible ; on n’y trouvera ni thèse inconnue ni domaine qui ne fut par ailleurs exploré. Néanmoins, dans une perspective spécialisante, ces textes permettent de saisir avec plus de subtilité l’évolution de la formulation d’une idée ou d’une proposition en la montrant en train de se chercher entre deux publications majeures.
Dans ce point de vue, je souligne l’intérêt des deux premiers textes. Il s’agit de textes rédigés en 1956-7, destinés soit à ses directeurs de thèse (Jean Wahl et Jean Hyppolite), soit à une commission CNRS. Le premier est un « Résumé analytique de Phénoménologie du corps », travail précise Henry « achevé en 1949 » 9 et qui devait être à l’origine un chapitre de la thèse. Son important déploiement l’a finalement détaché comme thèse secondaire. C’est par convention d’édition qu’il sera publié après L’essence de la manifestation. Le second texte est cette fois le « résumé analytique » d’une thèse alors intitulée « L’essence de la révélation » – qui deviendra, on le sait, L’essence de la manifestation –, travail entrepris dès 1946. Henry l’expose dans un enchaînement concis de 77 § (et d’un Appendice déjà dédié à Hegel) qui rappelle que la longue rédaction de L’essence fut guidée depuis ses prémisses par une thèse propre et un schéma argumentatif d’emblée fixé 10.
Un autre texte à mentionner est « Intersubjectivité pathétique » 11. Il s’agit d’un essai commencé en 1991 sur la question de la communauté et dont le but affiché était d’approfondir les thèses posées dans la dernière partie de Phénoménologie matérielle publiée en 1990. Après en avoir rédigé une matrice épistémologique et méthodologique d’une grande clarté, Henry abandonnera ce projet et entamera la rédaction de la trilogie dont la première publication, C’est moi la vérité, date de 1996. Il ne reprendra spécifiquement cette question de l’intersubjectivité et de la communauté que dans Incarnation publié en 2000. C’est donc dire que le texte « Intersubjectivité pathétique » permet de mieux évaluer la radicalisation conceptuelle que Henry opère dans la décennie 90.
Contributions
Suivent rien moins que trente-huit contributions réparties en cinq approches de l’œuvre : vie et immanence ; Michel Henry devant l’histoire ; Sur Marx ; Savoirs de la vie ; Absolu et religion. Aux cotés de commentateurs avisés de Henry, parfois moins connus hors des cercles de la phénoménologie radicale, se succèdent une suite impressionnante de professeurs réputés. On y trouvera donc des contributions de Raul Ballbé, Sergio Benvenuto, Jean-Marie Brohm, François Calori, Jean-Louis Chrétien, Conor Cunningham, Alain David, Christophe Dejours, Natalie Depraz, Michel Dupuis, Jean-Pierre Fabre, Eric Faÿ, Michel Fichant, Guy Florès, Emmanuel Galactéros, Miguel Garcia Baró, Jean Greisch, Karl Hefty, Marc Herceg, Gabrielle Dufour-Kowalska, Rolf Kühn, Jean-François Lavigne, Jean Leclercq, Mario Lipsitz, Jean-Luc Marion, Florinda Martins, Yukio Naka, Adriaan Peperzac, Pierre Piret, Eric Rhode, Giuliano Sansonetti, François-David Sebbah, Carole Talon-Hugon, Karol Tanowski, Jerôme Thélot, Roland Vaschalde, Antoine Vidalin, Ruud Welten, Yorihiro Yamaga
Je ne puis rendre compte de toutes ces contributions, même des plus prestigieuses. A contre cœur, je n’attirerai l’attention que sur l’une d’entre elles, choix, me semble-t-il, au moins exemplatif du foisonnement de biais de lecture que la phénoménologie radicale est aujourd’hui susceptible de recevoir ou de générer, – caractéristique que les directeurs de l’ouvrage ont été soucieux de rencontrer dans leur demande de contributions. Si je n’en présente qu’une, c’est aussi pour lui faire droit plus en détail.
Cette contribution est celle de Christophe Dejours, psychiatre, professeur au Conservatoire nationale des Arts et métiers, auteur d’un livre retentissant Souffrance en France en 2006. Son texte ne s’articule pas autour d’une lecture serrée de Henry, et c’est justement là son intérêt et son intelligence. Il vient au contraire à la fois appuyer et tester les thèses de Henry sur le travail à partir de remarques cliniques issues du terrain.
Pour le clinicien, rappelle d’entrée Christophe Dejours, « le travail n’est pas en première instance le rapport salarial ni l’emploi, c’est le ‘‘travailler’’, c’est-à-dire un certain mode d’engagement de la personnalité pour faire face à une tâche encadrée par des contraintes (matérielles et sociales) » 12. Christophe Dejours propose sur cette base une ‘‘typographie’’ du travail qu’il dégage à partir de ses expériences thérapeutiques et théoriques. Un travail, même si son organisation est rigoureusement circonscrite par un cahier des charges, ne peut être véritablement de qualité si l’on se borne justement à en exécuter scrupuleusement les tâches. Un simple travail d’exécution n’est d’ailleurs rien d’autre qu’une « grève du zèle ». Tout travail appelle par conséquent une créativité. Car « travailler, c’est combler l’écart entre le prescrit et l’effectif » 13. Si une telle créativité, même minimale, est niée ou récusée, c’est à la fois la qualité du travail qui est amoindrie et la subjectivité du travailleur qui est atrophiée. Les travaux de Henry sur Marx sont évidemment un lieu privilégié pour de telles analyses.
Tout travail implique donc une véritable « intelligence inventive » par laquelle le travailleur fait face au réel et le surmonte, trouve une réponse à un problème dont la solution n’était pas connue. Cette intelligence qui passe du prescrit à l’effectif est trop souvent recouverte. « Si j’insiste sur ce point, explique Christophe Dejours, c’est parce que précisément, en même temps que l’on méconnaît l’écart entre le prescrit et l’effectif, on méconnaît que tous ceux qui travaillent doivent mobiliser une intelligence inventive qui fait partie intégrante du travail ordinaire. Même les savants, en psychologie, en particulier en psychologie cognitive, méconnaissent cette intelligence, parce qu’ils n’étudient pas le travail, mais des situations artificielles. Ils n’étudient pas l’intelligence confrontée au réel, ils s’en tiennent à ce qu’on appelle la ‘‘résolution de problème’’ dont précisément on connaît déjà la solution » 14. Or, Christophe Dejours identifie dans la phénoménologie radicale de la vie une méthodologie permettant de tenir compte de cette intelligence, de l’élucider, peut-être même de l’intensifier. Il se réfère aux recherches de Henry sur le corps, plus exactement – il ne le dit pas – sur le thème de la mémoire du corps que Henry reprend à Nietzsche. « L’habileté, la dextérité, la virtuosité et la sensibilité technique, passent par le corps, se capitalisent et se mémorisent dans le corps et se déploient à partir du corps » 15.
L’article de Christophe Dejours devient à ce moment – sans doute à son insu car telle n’est pas son ambition – du plus haut intérêt pour la réception théorique de l’œuvre de Henry. En partant du concept de « corpropriation » qu’il applique à la relation qui s’instaure entre le travailleur et sa machine, Christophe Dejours rappelle en fait combien on continue de lire la phénoménologie radicale selon un cadre qu’elle ne cesse pourtant de déconstruire en opposant l’immanence à la transcendance, l’épreuve pathétique de la vie à son expérience pratique et concrète dans le monde, bref en la taxant de philosophie éthérée [Sur cette question, on se référa par exemple à l’interview de Renaud Barbaras publiée sur ce site : [https://www.actu-philosophia.com/spip.php?article69 [/efn_note]. « Böhle Milkau (1991) proposent de cette clinique du travail une théorisation à partir de Merleau-Ponty et de Lévy-Strauss. L’analyse diffère quand on prend appui sur Michel Henry. Comment acquiert-on cette sensibilité extraordinaire que les auteurs américains appellent ‘‘tacit skills’’, que d’autres caractérisent par le terme de ‘‘sens technique’’ ou de ‘‘sixième sens’’ ? Il faut se familiariser avec la machine, pour ‘‘devenir la machine’’ – c’est ce que l’on appelle ‘‘faire corps’’ avec la machine » 16. Travailler avec une machine, c’est l’habiter avec son corps, c’est sentir sa machine dans son corps, c’est faire en sorte que la machine devienne le prolongement du corps. Le travail est donc bien ce milieu où le corps du travailleur tend à se transformer, à accroître sa sensibilité, sa subjectivité. Un passage de Henry complète remarquablement l’analyse proposée : « Le système d’ensemble formé par mon corps en mouvement et faisant effort, mon Corps immanent absolument subjectif et absolument vivant – par le corps organique qui se creuse et se ploie sous son effort – par la Terre enfin qui refuse de plier à son tour et s’oppose à l’effort, se donnant en lui comme ce qu’il ne peut plus vaincre ni faire céder, telle est l’essence originelle de la tekhnè. […] L’instrument n’est originellement rien d’autre que le prolongement du Corps subjectif immanent et ainsi comme une partie du corps organique lui-même, à savoir ce qui cède à l’effort et se donne comme tel et seulement de cette façon. […] C’est pourquoi l’instrument est détaché de la nature pour être livré à l’initiative du corps et mis à sa disposition » 17.
Christophe Dejours relie finalement ses dernières analyses avec sa première thèse. « Ce que suggère la clinique rapidement évoquée ci-dessus, c’est que le travail est toujours une lutte avec le réel, avec cela même qui résiste à la connaissance et à la maîtrise. Et pour surmonter cette épreuve, il faut user d’une intelligence qui procède de la mobilisation et de l’implication du corps tout entier engagé dans un corps-à-corps avec le réel : la ‘‘corpropriation’’ du monde confine à une familiarisation qui s’offre comme une réconciliation avec soi lorsque la vie l’a emporté sur la résistance du réel » 18. Seulement, ajoute-t-il dans une dernière page dense et bouleversante pour autant que l’on entende la réalité qu’elle décrit, une telle clinique du travail révèle en même temps à rebours la souffrance, les « ravages » que le travail peut identiquement provoquer lorsqu’il se « clive » de la vie et dénie la subjectivité qui s’y réalise. « Lorsque tournant le dos à la culture, le travail déshonore la vie, lorsque le travail se retourne contre ‘‘l’être générique de l’homme’’ pour reprendre ici une expression marxienne des ‘‘manuscrits parisiens’’, se profile le spectre de la psychopathologie voire de la mort sous la forme incroyable des hommes et des femmes qui viennent aujourd’hui se suicider sur le lieu même de leur travail » 19. On ne peut s’empêcher de repenser à quelques lignes annonciatrices de La Barbarie que Christophe Dejours ne cite pas mais qu’il n’ignore certainement pas : « Dès le début de la première révolution industrielle et comme le simple effet du remplacement progressif de la ‘‘force de travail’’ par des énergies naturelles, il était possible de pressentir la réduction de l’activité des travailleurs à un travail de surveillance, lequel signifie l’atrophie de la quasi-totalité des potentialités subjectives de l’individu et ainsi un malaise et une insatisfaction croissante » 20.
Je laisserai le denier mot à Christophe Dejours parce qu’il conclut son propos sur une invitation intelligente à relire Henry. « Cette évolution désastreuse et ruineuse n’a rien d’inéluctable. Elle dépend d’abord et avant tout du consentement de nos contemporains à apporter leur concours à des organisations du travail qui déshonorent la vie, et sont fondés sur des contresens aberrants quant aux rapports entre le travail et la vie. Mais beaucoup d’entre eux s’exécutent sans y penser […] Les rapports entre le travail, la technique et la vie dont les lignes de forces ont été dégagées par Michel Henry, ne sont pas suffisamment repris, commentés, approfondis par les philosophes après Michel Henry. De sorte qu’ils sont aussi insuffisamment connus et pensés par nos contemporains. Il se pourrait que ce défaut de pensée soit en cause dans la résignation caractéristique de notre temps » 21.
- J.-M. BROHM et J. LECLERCQ (dir.), Michel Henry, Lausanne, L’Age d’homme, coll. « Les dossiers H », 2009, 552 pp.
- J. GREISCH et A. DAVID (dir.), Michel Henry, l’épreuve de la vie, Paris, Cerf, coll. « La nuit surveillée », 2001, p. 489.
- Ibid., p. 491.
- Michel Henry, op. cit., p. 13.
- Ibid., p. 15.
- Ibid., p. 16
- Ibid., p. 19.
- M. HENRY, Phénoménologie de la vie, 4 t., Paris, PUF, coll. « Epiméthée », 2003-2004 ; ID., Auto-donation, Paris, Beauchesne, coll. « Prétentaine », 2002 ; ID., Entretiens, Arles, Sulliver, 2005.
- Michel Henry, op. cit., p. 53.
- Ibid., pp. 55-60.
- Ibid., pp. 124-147
- Ibid., p. 353
- Ibid.
- Michel Henry, op. cit., pp. 353-354.
- Ibid., p. 354
- Michel Henry, op. cit., p. 354.
- M. HENRY, La Barbarie, Paris, Grasset, 1987, 2004, pp. 81-83.
- Michel Henry, op. cit., pp. 353-354.
- Ibid., p. 354.
- M. HENRY, La Barbarie, que nous citons dans l’édition Paris, PUF, coll. « Quadrige », 2004, p. 92.
- Michel Henry, op. cit., pp. 353-354.








