Jusqu’à présent, le public français ne disposait que de trois articles traduits de Dieter Henrich, ce qui était fort mince ; dans les deux plus récents, Henrich proposait une explication du passage probablement le plus difficile de la Grande Logique de Hegel, celui consacré à la réflexion. Ces deux textes traduits dans la revue Philosophie 1 s’ajoutaient à un article paru en 1967 dans la Revue de métaphysique et de morale, intitulé « La découverte de Fichte »2 si bien que ces trois textes constituaient la seule trace française de la pensée de cet éminent spécialiste international de l’idéalisme allemand, et le public hexagonal peinait donc à comprendre l’impact que pouvait avoir eu Henrich dans l’histoire de l’interprétation de l’idéalisme3. La traduction en français des leçons d’Henrich sur la subjectivité constitue, ne serait-ce qu’à cet égard, un louable effort de diffusion d’une pensée puissante et originale, détonnant singulièrement dans le concert actuel de célébration de la mort du sujet.
I : Une réhabilitation de la subjectivité transcendantale
Les leçons traduites par Martina Roesner proposent au lecteur français de prendre connaissance d’un ensemble de leçons prononcées de 2003 à 2005 et éditées en allemand en 2007, organisées autour du problème de la subjectivité, et plus précisément de la défense de celle-ci contre les attaques désormais classiques en œuvre depuis les années 50. Aux yeux de Dieter Henrich, le sujet n’est pas mort, ni même moribond philosophiquement, et ni la psychanalyse ni les neurosciences, ni le primat lévinassien du « toi » sur le « moi » ne l’ont véritablement achevé. Ainsi que le remarque Martina Roesner dans son avant-propos, Henrich est peut-être encore le seul aujourd’hui à défendre une subjectivité transcendantale, quand bien même celle-ci serait réduire à son minimum. « C’est donc en quelque sorte un idéalisme, ou plutôt un transcendantalisme « minimaliste » que celui que développe Henrich. »4
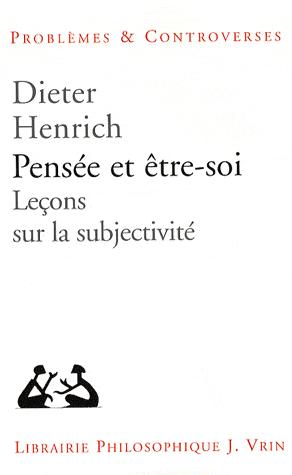
C’est bien d’un idéalisme transcendantal encore viable dont il est question dans ces leçons, dont la viabilité sera précisément abordée à travers le prisme successif de l’irréductibilité de la conscience de soi, péniblement traduite par « auto-conscience », de la morale, de l’altérité et des neurosciences. Le point de départ de Dieter Henrich se veut donc être une sorte de fin de non-recevoir de la mort de la subjectivité, annoncée par ces différentes régions de la pensée. « Mes propos ne s’appuieront pas sur le principe d’un soupçon généralisé à l’égard de tout ce qui a été développé dans les courants principaux de la tradition philosophique moderne. Je ne partage pas l’avis selon lequel ils devraient être révolutionnés ou auraient déjà été rendus obsolètes par un nouveau paradigme de pensée. »5 Contre les tentatives de destitution de la subjectivité de ses initiatives, Henrich rappelle ce qui lui semble être le point irréductible de tout départ philosophique : le sujet est maître de ses pensées et de ses actions : tel est l’irréductible apport de la pensée classique et à cet égard l’irréductible impulsion de toute philosophie véritable.
II : Renforcer la subjectivité par l’intégration des critiques
Néanmoins, et là réside toute la force de l’ouvrage, Henrich va reprendre un certain nombre de critiques qui ont été faites à l’encontre de la subjectivité, les intégrer à sa propre redéfinition, tout en en rejetant les conséquences ultimes, si bien que l’entreprise d’Henrich consiste à fortifier la notion même de subjectivité par l’intégration d’un certain nombre de critiques qui lui ont été adressées. La première critique que développe Henrich est celle de la présence, terme aux accents derridiens bien connus et qui va recevoir ici un traitement extrêmement subtil : comment penser un sujet conscient de lui-même, mais échappant au reproche de présence à soi ? Je trouve cette problématisation extrêmement judicieuse, dans la mesure où elle impose de mettre la profondeur conceptuelle du sujet à la question, et ainsi d’identifier ce qui lui est absolument consubstantiel, et ce qui peut lui en être soustrait sans en menacer la validité. Penser une conscience de soi sans présence à soi, voilà qui invite également à ne pas sombrer dans un raisonnement par trop mécanique, qui penserait jeter la subjectivité avec ses supposés attributs essentiels. Par sa première interrogation Henrich propose donc de poser un sujet n’étant pas donné lui-même dans son propre rapport à soi. L’évidence de la conscience réflexive doit être ainsi affranchie de l’illusion d’auto-donation du sujet, et à ce titre il serait possible de ménager une issue à la subjectivité comme réflexivité mais non comme présence à soi et d’intégrer la critique derridienne à un maintien de la subjectivité.
Cette intégration de la critique derridienne libère en même temps une possibilité qui est celle de la modulation des rapports à soi du sujet ; une fois évincé le risque de présence ou d’auto-donation, la possibilité de la multiplicité des rapports du sujet à lui-même se trouve ouverte. Ainsi, ce qui est suggéré dès la page 15 reçoit une éclatante confirmation au cœur même de l’ouvrage : « Que l’être-soi soit soumis à une dynamique signifie précisément qu’on peut distinguer plusieurs niveaux de sa réalisation, niveaux dont chacun se différencie à son tour en plusieurs modes de la relation à soi – par exemple la connaissance distanciée et l’agir impliqué dans certaines situations et circonstances. Mais partout l’être-soi comme tel est quelque chose d’intelligent et même le point central de prestations intelligentes. »6
Ainsi, ce qu’Henrich va sauver c’est la connaissance élémentaire de soi-même à l’œuvre dans le procès subjectif, tout en désolidarisant celle-ci de toute idée d’auto-puissance, auto-puissance mise en échec par l’impossibilité qu’éprouve le sujet à acquérir une connaissance de lui-même par un simple rapport à soi. En d’autres termes, parce que le sujet se dirige naturellement vers ce qui lui est transcendant, nous ne pouvons pas croire une seule seconde que la subjectivité soit synonyme d’auto-puissance. Une fois encore, la position d’Henrich est extrêmement subtile : oui le sujet entretient privilégié à soi et ce rapport désigne même l’évidence la plus irréductible de la philosophie, mais non, ce rapport ne signifie en aucun cas un octroi de puissance du sujet à lui-même ; en d’autres termes, le sujet ne doit tirer aucune gloire de la réflexivité dont il est capable, et la dilection qui est la sienne pour la transcendance des objets signale combien apparaît comme insuffisant ce rapport à soi. Et cette insuffisance doit être interrogée comme telle, en tant qu’elle offre un début de réponse : ce besoin de dilection vers la transcendance signifie clairement que le rapport à soi ne délivre en aucun cas l’essence même du sujet. Le sujet est ce qui ce rapporte à soi mais ce rapport ne permet pas d’identifier l’essence du rapport.
III : Subjectivité et totalité
Henrich, part donc de l’insuffisance cognitive du rapport à soi pour en interroger le sens et comprendre que le sujet est aussi ce qui a un rapport à la transcendance, et même à toute la transcendance ; le sujet est ce qui possède une protention vers la totalité. Accéder à soi, c’est accéder à soi comme insuffisant et donc du même geste ménager un accès à la totalité du monde. Ce faisant, Henrich propose un double geste, maintenant la spécificité de la subjectivité, en ce sens où le rapport à soi du sujet doit demeurer le propre de l’humain, mais où le rapport au monde que suppose la subjectivité intègre celle-ci à celui-là. C’est précisément ce qu’énonce Henrich à travers la description de la double protention de la conscience : « La réalisation de la première protention implique la tendance à situer la subjectivité elle-même hors de la totalité du monde, au point de la faire disparaître. Pour la deuxième protention, en revanche, qui procède dans la direction inverse, la compréhension de soi du sujet de la subjectivité reste toujours le point de mire, c’est-à-dire dans la pensée d’un tout conçu de façon à inclure cette subjectivité et dans lequel elle peut trouver son fondement. »7
Il est intéressant de noter ici que l’exigence de la subjectivité identifiée par Henrich ressemble étonnement à celle qui lui avait assignée Renaud Barbaras dans son Introduction à la phénoménologie de la vie où ce dernier faisait du sujet cela même qui était dans le monde, et cela même qui lui était transcendant, de sorte que la vie que recherchait Barbaras consistait à situer celle-ci aussi bien comme immanente et transcendante au monde. « Le sujet de la corrélation a ceci de propre qu’il vit : il est à la fois un vivant, et il fait partie en cela du monde, et un sujet qui vit le monde, c’est-à-dire pour lequel il y a ce monde. »[Cf. Renaud Barbaras, Introduction à la phénoménologie de la vie, Vrin, 2008, p. 20[/efn_note] Certes, Henrich ne problématise pas à partir de la vie8, mais il n’en demeure pas moins vrai que l’exigence qu’il pose d’une subjectivité à la fois immanente et transcendante au monde est similaire à celle que s’impose Barbaras dans ses propres travaux. De là la conclusion d’Henrich s’impose d’elle-même : « De tout cela résulte une conclusion importante pour la philosophie dans son ensemble. La tendance à l’élargissement et à l’approfondissement de la connaissance du monde et une pensée qui transcende, voire qui se détourne du monde sont donc inséparables et naissent au même titre de la subjectivité de l’homme ! »9
IV : Déploiements de la subjectivité
Très classiquement, Henrich assoit la subjectivité d’abord sur la notion de rapport du sujet à soi et au monde – et à cet égard, Henrich demeure très fidèlement hégélien, particulièrement lorsqu’il pense la subjectivité non pas comme une présence à soi mais comme une distance à soi bien que cette distance soit le fait du sujet lui-même – et pense ensuite ce que va rendre possible concrètement la subjectivité. Classiquement encore, Henrich reprend une appréhension kantienne de la morale, avec toutefois des prétentions moindres que son illustre prédécesseur. « Le philosophe n’a aucune compétence particulière en tant qu’expert en matière de jugement moral. »10 Le philosophe ne pense pas le jugement moral mais le fonctionnement de la « conscience morale »11, c’est-à-dire le rapport qu’entretient le sujet à son propre contenu moral. Très kantiennement, Henrich reprend un des principaux résultats de la philosophie critique, en décrétant que le Bien se trouve non pas dans l’action elle-même, mais dans l’intention qui guide l’action si bien qu’Henrich reprend le procès de désobjectivation du Bien que Kant avait esquissé. Dans une formule qui pourrait être de Kant, Henrich écrit ainsi : « En fin de compte, il n’y a que le motif de l’action, la bonne volonté ou l’intention et non pas l’action, qui puissent être appelés bons sans aucune restriction, c’est-à-dire bon au sens moral. »12 Seulement là où Henrich va rompre avec Kant, c’est lorsqu’il va lui falloir penser la question de la fondation de la morale : rappelons que Dieter Henrich, contrairement à Kant, refuse que le rapport à soi devienne l’illusion d’une auto-puissance ; par conséquent, si le Bien réside dans la bonne intention, cela ne signifie pas pour autant que se trouve fondé dans la subjectivité le Bien lui-même. Une fois de plus, Henrich fait preuve d’une très belle subtilité : la norme morale est bien située dans la subjectivité, mais ça ne signifie pas qu’elle y soit fondée. « Si l’on veut que de telles normes aient une quelconque validité, le présupposé en doit être situé dans la constitution de la subjectivité elle-même. L’appropriation ne peut donc pas se faire contre tout intérêt. Néanmoins, la constitution des normes contredit toute fondation à partir d’un tel intérêt. »13 Par cette subtile distinction, Henrich échappe intelligemment aux apories de la fondation de la morale, tout en maintenant l’immanence des normes morales à la conscience subjective. En d’autres termes les normes morales sont bien situées dans la rationalité subjective, mais il serait absurde d’affirmer qu’on est capable les liens entre rationalité et moralité à partir de la rationalité.
Une autre application de la subjectivité telle que la souhaite Henrich est celle de son déploiement et de sa connexion avec les modes de l’être-avec. Henrich demande d’ « accepter l’être-avec de l’homme comme un fait élémentaire et basal qui fournit la base d’une compréhension plus simple et moins artificielle de l’être-soi de l’homme. »14 Mais dire cela, c’est laisser ouverte la question suivante – et redoutable : suis-je sujet en vertu de l’intersubjectivité, où n’y a-t-il d’intersubjectivité qu’en vertu de ma propre subjectivité ? La réponse d’Henrich est plutôt ambiguë. Plus qu’une réponse, c’est à une analyse de la préséance de l’intersubjectivité sur la subjectivité qu’il se livre, pour en réfuter la possibilité. Mais le refus analytique de la préséance de l’intersubjectivité, s’il est bien mené, ne signifie pas nécessairement la préséance de la subjectivité, et il me semble que là réside une faiblesse de la démonstration de l’auteur car révéler une impossibilité ne signifie pas libérer une possibilité même si l’on comprend bien que l’être-avec est une des modalités du déploiement du sujet vers la totalité et procède donc de la protention du sujet vers le monde inhérent à la finitude du sujet.
L’ensemble des déploiements de la subjectivité procèdent donc de l’insuffisance du sujet, du caractère introuvable de son fondement, et la question porte alors sur le sens de ce fondement. « Les sujets vivent toujours dans la conscience d’un fondement qui n’est pas à leur disposition. Ils peuvent considérer ce fondement comme un événement facticiel, par exemple comme un processus très complexe dans leur corps dirigé de façon neuronale. Ils peuvent aussi s’ouvrir à ce fondement à travers une pensée qui confère au déroulement de leur vie une signification qui ne se réduit pas au simple fait de l’inéluctabilité de sa réalisation. »15 La question du sens de la subjectivité apparaît inéluctablement car c’est au fond elle qui va rendre possible la dimension sensée de l’action morale, si bien que le réductionnisme du sujet aux processus purement neuronaux va recevoir une interprétation précise qui est celle de la perte de sens des différents déploiements du sujet. Contre cette fuite du sens que portent en elles les neurosciences, Henrich va réaffirmer le sens des actions du sujet en les enracinant dans ce qui peut-être constitue la part la plus irréductible du débat avec les neurosciences, la psychanalyse et le naturalisme, à savoir la liberté humaine. « La liberté présuppose donc la continuité du sujet et l’orientation de la personne sur un équilibre d’identités. »16 C’est probablement là, dans la question de la liberté, que se joue l’essentiel du débat autour du problème de la subjectivité, et ce n’est pas un hasard si les conclusions d’Henrich y sont consacrées : le dynamisme même de la subjectivité repose sur l’intégration du dynamisme de la liberté. Pour autant, la liberté ne décrit pas le dessein ultime de la subjectivité, et une fois de plus Henrich dessine les contours d’une pensée subtile qui chercherait à dépasser les apories du « tout-liberté » et du « tout-contraint ».
Ces quelques leçons, la plupart du temps brillantes, proposent de repenser le sujet en fonction des attaques qui lui ont été explicitement ou implicitement portées depuis plusieurs décennies. Néanmoins, l’essentiel des analyses de Dieter Henrich demeurent principielles et, pour ainsi dire, métaphysiques. Le sujet est quelque chose de plus que ce à quoi veulent le réduire le naturalisme ou la psychanalyse, mais comment justifier ce surcroît ? Il n’est pas certain qu’Henrich parvienne à intégrer réellement l’ensemble des critiques qui ont été faites dès lors qu’elles ne sont plus d’ordre philosophique : ainsi Henrich intègre-t-il magnifiquement les critiques de Derrida, Levinas, voire même Habermas, parce qu’elles conservent un arrière-fond sinon métaphysique, à tout le moins nettement philosophique. Mais lorsqu’il s’agit des neurosciences, Henrich change de stratégie et opère des refus du principe : il n’est pas possible que le sujet ne soit qu’un événement matériel facticiel. Certes ; mais comment démontrer cela ? Pour cette raison, ces belles leçons, pas toujours finement traduites, portent en elles quelque chose comme un projet ou comme une tâche à accomplir, qui consisterait à intégrer les neurosciences à une philosophie de la subjectivité, plutôt que de les refuser principiellement sous le seul motif qu’elles seraient métaphysiquement intenables ; cela permettrait ainsi de mettre fin à l’impression parfois diffuse qui émane de ces leçons d’une impossibilité pour la philosophie et les neurosciences de parler du même objet.
- cf. Dieter Henrich, Hegel et la logique de la réflexion, Philosophie, Minuit, numéro 90 et 91, 2006
- Dieter Henrich, « La découverte de Fichte », in Revue de métaphysique et de morale, 1967 / 2
- Dans une moindre mesure, nous rencontrons le même problème avec les ouvrages de Reinhard Lauth.
- Dieter Henrich, Pensée et être-soi, leçons sur la subjectivité, traduction Martina Roesner, Vrin, 2008, p. XI
- Ibid. p. 13
- Ibid. p. 118
- Ibid. p. 30
- Pour de plus amples précisions sur la problématisation de la vie chez Barbaras, cf. [https://actu-philosophia.com/spip.php?article69
- Ibid. p. 30
- Ibid. p. 67
- Ibid.
- Ibid. p. 70
- Ibid. p. 77
- Ibid. p. 107
- Ibid. p. 171
- Ibid. p. 243








