Introduction
Dans ce court essai[1] d’une densité et d’une richesse absolument remarquables, Didier Franck propose une sorte d’étude comparative en miroir entre Husserl et Heidegger sur le temps. Nous disons cela dans la mesure où le deuxième texte du volume intitulé « Le séjour du corps », recouvre en réalité le temps, puisque Didier Franck tente d’y repenser ce que nous pourrions appeler l’échec de Être et Temps avoué par Heidegger en 1962 : « La tentative, dans Être et Temps, §70, de reconduire la spatialité du Dasein à la temporalité n’est pas tenable[2] » (p. 92).
Dans cette perspective, le corps est l’expression d’un nœud problématique où se jouent la constitution de la temporalité comme de la spatialité, soit chez Heidegger comme « Rapport des rapports » (p. 98), soit chez Husserl, comme clé de l’énigme du temps, puisque « le sentir, c’est ce que nous tenons pour la conscience originaire du temps » ou « la sensation est la conscience présentative du temps » (p. 8). Ainsi, pour comprendre phénoménologiquement les modes des « dissensions de l’âme », Didier Franck propose-t-il de repartir principalement des Leçons sur la conscience intime du temps de 1928 – sur lesquelles Husserl avait d’ailleurs fait retravailler son assistant de l’époque après sa lecture peu convaincue du livre qui lui était dédié en 1927 – avant d’engager une étude à partir d’une conférence de 1964 par Heidegger comme nous le verrons en deuxième partie du recueil.
- Première partie
La question du temps chez Husserl n’est pas qu’une simple description des vécus de conscience, car cette entreprise met en cause la teneur même du discours et de la démarche phénoménologique, puisque le temps conditionne la possibilité de constituer un objet et sa donation : le temps s’identifie à la constitution du vécu, et décrire le vécu c’est produire simultanément son sens temporel – mais ici, même le terme de « simultanéité » est de trop. puisque selon Husserl « nous ne saurions parler d’un temps de la conscience ultimement constituante » (p. 45). Il faut donc poser la question de cette manière : « Y a-t-il un sens à dire au sens propre et effectif, que les apparitions constitutives de la conscience de temps (de la conscience intime du temps) tombent elles-mêmes dans le temps (immanent) ? » (p. 41). Car en lui-même, le temps n’est pas un objet comme les autres, puisqu’il rend possible la dimension constitutive du vécu et « l’événement » même de la donation d’objet (cf. note 3 p. 63), à savoir le sens même de la sensation.
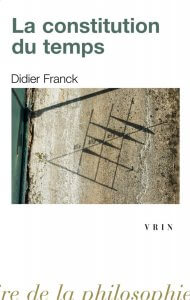
Il s’agit donc de décrire toute présentification, donation à la sensation qui pourtant n’est pas, en tant que temps, réductible à un « data », une donnée. Le mystère du temps, lorsque Husserl veut en quelque sorte le penser indirectement avec un élément sonore, c’est qu’il « a sa temporalité propre » (p. 12), comme si le son se maintenait lui-même dans une forme unitaire autorétentionnelle : le son pose son flux constant et pourtant, ses modes d’apparitions sont multiples, son « apparition est toujours autre » (p. 13), et cependant, commente Didier Franck, il y a une « continuité de mode » (p. 12) : sa donation est toujours seconde sauf comme passé conscient dans la rétention. Nous avons donc deux possibilités descriptives à articuler et à ne pas confondre : « selon que nous avons sous les yeux la relation de la conscience à l’identité de son objet ou à la multiplicité de ce qui le constitue en tant qu’identique » (p. 15). Le problème et la difficulté de cette entreprise, c’est que, sans rabattre l’une des alternatives sur l’autre, nous devons aussi expliquer leur conjugaison et la priorité de l’une sur l’autre.
La conscience a donc un flux, un flux très étrange puisque Husserl le considère comme non temporel et « pas dans le temps », mais qui pourtant constitue le temps (p. 16) : c’est ici que Husserl intensifie le paradoxe du temps et le problème : « le temps est fixe, et pourtant le temps flue » (p. 17) et Didier Franck commente alors : « le flux peut être qualifié d’in-pré-temporel » (ibid.). Comment donc penser concrètement cette continuité immuable dont les moments de mutation ne peuvent lui être indépendant sans être de simples abstractions ? Tout semble s’écouler dans la profondeur du temps et le son semble pouvoir être décrit selon une double continuité où les points du « Maintenant » multiples se tiennent pourtant par phases unifiées, continues, où le maintenant initial se maintient, se poursuit, même, à travers d’autres surgissements prochains. Ici, Husserl note qu’il y a donc « continuité des esquisses temporelles du son » (p. 20), ce qui engendre une continuité de divers points temporels d’écoulement et un passage de rétention en rétention (p. 21).
Dans ces dilemmes, nous avons toute la tension descriptive essentiellement problématique de la méthode phénoménologique dont le but essentiel va être de classer et hiérarchiser ces différents modes descriptifs, dans la mesure où « chaque objet considéré d’un point de vue formel n’est autre que le simple nœud d’un réseau de relations, c’est-à-dire dans la forme relationnelle où les objets peuvent être situés. […] Si nous définissons une multiplicité, nous définissons un domaine d’éléments par le biais de leurs relations[3]. ». D’où ces continuels glissements de terrains et récupérations dont Husserl maintient pourtant, in fine, l’ancrage subjectif de la conscience tout en développant des descriptions remettant en cause celui-ci. Il semble que, malgré lui, Husserl ait fait une sorte de d’exposition du cheminement vers la « certitude immédiate » dont parle Hegel en 5ème partie de sa Phénoménologie, pour finalement s’en apercevoir après coup, et faire « face à d’autres certitudes immédiates, qui n’ont été perdues que sur ce chemin-là » (PdE, 165).
Mais poursuivons les différents paradoxes que Husserl rencontre et dont il veut rendre compte en décrivant le son et ses modes temporels : il y un point-source qui produit le son (p. 22), qui entre en scène tout en retenant le son passé. Là-dessus, « dans la même conscience impressionnelle où se constitue la perception, se constitue aussi et précisément par là, le perçu » (p. 24), et Husserl ne peut expliquer cette combinaison par l’inconscient : même si « la rétention elle-même n’est pas un « acte » (c’est-à-dire une unité de durée immanente constituée dans une série de phases rétentionnelles) », elle est cependant « une conscience instantanée de la phase écoulée et à la fois soubassement pour la conscience rétentionnelle de la phase prochaine » (p. 25).
Alors, quel est donc le lien entre l’impression originaire et la rétention puisque celle-ci n’est pas le souvenir ou sa reproduction ? « Le maintenant de son se change en passé de son, la conscience impressionnelle s’écoulant constamment passe en conscience rétentionnelle toujours nouvelle » (p. 27). Chaque rétention est donc ce surcroît impressionnel qui se dédouble dans une rétention redoublée et pourtant différenciée qui se poursuit dans une continuité d’esquisses : il y a une sorte de jeu dialectique – passez-nous l’expression – où la sensation venant à son autre se change en rétention et la rétention se change en sensation qui sédimente le vécu de conscience : il est alors difficile de distinguer les types de contenus et d’actes qui se constituent dans cette multiplicité continuelle contrapuntique.
Didier Franck pose alors la question suivante : « comment distingue-t-on entre le contenu réel et le contenu intentionnel d’un vécu, entre ce qui y est proprement vécu ou senti et ce qui y est visé sans être proprement vécu, alors que le son retenu n’est pas réellement mais intentionnellement contenu dans la rétention ? » (p. 30). La rétention est le rapport d’un maintenant à l’autre et avant toute objectivation ; et la rétention d’une impression est aussi une autre impression (p. 31). On ne peut pas non plus opérer ces distinctions à partir du sujet individuel, puisque « l’identité de l’individu est eo ipso l’identité de la situation temporelle » (p. 37).
Il faut donc dans un premier temps, repartir du socle de « l’impression originaire », laquelle requiert la modification rétentionnelle : alors apparaît l’impression comme « un acte en dégradé continu » (p. 38). C’est donc depuis une impression à laquelle appartient essentiellement « la queue de comète » rétentionnelle qu’est accessible par voie d’abstraction l’impression originaire. Et non l’inverse selon Didier Franck, ce qui renforce les paradoxes et est hautement problématique pour la méthode phénoménologique même, car affirmer que « la conscience n’est rien sans l’impression » revient à dire une fois encore que toute conscience est intentionnelle sans être ipso facto objectivante (p. 39).
Le problème se repose cependant dans les termes suivants : « le nœud du problème de la conscience intime du temps c’est le noyau impressionnel et sa queue rétentionnelle » (p. 46). Et cela créé une sorte de situation monstrueuse, car « nous avons dans le courant de conscience, une double intentionnalité. Ou bien nous considérons le contenu du flux avec sa forme de flux. Nous considérons alors la suite des vécus originaires, qui est une suite de vécus intentionnels, conscience de… Ou bien nous focalisons le regard sur les unités intentionnelles, sur ce qui, dans l’écoulement du flux, est intentionnellement conscient en tant qu’une unité ; alors se tient là pour nous une objectivité dans le temps objectif, le champ. temporel proprement dit par opposition au champ. temporel du courant des vécus… la perception attentive de cette unité est un vécu intentionnel à contenu variable » (p. 53).
Selon ces deux voies, Didier Franck considère que « reconduisant l’être et le connaître au flux depuis sa seule structure formelle et, du même coup, la phénoménologie à son domaine d’expérience originaire, au pur apparaître, Husserl qui à sa manière conjugue ici être et devenir, peut conclure en soulignant le verbe être que « le flux de la conscience immanente constitutive du temps non seulement est, mais, de manière remarquable et néanmoins intelligible, est tel que le flux apparaît nécessairement lui-même à lui-même et, par conséquent, que le flux lui-même doit nécessairement pouvoir être saisi en son fluer. L’apparition du flux à lui-même ne requiert pas un second flux mais, en tant que phénomène, il se constitue lui-même en lui-même (§ 39) » (p. 56). On voit les conséquences d’une telle auto-constitution vis-à-vis de la conscience, et par ailleurs, la manière dont Heidegger a pu ainsi s’émanciper du style et des intentions phénoménologiques de son maître.
Reprenons. La sensation ayant un double jaillissement perceptif vers le passé (rétention) et le futur (protention), Didier Franck va alors décrire et d’expliquer chez Husserl l’articulation de la rétention avec cette intention protentionnelle qui n’est pas imaginative (p. 59). Ici, Husserl constate que même dans le souvenir et le ressouvenir, il y a déjà des « intentions d’attente dont le remplissement conduit au présent » (p. 60). La protention est alors thématisée dans un « halo » impressionnel, où, comme une sorte de miroir du souvenir, se coordonnent des « intentions de l’entour, elles se trouvent dans la direction opposée » dans des formes plus ou moins déterminées.
Ici, Didier Franck pose la question suivante à partir des Manuscrits de Bernau de 1917 : « si la rétention appartient à l’impression comme une queue de comète à son noyau, sur quel mode la protention y ressortit-elle ? » (p. 68). Est-ce sur le mode de l’intention d’attente à remplir selon ce qu’elle vise ou signifie ? Il y a là selon Husserl, par principe, toujours une « entrée en scène » perceptive « constante » (p. 71) qui, ainsi, remplit ses intentions en intuition ou se remplie continuellement de présentification incarnée. Il faut donc que la perception même, la présentation originaire s’accomplisse parce qu’il s’y opère une « rétention d’une protention » (p. 72), et donc, que « le remplissement enferme en soi une rétention de l’intention qui a précédé » (ibid.). Ainsi, l’unité du flux temporel est spontanément constituante en et d’elle-même : la protention s’inscrit donc d’emblée dans un avenir rétentionnel.
Le paradoxe de l’articulation de ce flux qui semble en train de se scinder, c’est que la rétention est une impression, qu’elle est donc remplissante, et qu’alors la protention est aussi remplie par une impression, mais comme à vide, ou bien encore une sorte d’impression qui s’évide dans la progression (p. 75sq). C’est donc un procès concret, vivant et on ne peut reconduire le temps à une simple présence. A ce point de la réflexion, Didier Franck hégélianise quelque peu Husserl en décrivant : « le présent est certes « vivant », mais d’une vie qui (…) porte la mort et se maintient dans cette mort même qui est sa propre vie » (p. 77).
L’enjeu est donc de « savoir si la temporalisation s’accomplit depuis la rétention du maintenant ou à partir de la protention d’un maintenant dont cette protention serait la source et le mode de donnée » (p. 83). Là-dessus, Husserl laisse le problème ouvert selon Didier Franck, laissant la description de la protention comme présupposant la rétention, et la rétention comme anticipant la protention dans l’accomplissement de l’événement. Il semble donc au terme de ce texte, qu’il faille passer à une autre instance que la conscience pour décrire ces conjonctions intentionnelles. En renouant avec ce qu’il avait décrit plus haut sur l’autonomie du flux qui se constitue lui-même en lui-même, Didier Franck conclue alors ouvertement sur l’option à prendre, et la nécessité de passer de l’analyse intentionnelle à l’analyse existentiale : « la temporalité ekstatique qui, sens d’être du Dasein, se temporalise à partir de l’avenir d’où naît le passé et qui délivre le présent » (p. 87).
2. Deuxième partie
Le texte consacré à Heidegger, « Le séjour du corps », avait déjà été publié en 2008 dans la Revue « Les Temps Modernes » n° 650 des mois de juillet – octobre 2008, puis en mars 2009 avec la traduction de la conférence « Remarques sur Art – sculpture – espace » prononcée par Heidegger en 1964. Didier Franck considérait que la parution de sa traduction et de son étude dans la revue consacrée au Lieu chez Heidegger « constituait un contexte pour le moins inapproprié », mais, ultérieurement, les Éditions Rivages ont retranché l’étude de Didier Franck de sa traduction lors de la réédition en avril 2015. Le temps nous dira donc si ce texte a enfin su trouver et aménager sa place éditoriale convenable dans la maison Vrin. Nous pourrions y voir une énième redite, mais, fort des précédentes descriptions husserliennes, ce texte, fait pour faire voir l’essentiel, est donc cette fois-ci inauguré par une teneur tout aussi riche que la conférence de Heidegger, même si, au demeurant, il aurait tout de même été très utile de l’y voir inséré dans ce recueil.
Nous l’avions indiqué au début de notre recension, le texte de Didier Franck – fort de ses précédentes recherches notamment aux éditions de Minuit en 1986 – part de l’impossible reconduction de l’espace au temps tentée précédemment par Heidegger. Ainsi, pour aborder la question de l’espace dans son rapport à l’appropriation (Ereignis), Heidegger tente de « défricher » son sens propre en entrant et en se tenant dans la chose-même, auprès d’elle pour s’y adonner : une question circulaire s’opère alors, le fameux « cercle herméneutique » (p. 93) s’impose donc dans l’accès même au rapport de l’essence spatiale. Si la pensée est selon Heidegger le pieux questionnement de reconduction de l’étant à l’être, la pensée à son affaire (p. 95) n’est cependant plus régie par cette différence ; elle pose alors la question de la manière suivante : « Qu’est-ce donc que l’espace comme espace ? Réponse : l’espace espace, der Raum räumt » (p. 96). C’est ici qu’interrogeant ce que veut dire ce verbe « raümen » comme éclaircie et ouverture, la description prend un tour que l’on peut considérer comme hors du cercle. Didier Franck note immédiatement après : « L’espace en tant qu’il espace ne va donc pas sans l’homme » (p. 96, sq), et l’homme n’est pas un corps dans l’espace car « espacer en tant qu’espace, requiert l’homme ». Comment comprendre ce saut apparent ?
A la lecture de cette situation parfaitement décrite, nous nous permettons ici de faire quelques remarques qui ne sont pas celles de Didier Franck. Il semble que Heidegger ne veuille pas éviter le cercle de la question de la spatialité de l’espace en posant l’espace avec un aliquid. Mais en travaillant la langue qui dans un mouvement significatif le désigne et entre en relation avec lui, il remonte à l’origine signifiant du mot, ce qui permet cette fois de parler de l’essence à travers l’aliud ou son écho originel : le mot selon la forme de la question n’est plus tautologique ou autoréférentiel, mais a des résonances quasi « tautégoriques » comme nous l’avions vu par ailleurs chez Novalis, mais avec cette fois-ci les orientations du Quadriparti, celle de la terre, du ciel, des dieux et des mortels : à travers ce fil conducteur, nous tentons de remonter à sa source productive primordiale en dépit de la perte significative dérivée que nous prononçons toujours, et dont l’inflation recouvre toujours plus l’origine. Le dilemme est de « décréer » une langue parlée pour laisser luire une langue d’écoute originelle. Au fond, en redoublant la question dans le cercle d’un rapport qui se rapporte, « l’espace espace », il semble que Heidegger ne fasse ensuite que reparcourir le processus inflationniste du langage qu’il avait pourtant principiellement dénoncé : mais celui-ci est repensé à partir et en-deçà donc au-delà de l’expérience originelle de la langue – grecque – et alors, on peut espérer aménager par la langue, par son fond productif primaire, sa force poétique fondamentale, la venue prochaine d’un événement salvateur puisque, si l’on suit là ce qu’écrivait Aristote en Poétique, 1451 b 6 sq : « non seulement mais encore plus rigoureux est l’art, la poésie, par différence avec l’histoire ».
C’est donc dans cette reprise du retour, « Avec une angoissante nostalgie nous voyons/Le passé enveloppé de sombre nuit./Qui cherche encore notre retour » que s’ouvre le Rapport entretenant tout rapport, « écoute de l’être parce qu’elle lui est appropriée » (p. 98) en dépit du fait que l’on tente de revenir à l’espace dans un « monde où l’être s’évanouit » (p. 99). Didier Franck pose alors la question : « Comment peut-on accéder à l’espace lui-même lorsqu’il n’est plus possible d’y remonter en partant de l’ustensile et de la place que lui assigne le Dasein ? » (p. 100). Être, c’est habiter, ainsi, la question de l’espace est celle des modalités de l’habiter, du « séjourner auprès » comme chez Hegel, mais cette fois-ci selon la préservation du Quadriparti. Il ne s’agit pas de saisir, mais de s’adonner à la situation humaine et de s’oublier dans sa rencontre par ce qu’assemble le Quadriparti (p. 102). Alors, ce que l’espace espace, aménage, est authentiquement un lieu, « Ort », mot qui « désigne la pointe de la lance. Sur elle, tout converge. Le lieu unit en soi le plus haut et le plus extrême. Le rassemblant transit tout et déploie son essence » (p. 103).
Le lieu est donc rassemblement rassemblant, et non plus place d’une position ; si le lieu n’apparaît d’ailleurs plus qu’ainsi, comme coordonnée du spatium ou extensio, ce n’est que parce qu’il est en tant relation de la relation « l’unité du quadrat s’est retirée au préalable » (p. 107) ; et alors, dénoué, il « demeure en retrait » (ibid.) et laisse alors la place.
C’est donc ce retrait, ce refus que nous voyons alors rayonner (p. 108) comme espace : « Le maintenant à partir duquel apparaît l’espace sans chose et disparaît la chose-lieu, où bascule la situation descriptive et avec elle le site même de la pensée » (p. 110). Alors viennent les « habitants », admis au séjour (p. 111), comme « mortels ». Ce sont ces modalités de l’habitant mortel en son séjour sur lesquels va appesantir la pensée heideggerienne : ce séjour est celui d’un corps, qui n’est pas à entendre comme une « boîte » ; le corps est toujours dans son « dehors » (p. 112), il est vie d’incorporation extérieure et non assimilation isolée ; ainsi, le séjour peut traverser ce qui s’aménage et alors, l’habiter « ménage le quadrat dans son essence » (p. 113).
A partir de là, Didier Franck repose la question dans des termes approfondis : « Y a-t-il alors un rapport entre le corporer et le séjourner en vertu duquel le premier serait ouvert non tant à la vie qu’à l’espace sans lequel ne va pas le second puisque le « rapport de l’homme à l’espace n’est rien d’autre que l’habiter pensé dans son essence » ? » (p. 114). On l’a vu, le corporé n’est admis dans l’espace que parce qu’au préalable son séjour l’a aménagé. Il habite alors, c’est-à-dire « libère (freien) lorsque nous l’entourons (enfrieden) » (p. 115). Ce n’est plus l’encapsulage, mais l’aménagement qui fait luire parce qu’il rassemble et sauvegarde selon que le « corporer est requis par le ménager, le séjourner, l’habiter, le quadrat » (p. 117). Il devient donc possible de penser le corporer depuis l’appropriation mais cependant, comme il est requis par le Quadrat dont nous avions vu que, selon Heidegger, celui-ci se retire, cette appropriation initiale de l’homme est un « maintenant, un mode de ce qui en est le prélude, à savoir l’essence de la technique comme anéantissement de la chose et refus du monde » (p. 117). Le retrait du lieu ayant concédé l’apparition de l’espace, le corps n’est plus alors « Leib », chair incorporatrice, mais le « Körper » dont les volumes occupent une configuration : l’espace est inhabitable dans cette extensio (p. 118) car sans monde.
Alors, Didier Franck conclue et constate la situation problématique mentionnée en introduction par Heidegger : « ce n’est pas le corps à lui seul mais le corporer spatialisant en tant que mode de l’appropriation qui rend impossible la reconduction de l’espace au temps » (p. 119).
Conclusion
Une nouvelle fois Didier Franck nous délivre un ouvrage d’une qualité superlative commentant avec toute la rigueur et le sérieux possible, à la mesure de l’exigence d’une haute lecture de Husserl et Heidegger. A titre personnel, nous espérons voir dans l’étude de Husserl, un prélude à un ouvrage prochain consacré à la constitution d’Etre et Temps selon cette perspective de la constitution du temps et des différentes difficultés husserliennes que Heidegger a repensé.
Si chez Althusser, l’Histoire dans son interprétation marxiste a pour objet les formes des transformations ayant prises ou avortées, nous pourrions dire que les commentaires de Didier Franck ont pour objet les échecs problématiques des Grands Penseurs. Nous pourrions y trouver là matière à déception ; mais en réalité, c’est aussi et surtout un travail qui permet, en revenant l’initial d’une pensée, de la repenser et de la dépasser sans se contenter des cosses d’une œuvre aussi édifiantes que mortes, car « c’est à cela même dont l’esprit se contente, qu’on peut mesurer l’importance de sa perte » (Hegel, Phénoménologie de l’Esprit, Préface XI).
[1] Didier Franck, La constitution du temps, suivi de : Le séjour du corps, Paris, Vrin, 2020.
[2] Cf. Didier Franck, Heidegger et le problème de l’espace, Paris, Minuit, 1986.
[3] Husserl, Articles sur la logique (1890-1913), Paris, PUF, coll. Epiméthée, 1975, pp. 535, 539








