Une identité interrogée dans les actes
Le livre de David Brakke, professeur titulaire de la chaire Engle à la faculté d’histoire du christianisme de l’université d’État de l’Ohio, est à la fois une enquête sur l’identité des gnostiques et un cours complet sur leur histoire, entre querelles, détermination de leur identité et place dans l’histoire des monothéismes, entre judaïsme et christianisme. En supprimant le lien causal induit par les deux points, peut-être que la mise en page francophone du livre de David Brakke atténue le geste original anglais de cette enquête épistémologique sur les gnostiques. En effet, plutôt que d’avoir un titre et un sous-titre qui distingue deux réalités, deux champs de l’approche, l’essai est ainsi hiérarchisé par les Harvart University Press :
« The Gnostics : myth, ritual, and diversity in early Christianity »
La nuance opérée par Marie Chuvin, la traductrice de l’ouvrage, est minime, et d’ailleurs cette remarque constitue simplement l’occasion, pour nous, de souligner la perspective du texte original. Celle-ci inscrit sur un même plan le problème de l’identité des gnostiques, leur rapport au mythe et la particularité de leurs rites dans la chrétienté dite « primitive », sans distinguer la pratique de l’identité.
Par ce texte, David Brakke cherche donc à redéfinir une base de travail sur l’identité de cette communauté particulière de la première chrétienté, protéiforme et riche de nombreuses veines esthétiques, mythiques et intellectuelles. Le premier christianisme, tout pluriel qu’il fût, est resté au moins deux siècles une philosophie de la vraie vie, véhiculant par là la métaphysique du judaïsme hellénisé et ses liens très étroits à l’apocalyptique juive propre à une conception messianique du Salut. Il présente d’ailleurs bien des connexions, tant par ses thèmes de prédilection que par l’histoire des ses auteurs, avec le néoplatonisme. Ce mouvement philosophique apparait au milieu du Ier siècle de notre ère qui prend toute sa vigueur dans le deuxième tiers du IIIe siècle et qui imprègne toute l’histoire patristique et connaît des ramifications jusque dans la scolastique très tardive (on peut penser à Nicolas de Cues (XVe siècle), par exemple). En effet, comme pour la lecture du Timée par le néoplatonisme, les gnostiques donnent à la question du savoir, de la connaissance, de l’intelligible toute prévalence qualitative sur le monde sensible.
Par ce texte, David Brakke paraît aussi nous encourager à nous défaire des mythes et des identités figées, cernées, distinguées les unes des autres, alors en bouillonnement dans les phénomènes religieux des quatre premiers siècles de notre ère. Et c’est bien là d’un des points qui rendent absolument nécessaire, aujourd’hui, une telle enquête.
« Qui sont les Gnostiques ? » : une mise au point nécessaire
Ainsi, en posant cette question d’apparence simple (pour un spécialiste) : « Qui sont les Gnostiques ? », le professeur d’histoire du christianisme pose en fait une question de méthode ; et il nous appelle à redéfinir l’entièreté des approches qui nous permettent de percevoir les mécanismes religieux de ce fabuleux essor du monothéisme dans la fin de l’Antiquité puis dans toute l’Europe médiévale. Il pourrait donc n’être pas tant question d’une définition de l’identité des gnostiques que d’une compréhension de ce dont ils sont phénomène. Interne au christianisme et contre lesquels tant de Pères de l’Église ont écrit, contre ou grâce auxquels la notion même d’hérétique a pu émerger dans le christianisme, les gnostiques ont donné l’opportunité à « la Grande Église » de se penser, de se construire contre et d’initier une longue et riche tradition philosophique et théologique — nous pensons évidemment à Irénée de Lyon et à son texte fondateur, Dénonciation et et réfutation de la gnose au nom menteur, ou Contre les hérésies[1]. Il se pourrait donc que ce livre soit une invitation à redéfinir notre conception de l’histoire de cette « early Christianity », ce plasma idéologique, philosophique, esthétique, mystique et religieux qui bouillonne encore aujourd’hui dans la perception que nous en avons.
L’exemple de la (re)découverte récente de l’Évangile de Judas permet à l’auteur d’évoquer la richesse de cette matrice philosophique et religieuse qu’était la toute jeune chrétienté. Quand Irénée de Lyon, qui évoque l’Évangile de Judas dans son texte, rédige son Contre les hérétiques, l’évêque et Père de l’Église n’inscrit pas une forme du christianisme qui serait « véritable » dans l’histoire. Il ne parvient à imposer son interprétation du christianisme qu’au prix d’un affrontement idéologique.
En somme, ce que nous recevons comme une évidence aurait pu se présenter à nous tout autrement, selon que tel ou tel auteur, à commencer par Irénée lui-même, ait perçu différemment la « vérité » du tout jeune christianisme. Le christianisme aurait-il été très différent si, par exemple, Saint Augustin n’avait pas combattu Pélage ou le manichéisme ? Très certainement, si l’on suit la proposition de David Brakke ; ce qui nous paraît nécessaire. Au fond, la victoire théologique d’Irénée contre les gnostiques a déterminé un cap, et privilégié une direction dans les formes à venir du christianisme. Tant et si bien que l’Évangile de Judas, non moins légitime pour les communautés chrétiennes de son époque de diffusion que ne l’étaient peut-être les propos de l’évêque de Lyon, a paru à bon nombre de commentateurs modernes fantaisiste, insupportable, voire même comme un blasphème pour certains. La communauté scientifique, elle aussi, s’est retrouvée « sens dessus dessous »[2] à propos de la place de Judas, de la valeur politique et apostolique de ce texte, ainsi que de son inclusion dans la littérature chrétienne primitive. Tout cela étant écrit, il n’en demeure pas moins que l’Évangile de Judas était en fait très valable au temps de son écriture, sans doute contemporaine de l’évêque. Irénée comme les gnostiques défendaient leur perception sensible de la toute jeune chrétienté et ni l’une ni l’autre de ces deux perceptions n’étaient a priori bonnes ou mauvaises.
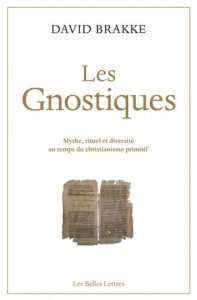
« Le christianisme qui a finalement triomphé dans le monde romain pour façonner les diverses foi actuelles a beaucoup plus en commun avec la religion d’Irénée qu’avec celle de Judas. Mais, d’un autre côté, le christianisme d’Irénée n’était pas le christianisme quand l’Évangile de Judas est apparu. Les chrétiens qui écrivirent et ceux qui lurent l’Évangile de Judas étaient sans aucun doute sincères dans leur foi et se considéraient comme les vrais chrétiens. Ils ignoraient qu’ils mettaient le christianisme sens dessus dessous ; ils croyaient enseigner le vrai christianisme, et reprochaient durement aux autres chrétiens de s’être irrémédiablement laissé tromper. L’exclusion de l’Évangile de Judas du canon final du Nouveau Testament n’était ni historiquement inévitable, ni, comme le diraient les historiens, le résultat d’une intervention divine. Ce fut le fruit d’un processus complexe au cours duquel différentes formes de christianisme luttèrent, s’influencèrent, empruntèrent les unes aux autres et se rejetèrent mutuellement. »[3]
Or c’est bien à l’étude de ce processus que l’auteur s’attaque afin de permettre au lecteur de se rapprocher des gnostiques de façon, sinon plus authentique, du moins plus nue, d’une façon qui s’évertuerait à se libérer des clichés, de la mystification édifiée par plus de quinze-siècles d’histoire littéraire, théologique, mystique et politique. Il n’est pas question de prétendre connaître les vraies formes de ce mouvement, une fois le livre de David Brakke achevé, mais plutôt de chercher la juste nuance entre le phénomène religieux des gnostiques et l’ensemble des fantasmagories qui se sont agglomérées autour de ces communautés parmi les communautés des premiers chrétiens. C’est une affaire de méthode historique, invitant à regarder les gnostiques non plus comme les hérétiques dépeins par Irénée mais plutôt comme les tenants d’une version vaincue des premières possibilités du christianisme.
Si l’histoire des phénomènes religieux, comme l’histoire de ses institutions, nous paraît inamovible et inscrite dans le marbre du temps passé, il faut donc garder à l’esprit que nous interrogeons des idées, des processus et des vies humaines dont nous connaissons déjà le devenir et la fin. La vision d’une jeunesse unifiée d’un christianisme qui n’aurait connu de diversité interprétative est donc hâtive. De tout temps, tout au long de l’histoire de la littérature patristique, jusqu’au VIIe ou VIIIe siècle, puis également au long de l’exégèse scolastique, les auteurs chrétiens n’ont eu de cesse de « ramasser » le christianisme sur le socle d’une forteresse idéologique de plus en plus inattaquable. Si bien que les deux grands schismes de son histoire, de même que l’histoire papale, sont d’autres manifestations de l’activité continue de la dynamique théologique, philosophique, politique et religieuse qui semble ne s’être jamais interrompue depuis la lutte contre les gnostiques.
Les vainqueurs et les vaincus
Au fond, la démarche de David Brakke nous permet d’aller chercher la parole des vaincus afin de mieux se positionner vis-à-vis de l’histoire écrite par les vainqueurs. L’étude de la « pluralité » du christianisme primitif et ses limites[4] permet d’envisager comment et pourquoi le christianisme (ou, en l’occurrence, les christianismes) se caractérise par une telle mutabilité et offre pendant plus de dix siècles matière à réflexions érudites sans montrer le moindre signe d’épuisement dans l’histoire des idées. Le processus d’unification du Christianisme en Église ne s’est pas fait avant que ne s’impose une volonté politique implacable :
« Au fur et à mesure que l’on imagine le développement du christianisme (ou des christianismes) dans les trois premiers siècles, il nous faut éclaircir deux points. Premièrement, les chrétiens avaient entre eux des différences notables, et n’étaient d’accord sur presque rien. Bien que d’aucuns aient tenté de contrôler cette diversité, de l’homogénéiser et de l’uniformiser, cette tentative se solda par un échec. Puis, au début du IVe siècle, Constantin devint le premier empereur romain à non seulement tolérer le christianisme, mais à le soutenir ouvertement. À partir de là, l’idée d’une seule Église « orthodoxe » pour les chrétiens du monde entier prit rapidement corps. Les groupes chrétiens hétérogènes de la période primitive avaient souvent essayé de s’organiser pour unifier le christianisme autour du bassin méditerranéen. À partir du IVe siècle, évêques et empereurs firent des progrès significatifs dans l’établissement d’une Église unique, même si quelques résistances perduraient. »[5]
L’organisation administrative centralisante de l’Empire Romain n’est probablement pas étrangère à la réussite, tardive, de la concentration de toute la pluralité chrétienne en un seule perspective désormais unifiante[6]. Cela étant, cette redéfinition de l’historicité du phénomène religieux que l’on rassemble traditionnellement sous le titre du christianisme primitif ne vise pas simplement à un soucis méthodologique en histoire des religions : il permet de concevoir la nature d’un phénomène tel qu’il s’est pensé lorsqu’il s’est pensé. La mystification des communautés gnostiques, opérée par la tradition irénéenne puisque les gnostiques sont les premiers chrétiens, en somme, à être excommuniés, se critique jusque dans l’usage du terme scientifique qui les regroupe. C’est parfaitement à dessein si nous n’avons pas utilisé une seule fois le terme de « gnosticisme »[7]. Et pour cause puisque, comme l’écrit dit David Brakke, il s’agit d’une construction terminologique qui nomme une identité incertaine et indéfinie :
« Le « gnosticisme » nous donne un superbe exemple de catégorie inventée par les spécialistes qui, faute d’avoir été clarifiée, a perdu son utilité et doit être abandonnée ou révisée. On l’a vu, le terme est un héritage d’Irénée. Celui-ci en affublait tous les groupes de chrétien qui lui déplaisaient : ils incarnaient la fausse gnōsis enseignée par Simon le magicien. Mais même Irénée reconnaissait que ces diverses communautés n’étaient pas unifiées, et qu’elles avaient de profonds désaccords. Il en concluait qu’aucune d’elles ne pouvait détenir la vérité de la foi chrétienne. Ses descriptions, pour polémiques et partiales qu’elles soient, tracent des délimitations claires entre les différents maîtres, écoles et doctrines : Irénée nous fournit à son insu des renseignements sur la grande pluralité du christianisme de son époque. »[8]
Ainsi Irénée se fait-il source directe de la stratification littéraire et idéologique de son époque en témoignant, par sa volonté de les éteindre, les nombreux éclairages chrétiens autres pourtant possibles dans le feu du christianisme. Dès lors l’époque d’Irénée et des gnostiques nous semble-t-elle une époque obsédée par l’ascension spirituelle de la connaissance pour atteindre la vérité, et le néoplatonisme, la gnose, le christianisme « proto-orthodoxe » et probablement d’autres écoles inconnues de nous manifestent tous le même engouement pour la quête d’une vérité dissimulée, d’une réalité derrière le monde. Nous pourrions presque y voir un tournant téléologique majeur : le messianisme monothéiste du christianisme aurait répondu en ce sens à une nouvelle préoccupation essentielle, débordant la métaphysique hellénistique par la question du télos, du sens de l’être. Toutes ces voies, toutes ces méthodes, d’Irénée aux gnostiques, pourraient se réunir sous une même catégorie : la raison spéculative. Et la détermination de l’évêque de Gaule ne nous renseignerait pas tant sur les gnostiques que sur sa propre conception de l’accès à cette lumière divine. Quoi qu’il en fût, l’immense historiographie du « gnosticisme », présentée par l’auteur dans les pages suivantes (pp. 38-46) a montré que le commentaire universitaire pouvait constituer de toute pièce une homogénéité à partir de fragments épars.
Hérésiologue mais témoin de son temps…
Cela étant et pour tout militant qu’il fût, et quoiqu’il faille tempérer son ardeur polémique, Irénée demeure un matériau essentiel pour l’histoire du christianisme.
« Car si Irénée voulait persuader ses lecteurs de la justesse de ses attaques contre les autres formes de christianisme, ses descriptions ne pouvaient pas complètement déformer la situation que ses contemporains avaient sous les yeux. Il est donc probable que les personnes et les textes mentionnés par Irénée aient réellement existé, et que les mythes qu’il résume (et moque) aient réellement circulé, même s’il a altéré les doctrines et pratiques que ses rivaux en tiraient. Irénée est le seul auteur du IIe à fournir un compte rendu détaillé de la pluralité religieuse de son temps. Pour reconstituer cette diversité, il faut donc récolter les informations utiles chez Irénée, en séparant le bon grain de l’ivraie. »[9]
Alors le travail critique de l’historiographe commence. Les pages suivantes (pp. 50 à 55) se concentrent sur une étude terminologique des « gnōstikos » qui est un terme dont l’auteur attribue la paternité à l’évêque, s’agissant d’individus. On y croise la figure de Clément d’Alexandrie, « sage chrétien » (p. 51) qui n’appartient à aucun clergé et dispense son enseignement à qui le recherche, tout à fait sur le modèle de l’Académie platonicienne — notons toutefois que ce « sage chrétien » est admis parmi le cercle très sélect des premiers Pères de l’Église. On y apprend également que les gnostiques avaient de nombreuses écoles dont certaines, seulement (comme celle des « gnostiques sethins », p. 49) sont parvenues jusqu’à nous, mais toutes, combattues comme une seule par Irénée se sont fondues en une seule et unique doctrine. L’auteur s’intéresse ensuite doublement aux textes d’Irénée (pp. 55 à 70) : en tant que sources mais aussi comme supports d’analyses de l’historiographie du terme. L’auteur propose une analyse entre les deux traditions pré-existantes et donne aux gnostiques ainsi qu’à Irénée une part équivalente de crédit :
« Un grand nombre de spécialistes reconnaissent une valeur de preuve à cet ensemble de textes c’est ensemble de textes et de témoignages, démontrant une tradition religieuse antique qu’ils ont appelé « séthianisme ». D’autres cependant penchent plutôt en faveur de notre thèse : appeler « gnostiques » uniquement la tradition et les textes décrits plus haut, à l’exclusion des autres. […] Notre approche a le mérite de faire une place à ce qu’Irénée et ses collègues admettent, en dépit des déformations volontairement polémiques : il y avait réellement des gnostiques, mais il ne suffisait pas de croire en un démiurge inférieur, en un désastre cosmique causé par Sagesse ou d’offrir la gnōsis du Dieu suprême, pour en faire partie. »[10]
Car, au fond, il est question d’actualiser cette identité des gnostiques et, comme souvent, il semble bien que ce soit plus facile de l’envisager par une juste insertion dans les mécanismes et préoccupations propres à leur époque. Communautés en quête du savoir, « la gnōsis du Dieu suprême », comme Irénée lui-même, le matériau mythologique et mystique brassé donne le vertige par sa richesse et la superposition des inspirations variées :
« Le mythe gnostique était une tentative audacieuse d’expliquer l’origine et le devenir de l’univers, mais aussi de prêcher le salut de l’homme, à travers un mélange d’Écriture juives, de spéculations mythologiques platoniciennes et, semble-t-il, de méditation révélant la structure de la psyché humaine. La complexité extrême voire excessive des différentes versions du mythe frappe le lecteur moderne. Les personnages divins importants ont des noms étranges (Barbélo, Eleleth, Ephesekh…) et sont tous apparentés de manière obscure. Les écrits gnostiques sont truffés de termes hautement philosophiques — de jargon, en réalité. Pour comprendre ce que ces textes entraînaient comme devoir religieux, et voir ce que l’école gnostique avait d’attractif parmi une foule d’autres options, il faut trouver le messager de salut que le mythe cherche à transmettre. »[11]
Les gnostiques sont donc caractérisés par un rassemblement autour d’une méthode littéraire et spéculative, et par des préoccupations téléologiques qui paraissent nouvelles. Pour autant et quoique la classification des gnostiques dans la chrétienté pourrait être à ce titre regardée avec suspicion, la Bible[12] était absolument centrale pour eux, et leur quête de cette « gnōsis du Dieu suprême » était tout à fait conforme aux paradigmes plutôt inclusifs (au début du moins ) de la Révélation.
« Bien que la littérature gnostique qui nous reste soit majoritairement mythologique et pseudépigraphique, ne laissant que peu de place à des références explicites à des personnes ou événements contemporains, elle expose plusieurs stratégies grâce auxquelles les gnostiques se distinguaient des autres groupes s’appuyant eux aussi sur la tradition biblique. Puisque les gnostiques différaient de leurs concurrents sur la manière de s’approprier le récit biblique après l’événement christique, la plupart de leurs méthodes étaient centrées sur leur interprétation de la Bible. Les gnostiques affirmaient l’autorité de leurs lectures en faisant appel aux sources de révélation divine. […] À la façon des autres apocalypses juives de la période, la révélation est supposée avoir été écrite et préservée dans le secret jusqu’à ce moment eschatologique crucial. Dans ces écrits, aucun maître gnostique contemporain ne dit explicitement son autorité interprétative ou sa supériorité dans l’exégèse biblique : ils sont vrais parce qu’un être divin ou divinement inspiré du passé a parlé ainsi. »[13]
Autrement dit les gnostiques justifiaient un certain éclairage de la Bible dans les travers de textes presque ésotériques et jargonnants issus d’une certaine philosophie de la connaissance. Peut-être comprendrions-nous mieux, à l’aulne d’une telle pratique, pourquoi ou comment ces communautés de gnostiques ont pu passer pour une autre « religion », même, que le christianisme, et ce en toute indépendance des cris d’Irénée. Ni tout à fait une philosophie, ni tout à fait une religion, et si nous nous permettions quelque analogie sur la méthode (mais non sur la visée), cela pourrait nous rappeler la mythodynamie protéïforme de la franc-maçonnerie, par exemple. Nous pourrions aussi nous rapprocher des cultes à mystères pour tenter de saisir les singularités formelles et structurelles des communautés gnostiques[14].
Un proto-chrisitanisme ou un post-judaïsme ?
Il est du reste assez remarquable que les paroles gnostiques, notamment sur le plan de l’accès à la révélation divine, ne se mettent jamais en concurrence les unes avec les autres. Il n’est pas question de détenir la vérité, l’unique « gnōsis du Dieu suprême » : de même que dans la tradition de l’apocalyptique juive, c’est un foisonnement d’adhésion de fond qui travaille vers Dieu, non une centralisation par la forme (liturgique) comme va s’employer à la construire l’Église des évêques (les évêques sont les dépositaires de l’autorité des apôtres, et le pape est leur chef, comme Simon-Pierre était celui des apôtres). En somme au travers de la confrontation (perdue d’avance) qui opposait les communautés gnostiques aux évêques, c’est la lutte entre deux approches fondamentales du phénomène religieux qui se rejoue : d’une part la pluralité libre et foisonnante par le biais des intermédiaires charismatiques, les prophètes, d’autre part l’unité centralisante et catalysante par le biais d’une Église unique.
« Les gnostiques présentaient alors leurs interprétations de la Bible non pas comme leurs interprétations, mais comme les révélations faites par Ada, Seth, Paul ou le Christ en personne. »[15]
Les gnostiques, en somme, pratiquaient un christianise prophétique non canonique et non figé, et nous pouvons y trouver une sorte de transposition de l’apocalyptique juive dans le « paysage mythique », si l’on osait, propre au christianisme. La prépondérance de la dimension eschatologique rappelle la littérature de l’apocalyptique juive très vigoureuse sous sa forme monothéiste depuis le deuxième siècle avant notre ère, de même que l’accès répété à la parole divine par des hommes d’ordre charismatique. On retrouve même la tradition pratiquement tribale du judaïsme et de l’élection dans la posture gnostique :
« Ce faisant, les gnostiques utilisent un vocabulaire de la race et de la parenté pour tracer leurs contours et ceux des autres groupes. Comme on l’a vu, le nom exact de la secte était « l’école de la pensée gnostique » (gnōstikē hairesis), une auto-désignation élogieuse qui lui attribuait le pouvoir de fournir la « connaissance » (gnōsis). D’autres communautés se nommaient « hairesis », « école de pensée » : les disciples de l’école médicale associée à Hérophile s’appelaient « la hairesis d’Hérophile », et l’auteur juif Josèphe disait suivre « la hairesis des Pharisiens ». Mais les termes élogieux d’autopromotion des gnostiques appartenaient au champ lexical racial ou ethnique : « la race immuable », « la descendance de Seth », « ces Hommes-là ». »[16]
L’identité de la littérature gnostique appartient donc assez explicitement à un tiers-lieu, entre le judaïsme hellénisé et la christianisme naissant, mais il se déploie absolument sur le monothéisme issu de la révélation christique. En d’autres termes et s’il paraît difficile d’isoler une pensée des gnostiques, on peut saisir la quantité de chaque source dans la pluralité des influences, comme des couleurs dans un mélange. Or l’Évangile de Judas, qui n’est peut-être que la seule trace parmi d’autres allant en ce sens qui nous soit parvenue, établit une hiérarchie et s’oppose délibérément à l’interprétation des autres chrétiens. On y trouve donc même une volonté de centralisation semblable à celle qu’exprime Irénée dans son livre contre les hérésies.
« L’Évangile de Judas se démarque des autres œuvres restantes des gnostiques parce que son récit s’inscrit non pas dans les premiers temps d’Adam, Ève et Noé, mais sous le ministère de Jésus, et qu’il condamne les autres chrétiens avec autant de véhémence qu’Irénée ou n’importe quel hésiologue. Bien que l’apôtre Judas soit loin d’être parfait et semble destiné à jouer un rôle essentiel mais très négatif dans le théâtre du salut, il n’en demeure pas moins qu’il est le seul parmi les disciples de Jésus-Christ à connaître sa véritable origine (en Barbélo) et qu’il reçoit de lui la révélation sur Dieu, la création et l’avenir. Les autres disciples célèbrent inconsciemment l’Eucharistie en l’honneur de leur faux Dieu, et le Christ les accuse d’écarter les gens du droit chemin, en les menant non à la gnōsis et à la vie mais à l’ignorance et à la mort. […]
Les auteurs gnostiques savaient donc parfaitement que d’autres qu’eux croyaient en Jésus, et qu’ils avaient un autre point de vue. En réponse, ils présentaient leurs idées comme étant les interprétations correctes des Écritures juives, que des figures d’autorité divine leur avaient révélées. Les gnostiques s’identifiaient à Seth, le troisième fils d’Adam et Ève, et se servaient du récit de la Genèse pour se proclamer seuls possesseurs de la véritable gnōsis de Dieu : ils étaient la descendance de Seth et la race immuable. »
Véritables détenteurs de la foi en Dieu, ou seuls détenteurs de la véritable gnōsis de Dieu, même contre le judaïsme, les gnostiques se caractérisaient par un noyau rituel assez homogène[17] dont l’origine « sociologique » précède probablement la révélation christique. Les gnostiques sont peut-être le signe de la nécessité d’une réactualisation téléologique, tirant déjà le bilan des limites du judaïsme vis-à-vis de la portée messianique des besoins eschatologiques ; autrement dit, la promesse du salut, de la finalité spirituelle du monothéisme.
« De nombreux chercheurs pensent aujourd’hui que le mythe gnostique a émergé chez des juifs insatisfaits de leur religion et enclins à la philosophie, avant même l’arrivée de Jésus-Christ ou du christianisme. Ce n’est que plus tard que les gnostiques ont rajouté des éléments chrétiens (dont le Christ) à leurs croyances. Il faut être précis si on veut établir ce qu’implique l’hypothèse d’une origine juive du « gnosticisme ». Évidemment, tous les groupes chrétiens ont débuté parmi les Juifs : Jésus-Christ était juif, comme tous ses disciples, et la proclamation d’un messie, du fils du Dieu d’Israël, n’a de sens que pour les Juifs. […] Les tenants de cette théorie défendent que les Juifs auraient posé les bases du mythe gnostique avant d’avoir entendu parler du Christ, bien que cela ait pu se dérouler après la mort de celui-ci et l’émergence de la foi. Le mythe, selon cette version, était un développement du judaïsme sans lien avec la proclamation du Christ sauveur ; les gnostiques y ont inclus des références à ce dernier à mesure de leurs interactions avec les chrétiens. »[18]
Cela nous renseigne aussi sur le formidable essor du christianisme, son incontestable succès idéologique dans les communautés intellectuelles du bassin méditerranéen : nous dirions aujourd’hui que le besoin était latent, et que la forme du christianisme n’a pu prendre corps que dans la préexistence de ce besoin. Ainsi, peut-être, pourrait-on envisager que le mythe gnostique n’animait pas le christianisme primitif mais un foyer primitif du christianisme, et nous disposerions d’une réactualisation importante de l’identité des communautés qui le pratiquaient, les gnostiques.
Le potentiel « des » formes ecclesiastiques
David Brakke nous invite d’ailleurs dans son avant-dernier chapitre à faire une étude de la pluralité des lectures du christianisme à partir de « trois chrétiens importants de Rome, qui n’étaient pas d’accord avec les autres à propos de la signification à accorder à la foi nouvelle et qui avaient entendu parler de l’enseignement des gnostiques : Marcion[19], Valentin[20] et Justin[21]. »[22] Il convient peut-être d’indiquer que Marcion fut lourdement combattu par Tertullien (lu avec les Pères de l’Église, bien qu’il n’en soit pas lui-même puisque non canonisé par l’Église), le même Tertullien qui combat tout aussi farouchement Valentin. Quant à Justin, il s’agit d’un martyr chrétien encore célébré le 1er juin de chaque année. La postérité des interprétations du mythe gnostique est donc vaste — le marcionisme ne s’éteint définitivement qu’au Ve siècle en Orient. Les « stratégies de différenciation »[23] des différents auteurs principaux analysées par David Brakke montrent également, à l’intérieur de la chrétienté et indépendamment des gnostiques, une volonté de faire école qui influencera grandement l’histoire de la « Grande Église », celle qui connaîtra une histoire tellement essentielle pour tout le devenir de l’Europe médiévale. « L’école valentinienne, tenante d’une tradition apostolique »[24] cherchait par exemple à reproduire la logique de la diffusion de la parole chrétienne sur le modèle de l’enseignement ou transmission apostolique :
« Les maîtres de l’école présentaient leurs idées comme la seule interprétation correcte des écritures et des credos chrétiens, et se revendiquaient d’une autorité apostolique. Comme les gnostiques et de nombreuses autres écoles de pensée de l’Antiquité, la communauté valentinienne voulait aider ses fidèles à progresser dans la connaissance et la vertu, c’est-à-dire leur enseigner un mode de vie qui les mènerait au salut. »[25]
Peut-être beaucoup plus politique que celui dont il prend la succession dialectique directe, Justin le Martyr (connu aussi sous le nom de Justin de Naplouse), Irénée de Lyon entame une perspective centralisante[26], revendiquant aux évêques un rôle aussi central et essentiel que l’était celui des apôtres lors de la diffusion de la parole du Christ — un rôle pratiquement aussi fondateur que celui de la bonne nouvelle des Évangiles. Rappelons qu’alors le canon évangélique pouvait être officieusement assez stable mais encore sans établissement définitif. Clément d’Alexandrie[27] pourrait sembler mélanger la posture d’Irénée avec celle des valentiniens (quand, pourtant, la conception du premier s’oppose explicitement à celle des seconds) :
« À Alexandrie, Clément et Origène ressemblaient à des maîtres valentiniens : ils offraient à de petits groupes d’étudiants l’opportunité de progresser dans la spiritualité par l’étude des écritures et doctrines chrétiennes. Cependant, chacun s’efforçait de se démarquer de ses rivaux et de revendiquer quelque relation aux réseaux d’évêchés émergeants. Clément, par exemple, avait deux principaux points d’attaque. En premier lieu, il donnait sa « gnōsis domestiquée » (les termes ne sont pas de lui) pour plus fidèle à la doctrine chrétienne d’origine que celle que proposaient les maîtres gnostiques ou valentiniens, qu’il appelait hérétiques. En second lieu, il défendait sa philosophie spéculative et revendiquait la formation de vrais « gnostiques », contre ds chrétiens décrits comme « ceux que l’on nomme orthodoxes » et qui insistent sur la seule foi. »[28]
En somme l’organisation de ce rapport à la gnōsis rappelle à bien des égards les écoles athéniennes de philosophie. Que l’on songe seulement aux oppositions dialectiques entre l’école d’Aristote et l’Académie, l’école de son maître Platon, pour vérifier comme les constructions sont encore très semblables, un demi millénaire après. La stratification idéologique ne va pas sans une accumulation des dissensions dialectiques qui prennent forme dans les variations interprétatives à partir d’un texte fondateur commun à tous — Aristote et Platon, par exemple, s’affrontent sur la possibilité d’une solution du poème de l’être de Parménide. Ce n’est qu’un parmi les nombreux exemples. Or en observant les comparaisons que propose David Brakke, force nous est donnée de constater comme les écoles des principaux auteurs de cette « early Christianity » sont autant de moteurs philosophiques directement dépendants du modèle des écoles grecques. Les structures de production de sens chrétiennes, au fond, polarisaient les mêmes intérêts politiques et la même quête vis-à-vis de la gnōsis que leurs prédécesseurs panhellénistiques attachés à l’étude de ce que nous appellerons sur le tard la métaphysique. Il n’est, semble-t-il avec David Brakke, question que d’un nouveau champ de spéculation téléologique, non d’une nouvelle forme de la pensée et tout le christianisme paraît en ce sens l’héritier direct de la tradition philosophique grecque.
La « lumière » de la connaissance
Le dernier des grands auteurs chrétiens avec lequel l’historien illustre ces stratégies de la différenciation est Origène[29]. Origène qui concilie manifestement les deux conceptions opposées animant les différentes stratégies pédagogiques des auteurs antérieurs. Brillant et très cultivé, Origène fréquente les salons de riches chrétiens et débat avec eux, qui sont essentiellement valentiniens, mais ne prie pas en leur compagnie. La théologie d’Origène est très proche de la théologie chrétienne qui a filtré jusqu’à nous — les ouvrages d’Origène paraissent en effet pour être fondamentaux dans la littérature chrétienne. Origène et Saint Augustin passent probablement pour les deux plus importants Pères de l’Église de cette étape du christianisme et ils sont parmi les auteurs chrétiens dont les ouvrages ont été les plus commentés et les plus influents dans la tradition chrétienne, jusqu’à nos jours. Origène fonde la forme de la structure de l’enseignement sur la logique de sa théologie et concilie synthèse et différenciation :
« Le mythe chrétien d’Origène, tout comme les mythes valentiniens et gnostique, relatait la chute d’un état originel d’unité spirituelle à un univers matériel, souillé par le mal, jusqu’au retour final de toute chose en Dieu. Cependant, Origène n’attribuait pas la création à un Dieu imparfait et plaçait le libre-arbitre au cœur de son récit. Tout comme ses rivaux gnostiques et valentiniens, il décrivait le Dieu suprême comme « incompréhensible » et « impossible [à] penser », « un être intellectuel [qui] existe d’un existence propre ». Ainsi, comme les gnostiques, Origène enseignait qu’ « il y [avait] une certaine parenté entre l’intelligence et Dieu, dont l’intelligence elle-même [était] une image intellectuelle, et que par là elle [pouvait] saisir quelque chose de la nature divine » (DP 1.1.5-7) Autrement dit, l’intelligence humaine est modelée sur celle de Dieu et l’on peut s’approcher de lui si l’on soumet son corps à la discipline et son esprit à l’étude. On connaît Dieu à travers son Fils, lee Verbe ou la Sagesse, dont la relation au Père se définit comme suit : « Il procède inséparablement de lui comme le rayonnement de la lumière. » »[30]
Il faut noter l’extrême fertilité de cette tradition métaphorique de la lumière/connaissance, et notamment chez l’auteur non chrétien Plotin, qui produit une magnifique métaphore du lien au divin par la lumière dans ses Ennéades[31] ; mais jusqu’à l’herméneutique de Gadamer au XXe siècle, élève de Heidegger, et un très grand nombre d’autres philosophiques dans l’intervalle et même depuis. Peut-être comprendra-t-on alors comment David Brakke écrivait dès son premier chapitre comme :
« […] Ces chercheurs […] veulent considérer le gnosticisme non comme une hérésie chrétienne, à l’instar d’Irénée, mais comme une religion ou une vision du monde pleine et entière. »[32]
En somme et après une telle lecture, si les communautés qui partageaient des interprétations du mythe gnostique et qui se différenciaient à la fois entre elles et vis-à-vis du reste des chrétiens ne paraissent pas pouvoir être assignables à la moindre identité, ni même à une simple définition (ou même des définitions), nous pouvons envisager l’incroyable richesse de cette tradition littéraire à la fois contemporaine de l’apocalyptique juive, du christianisme primitif — cette « early Christianity » —, des écoles philosophiques grecques plutôt tardives et d’une préoccupation actualisée pour un cheminement spéculatif d’un télos articulé en vue de la gnōsis. Si l’identité des gnostiques ne paraît finalement pas révélé ni « révélable » en tant qu’ils sont intrinsèquement lié à l’infinie multiplicité des possibilités de la forme monothéiste de l’eschatologie, il nous semble toutefois que l’on peut les rattacher à ce dont ils sont le phénomène le plus visible, le signe le plus exemplaire : le bouillonnement d’une activité sismique dans le paysage téléologique de l’Antiquité.
[1] — Disponible selon deux traditions éditoriales aux éditions du Cerf, soit dans la collection Sources chrétiennes en dix tomes, parus entre 1976 et 2006, ou dans la collection Sagesse chrétienne, 2001.
[2] — C’est l’expression d’Irénée pour caractériser l’effet de l’Évangile de Judas sur le christianisme, nous dit David Brakke, page 15. L’auteur nous renvoie en outre au texte qui accompagna la redécouverte de l’Évangile de Judas : « Christianity Turned on Its Head : The Alternative Vision of Gospel of Judas », 2006.
[3] — D. Brakke, Les Gnostiques – Mythe, rituel et diversité au temps du christianisme primitif, traduction par Marie Chuvin, éd. Les Belles Lettres, 2019, page 17.
[4] — Sous-titre que l’auteur déploie de la page 20 à la page 36 de son ouvrage.
[5] — Ibid., page 20.
[6] — Voir à ce sujet l’excellent livre de A. Piganiol, L’Empire Chrétien (325-395), éd. Presses Universitaires de France, 1973, Paris.
[7] — Du reste David Brakke en discute la pertinence, Le « gnosticisme » et ses limites, pp. 36-46.
[8] — page 36.
[9] — Ibid., page 48.
[10] — Ibid., page 70.
[11] — Ibid., page 73.
[12] — Aucune des théories sur le canon du Nouveau Testament, le rassemblement des corpus propres aux communautés chrétiennes, ne fait remonter sa fixation, même indirecte ou officieuse, avant le IIe siècle avant Jésus-Christ. Les textes, aussi nombreux que variés, des Évangiles mettaient tous les mêmes personnages en scène et l’on peut voir de ce qui suit que Paul y jouait déjà une place centrale, justifiant peut-être a priori la prépondérance de sa parole, puisque parmi les vingt-quatre « livres » du Nouveau Testament, treize sont imputés à la paternité de Paul.
[13] — Ibid., page 94.
[14] — Voir à ce sujet le livre de W. Burkert, Les Cultes à mystère dans l’Antiquité, traduit par A.-P. Segonds, éd. Les Belles Lettres, 2003, Paris.
[15] — Ibid., page 94.
[16] — Ibid., pages 95 et 96.
[17] — Les rituels : le baptême et l’ascension mystique, pp. 98-108.
[18] — Ibid., page 110.
[19] — Marcion : le problème des écritures et le rejet de la congrégation, pp. 124-128.
[20] — Valentin, entre adaptation du mythe gnostique et autorité personnelle, pp. 128-135.
[21] — Justin le Martyr : hérésiologie et rejet du mythe gnostique, pp. 135-143.
[22] — Ibid., page 124.
[23] — Titre du dernier chapitre, pp. 145-174.
[24] — Ibid., pp. 148-154.
[25] — Ibid., page 149.
[26] — Des évêques, des prêtres, mais non des maîtres : Irénée de Lyon (v. 155-v. 202), pp. 154-160.
[27] — Le maître est le vrai prêtre : Clément d’Alexandrie (vers 160-215), pp. 160-163.
[28] — Ibid., page 160.
[29] — Origène (v. 185-251), le prêtre et le maître, pp. 163-168.
[30] — Ibid., page 164.
[31] — À plusieurs reprises dans le cinquième tome de ses Ennéades, Plotin développe cette image de la lumière de la connaissance de Dieu, notamment en V, 3, mais aussi et surtout, pour la célèbre métaphore de la lune, du soleil et de la lumière, en V, 6, précisément page 116 pour l’édition Guillaume Budé, actualisée par E. Bréhier, 1967, Les Belles Lettres.
[32] — Ibid., page 19








