C : L’édition de la Pléiade
L’édition de la Pléiade mérite, quant à elle, une approche plus approfondie que celle du Cerf car les ambitions diffèrent sensiblement bien que, là aussi, ce soit bien la reprise d’une traduction déjà existante – quoique remaniée – qui constitue la trame de cette nouvelle édition.
1°) Le reflux des Œuvres complètes
Il convient d’abord et avant tout de remarquer que cette nouvelle édition rompt avec l’idée de publier les Œuvres complètes de Dante, l’édition de Pézard étant toujours disponible et n’étant donc pas au sens propre remplacée par ce nouveau volume. Carlo Ossola, maître d’œuvre de la nouvelle édition, reconnaît volontiers cet état de fait en rappelant que l’édition bilingue « de la Divine Comédie vient compléter, en l’année du septième centenaire de la mort de Dante, 1321-2021, l’excellent opus vitae d’André Pézard, paru dans cette même collection lors du centenaire précédent, celui de la naissance du poète en 1265 : Dante, Œuvres complètes, traduction et commentaires par André Pézard, 1965[1]. »

A cet égard, il ne s’agit pas de mettre fin au travail gigantesque mené par A. Pézard, ni même de concurrencer l’édition des Œuvres complètes parue chez LGF en Pochothèque mais d’offrir à la fois une édition du texte italien issue des travaux de Giorgio Petrocchi, auprès duquel avait travaillé Jacqueline Risset, et en même temps l’ultime version de la traduction de cette dernière, le tout agrémenté de notes polyphoniques visant à éclairer le sens du Poème.
Une telle démarche appelle plusieurs remarques : contrairement à certains traducteurs, parfois sévères avec Pézard, l’équipe réunie pour cette nouvelle édition rend hommage à son opiniâtre devancier et ne prétend nullement rompre avec lui. Tout autre est l’ambition de René de Ceccatty qui réduit l’entreprise de Pézard à « des souvenirs composites de langue vieillie (qui, en français, va de Villon et Eustache Deschamps à Montaigne en passant par Rabelais), ce qui donne une langue ampoulée et amphigourique, d’un style néoclassique qui triompha au XIXème et au XXè siècle chez certains romanciers populaires, chez les poètes officiels, chez les librettistes d’opéras et chez les peintres pompiers sollicités par les institutions, recréant un Moyen Âge grisâtre, poussiéreux et de pacotille[2] ». Certes, la langue de Pézard ajoute à la difficulté intrinsèque de la Commedia l’archaïsme des termes retenus, mais on peut fort bien estimer qu’une traduction ait pour tâche de rendre une langue d’époque et non d’actualiser un texte en vue de le rendre disponible pour les temps présents, l’entreprise de traduction n’étant pas réductible à une mise aux normes présentiste.
Mais il faut également remarquer qu’en choisissant de n’éditer « que » la Commedia, la Pléiade exclut le Banquet dont tout le monde s’accorde à dire qu’il constitue un principe d’intelligibilité du Poème, mais aussi le fameux De Vulgari eloquentia qui justifie l’usage d’une langue vernaculaire pour sa rédaction et qui « laïcise » si l’on peut dire la langue du sacré. Quant au De Monarchia, il permet de comprendre les positions politiques de Dante mais aussi l’étendue de l’usage des syllogismes, chers à la scolastique, dans un domaine qui, de prime abord, leur est étranger. Cette série d’absences pose de sérieuses difficultés car, de toute évidence, l’intelligibilité de la Commedia ne saurait être tout entière contenue dans le seul texte de cette dernière ; à cet égard, en dépit du système de notes très abouti, on peut regretter que ne soient pas édités avec elle au moins les trois traités mentionnés qui permettraient de se référer à nombre de leurs passages pour comprendre bien des allusions. A cela s’ajoutent les lettres, dont Ruedi Imbach, par exemple, tire le plus grand profit, notamment à partir de la lettre XIII dont il rappelle qu’elle constitue une « sorte de préface-introduction à la Comédie[3]. »
Là se dévoilent deux aspects de cette édition. Le premier, immanent à l’évolution de la Pléiade elle-même, et fort bien relevé par Marc Lebiez dans sa recension pour En attendant Nadeau, témoigne du reflux des œuvres complètes dans l’illustre collection ; de plus en plus focalisée sur les œuvres majeures, elle tend à laisser de côté les minores et à mettre fin à ce qui fut, plusieurs décennies durant, son ambition. Ce choix, qui peut se défendre, soulève de nombreuses questions aussi bien pour les œuvres littéraires que philosophiques, et l’on se rappelle que les Œuvres de Nietzsche avaient pris le parti de ne pas y inclure les Fragments posthumes, si ce n’est par petits extraits en notes, et donc de ne pas intégrer l’élément textuel qui, depuis au moins trois décennies, a profondément affiné les lectures de Nietzsche. Cela amène à questionner un deuxième aspect, à savoir celui du lectorat. En effet, cette nouvelle édition en Pléiade a quelque chose de profondément hybride. D’un côté, par l’érudition des notes, l’exigence bilingue, et encore le choix d’un texte italien particulièrement fiable, le travail se veut scientifique et s’adresse donc aux chercheurs afin de leur procurer un outil extrêmement abouti. Mais, de l’autre, l’absence des traités philosophiques de Dante, la reproduction d’extraits de commentaires marquants (depuis Ezra Pound et Claudel jusqu’à Bonnefoy et Jabès, en passant par Sollers), semble viser le grand public cultivé en mettant à sa disposition quelques passages célèbres, et non plus le chercheur ou le spécialiste érudit, ce que confirme du reste la reprise de la traduction de Jacqueline Risset qui, aussi excellente fût-elle, est déjà détenue par tous les connaisseurs de Dante. De surcroît, l’absence plus que surprenante d’index semble parachever la volonté de ne pas s’adresser aux connaisseurs ni aux chercheurs.
Posons également une question : que les extraits de commentaires de Borges, Sollers, Montale, Pasolini, etc., présentent un intérêt, c’est certain, bien que lesdits extraits soient déjà très célèbres ; mais, quitte à ne proposer une édition « que » de la Commedia, pourquoi ne pas reproduire des passages entiers des maîtres auxquels se réfère Dante ? Pourquoi ne pas reproduire des passages significatifs de Thomas d’Aquin, de Saint Bonaventure, d’Aristote, de Virgile, d’Al-Farabi, d’Avicenne (la note 15 du chant II du Paradis est paradigmatique : d’une densité conceptuelle farouche, elle ne saurait être comprise que d’un spécialiste de la cosmologie médiévale, et l’absence de reproduction des sources auxquelles se réfère Dante rend en partie inintelligible la note, y compris pour l’ « honnête homme ») ou encore des commentaires aussi essentiels que ceux de Landino ? Quitte à sortir du texte même, pourquoi privilégier à ce point le commentaire contemporain et non les sources ou les commentaires renaissants ? D’où vient ce privilège qui présente un caractère arbitraire et qui, quant à ce qui est déjà facile d’accès, n’ajoute rien ? En revanche, une traduction inédite de larges pans du commentaire de Landino ne serait pas inutile et permettrait de saisir ce que peut être une approche néoplatonicienne du texte, bien que certaines phrases de celui-ci (par exemple la note 47 du chant XXVII du Purgatoire) puissent être citées en vue d’éclairer le texte.
Ajoutons un dernier élément ; parmi les ouvrages – somme toute peu nombreux – consacrés à Dante en langue française, celui de Jacqueline Risset[4], au demeurant excellent, navigue dans l’œuvre complète et convoque aussi bien la Vita nuova que les Rime ou le De Monarchia. Or, comment s’ouvre ce livre ? Il s’ouvre par la notion d’énigme et par l’idée que seul un parcours général des écrits de Dante permet de naviguer au sein de cette énigme ou de ce « secret ». Se demandant donc comment lire Dante, J. Risset répond en ces termes :
« chercher dans l’écrit de Dante la naissance de la forme, la naissance de la pensée, c’est peut-être la seule façon d’approcher une démarche qui est surgissement perpétuel, et de se garder de l’enfermer dans l’espace clos du système qu’elle désigne pourtant, mais transgresse et transcende par un mouvement interrogatif qui est peut-être sa part la plus essentielle, rouvrant et présentant ainsi continuellement l’énigme là où semblait se présenter la clef[5]. »
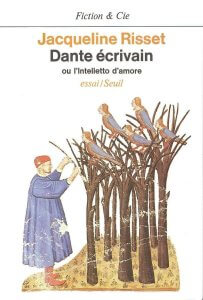
Il n’est donc pas certain que J. Risset elle-même, bien qu’elle eût traduit en priorité la Commedia, eût jugé bon de n’éditer dans un volume de Pléiade que le Poème, tant le mouvement immanent de l’écriture de Dante – de toute l’écriture de Dante – doit être convoqué pour percer le secret qu’il semble y avoir introduit. J. Risset avait d’ailleurs traduit les Rime.
2°) Les principes de l’édition du texte
Deux éléments concourent à assurer l’intérêt de cette nouvelle édition, à savoir l’extrême soin apporté à l’édition des textes italien et français, mais aussi la qualité des notes qui, à la différence de l’édition de Pézard, se trouvent à la fin et non sous le texte. A cet égard, Carlo Ossola, maître d’œuvre de l’édition, ainsi que Luca Fiorentini, dressent en quelques pages l’importance du travail de Giorgio Petrocchi tout en rappelant le problème que constitue l’absence de tout manuscrit autographe de Dante, et ce pour quelque texte que ce soit. Par conséquent, « l’édition de ses textes appartient à la branche de la philologie dont l’objet consiste à reconstituer un original perdu. Transmis par plus de huit cents manuscrits, les uns complets, les autres partiels, le poème de Dante a donné à vie à une tradition textuelle parmi les plus riches et les plus complexes de l’histoire littéraire romane[6]. » Retraçant à grands traits l’histoire de la transmission de la Commedia et de sa reconstitution, L. Fiorentini rappelle les altérations inévitables que subit le texte à travers les copistes et résume la situation du XIVè siècle en ces termes :
« Celle-ci se caractérise – en premier lieu – par une contamination primitive entre des traditions différentes, dont la plus ancienne concerne la transmission indépendante des deux premiers cantiques et la plus récente, l’intégralité de l’œuvre ; en second lieu, par la prévalence sur l’habituelle « transmission ‘verticale’’ » (la réalisation d’une ou de plusieurs copies à partir d’un modèle unique), de l’ « exigence ‘’horizontale’’ de la recherche d’exemplaires plus fiables de la corrélation, à partir de ces exemplaires du texte copié ». En d’autres termes, la traduction manuscrite du poème ne respecte guère le premier présupposé de la Textkritik de Paul Maas : « aucun copiste ne doit mêler plusieurs sources en les contaminant »[7]. »
On comprend que, de cette incertitude quant au matériau textuel, découle l’importance du remarquable travail de Petrocchi dont, là encore, les décisions sont clairement restituées par L. Fiorentini :
« L’entreprise de Petrocchi a déterminé un progrès fondamental, non seulement pour la constitution du texte de la Comédie, mais aussi pour la rationalisation de sa tradition manuscrite. Petrocchi procéda en premier lieu à la réduction du nombre de témoins manuscrits à prendre en considération, en recourant à un critère qui n’était pas géographique (…) mais chronologique : la reconstruction du texte se fonda ainsi sur vingt-sept manuscrits antérieurs à 1355. Faisant office de seuil, cette date n’a rien de fortuit : cette année-là, Boccace acheva la transcription de la première de ses trois copies de la Comédie, transmise par l’actuel manuscrit Zalada 104.6 de Tolède ; l’activité de Boccace copiste et éditeur de Dante donna vie à une « nouvelle vulgate » du poème dans laquelle il n’était plus possible, selon l’opinion de Petrocchi, d’identifier des rapports de filiation entre les manuscrits, alors que cela restait permis pour les textes relevant de la phase la plus ancienne de la tradition[8]. »
Le texte italien reprend donc ici la version établie par G. Petrocchi, avec une seule dérogation au chant XXVI du Paradis pour le vers 104, tout en signalant dans les notes et non dans le corps de textes les variantes de la célèbre édition d’Inglese, puis d’Antonio Lanza et Federico Sanguineti. « Le cadre de la réflexion philologique autour du poème de Dante offert au lecteur est, donc, le plus à jour possible[9]. » C’est précisément cela qui contribue à la valeur de l’édition, cette forme de version ultime – pour le moment – du texte italien, tenant compte de toutes les nuances et variantes, dont il faut toutefois préciser qu’elles sont présentes en tout petit nombre.
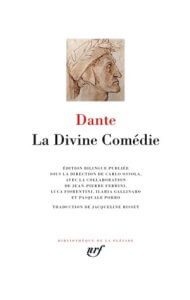
Quant à la traduction, il s’agit de celle bien connue de J. Risset établie à partir des éditions de Petrocchi. Ses mérites ont été amplement établis, et chacun connaît quels en sont les principes directeurs : un vers libre quoique mesuré et collant au rythme italien, une langue simple et globalement actuelle – à la différence de Pézard – mais aussi une connaissance des enjeux conceptuels et théologiques du texte dont témoigne son Dante écrivain déjà évoqué. Dans ce dernier, elle consacrait d’ailleurs un chapitre à l’activité de traduction et notait les spécificités de l’écriture de Dante – on sait combien dans le sillage de Sollers était essentielle cette question de l’écriture finissant par l’emporter sur la figure du poète : rappelant que tout le texte est organisé sur un modèle de strophe en tierce rime – trois vers dont le premier rime avec le troisième, le deuxième avec le premier de la strophe suivante –, elle en scrutait les effets paradoxaux : il donne d’abord l’impression d’un « mouvement rapide en renouvellement continu, renforcé par l’action du rythme propre du grand poème : rythme régulier de l’endécasyllabe, fortement scandé par la rime, marque claire – si clairement portée qu’elle semble chaque fois se constituer comme une sorte de « preuve de vérité » du discours dans lequel elle s’inscrit (…)[10]. » Mais à peine l’avait-elle noté qu’elle ajoutait les nombreuses surprises inscrites à même le texte : des haltes inattendues, des accélérations brutales, « où la structure métrique semble par moments se dissoudre et laisser la place à un mètre nouveau, heurté, absolument irrégulier et rigoureusement inclassable[11]. » Revenant à son activité propre de traductrice et non de lectrice, elle constatait dès lors l’espèce d’autonomisation de la traduction à l’endroit de sa propre activité :
« L’expérience surprenante qui attend le traducteur ainsi disposé, en face de cette poésie « intraduisible », est celle-ci : que de temps en temps elle semble « se traduire d’elle-même » : certaines ouvertures de poème, dans les Rimes en particulier, se transposent immédiatement en vers français[12]. »
Donnant à la rime non pas le rôle d’un écho sonore mais bien celui d’un moteur, elle avait attribué au Poème une vitalité qu’on ne lui connaissait pas encore en français.
Ainsi, l’association au texte de Petrocchi de la traduction de celle qui lui fut si proche paraît naturelle et justifiée, en dépit du fait que l’édition en GF contenait déjà ces deux versions, J. Risset remerciant en préface celui-ci « pour la générosité irremplaçable et pour l’attention efficace avec lesquelles il a suivi ce travail de traduction[13]. »
3°) Le système de notes
Au regard de l’édition bilingue de J. Risset parue chez Flammarion, la Pléiade ajoute une série de notes bien plus détaillées que celles de la traductrice, qui s’était contenté de précisions et d’explications, mais pas de présentation générale de chaque chant ni de références érudites permettant de situer à chaque fois les sources du texte.
Là, pas moins de cinq chercheurs ont été réunis pour annoter richement le Poème et lui conférer ainsi un apparat critique comparable à celui des éditions italiennes. De profils variés, les chercheurs retenus couvrent un vaste domaine, depuis la philosophie avec Pasquale Porro jusqu’à la tradition des commentaires de Dante avec Luca Fiorentini en passant par le professeur au Collège de France, Carlo Ossola ou encore Jean-Pierre Ferrini, élève de Jacqueline Risset.
Chose particulièrement significative est le partage des notes entre chaque auteur : si Luca Fiorentini s’est chargé de l’essentiel de l’Enfer, Carlo Ossola a annoté pour l’essentiel le Purgatoire – nous reviendrons sur ce choix – et la moitié du Paradis, tandis que Pasquale Porro s’est occupé de l’autre moitié du Paradis.
Formant un bloc d’environ cinq cents pages, les notes occupent plus d’un tiers du volume de Pléiade, et représentent un peu moins des deux tiers de l’entièreté de la Commedia. Cela revient à dire que, pour une édition unilingue, il y aurait plus de textes en notes que pour le texte original. Très riches et particulièrement utiles, elles offrent plusieurs vertus : outre les variantes déjà mentionnées, elles alternent entre explication d’un terme désormais inusité, remarques philologiques et / ou stylistiques, et mention des sources permettant d’éclairer le sens du texte. L’introduction de chaque chant permet de situer le cadre narratif et d’en proposer une sorte d’explication déjà interprétative. A cet égard, nous pouvons affirmer sans grand risque d’erreur que c’est en elles que réside la principale valeur ajoutée de ce nouveau volume au regard des éditions déjà existantes : ce sont, à l’heure actuelle, les notes les plus éclairantes en français, les plus riches et les plus adaptées à des niveaux de lecture différenciés. A bien des égards, le résumé narratif et explicatif qui ouvre chaque chant permet de lire de manière cursive le texte, tandis que chaque note apporte une précision bienvenue quant à la bonne intelligibilité du Poème.
Il convient néanmoins d’apporter une légère restriction à notre enthousiasme. En effet, en répartissant les notes selon les auteurs, il en découle inéluctablement que certains chants seront essentiellement lus à partir des compétences propres de l’auteur, qui sont autant de perspectives certes judicieuses mais toutefois partielles. Le chant III de l’Enfer est ici paradigmatique. Luca Fiorentini annonce examiner « attentivement dans les notes aussi bien les simples images que les séquences narratives puisées à la source par Dante, et surtout les variations souvent subtiles du récit de Virgile[14]. » En privilégiant les « séquences narratives », l’auteur se concentre sur le parallélisme entre le texte de Virgile et celui de Dante, éclairant en effet l’écriture de Dante ; mais pareil choix entraîne mécaniquement une sorte d’atténuation de l’importance théologique et conceptuelle de l’Enfer. Ce dernier, de toute évidence coéternel à Dieu, avec toutes les difficultés que cela engendre, ne se voit traité comme enjeu théologique qu’en deux lignes à la faveur de la note 3, mais ne reçoit guère d’autre éclairage. De la même manière, les enjeux de la théodicée se trouvent quelque peu écrasés sous l’examen de la trame virgilienne et l’on reste sur sa faim sur le plan conceptuel. Aussi riches soient-elles, les notes tendent à privilégier la perspective de leur rédacteur qui, toujours pertinente, ne saurait être exhaustive.
4°) L’interprétation de Carlo Ossola
Nous avions rendu compte ici même de l’excellente introduction proposée par Carlo Ossola[15] à la lecture de la Commedia. Sans surprise, la préface reprend les grandes lignes directrices de sa lecture qui, très ancrée dans un dialogue avec les écrivains du XXè siècle, rend compte du choix d’avoir reproduit un grand nombre d’extraits des écrivains commentateurs du Poème. Cette approche « littéraire », quoique largement irréductible à cette dimension, induit une réflexion sur le « je », la nature de Dante comme personnage et comme écrivain, mais aussi sur le rôle du lecteur dont peut-être aucune autre œuvre que celle-ci ne requiert autant sa pleine collaboration. « Si l’on sort de la lecture de la Comédie comme on y est entré, cela signifie qu’on n’a pas lu le poème[16]. »
Par ailleurs, C. Ossola n’adhère pas aux lectures mystiques, initiatiques ou même sacrales du Poème. Ainsi que le signalait déjà son Introduction, la Commedia est un accessus, une « approche – ardue et fuyante – de la jouissance du regard, de lumière en lumière, de ciel en ciel, dans la « gloire de celui qui meut toutes choses » et dont – comme les ciels – le poème « prend l’image (…) et en devient le sceau »[17]. » Aussi forte et séduisante soit-elle, cette lecture nous a toujours semblé déroutante sur un point : en effet, corrélée à l’idée que la lecture de la Commedia doit être porteuse d’un certain effet sur le lecteur, pour ne pas dire d’une certaine transformation, il est difficile de comprendre comment elle pourrait ne pas être une initiation, c’est-à-dire une forme de recommencement par lequel l’âme se rend progressivement digne de la lumière divine.
De la lumière, pourtant, C. Ossola n’a pas son pareil pour en faire sentir l’importance. Aux obscures ténèbres infernales, il remarque que le Purgatoire, déjà, dispense une lumière pure, et note combien la pulsation même du temps humain se fait elle-même lumineuse. Toute la lecture de C. Ossola est orientée vers une problématique de la visibilité et de la luminosité, et se pense donc depuis ce qu’il aime à appeler la « joie du regard ». Le « voir » acquiert dès lors une prééminence, que C. Ossola s’attache à relever dans ses notes qui, commençant avec le Purgatoire, commencent justement avec la sortie de l’obscurité et le retour d’un ciel lumineux rendant possible la description d’une astronomie.
De fait, une proportion considérable des notes du maître d’œuvre concernent très précisément ce qui se voit, qu’il s’agisse du ciel et de la carte de celui-ci, des ombres, des rayons du soleil, du regard, du fameux « face à face » biblique, etc. Si nous prenons par exemple les notes du chant III du Purgatoire, un quart d’entre elles (10 / 40) sont consacrées à expliciter le domaine du visible, depuis le décor jusqu’au regard, en passant par ce que voient les sens et l’intellect. Certes, tous les chants ne se prêtent pas avec une telle générosité à une approche depuis la perspective de la visibilité, mais il n’en demeure pas moins que l’un des mérites essentiels des notes de C. Ossola consiste à faire voir le visible, à figurer et à faire de cette visibilité un élément constitutif du fameux accessus que narre le Poème.
Par ailleurs, quant aux auteurs convoqués pour expliquer le texte, nous pouvons distinguer trois catégories :
- les sources et les autorités avec lesquelles discute Dante, d’Augustin à Saint Bonaventure, ce qui permet de ne pas succomber à la tentation américaine de déthéologisation de l’œuvre de Dante ;
- les contemporains de Dante comme Francesco da Buti, ou les commentateurs humanistes comme Landino, qui permettent d’en penser la réception
- les écrivains modernes, de Flaubert à Bonnefoy, qui confèrent à l’ensemble une problématique littéraire inscrite dans la question de l’écriture.
Une mention de l’importance accordée à Bonaventure doit ici être proposée, tant ce dernier occupe dans l’Introduction à la Divine Comédie une place prépondérante. « Le rôle du traité de saint Bonaventure dans l’enracinement « théologique » de la Comédie est reconnu, y écrit C. Ossola, mais on n’a pas évalué la mémoire concrète de ce texte jusque dans les solutions les plus hardies et dans les déclarations les plus exposées du discours dantesque[18]. » Un des passages centraux aux yeux du commentateur se trouve justement dans le chant XXVII du Purgatoire où la reprise des arguments de Bonaventure quant à la définition de la qualité la plus haute du progessus humain, se trouve explicitée : sa mens, qui place l’homme au-dessus de soi, est ce par quoi s’accomplit le supra nos ainsi que l’indique la présentation générale du chant. Mais, au moment de commenter les trois derniers vers du chant, ce n’est plus Bonaventure mais Landino qui est convoqué, ce qui peut surprendre au regard de l’interprétation que le même en avait donnée dans son Introduction.

Un autre étonnement surgit à l’examen des notes du chant XVI du même Purgatoire. Dans son Introduction, C. Ossola insiste sur l’analyse dantesque du libre-arbitre et en fait un pivot du Poème, dramatisant d’un côté la question de son usage et du mal qui en résulte, et en en faisant de l’autre notre raison d’être même. Or, les notes du chant XVI ne mentionnent le libre-arbitre qu’en passant, la note 14 évoquant d’ailleurs une prise de distance à l’endroit d’un certain aspect de l’augustinisme politique. Certes, ce n’est pas C. Ossola qui a rédigé les notes du chant XVI mais Pasquale Porro, qui consacre une très longue et très instructive note aux influences célestes, et l’on peut donc juger qu’ils ne hiérarchisent pas les thèmes décisifs de ce chant de la même manière ; mais ici se joue un élément essentiel portant sur l’objet dont doivent traiter des notes : en insistant sur les « influences célestes », Pasquale Porro étaye essentiellement la raison historique éclairant le vers 74 : « Le ciel commence vos mouvements ». En insistant dans ses écrits propres sur le libre-arbitre, C. Ossola montre pourquoi le ciel ne « finit » pas les mouvements et rend compte de la hiérarchie des forces si l’on peut dire en évoquant le vers 79 qui confère au libre-arbitre une « maggior forza » que celle des influences célestes ; ce faisant, la note de P. Porro ne permet pas tant d’expliquer la doctrine dantesque en matière de libre-arbitre que de rendre compte de l’intégration d’influences célestes au sein d’une pensée du libre-arbitre qui, comme telle, ne reçoit aucun éclairage précis.
Conclusion
Que Dante soit au cœur de l’activité éditoriale de l’année 2021 ne saurait être qu’une excellente nouvelle tant elle témoigne de la vigueur d’une œuvre 700 ans après la mort de son auteur. Défi ultime pour les traducteurs tant elle brasse de domaines et de registres, la Commedia semble toutefois condamnée à disposer d’une richesse qui ne peut pour des raisons intrinsèques être parfaitement – exhaustivement – rendue par une traduction, si bien que l’on serait tenté de se rapporter simultanément à toutes les traductions existantes pour, à chaque fois, bénéficier d’une perspective sur le texte. Mais c’est justement au cœur de cette impossibilité que doit être menée l’analyse différentielle de chaque traduction proposée, et de chaque apparat critique associé. Or, de cet examen, il apparaît que la traduction de Danièle Robert atteint une certaine forme d’excellence, et qu’il sera sans doute difficile de faire mieux dans les décennies à venir. Quant à celle de J. Risset, reprise en Pléiade et agrémentée d’un apparat critique, elle demeure tout à fait remarquable en dépit de la très regrettable absence d’index, et si l’on peut déplorer la décrue de l’édition des œuvres complètes en général et de celles de Dante en particulier, mutilant ainsi le « réseau » que forme ses écrits, on ne peut que saluer avec enthousiasme la qualité scientifique du travail accompli, enrichissant d’ailleurs le faible nombre d’éditions réellement annotées de la Commedia en français. Quant à l’édition illustrée du Cerf, en tant que « beau livre », elle offre une réjouissance visuelle grâce au remarquable travail de mise en page et invite à comprendre par l’œil les pérégrinations du divin poète.
[1] Carlo Ossola, « Note sur la présente édition », in Dante, La Divine Comédie, Paris, Gallimard, coll. Pléiade, 2021, p. XLIII.
[2] René de Ceccatty, art. cit., p. 20.
[3] Ruedi Imbach, art. cit., p. 11.
[4] Jacqueline Risset, Dante écrivain. Ou l’intelletto d’amore, Paris, Le Seuil, 1982.
[5] Ibid., p. 15.
[6] Luca Fiorentini, « Note sur le texte italien », p. XLV.
[7] Ibid., p. XLVII.
[8] Ibid., p. XLVIII.
[9] Ibid., p. XLVI.
[10] Risset, Dante écrivain, op. cit., p. 235.
[11] Ibid., p. 236.
[12] Ibid., p. 239.
[13] Jacqueline Risset, « Traduire Dante », in Dante, La Divine Comédie. L’Enfer, Traduction Jacqueline Risset, Paris, GF, 1992, p. 22.
[14] Enfer, III, présentation, p. 869.
[15] Carlo Ossola, Introduction à la Divine Comédie, le Félin, 2016. Recension disponible à cette adresse.
[16] Carlo Ossola, « Préface », p. XXIX.
[17] Ibid., p. XXV.
[18] Carlo Ossola, Introduction…, op. cit., p. 45.








