A lire le dernier « essai » de Lindenberg, Le procès des Lumières1, on comprend mieux la détestation qui était la sienne de l’idée d’une « défaite de la pensée » chère à Alain Finkielkraut, tant son dernier ouvrage en est une désolante illustration. Pour paraphraser Jérôme Garcin évoquant Marc Lévy, je serais tenté de dire à son sujet : « ce n’est pas mauvais, c’est pire. » Sous couvert de dresser un tableau de la pensée néo-conservatrice mondiale – le « monde » se réduisant pour Lindenberg aux think tank américains républicains et à quelques historiens italiens – l’auteur propose un pamphlet médiocre et confus contre le sarkozysme, véritable sujet du livre, le tout sous une pseudo-défense des Lumières que, naturellement, il se garde bien de définir. Ouvrage très essentiellement hexagonal, donc, faussement paré des vertus d’une approche globale et mondiale, le procès des Lumières s’apparente à un symptôme, celui de l’immense misère de la pensée contemporaine, pour laquelle l’antisarkozysme constitue l’ultime os à ronger qu’elle s’efforce de décliner à tous les temps (de Barrès à Sarkozy) et à tous les modes (réactionnaire, conservateur, ultra-conservateur, néo-libéral, fascisant, ultralibéral, etc.). Mais que l’on se rassure : ces indigents brûlots continueront d’avoir les faveurs de l’édition et de la presse, et jouiront d’une publicité certaine, parfois teintée d’une distance critique lorsque ne pourra plus être dissimulée l’infinie médiocrité dont certains font preuve.
Jadis thuriféraires du pamphlet Le rappel à l’ordre2, ouvrage sentant bon sa liste de dénonciation où étaient égrenés des noms livrés à l’infamie réactionnaire, les journaux dominants ont précisément eu du mal à encenser la nouvelle chose de Lindenberg : sous la plume ironique de Nicolas Weil, Le Monde déplora la confusion extrême de l’ouvrage : « Comme il eût été beau, pour un ouvrage qui brandit haut l’étendard des Lumières face à une vague de contre-révolution intellectuelle censée s’étendre aux dimensions de la planète, de manifester une des qualités principales des philosophes du XVIIIe siècle : la clarté ! Las, ce livre laisse l’impression d’un fatras où se perdent la thèse, l’adversaire et le lecteur. Comme si Daniel Lindenberg, professeur à l’université Paris-VIII égrenait, en lieu et place d’argumentaire, ses fiches de lecture, distribuant bons et (surtout) mauvais points, lâchant à jet continu un flot de noms propres – sous l’invocation de ses grands hommes à lui, Jacques Rancière et Emmanuel Todd… »3 ; même Télérama, pourtant progressiste devant l’éternel, ne peut dissimuler son scepticisme face à tant d’imprécisions et d’amalgames, notamment sur l’islamisme et le racisme : « On aurait aimé qu’il précisât mieux la frontière entre racisme indécent contre l’islam et positions justifiées contre l’islamisme intolérant, et identifiât plus les raisons qui poussent ceux qui, à gauche, sont au bord de la conversion. »4 Le constat est cruel, mais limpide : lorsque c’est vraiment trop médiocre, même la presse « amie » est acculée à pointer les limites de la chose commise, et à prendre ses distances – polies – avec l’auteur.
A : Un énième brûlot anti-sarkozyste qui ne s’assume pas comme tel
En dépit du titre et des intentions affichées, l’ouvrage n’est guère autre chose qu’une énième charge anti-sarkozyste, charge paradoxale s’il en est puisque, tout à la fois, elle ne se présente pas comme telle, mais s’expose néanmoins ainsi. Le problème n’est évidemment pas le fait que Lindenberg décide de livrer un 10 000ème ouvrage contre Sarkozy – au pire, il souffrirait d’un manque d’originalité –, mais il réside bien plutôt dans le fait que Lindenberg simule une enquête intellectuelle qui n’est en réalité que l’alibi quelque peu pitoyable d’une charge éculée contre le Président de la République, là où il n’y a que billet d’humeur. Ainsi, de la première page où il exhibe une citation de Kalinovski, à la dernière qui se conclut fort significativement sur Sarkozy, Lindenberg produit une nouvelle charge contre celui-ci, sous couvert d’une caution intellectuelle de l’essai sur la mondialisation des idées, dont Sarkozy serait une illustration parmi d’autres : c’est exactement l’inverse qui est vrai : partant de ce qu’il croit comprendre du sarkozysme – quitte à le reconstruire de manière totalement artificielle – Lindenberg en cherche désespérément des résonnances à l’étranger, résonnances qu’il tente maladroitement de rétroactivement présenter comme la matrice idéologique du premier. Cela sent l’artifice, suinte la précarité intellectuelle, transpire l’effort laborieux.
Prenant appui sur les débats japonais, Lindenberg convoque donc en ouverture Kalinovski pour comparer les problématiques japonaises avec les nôtres, sous-entendu avec le sarkozysme : « Une certaine parenté se fait sentir avec les nouveaux courants conservateurs occidentaux ; le même procès du droit-de-l’homisme, le même constat d’une modernité malade d’elle-même, la même exaltation de la puissance et de la dignité nationale. »5 On l’a compris dès la première page, le problème est moins le procès des Lumières – qui, faute d’une définition rigoureuse des Lumières, sera du reste fort mal rattaché aux questions politiques et apparaîtra à chaque instant davantage comme un alibi – que celui d’une recherche pseudo-fouillée des sources de la pensée du sarkozysme, qui reviendra comme le leitmotiv des dénonciations de l’ouvrage.
Bien évidemment, si la première page y est consacré, le livre ne pouvait que se clore sur l’incarnation française du mal absolu, toujours le sarkozisme : « Malgré ces réserves, il est clair que le sarkozysme incarne bien, au final, l’accomplissement français de la grande régression idéologique amorcée un peu partout au seuil des années 2000. »6 Mais, aussi amusant que cela puisse paraître, convaincu qu’il est d’être un intellectuel sérieux, Lindenberg n’ose thématiser explicitement le problème sarkozyste qu’en postface, comme si, soudainement, il lui apparaissait fortuitement que ses recherches et ses « travaux » sur la pensée mondiale pouvaient donner lieu à une digression finale sur la pensée du Président de la République française, comme si la hauteur de vue mondiale qu’il avait atteinte lui permettait enfin de penser le cas particulier de la France ; la seconde partie de la postface est ainsi cocassement intitulé « Et Sarkozy dans tout ça ? », comme s’il ne se rendait compte qu’en postface qu’il pouvait évoquer le cas Sarkozy. L’hypocrisie est ici poussée à son comble, tant la totalité de l’ouvrage est construite autour de Sarkozy, avec quelques excroissances américaines ou italiennes, qui sont autant d’alibis à une laborieuse tentative de cerner la pensée politique de ce dernier.
En somme, Lindenberg n’assume pas sa démarche : partant du cas français pour trouver quelques similitudes à l’étranger, il voudrait faire croire qu’il part de la scène mondiale pour penser le cas français : mais les situations étrangères, fort mal maîtrisées, et relevant bien de « fiches de lecture » mal retranscrites comme l’a justement souligné Nicolas Weill, ne peuvent tromper personne, ou presque. Que Sarkozy soit la cible essentielle de l’ouvrage, cela est confirmé à de nombreuses reprises : alors même qu’il prétend partir de la scène mondiale, de la « mondialisation des idées », Lindenberg ne cache pas sa jubilation de présenter la singularité du Président français, représentant à lui seul du néoconservatisme français : « Le cas français enfin est original en ce que la vague conservatrice nouvelle y est plus incarnée par le président Sarkozy et son équipe que par des idéologues dont l’influence, malgré des efforts pour suivre la voie américaine, reste finalement limitée lorsqu’elle ne passe pas directement au politique. »7 Ah bon. Mais que l’on se rassure, Sarkozy est évidemment l’héritier de l’horrible Idéologie française, de Maurras et Barrès ce qui fait de lui, certes, une singularité mondiale, mais un continuateur français : « L’examen de ses discours et de ses écrits depuis un certain nombre d’années fait apparaître que le président parle une langue politique qui est celle de la culture de droite la plus classique (Barrès, Maurras), quoique partiellement euphémisée par la rhétorique de la « rupture » et de la guerre aux « conservatismes français ». »8
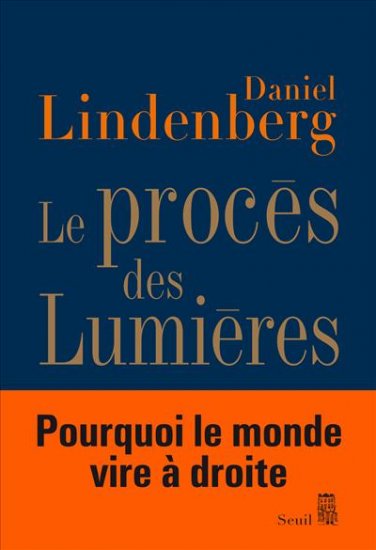
Mais, n’étant pas à une contradiction près, Lindenberg considère que Sarkozy est en fait gramsciste, à l’instar de la droite italienne, et cette culture de droite politique, classique, ultra-réactionnaire relevée page 152 devient soudainement une tentative néolibérale farouche, faite de ruptures et de révolutions terrifiantes, comparables à l’ignoble Koizumi : « L’ère Koizumi a mis à mal le modèle japonais classique. Elle évoque terriblement notre « sarkozysme » hexagonal, avec son mélange de néolibéralisme, de rupture avec l’ « ordre conservateur » cher à la vieille garde du PLD, de nationalisme (…). »9 Si l’on comprend bien Lindenberg, Sarkozy est à la fois un ultra-réactionnaire façon Maurras10, et un ultra-libéral juché sur le bulldozer terrifiant de la destruction des modèles « classiques ». De deux choses l’une : soit la contradiction se trouve au sein du sarkozysme et ce dernier constitue alors un mode politique nouveau qu’il est vain de vouloir penser à l’aide de mots aussi datés et inopérants que « réactionnaire » ou « libéral », soit la contradiction se trouve dans l’esprit de Lindenberg, et l’on se prend à désespérer d’avoir à chroniquer pareil ouvrage. Quoi qu’il en soit, il est évident que Sarkozy parcourt tout l’ouvrage, et il apparaît bien hypocrite de la part de Lindenberg de simuler dans la postface une possible application à Sarkozy alors même que l’ouvrage tout entier lui est consacré.
B : Questions de méthode
Au-delà de cette tromperie sur le contenu et les intentions de l’ouvrage – énième brûlot anti Sarkozy présenté comme une enquête sur la mondialisation des idées conservatrices –, le plus désolant est sans doute la méthode intellectuelle retenue qui constitue assurément une leçon de non-pensée. Que l’auteur n’aime pas les pensées conservatrices, c’est son droit ; qu’il le fasse savoir et suscite le débat, voilà qui est fort sain. Mais là où l’on se désole, c’est lorsque l’on examine d’un peu plus près la manière dont il rend compte des pensées dites conservatrices ou supposément hostiles aux Lumières.
La méthode de Lindenberg est partout la même, et glace d’effroi tant elle est médiocre : elle consiste à relever quelques bribes de discours ou de textes de personnages jugés réactionnaires, à les mettre entre guillemets, et à dire quelque chose comme : « voyez ce que ces gens-là disent ! », sans que jamais ne soit apporté le moindre embryon d’analyse aux propos incriminés : ils sont livrés en pâture au lecteur comme s’ils étaient d’emblée fautifs et coupables : ainsi, toute pensée pointant les contradictions ou les apories de la modernité est aussitôt cataloguée comme étant hostile aux Lumières – lesquelles n’étant jamais définies, semblent désigner dans l’ « esprit » de Lindenberg l’amour inconditionné de la modernité – sans que jamais n’en soit donc analysé le contenu, si bien qu’aux yeux de Lindenberg, le fait même de critiquer la modernité vaut invalidation immédiate de la pensée qui accomplit ladite critique. On ne saurait mieux palper dans sa chair même la défaite de la pensée qu’incarne ici Lindenberg, ce dernier croyant hélas incarner la défense de la rationalité menacée, alors qu’il en est la première menace.
Ainsi, loin d’examiner la pertinence des discours qu’il dénonce, fuyant tout esprit d’analyse, Lindenberg va se contenter d’identifier la nature des discours qu’il rencontre ; mais ce que Lindenberg ne comprend pas, c’est que faute d’analyse, l’identification de la nature d’un discours est elle-même dénuée de sens. Ainsi, si l’ « islamophobie » (Lindenberg n’est pas islamophobe, il aime à le faire comprendre), est condamnable, ce n’est pas parce que c’est une pensée fausse, ou parce que c’est une pensée qui commet une erreur sur l’islam, non certainement pas ; c’est parce que l’islamophobie est identifié comme étant un discours antisémite. « Il faut le dire, l’ignominie d’un certain discours islamophobe, même revêtu des oripeaux de la « science », ne le cède en rien à celle de l’antisémitisme de naguère, visant d’autres « sémites ». »11 Faute de pouvoir analyser l’islamophobie – ce qui supposerait en effet un long et patient travail sur l’Islam lui-même, ce dont Lindenberg semble incapable – Lindenberg se contente de la disqualifier en identifiant sa prétendue nature, laquelle relèverait in fine de l’antisémitisme. C’est d’ailleurs un leitmotiv de l’ouvrage ; plutôt que d’examiner la pertinence de ceux qui considèrent que l’Islam pose problème à l’Occident – ce qui, je le répète, supposerait un savoir sur l’islam que Lindenberg ne possède manifestement pas –, Lindenberg se contentera de discréditer l’islamophobie comme étant une forme larvée de l’antisémitisme, ce qui lui évite à la fois de penser l’Islam, l’islamophobie et l’Occident. L’amalgame tient ici lieu de pensée, tandis que la dénonciation simule l’ajout « critique » à ladite pensée. L’islamophobie, s’expliquerait selon Lindenberg, à la fois par la nécessité de justifier l’éternel combat contre les ennemis de l’Occident, et « par le souci de se faire comprendre, sans dire explicitement, qu’on s’était trompé d’ennemi en stigmatisant les Juifs et le judaïsme. D’où une valorisation d’Israël et le fait que ce soit désormais le monde arabo-musulman qui porte le stigmate de l’antisémitisme, tout en occupant la place des Juifs d’hier comme ennemi de l’Occident chrétien. »12 Ce qui est ici fascinant, c’est qu’à aucun moment, Lindenberg n’envisage la possibilité que le monde arabo-musulman soit réellement antisémite, il se contente de l’exposer comme étant le discours d’une supposée islamophobie, qui est décrétée par nature aberrante. Défaite de l’analyse, défaite de la pensée, défaite aussi du sens critique pourtant revendiqué.
L’ouvrage est ainsi saturé de présupposés, qui en rendent la lecture particulièrement pénible : ressemblant plus à un tract qu’à une enquête intellectuelle, certaines choses vont de soi, comme si Lindenberg s’adressait uniquement à son cercle de lecteurs par avance convaincus, ce qui le dispenserait de bon nombre de démonstrations. Plutôt que d’étudier la pertinence de thèses qu’il ne partage pas afin de les réfuter, il se contente d’exposer ces dernières comme des propos absurdes par nature. Ainsi expose-t-il la supposée thèse des supposés islamophobes : « La thèse est limpide : l’Europe, depuis les années soixante-dix, a capitulé devant les pressions arabes la sommant de ne plus soutenir Israël. De plus, elle a laissé sans réagir des millions d’immigrants musulmans s’installer sur son sol et y transplanter leur religion et leurs coutumes intolérantes. Ce faisant, elle a accepté un statut de « dhimmitude » collectif. Il n’y a plus d’Europe mais une « Eurabia » qui est bien symbolisée par cet immense croissant rouge qui figure sur la couverture et enserre le petit Israël comme les mâchoires d’un étau ! On retrouve la même rhétorique hallucinée, d’autant plus légitimée qu’elle émane de femmes en rupture avec l’islam familial, chez une Ayan Hirsi Ali aux Pays Bas. Sans compter Mohamed Sifaoui, un Algérien « éradicateur » devenu un pilier de toutes les chapelles néoconservatrices en France, un temps invité permanent des plateaux télé.»13 Aux yeux de Lindenberg, il suffit d’énoncer pour dénoncer, ce qui le dispense d’une analyse dont on le croit, à la fin du livre, bien incapable. Exposer la pensée des autres suffit à les réfuter, puisqu’il s’agit précisément de la pensée des autres, des conservateurs, des réactionnaires qui ont, quoi qu’ils disent, intrinsèquement tort. Pourquoi s’en prendre à Mohammed Sifaoui ou à Aryan Hirshi Ali ? Parce que leurs propos sont faux ? Non ! Ce serait bien trop difficile à établir ; parce qu’ils sont de mèche avec les « chapelles néoconservatrices » ! L’affiliation vaut condamnation. On retrouve exactement le même procédé lorsque M. Lindenberg, évoquant un think tank italien, nommé la destra, peut écrire : « La Destra, à qui on ne peut reprocher de ne pas annoncer la couleur… »14 Quel est le sous-entendu de la remarque et des points de suspension lourds de sens ? Elle sous-entend qu’ici il n’y a même pas à chercher une identification à une couleur politique, la Destra se présente elle-même comme de droite, et est donc d’emblée réfutée…
C : Un festival d’ignorances
Si la méthode est donc intellectuellement vautrée dans une nullité satisfaite, le contenu est, quant à lui, désastreux : Lindenberg enchaîne avec une persévérance qui force l’admiration les erreurs et les approximations qui laissent pantois. Il serait vain de les comptabiliser ou de les relever en totalité, alors je me concentrerai sur trois aberrations récurrentes qui jalonnent la chose.
a) Une ignorance historique : l’origine de la Nation
A en croire Lindenberg, la revendication nationale serait un geste typiquement réactionnaire, hostile aux Lumières, ce qui lui fait dire que certains intellectuels de gauche revendiquant le retour à la Nation sont eux-mêmes réactionnaires, au point d’ailleurs de déplorer que l’ensemble de la pensée politique en fasse un idéal. « Restauration de l’ « autorité », défense de la famille, exaltation de la nation, réaffirmation de la religion… Ce n’est plus seulement la droite qui veut s’approprier ce programme, mais l’ensemble du spectre politique. »15 On imagine ainsi tous ces intellectuels « de gauche », pourtant favorables à la Nation – Max Gallo, Régis Debray, Alain Finkielkraut, etc. –, être à peu de frais accusés de l’étiquette infamante de « réactionnaires », alors même que le pauvre Lindenberg commet un contresens majestueux sur l’origine même de la Nation.
Il me faut lui rappeler que, loin d’être le symbole d’un repli identitaire, la revendication même de la « Nation » comme telle fut un des combats des Lumières au point d’être, comme le rappelle Georges Burdeau, l’emblème de la lutte des Lumières contre l’absolutisme. « La France, écrit ce dernier, cependant va, cette fois, se séparer de l’Angleterre, parce que l’exaltation de la nation s’y fait contre l’Ancien Régime avant de s’attaquer à la monarchie elle-même. (…). Les droits de la nation sont bientôt proclamés à l’encontre du pouvoir royal. On crie « Vive la nation ! » ; le roi ne saurait être que son représentant. » Faut-il également rappeler – apprendre – à Lindenberg, que la Place de la Nation à Paris, a symboliquement pris son nom le 14 juillet 1880, remplaçant la « Place du trône renversé », ainsi baptisée en 1792, qui elle-même marquait la chute de la royauté, le nom initial étant celui de « place du Trône ». La Nation est donc, n’en déplaise à D. Lindenberg, le symbole même du refus de l’absolutisme, de la lutte des Lumières pour la liberté, et du corps constitué du pays, à tel point, note Burdeau, que « la pensée révolutionnaire en France est venue apporter une consécration juridique en faisant de la nation un sujet de droit. Propriétaire de la souveraineté, la nation est la source de tous les pouvoirs qui ne peuvent être exercés qu’en son nom. »
Faire de l’évocation – ou de l’invocation – de la Nation, la marque d’une pensée réactionnaire, ce n’est pas analyser une pensée, mais ce n’est même pas identifier la nature d’une pensée, c’est commettre une erreur, une de plus, c’est voir un réflexe réactionnaire là où se joue peut-être un des plus grands acquis de la Révolution.
b) Une ignorance politique : la repentance
Parmi les innombrables erreurs de Lindenberg, une est particulièrement visible, celle qui identifie le refus de la repentance à la pensée réactionnaire ou conservatrice. La révolution conservatrice serait d’abord une « contre-repentance »16 qui veut réhabiliter la Nation ; le problème méthodologique va ici ressurgir, bien entendu, dans l’exacte mesure où jamais Lindenberg n’examinera la pertinence du refus de la repentance ce qui supposerait une analyse de celle-ci. Mais il va faire mieux encore, si l’on peut dire, en déréalisant cette dernière. En effet, à ses yeux, la repentance est un fantasme qui n’existe que dans le regard réactionnaire. « Ce thème de la « repentance » est une pure affabulation. En fait, personne, sauf les évêques en 1997, n’en a jamais parlé. Les victimes et leurs héritiers demandent surtout une reconnaissance des crimes et éventuellement une réparation. »17 Ah bon.
Il me faut alors signaler à M. Lindenberg que la repentance, loin d’être un terme utilisé par les seuls évêques, est omniprésent dans les débats contemporains. Abdelkrim Ghezali titrait de manière fort significative, le 1er novembre 2005 dans la Tribune : « L’Algérie attend de la France un acte de repentance »[cf. La Tribune, 1 er novembre 2005[/efn_note], article dans lequel il écrivait ces quelques mots : « Le 51ème anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale intervient cette année alors que l’Algérie et la France sont face à un dilemme sérieux, un traité d’amitié conditionné par un acte de repentance. En effet, et pour la première fois depuis l’indépendance, un consensus national s’est fait autour de la nécessité de réclamer à la France officielle un pardon pour tous les crimes commis au nom de l’Etat français et sous son autorité par ses armées et son administration coloniale. »18 Le célèbre site la-kabbylie.com, site culturel, avait évidemment réclamé une repentance de la France, employant à plusieurs reprises le terme, notamment dans l’article suivant : « Guerre d’Algérie : Les enfants de martyrs veulent la repentance de la France »19 et ainsi de suite. Faut-il également rappeler à M. Lindenberg qu’un ministre algérien avait demandé à la France non pas la « reconnaissance » comme il le prétend à tort, mais bien « l’incrimination de l’occupation française et la reconnaissance des crimes de guerre perpétrés contre le peuple algérien notamment les essais nucléaires, les mines anti-personnels, outre les pertes occasionnées à la nature et à l’homme » ?
c) Un foisonnement d’erreurs factuelles
De manière ironique, l’ouvrage de Lindenberg se clôt sur une erreur : en effet, croyant tirer son propos vers le haut en évoquant Habermas, il commet une erreur qui témoigne de toute l’approximation dont l’ouvrage est hélas coutumier : « La guerre culturelle continuera donc longtemps, c’est en tout cas ma conviction, avant que la production de nouvelles Lumières (ces « Lumières modernes » dont parle Jürgen Habermas, que certains accusent – un peu vite ? – d’avoir cédé aux sirènes vaticanes dans son dialogue avec Benoît XVI), issues non d’exportations humiliantes, mais d’une maturation indigène et endogène des civilisations non blanches et non européennes (Chine, Inde, Amérique latine, Afrique), ne change la donne. »20 Manque de chance, le dialogue d’Habermas avec Benoît XVI eut lieu en janvier 2004, à une époque donc où Benoît XVI n’était pas Benoît XVI, où il n’était « que » le Cardinal Ratzinger ; de surcroît, les « sirènes vaticanes » étaient bien loin puisque la rencontre eut lieu à Munich. On m’objectera que ce n’est pas là une erreur bien grave ; certes, mais c’est une erreur symptomatique, qui témoigne de l’aspect plus que bâclé de l’ouvrage, incessamment émaillé d’erreurs factuelles plus ou moins grossières ; je remarque en outre que pour confondre Benoît XVI et Ratzinger, Lindenberg n’a certainement pas lu ce fameux échange.
Ainsi apprend-on que Maurras revient en force dans la pensée française – et mondiale. « Livres, colloques, rééditions de ses œuvres majeures se succèdent pour rendre sa place à ce penseur important, plus présent qu’on ne le croit pas dans les idées en vogue. »21 Diable ! Mais pourrait-on avoir un exemple de colloque, de réédition, un début de preuve ? Mais bien sûr, Lindenberg nous l’apporte en ces termes : « « La France est hantée par l’esprit maurrassien », nous apprenait Marianne2.fr, le 23 décembre 2002 »22 La preuve du retour de Maurras est donc constituée par un article internet de Marianne 2. Nulle autre preuve ne nous sera apportée au cours de l’ouvrage, aucun colloque, aucune réédition précise ne seront évoqués ou cités. Et pour cause…
De la même manière, nous apprenons que Lindenberg n’a pas l’air très au fait de ce qui se publie aujourd’hui sur Marx et Hegel ; cette phrase stupéfiante laisse sans voix : « Aujourd’hui, le marxisme comme « historiosophie » est mort, et Hegel lui-même ne se porte pas très bien. »23 Ah bon ; rappelons à D. Lindenberg que Hegel est l’auteur sur lequel sont, depuis quatre ans, publiés le plus de commentaires et d’études, tandis que Marx connaît un retour en force depuis un certain temps déjà ; cela est vrai dans le grand public par la publication de revues qui lui sont consacrées ; en 2003, un hors-série du Nouvel Observateur titrait « Karl Marx, le penseur du troisième millénaire ? »24 tandis que Le magazine littéraire d’octobre 2008 proposait un dossier sur Marx, les raisons d’une renaissance25, et le Point lui-même consacrait un hors-série à Marx, « son histoire, son héritage »26 Le succès de la pensée marxiste et de la lecture marxiste de l’histoire, contrairement à ce que croit Lindenberg, ne se dément pas en librairie auprès d’un public plus spécialisé, comme en témoignent les ventes d’un Badiou ou d’un Zizek, ou l’extraordinaire succès des éditions Lignes. Je rappelle donc ce récent constat de Fischbach à Lindenberg : « de fait, il y a actuellement un retour sinon à Marx, du moins de Marx dans la théorie sociale et dans la philosophie politique, et au-delà, dans la société et les débats d’idées. Ce phénomène ne date pas du début de l’actuelle crise financière, mais il a toutes les chances d’être encore amplifié par elles. »27
d) Des erreurs logiques
Une des erreurs les plus courantes, dans cet ouvrage, est d’ordre logique ; souvent Lindenberg expose un fait – parfois faux – et en déduit une conséquence qui n’est aucunement justifiée. Le plus impressionnant est lorsqu’il aborde les rapports de la CIA et du communisme. Aux Etats-Unis, la CIA a, selon Lindenberg, étudié les méthodes communistes afin de se les approprier. Et les intellectuels anciennement trotskistes ont également contribué à développer un certain mode de pensée. « Les intellectuels venus du communisme « orthodoxe » ou du trotskisme ont apporté leur savoir-faire et leurs modes de pensée. »28 Soit. Mais le problème est qu’à aucun moment Lindenberg n’envisage le fait que cette porosité entre pensée néoconservatrice et trotskisme ne soit signe d’une parenté minimale : non seulement il n’aborde pas la possibilité, mais de surcroît il ne semble même pas l’apercevoir ni l’envisager. Pour lui, les trotskistes sont passés du trotskisme au néoconservatisme – ou au néolibéralisme – sans que cela n’implique jamais, à ses yeux, de parenté idéologique, fût-elle minimale.
Exactement de la même manière, lorsqu’il évoque Clavel et son glissement de la Gauche prolétarienne vers le christianisme, il ne voit pas qu’un glissement généralisé vers le néo-conservatisme – ce qui fait de ce dernier un terme vide de sens tant il est instrumentalisé au service d’une démonstration elle-même vide de sens – écrase les vraies questions sous une mécanique automatisée et sans vie. La démarche logique eût été d’interroger, au vu de ces innombrables trotskistes ou gauchistes devenus religieux (Benny Levy) ou conservateurs, les éventuelles parentés idéologiques qui les relient. Mais qu’on soit rassuré : « Beaucoup d’anciens gauchistes sont restés… à gauche, et se répartissent sur toute la palette de cette région du spectre idéologique, du rose pâle au rouge vif. Quant à ceux qui sont passés « de l’autre côté », c’est que leurs passions idéologiques ont changé de sens, pas d’intensité. »29 Et si c’était l’inverse ? Si les gauchistes devenus sociaux-démocrates, ou même libéraux n’avaient pas changé d’idées mais de degré d’indignation ? Cette hypothèse, qui est celle de Raymond Aron, n’est jamais envisagée par Lindenberg alors même qu’elle est logiquement nécessaire.
D : Dis moi comment tu te nommes, je te dirai ce que tu caches…
Au fond, Lindenberg a dû pressentir que ses propos étaient fort fragiles et, comme souvent dans ce cas, tant ce qu’il écrivait heurtait la raison, il s’est réfugié dans une prétendue étude des profondeurs, dans l’étude de ce qui demeure caché. Tout le livre est ainsi parcouru par la prétention de révéler ce qui demeure caché, enfoui, et dont Lindenberg se présente comme le modeste prophète. En d’autres termes, pour accréditer d’invraisemblables assertions, Lindenberg va faire appel à l’implicite afin de justifier l’injustifiable : si ce qu’il dit paraît étrange, ce n’est parce que c’est faux ou absurde mais parce qu’il nous révèle le sens caché – et donc surprenant – des choses.
A cet égard, l’islamophobie semble constituer la pointe d’un iceberg aux ramifications infinies. Grâce à Lindenberg, nous apprenons que ceux qui considèrent que l’Islamisme est incompatible avec l’Occident ne font qu’exprimer un refoulé anti-protestant (sic). « Dernière question. Derrière l’ « islamophobie » n’y a-t-il pas, paradoxalement, la haine de la modernité ? Un refoulé antisémite, voire antiprotestant ? Car s’il est exact que la stigmatisation de l’islam cache mal la volonté de ne plus accepter les migrants musulmans et de marginaliser ceux qui résident en Europe dans une sorte de ghetto moral, il faut aller plus loin dans l’analyse : c’est le pluralisme qui est visé. »30 Sous couvert d’aller « plus loin dans l’analyse », Lindenberg opère en fait une régression : ce que ne supporterait pas l’islamophobe, ce ne serait pas l’islamisme, mais le pluralisme, c’est-à-dire l’existence d’autres religions que le catholicisme, lequel catholicisme est implicitement associé par Lindenberg à la religion française par excellence, ce sans quoi on ne comprendrait pas l’assimilation de l’islamophobie au rejet des protestants… Bien sûr, cela revient à dire que le catholique seul peut être islamophobe, mais ce n’est pas le plus absurde : le plus absurde est que Lindenberg, précisément parce qu’il refuse d’analyser l’Islam et l’islamisme produit une forme vide, le « pluralisme », sous laquelle il souhaite mettre tout ce qui n’est pas censé être LA religion française, à savoir le catholicisme. En d’autres termes, être islamophobe, c’est finalement moins craindre l’islamisme qu’être hostile à toute forme de pluralisme, à toute coexistence de religions. On est ici au degré zéro de l’analyse, dans l’amalgame le plus complet, inéluctables conséquences du refus d’analyser les choses en elles-mêmes.
Mais Lindenberg ne s’arrête pas en si bon chemin : la laïcité positive ? « En réalité il ne s’agit rien de rien de moins que d’en finir avec la neutralité de l’Etat républicain. »31 Certes, mais ce que ne voit pas Lindenberg, c’est que la laïcité positive est essentiellement conçue pour satisfaire les revendications musulmanes, des menus scolaires au financement des mosquées, en passant par la formations des imams et les revendications en tout genre. Le problème est que, lorsque Lindenberg fustige la laïcité positive, il ne se rend pas compte que cette dernière est conçue pour attirer un électorat musulman sans cesse croissant, et ne se rend donc pas compte qu’il rejoint, sur le fond, ceux-là mêmes qu’il vitupère, lorsqu’il dénonce ceux pour lesquels l’Europe « a laissé sans réagir des millions d’immigrants musulmans s’installer sur son sol et y transplanter leur religion et leurs coutumes intolérantes. »32 En somme, il ne voit pas pourquoi la laïcité positive a été développée par le pouvoir sarkozyste ; en conséquence, il se trouve embarqué dans une contradiction majeure, qui est celle d’à la fois fustiger ceux qui craignent la fin de la neutralité de l’Etat à cause de l’Islam et en même temps de fustiger ceux qui tiennent à la laïcité positive, laquelle serait selon lui la fin de la neutralité républicaine.
Mais Lindenberg, ne comprenant pas l’origine profonde de la proposition de la laïcité positive transpose ses propres incompréhensions dans le discours sarkozyste qu’il croit contradictoire : « Ce discours comporte aussi ses apories. Comment concilier l’hommage rendu, à Ryad en particulier, à l’islam, et les relents d’islamophobie qui apparaissent dans les discours de campagne (le fameux mouton égorgé « dans la baignoire », les lourdes allusions à la polygamie, à la condition inférieure des femmes musulmanes) ? »33 Le paradoxe présent est que Lindenberg y voit une contradiction parce qu’il présuppose inconsciemment que l’Islam est incompatible avec les coutumes françaises : en effet, pour résoudre la contradiction qu’il croit voir dans le discours sarkozyste, il suffit de dire que la polygamie, l’infériorité de la condition féminine, ne désignent pas la vraie nature de l’islam ; de ce fait, il devient possible de produire un éloge de l’islam, tout en fustigeant des pratiques barbares ou médiévales, de concilier l’éloge de la spiritualité musulmane et la critique de pratiques en effet arriérées. Mais si Lindenberg y voit une « aporie » ou une contradiction, c’est qu’il présuppose la réduction de l’islam à de telles pratiques (voile, polygamie), bref qu’il réduit l’islam à des pratiques effectivement inconciliables avec l’Occident démocratique. En somme, on ne peut voir une contradiction dans un discours faisant à la fois l’éloge de l’islam et une critique de pratiques barbares que si l’on réduit l’islam auxdites pratiques barbares…
Il est donc stupéfiant qu’une grande maison d’édition publie un tel ouvrage ; on n’y apprend rien ou presque ; les quelques excursions vers les pensées non françaises s’orientent soit vers Hannah Arendt et Léo Strauss, que l’on connaît fort bien sans Lindenberg, soit vers les think tank américains ou italiens, dont Lindenberg nous donne le compte-rendu de ses fiches de lecture des articles wikipédia. On peut ainsi résumer l’ouvrage en disant que nous apprenons que W. Bush fut influencé par un livre de Lyron Magnet, auteur d’un best seller, Le rêve et le cauchemar. Les legs des années soixante à la sous-classe, ce qui en réalité ne nous avance guère… Nulle distinction conceptuelle, nul plan démonstratif précis ne structurent cet ouvrage brouillon et bâclé, qui prétend s’attaquer à la pensée mondiale alors qu’il se résume à une énième critique anti-sarkozyste on ne peut plus convenue. Il n’est jusqu’au bandeau qui entoure l’ouvrage qui ne soit à contre-emploi : « pourquoi le monde vire à droite » demande ledit bandeau, alors même que le cinquième chapitre fustige les pensées postmodernes de gauche (Lyotard, Foucault, Derrida, etc.) qui ont envahi la pensée contemporaine et qui mènent le procès de la rationalité technique… Finalement, ce que l’on comprend à l’issue de la lecture d’un tel ouvrage, c’est que Lindenberg ne sait pas ce que sont les Lumières, et que, s’il le savait, il y verrait certainement le paradigme de la pensée réactionnaire, ce qui ne peut qu’inciter à refermer ce livre sur un grand éclat de rire.
- Daniel Lindenberg, Le procès des Lumières. Essai sur la mondialisation des idées, Seuil, 2009
- cf. Daniel Lindenberg, Le rappel à l’ordre. Enquête sur les nouveaux réactionnaires, Seuil, 2002
- Nicolas Weill, « tous nouveaux réactionnaires », in Le Monde, 19 septembre 2009
- Gilles Heuré, dans Télérama, n° 3114, 19 septembre 2009
- Lindenberg, Le procès des Lumières. Op. cit., p. 7
- Ibid. p. 292
- Ibid. p. 127
- Ibid. p. 152
- Ibid. pp. 188-189
- On suggère d’ailleurs à M. Lindenberg de lire la biographie de Barrès écrite par Jean-Pierre Collin afin de l’aider à distinguer Barrès de Maurras…
- Ibid. p. 80
- Ibid. p. 170
- Ibid. p. 84
- Ibid. p. 175
- Ibid. p. 131
- Ibid. p. 135
- Ibid. p. 154
- Ibid.
- cf. [http://www.la-kabylie.com/article-420-Guerre-dAlgerie-Les-enfants-de-martyrs-veulent-la-repentance-de-la-France.html
- Ibid. p. 285
- Ibid. p. 92
- note 4 p. 92
- Ibid. p. 91
- Le Nouvel Observateur, hors-série, octobre-novembre 2003
- Le magazine littéraire, n° 479, octobre 2008
- Le Point, hors-série n° 3, juin-juillet 2009
- cf. Franck Fischbach (dir.), Marx, relire le Capital, PUF, 2009, p. 7
- Le procès des Lumières, op. cit., p. 104
- Ibid. p. 55
- Ibid. p. 90
- Ibid p. 196
- Ibid p. 84
- Ibid. p. 237








