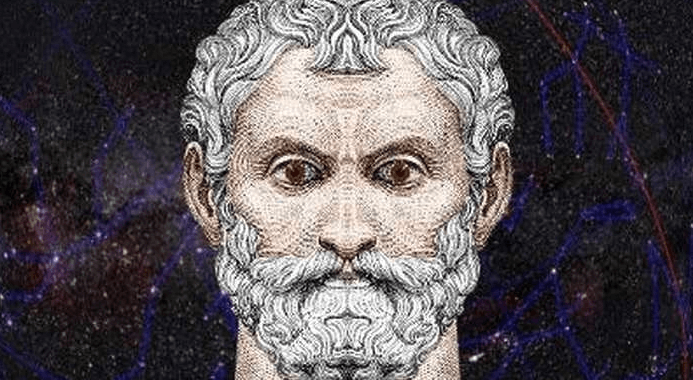Spécialiste de Plutarque et de philosophie hellénistique, Professeur à l’Université de Lyon II, Daniel Babut avait publié en 1974 une étude consacrée à la religion des philosophes grecs, s’intéressant non pas aux aspects sociaux, historiques et ritualisés d’un culte ou d’une pratique, mais bien au contraire aux discours retrouvés consacrés à la question du divin d’une part, et à l’organisation du culte d’autre part. Repris en 2019 par les éditions des Belles Lettres[1], augmenté d’une préface de Carlos Lévy – professeur de latin à la Sorbonne –, l’ouvrage propose une approche chronologique des discours philosophiques grecs consacrés au divin et établit de manière très descriptive la position de chaque auteur.
A : Ambiguïté constitutive du projet
Disons-le dès à présent, l’ouvrage nous semble présenter des mérites inégaux ; d’un côté, il propose une description pratiquement exhaustive de la position des auteurs grecs sur tout ce que nous appelons aujourd’hui le « surnaturel » ; à cet égard, le livre est très utile et construit une synthèse chronologique et féconde de ce que les discours antiques – grecs – élaborèrent aussi bien au sujet du culte que de la dimension civique de ce dernier, mais aussi au sujet du divin, de l’Intellect et même du mythe. Dans cette perspective, l’ouvrage est assurément bienvenu et sa réédition fort utile.
D’un autre côté – nous y reviendrons dans la partie E – l’indétermination foncière de ce que l’auteur appelle la « religion » crée l’impression qu’une projection anachronique de ce que nous appellerions le « surnaturel » unifie artificiellement ce qui, pour l’Antiquité, n’était pas spécifiquement lié : l’unité de la cité, le culte, la tradition, le divin, la théologie comme science du divin, l’Intellect, les mythes, voilà tout ce qu’aborde l’auteur comme s’il s’agissait à chaque fois d’un élément de la religion ; or rien n’est moins sûr et, pour le dire très rapidement, il n’est pas du tout explicite que les discours grecs consacrés au Noûs relèvent d’une quelconque question religieuse ; de la même manière, le lien entre les dieux de la mythologie et le divin comme tel mériterait pour le moins d’être interrogé, pas nécessairement pour en conclure à l’absence de rapports mais, à tout le moins, pour indiquer la dimension problématique d’une catégorie commune qui les subsumerait et qui serait « la religion ».
Ainsi, pour tirer profit de l’ouvrage, encore faut-il circonscrire le lieu de son apport : on n’en tirera pas de gain analytique mais on en tirera un gain de temps : il permet de manière efficace et rapide de résumer ce que disent les philosophes grecs de ce que, aujourd’hui, nous appellerions « le surnaturel », si bien qu’il délimite une série de discours à partir d’une catégorie sans doute étrangère à la mentalité grecque. Certes, l’auteur semble plutôt rabattre la « religion » sur la notion de « tradition » mais il n’est pas entièrement certain que ce qu’il prétend faire soit conforme à ce qu’il fait effectivement : loin de n’envisager que le rapport des discours philosophiques à la tradition, D. Babut prend en charge tout ce qui concerne aussi bien le divin que le culte, dépassant sans cesse la question de la tradition vers ce que la raison peut produire anhistoriquement comme discours sur le divin et le noûs. L’ambiguïté constitutive de la démarche de l’auteur ne doit pourtant pas masquer le vif intérêt dont est porteur l’ouvrage, et que saluait d’ailleurs Robert Joly en 1975 en évoquant « l’énorme enrichissement[2] » de celui-ci.
B : Quel matériau ?
L’ampleur historique du dessein pousse Daniel Babut à envisager sa fresque depuis les présocratiques jusqu’aux stoïciens dont l’auteur est spécialiste. Organisé en trois parties, l’ouvrage commence par une description des philosophies présocratiques et court jusqu’au cinquième siècle, puis ménage une partie pour Socrate, Platon et Aristote avant de clore le livre par l’épicurisme et le stoïcisme.
La première chose qui frappe quant à ce choix est la double sélection opérée par l’auteur : d’une part le néoplatonisme se trouve exclu du champ de recherche, et d’autre part ne sont pris en compte – en tout cas pour l’essentiel – que les discours philosophiques, et presque jamais la réalité historique du culte au moment où écrivent les philosophes dont sont présentés les écrits. Ainsi s’établit une dichotomie entre l’historicité de la tradition qui passe à la trappe et le discours philosophique qui serait discours sur une tradition dont l’historicité n’est guère évoquée. Un tel choix peut sembler problématique car il n’est pas du tout certain que le sens de la « tradition » au VIè siècle soit comparable à celui qu’il revêt au Ier siècle après J-C. Le fait de ne pas établir ce que désigne « la religion » ou « la tradition » pour chaque époque abordée rend quelque peu abstraite la présentation des philosophies et crée une unité artificielle qui résulte d’abord et avant tout du silence quant au contenu effectif de la tradition du point de vue historique.
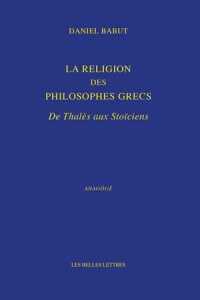
A cela s’ajoutent les éternels problèmes liés à la matérialité des sources pour tout ce qui concerne les présocratiques – dont D. Babut rappelle à quel point elles sont lacunaires – mais aussi la pensée d’Epicure, pour ne rien dire de celles d’Aristote ou des stoïciens. Avec probité, l’auteur signale dès la première partie que ce qu’il dira ne sera jamais qu’une analyse d’un corpus et non sans doute de la réalité des pensées de l’époque, tant nous ne pouvons nous y rapporter que de manière fragmentée :
« Parler de la religion des philosophes présocratiques est presque une gageure. Aucun domaine de recherches, dans le cadre de l’Antiquité classique, n’offre peut-être de conditions plus défavorables. D’abord parce que nous ignorons presque tout de la vie religieuse dans les cités où se sont élaborées ces philosophies. Ensuite et surtout, parce que les opinions religieuses propres à ces philosophes ne nous sont pas beaucoup plus accessibles que l’arrière-plan sur lequel elles se sont constituées[3]. »
A titre d’illustration, l’auteur rappelle que nous ne disposons pas d’une seule œuvre complète de l’époque et que, bien souvent, nous ne disposons que de fragments qui atteignent dans le meilleur des cas 450 vers (Empédocle). Parfois, ce ne sont que quelques mots qui ont été retrouvés, directement ou dans des textes doxographiques comme celui de Théophraste, Opinion des physiciens ; c’est dire la prudence avec laquelle il convient de traiter pareil matériau.
Ici s’imposent deux remarques : la première procède d’un étonnement ; D. Babut est très précautionneux pour ce qui relève du « présocratisme » mais bien moins pour ce qui relève de la pensée d’Epicure et de l’épicurisme en général ; ce qui est dit des présocratiques vaut également pour nombre d’auteurs postérieurs, ce que l’auteur ne souligne pas. La seconde remarque est justement liée à la mention de Théophraste et de son Opinion des physiciens : face à ce titre, l’auteur y voit une intention d’exclusion de ce qui n’est pas religieux, ce qui révèle dès le début de l’ouvrage l’ambiguïté de ce dernier puisque, à en croire Cicéron[4], Théophraste divinisait les cieux, le zodiaque et les astres ; parler de physique pour Théophraste, ce n’est donc pas exclure le divin ni peut-être même l’action efficace des éléments célestes sur la vie humaine et il n’y a donc aucune intention d’exclure ce que de manière indéterminée D. Babut appelle la religion ou les phénomènes religieux ; de surcroît, même si l’on réduisait la religion au culte traditionnel et que l’on éliminait la spéculation sur le divin, il serait insensé de ne pas prendre en compte le rapport du culte aux éléments célestes qui structure la plupart des cultes traditionnels.
C : Les vertus de l’ouvrage
- L’horreur croissante éprouvée face aux dieux homériques
Plusieurs points abordés par l’ouvrage méritent cependant d’être salués. Le premier est la maestria avec laquelle l’auteur dépeint l’horreur croissante qui saisit les philosophes face aux dieux décrits par Homère et Hésiode ou, plus précisément, face à la cruauté et la violence dont font preuve les dieux homériques et qui semblent incompatibles avec la divinité elle-même. Les lignes consacrées à Xénophane sont, à cet égard, excellentes car le lien entre l’effroi suscité par les dieux d’Homère et une sorte de scepticisme à l’endroit de l’anthropomorphisme se trouve fort opportunément tissé. La critique de l’anthropomorphisme de certaines figures divines n’a pas attendu les auteurs des Lumières pour trouver un vaste champ d’expression et la moquerie de Xénophane selon laquelle si les bœufs, les chevaux ou les lions avaient des mains, ils peindraient des dieux avec leurs corps, est bien plus savoureuse que l’ironie souvent peu fine des Lumières.
De manière très convaincante, l’auteur montrera la reprise platonicienne de l’argument, au sein d’un système dont les sources nous permettent d’entrevoir la cohérence. Refusant que le divin soit à l’origine de tout, Platon refuse également la cruauté des dieux homériques : le divin est absolument bon et ne peut être qu’à l’origine des bonnes choses. Il conteste les combats de dieux, leur jalousie, mais il reprend l’idée d’omniscience, ainsi que le contraste entre sagesse divine et ignorance humaine. Donc « il faut considérer que la critique platonicienne de la théologie des poètes ne coïncide pas nécessairement avec un rejet des croyances populaires ; il s’agit bien plutôt, comme dans le cas de Xénophane et Socrate, d’un examen critique de ces croyances et d’une épuration conduite selon une pluralité de critères, moral, social ou éducatif, et proprement philosophique[5]. »
L’autre élément passionnant concerne les enjeux multiples qu’analyse le discours philosophique à l’endroit des cultes traditionnels : si se trouve critiquée une certaine mythologie, ce n’est pas nécessairement au seul nom de la vérité et de la raison ; cela se peut faire aussi au nom d’une certaine modération éthique – ne pas présenter de cruauté excessive pour un être divin – comme au nom d’une réflexion politique visant une certaine paix que ne favorisent pas des discours violents. A partir des fragments dont on dispose se dessine de la sorte une prise de distance de Xénophane à l’endroit de la tradition qui ne vise pas tant à détruire toute forme de culte qu’à le purifier de ses aspects socialement et éthiquement néfastes. De là la conclusion nuancée de l’auteur :
« Dans une histoire de la religion des philosophes grecs, Xénophane apparaît, au total, à la fois comme un précurseur et comme un isolé. Avec lui, le conflit entre la philosophie et la religion traditionnelle, qui n’était que latent chez les Milésiens, éclate au grand jour[6]. »
Idem, le propos se fait subtil avec l’arrivée d’Héraclite qui semble critiquer non plus le contenu de la tradition mais aussi la tradition en tant que tradition. Accepter ce qui est transmis au motif que c’est transmis ne semble plus rationnellement admissible ; à cet égard, la critique de la tradition comme telle accroît le champ de la critique : si Xénophane ne touchait qu’au contenu concret du culte, donc à l’objet de ce que, anachroniquement parlant, nous pourrions appeler la « croyance », Héraclite l’étend au rite, à l’action concrète attachée au culte. « Cette dernière attitude, exceptionnelle chez les Présocratiques, et qui est restée relativement rare dans toute l’histoire de la philosophie grecque, avait une portée plus grande et une signification plus grave, dans les sociétés antiques, que la simple émission d’une opinion théologique, si contraire qu’elle fût aux idées reçues[7]. » Pourtant, s’étonne l’auteur, aucune source n’associe Héraclite à un « athée », et les fragments retrouvés mentionnent les dieux (fragments 98, 63 ou 27). Mais c’est alors au lecteur de s’étonner : pourquoi l’auteur n’envisage-t-il jamais que la question des cultes et de la tradition ne soit pas la même que celle d’une réflexion sur le divin ? Il ne l’envisage pas pour les raisons mentionnées précédemment : parce qu’il maintient le terme de « religion » dans une dommageable indétermination, il y introduit tout ce qui, de près ou de loin, est concerné par l’usage contemporain du terme, établissant de force des mises en relation qui, pour l’époque, sont inintelligibles.
Découle de cette indétermination une singulière difficulté à discriminer entre le nom des dieux de la mythologie et la réflexion sur le divin comme tel, dont les lignes consacrées à Héraclite portent la trace. Son Dieu, note D. Babut, est le feu toujours vivant dont dépend l’ordre du monde, éternel et immuable. Etrangement, s’étonne l’auteur, il reprend même les attributs de la religion populaire (foudre, fouet) pour les conférer à Dieu, tout en refusant de l’appeler Zeus (fr. 32) :
« S’il accepte ce nom, ce n’est sans doute pas parce qu’Héraclite se croit tenu de faire une concession à une religion qu’il malmène ailleurs si rudement, mais plutôt, au contraire, parce que le nouveau Dieu doit occuper le rang et recevoir les privilèges de celui auquel il se substitue[8]. »
Mais constater qu’Héraclite « refuse » d’appeler le divin élaboré par la pensée « Zeus », c’est s’étonner qu’il n’y ait pas de continuité entre les dieux de la mythologie et la réflexion rationnelle sur le divin, discontinuité qui n’est pourtant étonnante que si l’on noie les deux sous l’anachronisme du terme de « religion ». Le même problème ressurgit chez Parménide chez qui l’auteur oppose « foi » et « raison » : là encore n’assiste-t-on pas à un anachronisme dommageable ?
Concluons : il n’est pas inintéressant de constater que la critique de cultes traditionnels ne débouche pratiquement jamais sur un rejet du divin. Preuve, sans doute, de l’inadéquation du terme de « religion » pour englober le tout. Une exception signalée par l’auteur retient l’attention : Diagoras est qualifié d’atheos, ce qui semble frapper ses contemporains de stupeur ; il eût été bon, toutefois, de préciser si cet athéisme désignait un rejet de tous les dieux de la cité, un rejet du divin comme tel ou les deux à la fois ; le « quelque chose d’inouï[9]. » que relève l’auteur aurait gagné à être précisé quant à son objet précis. Nonobstant, donc, le cas de Diagoras, nous pouvons noter une certaine « continuité » (63) de leur pensée articulant une réserve nette à l’endroit des croyances et du contenu de la religion populaire, et un refus tout aussi net de se couper de la tradition, ce qui est marqué par l’emprunt du vocabulaire conceptuel à la « religion » elle-même.
- De l’épicurisme au stoïcisme
La troisième partie de l’ouvrage consacrée à ce que l’auteur appelle les « philosophies hellénistiques » est, à nos yeux, la plus stimulante. D’une part, elle s’ouvre par un panorama historique, permettant de brosser à grands traits l’état des mœurs, de la religion et des cultes ; D. Babut montre avec clarté et efficacité à quel point la religion traditionnelle décline, à quel point se relâchent les liens entre les citoyens et la cité, et comment cela bouleverse la reconnaissance de la théologie venant prendre la place de la religion traditionnelle. Le polythéisme semble en crise, la divination et les cultes officiels tout autant, si bien que l’un des fondements de la cité grecque se trouve ébranlé.
Les épicuriens se distinguent parmi cette période de critique de la religion traditionnelle dont la naissance est expliquée par la terreur engendrée par la nature. La providence elle-même se trouve mise en accusation tandis que la nature apparaît de plus en plus comme le lieu d’une adversité ne contenant rien de bon pour les hommes. Mais, là où excelle l’auteur, c’est dans la restitution des ambiguïtés de la pensée épicurienne qui, d’un côté, semble rompre avec les cultes populaires et la religion traditionnelle et qui, de l’autre, les réactive :
« Ainsi, malgré la condamnation prononcée par Epicure contre les « croyances de la foule » et les mythes propagés par les poètes, sa théologie se révèle, en définitive, beaucoup plus proche de la religion traditionnelle que des conceptions des philosophes : ce n’est pas sans quelque raison que, dès l’Antiquité, certains adversaires en soulignaient le caractère « mythique », et qu’aujourd’hui on a pu y voir une transposition philosophique de la religion olympienne[10]. »
A cet égard, D. Babut montre très bien qu’il y a dans l’épicurisme quelque chose de l’ordre du syncrétisme qui, reprenant ce qu’il y a de meilleur aussi bien dans la religion traditionnelle que dans la théologie platonicienne, vise à purifier ces deux dernières de ce qui en altéraient le sens autant que la santé. Loin de ramener l’épicurisme à une impiété ni à une pensée subversive, l’auteur montre au contraire sa parenté avec les pensées antérieures mais aussi avec la religion traditionnelle avec laquelle la distance est bien moindre que ce qu’il est d’usage de croire :
« Partie d’une critique destructive des « croyances de la foule » et de la religion des philosophes, la philosophie épicurienne de la religion aboutit ainsi à une conception épurée et idéalisée de la piété, qui se révèle étroitement parallèle à celle de philosophes qui ont précédé Epicure, en particulier Platon. Cette concordance ne peut manifestement pas être le fait du hasard[11]. »
Enfin, toujours dans cette troisième partie décidément fort éclairante, l’auteur montre le paradoxe constitutif du stoïcisme : si ce dernier semble, de toutes les philosophies abordées, la plus religieuse en sa nature propre, la religion dont elle est porteuse demeure inidentifiable. Pour le dire autrement, la pensée stoïcienne semble si religieuse en sa structure même qu’il ne paraît plus possible de distinguer ce qui relève de la physique de ce qui relève de l’explication religieuse, à telle enseigne que l’explication scientifique du monde fait appel à une causalité dont la nature entremêle intrinsèquement les deux registres de discours sans qu’une distinction nette ne soit possible :
« Pour les stoïciens, comme pour Aristote, il est permis de dire que la croyance religieuse est devenue totalement indiscernable de l’explication scientifique du monde, et du même coup elle a perdu toute spécificité : dans l’un et l’autre systèmes, on peut considérer que la philosophie est totalement religieuse ou la religion totalement philosophique. (…). Si paradoxal que cela puisse paraître, c’est bien d’Aristote qu’il faut rapprocher la doctrine stoïcienne si l’on veut en comprendre la signification religieuse, alors que, malgré leur opposition apparente, les conceptions du platonisme et de l’épicurisme sont beaucoup plus proches à cet égard. Et la raison profonde de cet état de choses apparaît avec évidence : chez Platon et Epicure, la fusion entre philosophie et religion aboutit à une coloration religieuse de tout le système ; chez Aristote et les stoïciens, en revanche, l’identification du « divin » et du « naturel » conduit inévitablement au résultat inverse : comme dans ces « mélanges totaux » décrits par la physique stoïcienne, la religion se dissout pour ainsi dire totalement dans la représentation philosophique du monde et y perd par là même nécessairement sa qualité spécifique[12]. »
D : La figure socratique et sa reprise platonicienne
Si la troisième partie nous semble excellente, la seconde partie nous apparaît plus délicate dans son traitement de la philosophie classique, alternant passages convaincants et analyses quelque peu indéterminées ; la seconde partie s’ouvre par la figure de Socrate dont l’auteur rappelle avec profit les présentations contradictoires qui en ont été faites dans les sources antiques. Privilégiant toutefois les textes platoniciens, l’auteur essaie de restituer la pensée socratique de la religion, ce qui débouche sur une conclusion passablement complexe, pour ne pas dire confuse :
« Au total, on ne peut nier n’extrême diversité des vues de Socrate, en matière religieuse, ni la complexité de l’image qui s’en dégage: traditionalisme et critique de la tradition, théologie finaliste à la manière ionienne et agnosticisme théologique, monothéisme et polythéisme, religion civique et religion personnelle, prophétisme et rationalisme, tous ces traits semblent coexister dans le portrait que l’Antiquité nous / a légué de Socrate[13]. »
Au risque de nous répéter, cette conclusion nous semble embrouillée faute d’avoir établi des distinctions entre différents domaines – civiques, cultuels, théologiques et philosophiques – à tort écrasés sous l’unique lexique de la « matière religieuse ». Cela est particulièrement sensible lorsque l’auteur fait appel à L’Apologie de Socrate (29d) pour analyser la convocation de dieu contre la cité par Socrate, et interprète en ces termes le passage :
« Pour la première fois, le lien essentiel entre les dieux et la cité se trouve rompu, pour la première fois, le rapport entre l’homme et la divinité ne passe plus par l’intermédiaire obligé de la communauté civique, mais devient direct et personnel[14]. »
Plusieurs points sont ici discutables : d’une part, le passage fait suite à une réflexion sur le démonique, et il n’est pas à exclure que la relation entre Socrate et le divin soit précisément médiatisée par le daimon ; d’autre part, à quoi renvoie la mention du « dieu » en 29 d ? Si c’est le dieu de la cité, alors s’ouvre un hiatus entre le cadre politique et le dieu qui y est associé, hiatus à interroger ; si c’est le divin comme réalité immortelle à laquelle parvient l’âme en sa partie rationnelle, alors il n’y a pas de rapport net avec les dieux de la cité. Enfin, la question du rapport « personnel » mériterait d’être questionné quant au choix de l’adjectif.
En revanche, les passages consacrés aux Lois sont excellents, précisément parce que l’auteur se fait circonspect et rencontre le problème de l’unité de la « matière religieuse », ce qui lui permet de faire surgir de véritables difficultés à partir d’une lecture très serrée, d’abord descriptive, puis interrogative. D. Babut observe que Platon rejette l’allégorie, pour des raisons sociale et théologique. Il rejette la rationalisation des croyances traditionnelles et pourtant il exige leur moralisation. On a enfin un élément curieux : « la critique de la théologie des poètes se conjugue avec une profession d’ignorance de tout ce qui touche à la nature des dieux ; tandis que, par ailleurs, cette sorte d’agnosticisme théologique débouche sur un ralliement formel à la tradition, comme dans le cas de Socrate et de certains sophistes[15]. » De même, Platon rejette toute innovation dans le domaine religieux. En fin de compte, dans les Lois, « la conception platonicienne de la religion [aboutit] à une vision totalement théocentrique de la vie humaine, qui dépasse de loin les exigences de la religion officielle des cités, comme celles de la conscience religieuse populaire de la Grèce antique[16]. » (105)
Une fois cela établi, apparaît l’analyse : la « religion » dans les Lois paraît être le fondement de la moralité et non plus l’inverse : pourtant, dans l’Euthyphron, Socrate montrait que la piété ne devait pas être confondue avec le désir de plaire aux dieux ; pourtant les Lois affirment que la moralité d’un homme dépend de l’opinion qu’il a sur les dieux (X, 888b) Naturellement, tout cela soulève d’énormes difficultés : comment fonder une théologie si les choses divines sont inconnaissables ? Pourquoi attribuer aux dieux les caractères des Formes ? La grande force de Platon est de juger que la vraisemblance joue en faveur des mythes et non contre eux si bien qu’il croit sans doute aux Olympiens mais en fait une forme de divinité peu élevée.
« Le recours à la tradition n’implique en aucune façon une subordination de la philosophie à la religion, mais plutôt le moyen le plus adéquat de se conformer aux données objectives du problème religieux. Quoi qu’on en ait dit, il n’y a pas de conflit entre raison et foi, car l’une et l’autre conservent leur valeur, mais sur des plans différents. En bref, Platon ne rejette ni n’accepte inconditionnellement les croyances traditionnelles, il les intègre dans sa vision du monde, il les « récupère »[17]… »
Nonobstant nos réserves sur cette présentation de l’alternative selon la lexicologie de la foi et de la raison, il nous apparaît que l’auteur fait face à de réelles difficultés sans chercher à les dissimuler ; naturellement, l’écrasement sous le lexique religieux accroît artificiellement quelque peu les problèmes mais la nature du discours platonicien, notamment dans les Lois, est objectivement délicate à établir. La place de la spiritualisation, des cultes, des rites, du politique semble se disputer selon les passages une certaine primauté, et ce n’est pas le moindre des mérites de l’auteur que de le faire remarquer. De surcroît, la conclusion faisant de la « sagesse » au sens sacré du terme le terme de la philosophie platonicienne nous semble extrêmement juste, ce qui amène à penser que la philosophie comme telle n’est jamais qu’un élément subordonné à une entreprise destinée à établir la ressemblance au divin.
E : Réflexions générales sur l’ouvrage
Le premier élément très problématique est celui du choix du terme « religion » ; le risque est grand de plaquer sur l’Antiquité un terme qui a pris son essor pour le christianisme et d’utiliser ainsi un lexique qui occulte davantage qu’il n’éclaire les pratiques effectives du monde antique ; on sait par exemple, que dans Le Dictionnaire de l’Antiquité dirigé par Jean Leclant[18], les auteurs refusèrent de faire figurer une entrée « religion », et choisirent sans doute à juste titre d’y préférer la notion de « culte », elle-même segmentée selon les différentes civilisations abordées. Fait significatif : la seule entrée « religion » du Dictionnaire de l’Antiquité est consacrée à la « religion révélée » s’opposant à la manifestation du sacré envisagée par les cultes antiques. Ainsi, lorsque D. Babut parle de « religion traditionnelle », sans doute faut-il y entendre l’idée de culte par lequel sont établies des relations avec le sacré, relations dont rien ne dit qu’elles sont de nature religieuse au sens monothéiste du terme. En somme, on peut regretter que l’ouvrage ne réfléchisse pas davantage le choix du terme de « religion » et ne justifie pas ce choix plutôt que celui de culte.
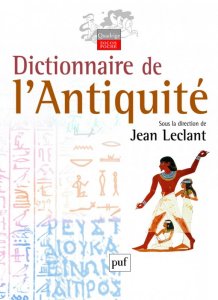
Le problème se redouble lorsque l’objet même de la religion est interrogé ; il n’est pas du tout certain, en effet, que la réflexion de nombre de philosophes sur le « divin » soit du même ordre que celle qu’ils vont consacrer à la pratique sociale du culte ou encore à l’analyse du discours mythologique ; ce sont là trois choses différentes qui ne peuvent pas se laisser subsumer sans justification sous le terme de « religion », fût-elle qualifiée de « traditionnelle ». Allons même plus loin : on ne voit absolument pas ce que le dieu d’Aristote peut avoir de religieux et, à vrai dire, on ne voit pas bien ce que la théologie aristotélicienne a de commun, thématiquement parlant, avec le discours de Xénophane critiquant l’immortalité des dieux d’Homère ou d’Hésiode ; à cet égard, l’unité même de l’ouvrage nous semble quelque peu discutable.
De surcroît, la thèse qui parcourt l’ouvrage est continuiste : à cet égard, la conclusion explicite les intentions du livre ; certes, des contradictions se manifestent entre auteurs mais celles-ci étaient conscientes et peut-être même aurait-on davantage de continuité entre eux qu’une approche superficielle le laisserait croire : mieux, à en croire D. Babut, on observe une « extraordinaire continuité qui s’y manifeste presque d’un bout à l’autre de son histoire[19]. » Manière de dire que les divergences y seraient moins essentielles que les accords ; mais quel est l’objet ici des divergences et des accords ? S’agit-il du rapport au divin comme tel, de la théologie, de la mythologie ou des cultes traditionnels, ce que l’auteur appelle la « religion traditionnelle » ? Sans aucun doute, D. Babut songe au culte, aux pratiques sociales et à la distance que le philosophe doit prendre à leur endroit sans pour autant miner les fondements de l’unité civique ; cela est très clair dans de nombreuses reprises synthétiques de la conclusion :
« L’attitude de la quasi-totalité des philosophes grecs face au problème religieux peut en effet se définir par un double refus, celui de se couper totalement de la religion civique traditionnelle, et celui d’en accepter inconditionnellement les exigences ou les implications[20]. »
On voit ici l’aspect politique et civique de la question et l’on ne voit pas bien pourquoi cela serait lié à une théologie qui, quelques lignes plus bas apparaît comme s’il s’agissait pourtant de la même question. Ainsi, le piège du terme « religion » semble se refermer sur la logique même de l’ouvrage : en effet, l’auteur semble y déposer tout ce que l’on y met depuis l’apogée du monde moderne, c’est-à-dire tout ce que « la » science moderne méprise ou refuse de traiter : divination, nature du divin et théologie, cultes, etc. Autrement dit, l’auteur présuppose la distinction moderne du naturel, objet de science, et du « surnaturel » qui désignerait l’objet de la religion, et cette présupposition permet d’unifier à nos yeux artificiellement l’ensemble des phénomènes dits religieux, ce qui conduit inéluctablement à une série d’indistinctions structurelles de l’ouvrage. Cela est patent dès l’introduction où la formulation de certaines thèses accuse la projection du religieux moderne sur la pensée antique : d’une part, en s’appuyant sur Plutarque (Vie de Périclès, 6, 4-5), l’auteur remarque que la question de la divination est intégrée à la philosophie, tout comme l’est la question de l’intervention des dieux ; certes, par ce biais l’auteur montre que l’opposition entre le discours « rationnel » et le discours sur la divination et sur les dieux n’a pas cours chez Plutarque ; mais pourquoi n’a-t-il pas cours ? Parce que la distinction naturel / surnaturel n’a pas elle-même de sens, si bien que le domaine du « religieux » ne peut pas s’indexer sur le domaine de ce que nous appelons aujourd’hui le « surnaturel ». D’autre part, D. Babut affirme que l’on a un paradoxe avec la philosophie grecque : d’un côté elle semble critiquer la vision religieuse du monde, et de l’autre elle culmine souvent dans une théologie. Mais où est le paradoxe ? Il n’y aurait de paradoxe que s’il y avait un lien entre la théologie et ce que l’auteur appelle une « vision religieuse du monde », c’est-à-dire au fond une sorte de culte socialement établi et traditionnel ; or il n’y a pas de liens nets entre les deux, et seule la projection de la notion moderne de religion comme fourre-tout indéterminé fait apparaître une forme de paradoxe voire de contradiction.
Conclusion
La découverte de l’ouvrage ne va pas sans paradoxes ; agréable de lecture, instructif à certains égards, déroutant à d’autres, il pèche sans doute par excès de description et défaut de réflexivité. Mais cette portée descriptive véhicule nombre d’informations et permet à qui souhaiterait découvrir la philosophie antique d’apprendre nombre de données fort clairement exposées. Nonobstant cette vertu, plusieurs éléments évoqués dans notre 5ème partie grèvent le projet général du livre et en réduisent la portée.
[1] Daniel Babut, La religion des philosophes grecs, Paris, les Belles Lettres, 2019.
[2] Recension de Robert Joly dans L’Antiquité classique, année 1975, 44-1, p. 331.
[3] Babut, op. cit., p. 15.
[4] Cf. La longue présentation de Cicéron dans De la nature des dieux, XIII.
[5] Ibid., p. 98.
[6] Ibid., p. 27.
[7] Ibid., p. 29.
[8] Ibid., p. 33.
[9] Ibid., p 61.
[10] Ibid., p. 189.
[11] Ibid., p. 198.
[12] Ibid., p. 238.
[13] Ibid., p. 83-84.
[14] Ibid., p. 76.
[15] Ibid, p. 101.
[16] Ibid., p. 105.
[17] Ibid., p. 110.
[18] Cf. Jean Leclant (dir.), Dictionnaire de l’Antiquité, Paris, PUF, coll. Quadrige, 2011².
[19] Babut, op. cit., p. 241.
[20] Ibid., p. 243.