L’ouvrage de Cristian Ciocan1 aborde ce qui est sans conteste « l’un des thèmes centraux d’Être et temps » ; comme le souligne à juste titre l’auteur, la place centrale du phénomène de la mort dans l’opus magnum de Heidegger est le corollaire de sa centralité dans l’existence du Dasein : la mort est, en effet, « le noyau le plus profond de l’existence déterminée comme mienne » (p. 3). C’est, plus précisément, en tant qu’elle relève « uniquement de l’être-possible du Dasein toujours propre » et ne se réduit pas à « quelque chose de factuel » (p. 3), que la mort joue un rôle crucial à l’intérieur d’une analytique de l’existence. En tant qu’il représente « le contre-mouvement facticiel qui amène le Dasein à modaliser son existence en dehors de l’authenticité » et « donne au Dasein cette force anti-gravitationnelle qui lui permet de s’arracher de l’absorption mondaine pour revenir à soi en tant que soi », le rapport à la mort peut en effet fonctionner comme le « pivot existential de l’existence du Dasein» (p. 4).
Si l’entreprise de Cristian Ciocan est parfaitement lucide eu égard à ses enjeux thématiques insignes, elle se distingue des approches antérieures de cette thématique fondamentale – par exemple, de celle qu’illustre le petit ouvrage classique de Françoise Dastur : La Mort : essai sur la finitude – par l’adoption d’un angle d’attaque inédit qui s’avère particulièrement fécond : elle voit d’abord dans le traitement heideggérien de la mort la solution à un « problème méthodologique décisif : la nécessité d’élaborer conceptuellement une totalité propre à l’être du Dasein » (p. 7) et reste de part en part attentive à la spécificité méthodologique de la démarche heideggérienne. En témoigne surtout l’agencement de la première partie, où l’auteur épouse, de son propre aveu, une « perspective systématique » (p. 9). En effet, après un bref premier chapitre qui cerne « Le lieu du problème de la mort dans Être et temps » et tente de fournir une première évaluation de la part qui revient respectivement à la « phénoménologie descriptive » (par l’analyse de l’être pour la mort dans la quotidienneté) et à la « phénoménologie constructive » (p. 20) (par l’analyse de l’être pour la mort authentique) dans la démarche de Heidegger, l’enquête se poursuit, d’une façon qui pourrait surprendre, par des « prolégomènes » (p. 85) qui différent l’approche frontale de la « chose même », en s’attaquant à la question épineuse de savoir « Qu’est-ce qu’un Existenzial ? » (chapitre 2). Plus précisément, il s’agit d’établir « si toutes les structures engagées par l’analytique existentiale […], ‘existentiales’ en un sens adjectival, sont […] aussi des ‘existentiaux’ (en un sens nominal) » (p. 21). Après avoir fourni (p. 22) une liste des structures qui sont expressément rangées par Heidegger dans la rubrique des existentiaux, l’auteur interroge avec justesse le sens de certaines omissions qui pourraient étonner, comme par exemple le fait que « de l’être-au-monde […] Heidegger ne dit jamais qu’il est un existential », et de même pour le souci (p. 24), le monde (p. 27), la spatialité (p. 28), le Mitsein (p. 29) ou encore l’ipséité ou l’être-soi (p. 33). Or, comme le souligne à juste titre C. Ciocan, ces omissions ne se justifient pas toujours : par exemple, « le Mitsein a toutes les caractéristiques essentielles d’un existential » (p. 32), et il en est de même pour le soi (Selbst), surtout si l’on pense au fait que le titre d’existential revient bien au On (das Man)
Le caractère systématique et proprement exhaustif de la typologie heideggérienne des existentiaux se trouve ainsi implicitement mis en doute, même si l’auteur a parfois tendance à entériner les difficultés qu’engendre le caractère inévitablement « rhapsodique » de cette typologie. Une autre question fondamentale qui est en outre abordée est celle des relations hiérarchiques de fondation et de subordination qui se laissent établir entre les différents existentiaux. À ce niveau encore, on pourrait relever quelques difficultés incontournables, comme la contradiction manifeste (que l’auteur ne mentionne pas en tant que telle) entre la place architectonique de la « possibilité comme existential subordonné au comprendre » (p. 42) et le statut de « détermination ontologique positive ultime et la plus originaire du Dasein» qu’Être et temps reconnaît à l’existential de la possibilité (Sein und Zeit, p. 143-144). Un autre problème éloquent est posé par la supposée co-originarité entre le parler et le comprendre, démentie pourtant dans une certaine mesure par le fait que « le parler présuppose le comprendre » (p. 52). Ces difficultés mettent devant la nécessité de trancher, de statuer sur l’édifice architectonique des existentiaux : c’est ce que l’auteur fait en émettant l’hypothèse d’une « circularité ontologique essentielle » de l’être du Dasein, circularité se reflétant « dans l’articulation des existentiaux » et expliquant, d’une part, l’ambivalence qui touche certaines de leurs relations de fondation et, d’autre part, l’absence apparente de « frontières nettes » (p. 53) entre certains d’entre eux.
Cependant, la démarche de l’auteur dans ce chapitre traitant du sens de l’existential manifeste malgré tout une certaine passion de l’aporie, en relançant sans cesse la question de savoir « ce qui distingue les existentiaux par rapport aux autres concepts qui, tout en étant à la mesure du Dasein (daseinsmässig), ne sont pas, précisément, des Existentialen » (p. 64). Il est en effet montré que la pertinence explicative du parallélisme entre l’existential et la catégorie est limitée, dans la mesure où il n’y a pas de correspondance rigoureuse entre ces deux types de structures (p. 65). Plus encore, la tentative de comprendre l’existential comme identique au « caractère d’être du Dasein» échoue à son tour, ce dernier étant visiblement plus large et englobant des déterminations qui ne reçoivent jamais le titre d’existential – même si, par ailleurs, « certains existentiaux sont déterminés comme guise fondamentale (Grundart) du Dasein» (p. 68). Mais finalement, le biais choisi pour préciser et caractériser positivement le statut des existentiaux a quelque chose de surprenant, dans la mesure où il entérine le rapprochement avec la catégorie plus qu’il ne le disqualifie ; l’auteur écrit ainsi : « Il semble que les traits les plus non-problématiques des existentiaux soient leur caractère apriorique et transcendantal » (p. 72). Cette caractérisation, dut-elle avoir sa part de justesse, peut donner l’impression de finir par rabattre l’analytique existentiale sur une analytique transcendantale des concepts. Et en effet, le rapprochement ne peut manquer de s’imposer : « Étant essentiellement apriorique, la démarche heideggérienne est inévitablement placée dans la descendance du projet apriorique kantien-husserlien de la philosophie européenne » (p. 72). Cette filiation qui n’est certes pas dépourvue de toute légitimité ne saurait malgré tout rendre compte de la spécificité d’une analytique proprement existentiale et du caractère sui generis de ces déterminations de l’existence – les Existenzialen – qui restent éloignées de tout concept kantien ou husserlien. Si, en effet, « le projet heideggérien est un projet transcendantaliste » (p. 72), il faut ajouter à cela tout l’écart qui sépare la possibilisation (des objets) de l’expérience (dont la visée reste gnoséologique) et la possibilisation de l’existence. À la question, que pose l’auteur, de savoir si « la constitution du Dasein est […] une reformulation de la subjectivité transcendantale-apriorique kantienne-husserlienne », la réponse ne saurait donc être positive : « Si Heidegger peut être rattaché au filon apriorique-transcendantaliste de la philosophie moderne, nous ne pouvons en dire autant concernant le filon subjectiviste » (p. 73).
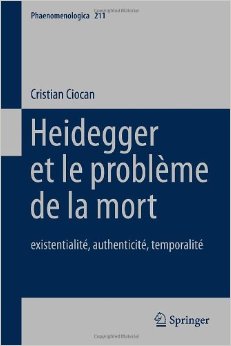
En se penchant sur les difficultés que présente la conception heideggérienne des existentiaux, l’auteur ne se borne toutefois pas à relever les apories, mais propose aussi parfois certains correctifs : ainsi, par exemple, lorsque, en conformité avec la neutralité ontique qui revient presque toujours aux existentiaux, il se demande « s’il ne serait pas plus adéquat que le Soi, dans sa neutralité formelle, soit considéré comme un Existential capable de se concrétiser au niveau existentiel » plutôt que le On (p. 74). C. Ciocan montre également que la tension « entre l’idée de fondation et l’idée de co-originarité » ne saurait se laisser résorber sans reste, même si l’hypothèse d’une « hiérarchie dans le cadre des existentiaux » (p. 76) est à son tour problématique. Toutes ces difficultés ne trouvent donc pas de véritable résolution, et la conclusion de ce chapitre propédeutique en témoigne : « Le concept d’existential se détermine comme concept aporétique, réfractaire à tout effort visant à le définir d’une manière appliquée et rigoureuse », dans la mesure où il s’agit d’« un concept dynamique, mobile, qui ne se laisse pas fixer en une seule définition » (p. 83). Finalement, le problème du statut exact de l’existential se trouve dissous dans une question plus large et donc moins précise : « ne devons-nous pas penser que la spécificité des concepts phénoménologiques consiste à échapper à toute tentative de les réduire aux contenus figés, spécifiques aux concepts métaphysiques ? » ; ou, plus précisément encore : « comment faut-il penser et élaborer la différence entre la conceptualité spécifiquement phénoménologique, qui surprendrait la vie dans son originarité réfractaire à toute systématisation (comme indications formelles, par exemple), et la conceptualité spécifiquement métaphysique, qui serait, par nature, immobile et fixée sur son contenu ? » (p. 83). Il est étonnant de constater que la suggestion contenue dans cette dernière question, qui reviendrait à lire les existentiaux comme des indications formelles des phénomènes concrets de l’existence, est lancée en ce moment conclusif de l’analyse sans être vraiment explorée, et que donc les profits du dispositif de l’indication formelle (qui, tel qu’il sera exposé par la suite, p. 205-206, permettrait sans doute de préciser le type d’apriorité mis en jeu par les existentiaux) ne sont jamais tirés.
Mais tout cela ne relève, comme l’auteur l’avoue, que de « prolégomènes » dont le caractère « labyrinthique » est ouvertement assumé et qui accomplissent « une exploration préalable, en mesure de déblayer, en quelque sorte, le territoire tellement accidenté de l’analytique existentiale » (p. 85). En en venant aux « choses elles-mêmes », la deuxième partie de l’ouvrage de C. Ciocan expose l’« Itinéraire structurel du phénomène de la mort », itinéraire qui commence, au chapitre 4, avec l’analyse du rapport entre « La mort, la totalité et les autres ». C’est dans ce chapitre que la spécificité de la démarche de l’auteur s’illustre sans doute au mieux, dans la mesure où la fonction de l’être pour la mort y est lue à travers le prisme du postulat méthodologique de la totalité : « Par l’approche du phénomène de la mort, Heidegger essaiera de résoudre précisément cette contradiction entre le concept existential de totalité (le souci) et le concept existentiel de totalité (être entre naissance et mort) » (p. 88). Autrement dit, c’est la manière dont la totalité ontique du Dasein (l’unité de son existence) est ressaisie du point de vue de sa signification ontologique qui assigne sa fonction décisive au Sein zum Tode. L’auteur y insiste : « C’est de cette manière (formelle, technique, méthodologique) que le phénomène de la mort entre dans le contexte de l’analytique existentiale » (p. 89), et c’est là que se trouve la justification de son approche qui est elle-même méthodologique et formelle.
Armé de cette vision de la place architectonique de l’être pour la mort, l’auteur est en mesure de proposer un brillant commentaire d’un moment de l’élaboration de l’analytique existentiale dont l’importance a été trop rarement reconnue : l’entreprise du § 48, visant à « déconstruire » la notion impropre de totalité « forgée par la notion de reste » (p. 91). La démarche remarquable de ce paragraphe étrange est décrite avec justesse en termes de « variation eidétique inversée » visant à « concrétiser l’eidos catégorial de la totalité et de la fin en fonction d’un domaine de réalité ou d’un autre » (p. 92). Nous avons là également, comme l’auteur le souligne dans le sillage des analyses de Einar Øverenget, le plus bel échantillon de la « méréologie heideggérienne » (p. 93), selon une caractérisation qui insiste sur le fait que « le problème heideggérien de la totalité s’enracine dans la théorie husserlienne du tout et des parties » (p. 99). Notons au passage que cette attention au rôle cardinal, quoique parfois inapparent, de la méréologie husserlienne dans l’élaboration de l’analytique existentiale et pour la thématisation de son objet a été également souligné, récemment, par l’ouvrage de Laurent Villevieille : Heidegger et l’indétermination d’Etre et temps[On peut en lire la recension à [cette adresse.[/efn_note] (Paris, Hermann, 2014), dont l’approche est, dans ce qu’elle a d’original, à maints égards proche de celle du livre de C. Ciocan (et ce, sans que l’on puisse parler d’une quelconque influence de l’un sur l’autre).
Un autre moment fort de l’ouvrage est représenté par la discussion de la question de l’altérité dans Être et temps à l’aune d’un questionnement très précis : « En quel sens le phénomène de la mort est-il constitué par l’être-avec du Dasein ? Comment l’altérité structure-t-elle le champ polymorphe de la phénoménologie de la mort ? » (p. 100). L’auteur évoque la critique de Levinas selon laquelle le cadre posé par l’analytique existentiale rend inconcevable une expérience authentique de l’altérité, et souscrit jusqu’à un certain point à cette critique en reconnaissant que, dans la mesure où « la perspective heideggérienne est dès le début orientée par l’exigence de comprendre non pas la mort de l’autre, mais la mort propre » (p. 100), « le statut de l’altérité est inévitablement miné » (p. 104). Plus précisément, la mort telle que la pense Heidegger « est une possibilité non-relationnelle […] qui efface toute relation à l’autre » (p. 104). En ce point précis se manifeste encore une fois le souci de l’auteur de compléter, voire de corriger les avancées heideggériennes, en proposant de « concevoir un authentique être-avec-l’autre devant la mort » sans cependant « abandonner les cadres de l’analytique existentiale » – donc sans forcément suivre Levinas sur sa propre voie – en tirant profit de l’indication selon laquelle il y a bien une forme de sollicitude devançante et libératrice (et non pas substitutive et dominatrice) qui « authentifie la mort de l’autre » (p. 108). Cela pourrait en effet permettre de répondre aux « exigences pressantes d’une éthique fondamentale où la vie et la mort du prochain prennent un rôle fondateur » (p. 108) : nous le comprenons, il s’agit ici d’un correctif dont l’inspiration reste levinassienne mais que l’auteur prend cependant soin d’extraire, pour ainsi dire, des ressources internes de l’analytique existentiale.
Après l’analyse passionnante guidée par les questions de la totalité et de l’altérité, l’enquête reprend un cours plus linéaire en se penchant, au chapitre 5, sur l’ensemble de la première section d’Être et temps, par un parcours intitulé « La mort à travers l’ouverture du Dasein». Ce parcours examine successivement la manière dont les différentes structures existentiales exposées dans la première séquence de l’analytique existentiale, et notamment l’affection, le comprendre et la parole, façonnent et sont façonnées en retour par l’être pour la mort : il consiste donc à opérer, comme le dira plus tard l’auteur, des « radiographies du phénomène de la mort […] à partir de ces structures fondamentales du Daseinqui sont révélées par la première section de Sein und Zeit » (p. 141). Ces analyses occasionnent de nouvelles propositions d’amendements, par exemple lorsque l’auteur se demande si les termes de « mystère » ou d’« inconnu » ne sont pas « phénoménologiquement plus adéquats » pour décrire ce qui vient « après la mort » (p. 118), ou encore lorsque, après avoir noté que « Heidegger ne met en jeu que la modalité inauthentique du parler sur la mort » (p. 128-129), il suggère que « le mode authentique du parler à l’égard de la mort pourrait être ‘déduit’ ou ‘reconstruit’ par le renversement de la manière inauthentique que cet existential revêt dans la quotidienneté du Dasein» (p. 129). En même temps, la vertu qu’a l’analyse heideggérienne de « faire exploser le conventionnalisme affectif […] devant la mort » (p. 127), c’est-à-dire d’empêcher « la transformation de l’angoisse en peur, et de la peur en indifférence » (p. 130) se trouve mise en avant afin de souligner ce que la récusation heideggérienne de la peur de la mort (dont le précédent socratique est brièvement évoqué) a de spécifique. L’auteur insiste à juste titre sur la destitution qu’opère Heidegger d’une « une vision généraliste de la mort », comme celle qu’exprime le syllogisme canonique de la logique classique et selon laquelle « la mort appartient d’abord au genre humain, et seulement ensuite à un individu, autre que moi, que l’on appelle Socrate » : bien au contraire, il importe de saisir la mort « dans ce qu’elle a de plus individuel et de plus individualisant » (p. 137). Il en découle un « changement radical de paradigme dans l’interprétation de la subjectivité », qui revient à passer « de la subjectivité cogitative, fondamentalement cognitive, déterminée par la raison, la connaissance, le savoir et la science, à la subjectivité comme finitude, comme charge existentiale à soi-même » (p. 138) : c’est dans ces termes que l’auteur saisit la reformulation du cogito cartésien en moribundus sum.
Le chapitre 6 continue à épouser le mouvement du « forage en spirale opéré par la recherche heideggérienne » (p. 143) en examinant, comme son titre l’indique, « La mort à travers la deuxième section de Sein und Zeit ». S’il avait déjà été conduit à parler d’une tâche « constructive » de l’entreprise heideggérienne, consistant à « élaborer phénoménologiquement un mode possible dans lequel l’étant puisse sauter de la modalité inauthentique de comprendre la mort à la modalité authentique » (p. 113), à l’orée de ces nouvelles analyses l’auteur interprète cette « tendance constructiviste » dans le sens d’un « désir de construire les choses de telle manière que le schéma conceptuel préétabli ‘force’ les phénomènes » (p. 145). L’on pourrait regretter, dans cette perspective, que la part et l’articulation de la description et de la construction dans la démarche heideggérienne ne soient pas davantage analysées, et que donc, dans ces deux chapitres qui suivent le fil du texte, l’attention portée à l’aspect méthodologique soit finalement moins marquée que dans le chapitre 4. En se penchant sur la deuxième section d’Être et temps, l’intérêt principal consiste à montrer que « la mort occupe un rôle de premier ordre dans le déploiement du problème de la temporalité » (p. 151), et plus précisément que la « dégénérescence » ontologique de la temporalité non-originaire à partir de la temporalité originaire ne s’accomplit pas sans l’intervention du phénomène de la mort, plus précisément sans la modalisation inauthentique de l’être pour la mort » (p. 155). C’est là une nouvelle et dernière forme que prend l’objectif d’« éclairer, pleinement et à nouveaux frais, l’articulation des structures ontologiques du Dasein » et d’en opérer donc la « radiographie structurelle » (p. 163).
En revanche, la troisième partie de l’ouvrage échange la perspective structurelle ou systématique pour une perspective historique à double orientation, car intéressée à la fois par « la genèse du problème de la mort avant Être et temps » et par son « évolution […] après l’époque de l’ontologie fondamentale, jusque dans la période tardive de la pensée heideggérienne » (p. 163). Cet agencement pourrait à son tour surprendre : si l’on comprend aisément pourquoi la postérité du Sein zum Tode après Être et temps ne pouvait pas être abordée avant, il est moins évident en quoi il est judicieux de faire du moment « génétique » de l’analyse un moment à son tour postérieur. Ce choix se dévoile, au début du chapitre 7 consacré à « La genèse du problème de la mort dans la pensée du jeune Heidegger », comme étant commandé par un parti-pris herméneutique ferme : celui selon lequel, du moins lorsqu’il s’agit de la thématique de la mort, « la genèse n’est compréhensible que dans la lumière de la révélation finale » (p. 167). Cette assertion (dont l’auteur n’affirme pourtant à aucun moment la validité générale) parle en faveur d’une manière de lire le jeune Heidegger qui se situe aux antipodes de celle illustrée, par exemple, par l’ouvrage récent de Sophie-Jan Arrien : L’inquiétude de la pensée. L’herméneutique de la vie du jeune Heidegger (1919-1923) (Paris, PUF, 2014), qui voit dans la pensée de Heidegger avant Sein und Zeit « un projet philosophique autonome et original ». Par contraste, l’optique téléologique, pour ainsi dire, du chapitre que C. Ciocan consacre à la genèse du problème de la mort avant Être et temps ne saurait viser ou permettre, sur ce problème précis, quelque chose comme une lecture immanente des écrits du jeune Heidegger : dans les cours élaborant une phénoménologie de la vie religieuse (GA 60), il s’agit de repérer « l’inspiration première à partir de laquelle Heidegger élaborera, par des formalisations et des ontologisations successives, la structure de l’être pour la mort » (p. 168-169), du fait du « parallélisme structurel de l’attente de la parousie et du Sein zum Tode » (p. 169). Semblablement, le cours de 1922 (GA 62) permet de découvrir la « fonction ontologique capitale » de la mort, celle de « contrecarre[r] la tendance interne de la vie facticielle à être absorbée dans le Was » (p. 173), alors que dans la conférence de 1924 portant sur « Le concept de temps » se met en place « la connexion fondamentale entre la mort et la totalité » (p. 179) et surgit pour la première fois l’approche de la mort en termes de possibilité. À une seule occasion, l’auteur relève une avancée dont la radicalité est supérieure à celle des thématisations d’Être et temps, à savoir la manière dont, dans le traité de 1924 : Le concept de temps, Heidegger va « jusqu’à considérer la mort comme la constitution d’être la plus originaire du Dasein » (p. 182), caractérisation que l’opus magnum de 1927 n’égalera pas. Enfin, le cours de 1925 : Prolégomènes à l’histoire du concept de temps apporte à son tour quelque chose de « réellement nouveau et novateur », à savoir « la référence à la problématique de l’angoisse » (p. 194). Ce chapitre génétique pourrait donner l’impression d’avoir une fonction simplement informative, dans la mesure où la signification des ces différents aspects de l’être pour la mort est considérée (rétrospectivement) comme acquise et, par conséquent, n’est jamais véritablement analysée dans son contexte d’émergence. Mais il faut cependant saluer le souci d’exhaustivité et l’acribie impressionnante de la démarche archéologique (à maints égards sans précédent) qui s’y déploie et qui évite constamment les inconvénients du regard de survol. D’autre part, le bilan des « innovations » qu’apporte dans la matière l’ouvrage de 1927, bilan proposé à la fin de ce chapitre, pourrait sembler un peu schématique et trop peu développé, car il laisse inévitablement le lecteur sur sa faim à propos de certains thèmes qui sont simplement mentionnés (comme, par exemple, « l’idée nietzschéenne de la “liberté pour la mort” », qui apparaît pour la première et dernière fois à la page 196).
Après la genèse, la postérité : tel sera l’objet du chapitre 8, portant sur « L’évolution du problème de la mort après Être et temps ». Si l’agencement des chapitres de l’ouvrage que nous examinons permet à lui seul d’affirmer que, selon l’auteur, c’est dans Sein und Zeit que se trouve le noyau de la pensée heideggérienne de la mort, C. Ciocan admet cependant que cette pensée connaît, après 1927, « un véritable approfondissement » (p. 199), voire qu’« en dépit des apparences, […] la portée philosophique de la mort est encore plus radicale dans les textes du deuxième Heidegger » (p. 200), diagnostic qui nous semble profondément pertinent. En effet, sans plus se limiter à fonctionner comme le centre de gravité de l’existence, dans la pensée postérieure de Heidegger « la mort se révélera finalement constitutive de la relation même entre l’homme et l’être » (p. 200). L’auteur montre que cet infléchissement n’est pas sans rapport avec la nécessité où se trouve le philosophe de Meßkirch, à la fin des années 20, d’écarter deux mésinterprétations : aussi bien celle « qui minimise l’importance et la signification de la mort pour l’existence du Dasein » et celle qui y voit le symptôme d’une « “vision du monde” pessimiste » (p. 203) ou de quelque chose comme une « “métaphysique de la mort” » (p. 201). La portée de ces mésinterprétations est manifestement de taille et revient à suggérer que « la compréhension authentique de l’ontologie fondamentale dépend de l’interprétation correcte du phénomène de la mort » (p. 208). Plus que ne l’avait fait Être et temps, le Heidegger des années 30 insistera sur la fonction hautement ontologique (et non plus seulement existentiale) de la mort, en tant qu’« élément de médiation entre l’être et le rien » (p. 209). Le « rapport entre la philosophie et la mort » (p. 219), présent seulement en filigrane dans l’opus magnum de 1927, connaîtra à son tour des thématisations explicites (par exemple, dans le cours sur Platon de 1931-32) allant dans un sens bien précis : « Le philosophe authentique (et, un peu plus tard, le poète authentique) doit être le plus mortel des mortels, le plus exposé à son essence mortelle », ce qui revient à affirmer la « vocation sacrificielle et messianique de la philosophie » (p. 222). Mais le sommet de cette méditation renouvelée de l’essence de la mort est représenté par les Beiträge zur Philosophie, qui reçoivent ainsi une attention particulière de la part de l’auteur. Il s’agit notamment d’élucider cette assertion fondamentale selon laquelle « la mort est la plus haute et la plus intime attestation de l’estre » (p. 228). Inscrit dans la pensée de l’Ereignis comme vérité de l’estre (Seyn), le Sein zum Tode sera pourvu d’« une certaine dimension « “eschatologique”, préparant une nouvelle pensée, un nouveau commencement » (p. 232). Par ailleurs, très représentative de l’attention au détail qui anime la démarche de l’auteur est l’élucidation d’une caractérisation énigmatique (présente à la page 282 des Beiträge) de la mort comme « aiguillon (Stachel) » (p. 237), pour montrer qu’il s’agit sans doute d’un emprunt implicite à… la première Épître aux Corinthiens (15, 55-56) !
Si les Contributions à la philosophie continuent à inscrire le problème de la mort dans l’horizon de la « coappartenance de l’être et du rien » (p. 236), après la guerre, la « rencontre de la pensée heideggérienne avec la poésie de Hölderlin et celle de Rilke » lui prescrit « une nouvelle syntaxe interprétative » (p. 239) : l’« assomption radicale de la mortalité », d’apanage des philosophes, devient le « lot des poètes véritables », qui seront donc compris selon « le paradigme du sacrifice de soi » (p. 241). Plus loin encore, dans la mesure où « le rapport à la mort ouvre la dimension essentielle de l’existence » (p. 244), c’est par lui que se trouve également délimitée « la différence entre l’homme et l’animal » (p. 246). Cependant, la fin de ce chapitre passionnant risque de laisser encore une fois le lecteur sur sa faim, en n’évoquant que très rapidement « la relation entre la mort, la poésie et la parole » (p. 249). Il nous semble en effet qu’une thèse cruciale comme celle selon laquelle « ce n’est qu’à partir de l’horizon de la parole que la mortalité de l’homme peut être expérimentée » aurait certainement eu besoin d’une justification plus ample. Et il aurait été sans doute encore plus intéressant de tenter de la mettre en rapport avec l’hypothèse, esquissée au chapitre 5, d’un mode authentique de la parole ou du discours sur la mort.
Nous voici au seuil de la Conclusion de ce livre, qui ne se borne pas à opérer un bilan des résultats, mais propose plutôt un relevé de « difficultés [qui] sont autant de pistes pour de futures recherches » (p. 256). Certaines des indications formulées à cette occasion, comme celle selon laquelle « sa propre mortalité concrète » serait « l’indication formelle du rien (Nichts) » (p. 258) (ce qui revient à ressaisir le phénomène de la mort à la lumière d’une intrication ontico-ontologique qui rend plus problématique, sans doute, son identification à une structure a priori) auraient mérité sans doute d’être explorées davantage dans le corps de l’ouvrage. Mais on ne saurait, en avouant nos quelques attentes déçues, sous-estimer la grande qualité de ce travail qui est assurément à la hauteur de son objet, s’il est vrai que « la question de la mort est à l’économie générale de l’œuvre de Heidegger ce qu’elle est concrètement pour le Dasein : un chemin vers les choses mêmes » (p. 259). Relevons également, pour finir, la présence salutaire de deux annexes contenant, respectivement, une « Bibliographie chronologique du problème heideggérien de la mort (1930-2013) » (p. 261-275) et une « Concordance des termes heideggériens traduits différemment dans les deux versions françaises d’Être et temps » (p. 277-287). C’est cependant, nous l’avons déjà suggéré, par son talent analytique, par son souci correctif et par l’originalité et la minutie de son approche attentive à la forme et à la méthode, que l’ouvrage de Cristian Ciocan apporte une importante et désormais incontournable contribution aux études heideggériennes.








