Leo Strauss, la « question juive », et le problème théologico-politique.
Si Leo Strauss doit une part de sa renommée à la redécouverte de la pertinence et de l’actualité de la pensée politique prémoderne, il n’a eu de cesse de présenter ce « rationalisme grec » (ou « classique », suivant l’usage anglais) accompagné de son « autre », de son alternative fondamentale, la Révélation hébraïque. L’alternative fondamentale au rationalisme ancien n’est pas le rationalisme moderne car celui-ci ne serait qu’une des réponses possibles à cette problématique plus radicale du face-à-face entre la Raison et la Révélation en tant que telles ; de même, la Révélation abrahamique en toute sa pureté telle que Leo Strauss le conçoit est nécessairement hébraïque, puisque le Christianisme est lui aussi, à ses yeux, déjà une tentative de synthèse des deux pôles (il n’en va pas forcément de même pour l’Islam, qui se présente à maints égards, aux yeux de Strauss, comme une sorte d’ersatz du judaïsme). Toute sa pensée a été d’une certaine manière une réactivation de la question posée par Socrate à Ménon : « qu’est-ce que la vertu ? », la question fondamentale que pose la philosophie politique, équivalent classique de la question kantienne « que dois-je faire ? », mais dont la modernité aurait escamoté les deux sources, grecque et juive, pourtant irréductiblement opposées l’une à l’autre :
[S]i nous cherchons la réponse [à la question de savoir ce qu’est la vertu] la plus élaborée et la moins ambiguë à cette question vraiment vitale, nous nous tournerons vers l’Ethique d’Aristote. Nous y lisons entre autres choses qu’il existe une vertu de haut rang appelée la magnanimité – l’habitude de prétendre à de grands honneurs pour soi-même accompagnée de la compréhension que l’on en est digne. Nous y lisons également que le sens de la honte n’est pas une vertu : le sens de la honte convient aux jeunes gens qui, à cause de leur immaturité, ne peuvent éviter de se tromper, mais non aux hommes mûrs et bien-élevés qui font toujours purement et simplement la chose juste et appropriée. Si merveilleux que soit tout cela – un message fort différent nous est parvenu d’une source très différente. Lorsque le prophète Isaïe éprouva sa vocation, il fut submergé par le sentiment de son indignité : « je suis un homme aux lèvres souillées au sein d’un peuple aux lèvres souillées. » Cela revient à une condamnation implicite de la magnanimité et à une défense implicite du sentiment de la honte. La raison en est donnée dans le contexte : « Saint, saint, saint est le seigneur des armées ». Il n’y a pas de dieu saint pour Aristote et en général pour les Grecs. Qui a raison, les Grecs ou les Juifs ? Athènes ou Jérusalem ? Et comment procéder pour découvrir qui a raison ? Ne devons-nous pas admettre que la sagesse humaine est incapable de résoudre cette question et que toute réponse se fonde sur un acte de foi ? Mais est-ce que cela ne reviendrait pas à la défaite totale et ultime d’Athènes ? Car une philosophie fondée sur la foi n’est plus une philosophie. Peut-être fût-ce ce conflit irrésolu qui empêcha la pensée occidentale de se tenir jamais en repos.[1]
La réponse à la question fondamentale de toute philosophie pratique : « comment faut-il vivre ? » avec son corrélat théorique, « qu’est-ce que la vie bonne ? », est donc subordonnée, aux yeux de L. Strauss, à celle qu’on voit énoncée à travers cette alternative : « Qui a raison, les Grecs ou les Juifs ? ». Cette question épistémico-existentielle, qui traverse toute l’œuvre straussienne de façon tantôt explicite, tantôt implicite, est proprement constitutive des limites de la connaissance que l’homme peut avoir de sa nature, de sa situation et de son destin. Mais, si la métonymie « Jérusalem », dans cette alternative, signifie toute la tradition révélée abrahamique, elle désigne en tout premier lieu non seulement la révélation judaïque originaire, mais aussi par extension le peuple lui-même à travers lequel cette révélation a été faite. Ce qui rend ce peule en lui-même le symbole ou même l’incarnation historique concrète de la première des deux options dans l’alternative fondamentale, aux yeux de L. Strauss, mais aussi ce qui rend ce peuple pris ensemble avec les autres peuples et dans ses relations avec eux le signe de cette alternative gnoséologico-politque fondamentale dans son ensemble. Voilà donc pourquoi le « problème juif », ou la « question juive », a été pour Strauss à son tour une métonymie pour le problème théologico-politique en général.
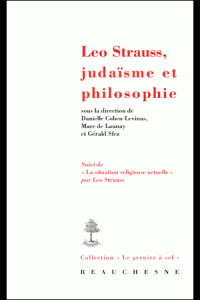 Que cela soit du point de vue autobiographique ou du point de vue proprement conceptuel, donc, la « question juive » a été pour L. Strauss un, sinon le point d’entrée vers sa problématique principale, la querelle des Anciens et de Modernes et le problème théologico-politique. L’idée même de l’existence du peuple juif en tant que « peuple élu » est une extension de l’idée de la validité de la Révélation, et la place de ce peuple à la fois parmi les nations (« goyim ») et dans la modernité est l’objet de la « question juive », qui est donc une extension de la question théologico-politique dans son universalité. Cette « question » se pose en amont de ses multiples « réponses » possibles : théocratique/juive orthodoxe, chrétienne, libérale/républicaine-assimilationniste, antisémite, sioniste, etc. Strauss retrace et reconstitue ce point d’entrée et son rapport à cette question (la question juive en particulier et la question théologico-politique plus largement) dans sa fameuse « Préface » de 1962 à la traduction anglaise de son premier livre, Spinozas Religionskritik (1930), qui est une véritable autobiographie intellectuelle. C’est cette même année qu’il donna sa conférence « Pourquoi nous restons juifs » à l’association des étudiants juifs de l’Université de Chicago. Celle-ci est la plus concrètement politique et le plus frontal de ses traitements de la question. Elle est aussi l’une des analyses les plus abouties et cohérentes de la condition du peuple juif dans le monde moderne et donc de la question juive, et aussi, en passant, le plaidoyer le plus conséquent en faveur de la solution sioniste à cette question.
Que cela soit du point de vue autobiographique ou du point de vue proprement conceptuel, donc, la « question juive » a été pour L. Strauss un, sinon le point d’entrée vers sa problématique principale, la querelle des Anciens et de Modernes et le problème théologico-politique. L’idée même de l’existence du peuple juif en tant que « peuple élu » est une extension de l’idée de la validité de la Révélation, et la place de ce peuple à la fois parmi les nations (« goyim ») et dans la modernité est l’objet de la « question juive », qui est donc une extension de la question théologico-politique dans son universalité. Cette « question » se pose en amont de ses multiples « réponses » possibles : théocratique/juive orthodoxe, chrétienne, libérale/républicaine-assimilationniste, antisémite, sioniste, etc. Strauss retrace et reconstitue ce point d’entrée et son rapport à cette question (la question juive en particulier et la question théologico-politique plus largement) dans sa fameuse « Préface » de 1962 à la traduction anglaise de son premier livre, Spinozas Religionskritik (1930), qui est une véritable autobiographie intellectuelle. C’est cette même année qu’il donna sa conférence « Pourquoi nous restons juifs » à l’association des étudiants juifs de l’Université de Chicago. Celle-ci est la plus concrètement politique et le plus frontal de ses traitements de la question. Elle est aussi l’une des analyses les plus abouties et cohérentes de la condition du peuple juif dans le monde moderne et donc de la question juive, et aussi, en passant, le plaidoyer le plus conséquent en faveur de la solution sioniste à cette question.
- « Pourquoi nous restons juifs » – Strauss, le problème juif et le sionisme.
Qu’est-ce que la « question juive » (ou le « problème juif ») selon Strauss ? Celle ou celui constitué par « l’élection » juive, son statut de peuple élu. Or, en quoi consiste cette élection et pourquoi suscite-elle cette « question » ? Elle la suscite justement dans la mesure où elle « pose question », où elle est « problématique ». La question qu’elle pose, selon Strauss, n’est autre que celle de la condition humaine en général. C’est donc sous la forme de cette « question » que l’élection du peuple juif interroge la condition humaine et inversement. Or, si la question que pose cette élection peut se prévaloir d’une portée universelle, c’est qu’il ne peut s’agir d’un simple particularisme ethnique quelconque, qui n’aurait qu’une portée particulière, mais elle aurait quelque chose à dire aux hommes en tant qu’hommes, et ce non pas simplement à titre d’exemple (celui d’une ethnie parmi d’autres), mais en tant que particulier. C’est-à-dire, que sa particularité même aurait quelque chose à dire d’universel.
Cette élection (divine, donc) devient « question » (problème épistémique, donc), dès lors qu’elle quitte le domaine pur de la foi pour celui de la raison et que l’assise théologique du peuple juif dans ce qu’il a d’exceptionnel ne va plus de soi. On pourrait dire de ce point de vue que la catégorie de « l’élection » ne va de soi que de point de vue fidéiste juif orthodoxe, et que la catégorie plus vaste de « question » ou de « problème » juif vaudrait tant pour les « goyim » que pout tout juif « non-orthodoxe » ; or, comme la finitude de l’esprit humain est une caractéristique insurmontable de sa condition, on peut également attribuer ce caractère « problématique » à la foi même.
Les données empiriques du problème incluent, selon Strauss, le caractère permanent de la persécution antijuive, le caractère permanent de sa possibilité actuelle. Il fait remonter cette certitude à un souvenir d’enfance, celui du passage de réfugiés des pogroms russes dans son paisible village allemand lorsqu’il avait cinq ans, en 1905. Son impression de certitude résulte, dit-il, du souvenir de l’évidence, qui précédait ou qui accompagnait cette expérience, de l’impossibilité d’une persécution antijuive en Allemagne. (En cela, cette expérience eut un effet analogue sur le jeune Strauss à celle qu’eut l’Affaire Dreyfus sur Theodor Herzl dans les années 1890.) Or, si cette possibilité est permanente, une solution, celle que Strauss associe à Heinrich Heine, se propose : celle de l’assimilation (c’est-à-dire, selon Strauss, « ne pas rester juif »). Au moyen âge, par exemple, cette solution en était une dans la mesure où il suffisait de se convertir au christianisme pour ne plus être juif (ceci est même la prémisse du christianisme). Mais cette possibilité est compromise, voire interdite par la transition de l’antijudaïsme religieux prémoderne vers l’antisémitisme racial moderne. Cette mutation a été entamée par l’expulsion ou la conversion forcée des juifs d’Espagne et par l’Inquisition qui s’en suivit, qui tenait en soupçon les conversos et faisait une distinction entre Chrétiens selon cette distinction de « race » (sang « espagnol » versus sang juif).
Néanmoins, la sécularisation et l’avènement des sociétés libérales modernes, postrévolutionnaires change la donne en rétablissant les Etats sur des fondements qui interdiraient par principe toute « discrimination ». La raison en est la laïcisation de l’Etat et la séparation concomitante opérée entre les espaces public et privé. L’Etat n’établit ni n’impose aucune religion, et les citoyens sont libre de croire ou de ne pas croire, et, partant, de s’associer comme ils l’entendent dans la sphère privée, autrement dit la « société civile ».
Or les obstacles à cette solution au problème de la permanence de la discrimination tels qu’il en persiste dans cette société sont double, selon Strauss. D’une part, l’expulsion du christianisme de la sphère publique disqualifie la conversion comme voie automatique vers l’assimilation – même si cette solution a déjà été compromise par l’avènement du racisme antisémite moderne. D’autre part, la séparation même entre sphères publique et privée qui est constitutive de la société libérale laisse libre cours aux discriminations sont donc extra-légales sans être illégales, et s’interdit par principe d’y intervenir afin d’y mettre un terme. Que ces discriminations proviennent des motivations religieuses ou raciales est indifférent aux yeux de l’Etat qui, de même qu’il ne discrimine pas, ne peut de même empêcher ou interdire la discrimination. Un Etat qui tenterait de résoudre ce problème en abolissant la discrimination (et donc la distinction libérale entre le public et le privé) se verrait obligé, à l’instar de l’Union soviétique de l’époque stalinienne tardive et khroustchévienne, de s’approprier, pour mieux les maîtriser, une dose mitigée des préjugés antisémites des masses qu’il prétend gouverner et qu’il ne peut pas entièrement dénaturer.
Donc, du point de vue de l’assimilation des individus, conclut Strauss, il est « impossible de ne pas rester juif », du fait de la discrimination inévitable et permanente de la société non-juive à l’égard des juifs. Mais là, Strauss envisage une autre possibilité, qu’il décrit comme étant l’assimilation en tant que groupe mais eu égard aux individus : autrement dit, le judaïsme serait considéré en tant que « culte », sur un pied d’égalité avec les autres « cultes » (« sects » en anglais)[2] auxquels on serait entièrement libre d’adhérer. Strauss l’estime inutile d’aller plus loin que de se contenter de réfuter cette option par la simple observation qu’elle serait incompatible avec le judaïsme sous quelque forme que ce soit. Les raisons du caractère expéditif de cet argument attirent l’attention par ce caractère même, et mènent directement à sa considération finale, la plus importante, qui est celle du sionisme. Il convient donc de s’attarder là précisément où Strauss va vite et d’ouvrir une brèche dans ce qui lui semble être acquis.
Résumons : dans un premier temps, Strauss avait parlé du « problème juif », celui d’une inassimilabilité supposée, comme relevant de la permanence de la « discrimination » antijuive de la part de la société non-juive, que celle-ci soit chrétienne ou laïque. Ici, il envisage la possibilité d’une parfaite tolérance laïque de la part d’une société qui mettrait toutes les religions (qui ne seraient de ce fait plus des « religions » mais des « cultes » [sects]) sur un pied d’égalité, mais dont la condition serait celle d’une liberté totale laissée à ses adhérents ou à tout un chacun d’y adhérer ou non. A première vue on voit mal ce qui distinguerait cette option de celle de la séparation « libérale » entre le public et le privé, avec la non-intervention de l’Etat dans de domaine de la liberté des hommes à s’associer ou à se dissocier, même au prix de discriminations privée. Or la différence selon Strauss réside dans la question de savoir si la liberté s’exerce entre cultes (entendus comme communautés étanches et autonomes), selon l’option « libérale », ou entre individus autonomes y compris à l’intérieur des cultes. (« On ne peut échapper à son passé », à ses ancêtres, ne cesse de marteler Strauss. A savoir, être juif ou pas juif ne saurait être un libre choix, mais une fatalité qu’il faut assumer.) On peut donc imaginer que dans la seconde option, c’est l’Etat qui imposerait aux cultes cette liberté des individus d’adhérer ou non, et qu’on pourrait changer de religion comme on changerait de nom. Ce serait donc incompatible avec « tout ce qu’on pourrait jamais entendre par judaïsme » dans la mesure où elle enlèverait aux autorités proprement religieuse et à la tradition le pouvoir de déterminer qui est juif et qui ne l’est pas. Mais, évidemment, l’appartenance religieuse comme une simple case qu’on cocherait sur l’état-civil et qui serait décidée en mairie sans la moindre décision des autorités proprement compétentes (c’est-à-dire, théologiques) serait absurde car elle viderait le nom des religions dont on cocherait la case de l’intégralité de leur sens. Il faut évidement que ce que cela veut dire que d’être juif, ou catholique, ou musulman demeure entre les mains des rabbins, de l’Eglise, des ulémas, autrement dit des concernés. Après, ce qui peut être garanti, c’est la liberté d’adhérer à ce contenu ou pas : « être chrétien » veut dire adhérer à un contenu « x » ; ce contenu « x » est déterminé par l’Eglise ; et que les individus soient libres d’être chrétien ou non veut dire qu’ils sont libres d’accepter « x » ou de le refuser. Cela doit donc être cette option-ci que Strauss déclare nulle et non-avenue car incompatible avec l’existence du judaïsme en tant que judaïsme : l’option selon laquelle on peut devenir juif en acceptant d’adhérer à ses doctrines, ou inversement cesser d’être juif en les répudiant.
La raison en devient tout de suite claire : Strauss affirme vigoureusement adhérer à la thèse selon laquelle « être juif », c’est appartenir à un peuple, à une ethnie, et non pas simplement adhérer à une religion. La « condition juive » est donc une double nécessité : due de prime abord à l’impossibilité pour les individus de s’assimiler à la société non-juive du fait du rejet de la part des goyim, mais aussi et surtout ce que Strauss décrit comme le caractère « ignoble » pour un juif de ne plus vouloir être juif, de vouloir renier les exigences propres à ses racines. Or, « les exigences propres à ses racines », cela signifie donc à la fois la foi de ses ancêtres, ou le contenu doctrinal dont est porteuse la religion Moïse, mais aussi l’exigence propre d’enracinement, de la fidélité ou de l’appartenance comme une fin en soi. Or, cette exigence aboutit, dans un premier temps, au sionisme. Strauss appelle le sionisme comme solution « l’assimilation en tant que nation » – c’est-à-dire, c’est la « nation » juive qui devient une « nation » (goy) comme une autre. L’exigence sioniste, selon Strauss, est affirmative d’un judaïsme « national » ; et cette « normalité nationale » implique le droit de cette nation à l’autodétermination, y compris par la conquête et y compris par le terrorisme, auquel Strauss rend un hommage non dépourvu d’ambiguïté. Mais cette « normalisation » de la nation juive qui est à l’œuvre dans le « sionisme politique » est inadéquate pour deux raisons : 1) le sionisme politique, la conquête et la colonisation violente par la force des armes d’un territoire et d’une souveraineté est « vide » et formel et peut parfaitement s’accompagner d’une déjudaïsation spirituelle ; 2) Cette normalisation, qui est la solution d’une « assimilation en tant que nation », partage avec l’exigence d’assimilation des individus la même prémisse selon laquelle « le judaïsme est un malheur », d’après Heine. Par là il faut entendre : le sionisme purement politique avec son assimilation du peuple juif aux autres nations avec leur manières immorales d’agir ferait perdre au peuple juif sa spécificité et sa judéité. Pour Strauss, si les juifs veulent « rester dignes » en tant que peuple et fidèles à leurs racines, il ne leur suffit pas de prendre leur destin en main en endossant de viriles vertus guerrières (qui sont aux yeux de Strauss à la fois une nécessité et un risque mortel) – ils se doivent de rester également et surtout fidèles à leur identité culturelle et religieuse.
Or, si le nationalisme ou l’autoconstitution culturels appartiennent en leurs concepts à un romantisme historiciste constructiviste[3], où l’ipséité de la culture d’un peuple se construit à partir de son propre génie créateur en même temps qu’il le fonde en tant que peuple, cette option est interdite au peuple juif dans la mesure où son « roman national », c’est la Bible et ses commentaires. C’est-à-dire que, la seule manière d’affirmer sa judéité en assumant une culture, une pensée, un héritage littéraire proprement juif, c’est d’affirmer le contenu de cet héritage, qui est explicitement universaliste et théologique. Dans ce cas précis, l’identité culturelle est forcément religieuse.
On peut donc dire que, dans l’analyse de Strauss, si l’exigence d’un sionisme politico-militaire est accidentelle, celle d’un nationalisme religieux ne l’est pas. Accidentelle, la première, parce que dépendant de circonstances socio-politiques a posteriori qui pourraient, même si Strauss affiche son pessimisme à cet égard, changer dans l’avenir. Elle dépend de l’hypothèse de la permanence des attitudes discriminatoire à l’égard des juifs dans les sociétés non-juives. Cette hypothèse est elle-même liée à son théorème a propos des relations entre Etat et société. Mais on peut en relativiser le bien-fondé en prenant en compte le contexte socio-historique dans lequel Strauss l’a émise. Nous sommes en 1962, soit deux ans avant l’introduction aux Etats-Unis des premières lois anti-discrimination (Civil Rights Act). Sans même y comparer le modèle laïc français, on peut se demander si, aux yeux de Strauss, la limitation du libéralisme absolu par ce genre d’empiétement du public sur le privé par l’introduction de telles lois, pour ne rien dire des interventions plus musclées et activistes en ce sens des années plus récentes, aurait donc, selon Strauss, rapproché les sociétés libérales du « modèle soviétique », comme il semblait le craindre.
A la différence donc de la nécessité de ce sionisme politico-militaire qui semble dépendre de ces évolutions de la société, la nécessaire re-théologisation de la question juive n’est pas une exigence liée aux circonstances mais, au contraire, elle lui est essentielle et constitutive. Et c’est en cela que la « question juive » demeure un problème à portée universelle, qu’elle éclaircit la condition humaine – car cette ré-théologisation a beau être une exigence propre et interne à l’identité juive, elle a été rendue impossible par la naissance du scepticisme philosophique ayant abouti à la modernité et à l’émancipation même des juifs.
Le paradoxe de l’analyse straussienne et la tension qui la sous-tend tient donc au double fait de sa reconnaissance envers les possibilités d’émancipation qu’a offertes la démocratie libérale aux juifs en tant qu’individus, et de sa reconnaissance du caractère nécessaire mais insuffisant (voire spirituellement dangereux) du sionisme politique, puisque celui ne fait en un sens que prolonger et radicaliser la Galout (exil) en assimilant les juifs en tant que nation aux autres nations, alors qu’il doit déboucher pour se racheter sur un sionisme culturel qui ne peut être, in fine, qu’un sionisme religieux qui tend vers le théocratique. Les hommes sont les êtres qui veulent « le beurre et l’argent du beurre », dit Strauss, et les juifs ne sont pas une exception – il faut soutenir, comme le fait Strauss, à la fois les protections qu’accord le libéralisme moderne aux individus en tant que citoyens, et l’authenticité à tendance anti-libérale et antimoderne qui, dans le cas des juifs et d’eux seuls, débouche non pas sur une énième identité nationale ou culturelle qui pose ses propres valeurs, mais sur l’authentique possibilité de la Révélation comme alternative fondamentale à la Raison.
2. Leo Strauss, judaïsme et philosophie.
 Ces questions, concernant la place de la question juive dans l’intelligence de l’opposition entre Raison et Révélation, l’opposition entre Anciens et Modernes, et la question théologico-politique qui sous-tend les deux, sont au cœur de la réflexion straussienne que nous avons essayé de mettre en lumière ; et ces questions font également l’objet du livre collectif, paru en 2016 aux éditions Beauchesne sous la direction de Danielle Cohen-Levinas, de Marc de Launay et de Gérald Sfez[4]. Le volume est issu d’un colloque qui a eu lieu rue d’Ulm en 2011, et thématise pour la première fois en français l’ensemble de ces questions touchant les rapports entre question et politique juives et problème théologico-politique chez Leo Strauss. L’ouvrage est une contribution extrêmement bienvenue à la littérature secondaire francophone sur la pensée de Leo Strauss, et par la qualité généralement très élevée des réflexions que livrent ses contributeurs, et par la relative absence de l’approche de l’œuvre de Strauss par le biais de cette thématique en français jusqu’à présent. Les directeurs ont su réunir une très riche palette d’approches diverses mais complémentaires de cette thématique. Les contributions de Bruno Karsenti et de Gérard Sfez (par ailleurs auteur de la seule monographie [Leo Strauss, foi et raison, Beauchesne, 2007] qui thématise cette problématique en français) traitent explicitement du sens de la « question juive » et de la réponse sioniste qualifiée qu’y apporte Strauss ; celle de Danielle Cohen-Levinas fait ressortir les résonances entre les pensées straussienne et lévinassienne concernant la question du mal et de l’Histoire ; celle de Marc de Launay et celle de Géraldine Roux sont plus proprement théologiques et textuelles, la première ayant affaire à la lecture straussienne du livre de la Genèse, la seconde abordant la question de la philosophie juive chez Strauss par l’angle de sa célèbre lecture de Maïmonide ; Heinz Weizmann présente la thèse de doctorat de Strauss, méconnue mais essentielle pour comprendre le point de départ philosophique de sa problématique, sur Jacobi ; et Jean-Claude Monod traite finalement de l’influence de Carl Schmitt sur l’élaboration de la problématique théologico-politique chez Strauss. Le volume inclut également la traduction d’un court inédit de Strauss, un texte de jeunesse sur le questionnement théologico-politique intitulé « La situation religieuse actuelle ».
Ces questions, concernant la place de la question juive dans l’intelligence de l’opposition entre Raison et Révélation, l’opposition entre Anciens et Modernes, et la question théologico-politique qui sous-tend les deux, sont au cœur de la réflexion straussienne que nous avons essayé de mettre en lumière ; et ces questions font également l’objet du livre collectif, paru en 2016 aux éditions Beauchesne sous la direction de Danielle Cohen-Levinas, de Marc de Launay et de Gérald Sfez[4]. Le volume est issu d’un colloque qui a eu lieu rue d’Ulm en 2011, et thématise pour la première fois en français l’ensemble de ces questions touchant les rapports entre question et politique juives et problème théologico-politique chez Leo Strauss. L’ouvrage est une contribution extrêmement bienvenue à la littérature secondaire francophone sur la pensée de Leo Strauss, et par la qualité généralement très élevée des réflexions que livrent ses contributeurs, et par la relative absence de l’approche de l’œuvre de Strauss par le biais de cette thématique en français jusqu’à présent. Les directeurs ont su réunir une très riche palette d’approches diverses mais complémentaires de cette thématique. Les contributions de Bruno Karsenti et de Gérard Sfez (par ailleurs auteur de la seule monographie [Leo Strauss, foi et raison, Beauchesne, 2007] qui thématise cette problématique en français) traitent explicitement du sens de la « question juive » et de la réponse sioniste qualifiée qu’y apporte Strauss ; celle de Danielle Cohen-Levinas fait ressortir les résonances entre les pensées straussienne et lévinassienne concernant la question du mal et de l’Histoire ; celle de Marc de Launay et celle de Géraldine Roux sont plus proprement théologiques et textuelles, la première ayant affaire à la lecture straussienne du livre de la Genèse, la seconde abordant la question de la philosophie juive chez Strauss par l’angle de sa célèbre lecture de Maïmonide ; Heinz Weizmann présente la thèse de doctorat de Strauss, méconnue mais essentielle pour comprendre le point de départ philosophique de sa problématique, sur Jacobi ; et Jean-Claude Monod traite finalement de l’influence de Carl Schmitt sur l’élaboration de la problématique théologico-politique chez Strauss. Le volume inclut également la traduction d’un court inédit de Strauss, un texte de jeunesse sur le questionnement théologico-politique intitulé « La situation religieuse actuelle ».
La contribution de Bruno Karsenti, intitulé « ‘‘Si je me bats seulement pour moi, que suis-je ?’’ Leo Strauss et l’élection des juifs », interroge la façon philosophique qu’a Strauss de « rester juif ». Comme nous l’avons déjà dit, l’élection des juifs n’est une catégorie ou une caractéristique qui ne va de soi que du point de vu juif orthodoxe fidéiste ; dès qu’on bascule vers un point de vue qui ne l’est plus, dont l’attitude proprement philosophique n’est qu’une déclinaison possible, cette élection devient dès lors « problème » ou « question », qui est précisément celui ou celle de la révélation, de la possibilité d’une connaissance issue d’une révélation divine, et partant de la question plus proprement politique de la possible cohabitation des communautés définies en référence à des prétendues connaissances révélées qui se contredisent. Et si justement nous ne nous situons plus dans une perspective fidéiste « naïve », comme c’est le cas de nous autres modernes, qu’est-ce que cela peut vouloir dire d’appartenir à cette communauté qui est constituée par cette Révélation à laquelle on ne peut plus croire ? Voilà ce qui est très précisément en jeu dans la question d’un possible « retour » à sa judéité (qui n’est, pour Strauss, qu’une des déclinaisons possibles d’un retour aux Anciens en général) : dans la mesure où « être juif » est une condition prémoderne, comme l’être après la critique spinoziste (dans son Traité théologico-politique de toute possibilité d’une connaissance révélée et des miracles en général, et de l’élection divine des juifs en particulier), autrement que dans un sens purement négatif, comme un résidu sociologique maintenu en vie par une éternelle possibilité du retour de la persécution ?
Pour Bruno Karsenti, cette question s’organise autour de l’analyse straussienne du triptyque de questions de Hillel (Hillel était l’un des fondateurs de l’école pharisienne du fiqh, l’un des premiers compilateurs de la Michna Thorah, au 1e siècle avant J-C. Il est donc l’un des fondateurs du judaïsme sous la forme que nous lui connaissons.) : « Si je ne me bats pas pour moi, qui va le faire ? Si ce n’est maintenant, quand ? Si je me bats seulement pour moi-même, qui suis-je ? » ; elle s’organise autour se ces trois questions, mais surtout autour de l’omission par Léon Pinsker, l’un des fondateurs du sionisme, de la troisième – ce qui mène à ce que B. Karsenti appelle la « solution technique » qui est celle du sionisme politique. Or, comme nous l’avons vu, et c’est l’objet de l’analyse de B. Karsenti, cette solution ne peut être que provisoire puisqu’elle laisse irrésolu tout l’aspect proprement philosophique du problème.
Bruno Karsenti voit bien que libéralisme et sionisme sont en réalité pile et face de cette même « solution technique » et restent tous deux de plain-pied dans la modernité : L’Aliyah, ou sa possibilité, ne fait pas sortir le juif de la Galout, de l’exil. Il voit également que la confrontation sa vie durant avec la pensée politique de Spinoza a été une façon pour Strauss de prendre à bras-le-corps ce problème de l’identité juive dans la modernité ; ou plutôt, pourrait-on peut-être dire, penser ce problème de l’élection des juifs jusque dans la modernité a été pour lui le point d’appui, peut-être accidentel, qui lui a permis d’accéder au problème des Anciens et des Modernes, puisque revenir à sa judéité est une façon de redevenir un « Ancien ». Bruno Karsenti voit également que cet aboutissement d’une solution philosophique (donc ni simplement politique, ni religieuse) au problème juif est rendu possible par le caractère inadéquat de la réfutation spinoziste moderne de la religion : ces Lumières n’ont pas réussi à démontrer de façon apodictique que la valeur de vérité des énoncés de la religion révélée est fausse[5]. Et que tout au plus réussit-elle à émettre des hypothèses sur le caractère dangereux et néfaste des croyances religieuses pour la paix civile dans le contexte des guerres de religion[6].
Ce que la contribution de B. Karsenti permet finalement de comprendre, c’est que ce retour (et partant, le fait de « rester juif »), ainsi donc que le contenu du « problème juif », pour Strauss, n’est plus tout à fait possible simpliciter comme ce fut le cas pour un prémoderne, pour qui il était une simple question de techouvah, du repentir. Les conditions épistémiques d’un repentir (c’est-à-dire d’une réconciliation avec Dieu auteur de la Loi qu’on aurait donc transgressée) sincère et sans arrière-pensées ne sont plus réunies pour nous autres modernes, habitants d’un monde définitivement désenchanté. Le retour à la Loi tel qu’il est possible pour un juif moderne c’est le retour non pas à une certitude mais à un problème, à une question. Le refus pur et simple de ce retour au judaïsme, la décision « d’épouser le mouvement moderne », mène tout droit soit à l’assimilation, soit au sionisme politique[7] ; mais le retour ou la tentative de retour que seul peut effectuer l’homme moderne, à partir de la problématique moderne, c’est cette tentative pour penser la Loi à partir de sa non-évidence. Le « problème juif », vu de l’intérieur, c’est ce problème de l’expérience d’une Loi qui ne peut être ni tout à fait oubliée ni tout à fait assumée, et qui se présente à l’intelligence comme un problème philosophique. Le juif moderne est donc porteur de cette tension, si seulement il décide de s’y confronter.
Ce problème de l’expérience problématique de la Loi comme donnée, Gérald Sfez le traite longuement dans sa contribution, « L’antériorité de la Loi ou la difficulté du retour ». La contribution de Gérald Sfez commence au milieu du gué pour ainsi dire, comme par une imbrication dense de questions et de problèmes ; or cette imbrication est en fait un nœud, et ce nœud est celui du problème théologico-politique tel que le judaïsme en constitue ce que Seth Benardete, l’élève le plus doué de Strauss, aurait appelé le « cœur excentré »[8]. Ce nœud consiste en ce que le problème fondamental, celui de la nature ultime des choses, c’est-à-dire leur provenance et leur fondement, à savoir celui de la question de savoir « Quid sit Deus ? », dépend, de point de vue gnoséologique, du problème de la foi en la révélation et de la raison, dont la forme historique et non seulement métonymique été l’opposition entre Jérusalem et Athènes, ou la révélation abrahamique et la philosophie grecque. Or cette révélation abrahamique a évidemment été faite à travers un peuple unique, le peuple hébreu. Ce qui rend ce peuple lui-même le symbole ou même l’incarnation historique concrète de la première des deux options dans l’alternative fondamentale, mais aussi ce qui rend ce peuple pris ensemble avec les autres peuples et dans ses relations avec eux le signe de cette alternative gnoséologico-politique fondamentale dans son ensemble.
Cette façon de désigner la centralité excentrée du « problème juif » pour la philosophie et pour l’homme, en amont donc de ses multiples solutions possibles (théocratique, libérale, sioniste, etc.) est celle de Strauss lui-même, d’où le refus de Strauss de le réduire à la simple question de la « discrimination », car ceci présupposerait la perspective libérale, ce qui présuppose à son tour qu’on ait déjà tranché en faveur de la « Raison » : voilà pourquoi l’emploi non-qualifié fait par Gérald Sfez de ce terme cloche avec la circonspection straussienne héritée de la méthode phénoménologique qui laisse les choses apparaître au ras de leur site d’apparaître « naturel »[9]. La position du problème de la connaissance humaine dans son eidétique même ne saurait donc présupposer l’égalité stricte et « aveugle » entre les hommes auxquels la Loi a été révélée et les autres hommes. Mais de même, si la problématique de la Révélation et de la Loi était constitutive à elle toute seule de la question juive de telle sorte que la haine du peuple juif ne soit rien d’autre que la haine de la Loi, comme l’affirme G. Sfez dès la première page[10], alors 1) il n’y aurait pas moyen de distinguer entre un Spinoza (ou n’importe quel partisan de l’assimilation et de la laïcité) et un « antisémite » (nous suivons ici l’usage de Strauss en mettant les guillemets autour de ce terme dont il récuse l’utilité. Strauss le récuse car il occulterait la spécificité du peuple juif non seulement en le « racialisant » mais en le diluant dans une « race » qui n’inclut pas que le peuple juif. Ainsi, Strauss exprime dans sa conférence son adhésion à la thèse selon laquelle il est impossible pour un arabe d’être « antisémite » en raison du fait que les arabes sont eux-mêmes des sémites.[11]) ; et 2) ce « rejet de la Loi » s’appliquerait, surtout à la lumière de la communauté, soulignée par Strauss (et par G. Sfez dès la page suivante), des rapports juifs et musulmans à la Loi, tout aussi bien à un rejet de la Sharia que les plus fervents partisans de cette loi qualifierait d’ « islamophobe ».
Or, la Loi, comme le souligne Strauss, n’est pas équivalent de « peuple juif », mais de « Dieu ». Comme G. Sfez le dit une page plus tard, « [p]our le juif plus particulièrement, la question de Dieu, c’est celle de l’obéissance à la Loi et non celle de la croyance en Dieu. La révélation aux hommes de la Loi, au sens où la Loi est antérieure à tout monde, c’est cela qu’il faut entendre par Dieu. Dieu, c’est la Loi avant le commencement du monde. »[12] Ou, comme Strauss le dit en une paraphrase approbatrice de Rosenzweig : « Si la Torah n’a pas son origine dans la nation juive, puisque celle-ci est manifestement constituée par la Torah, la Torah, qui a été créée avant le monde et pour laquelle le monde a été créé, lui précède nécessairement. »[13] Notons que si, d’une part, l’on réduit la haine du peuple juif au seul rejet de la Loi, ce peuple-prophète qui a été le signe mondain, le véhicule historique de la communication de cette Parole aux hommes ; et si, d’autre part, l’islam selon Strauss jouit du même statut quant au rapport entre la Loi et la manifestation historico-mondaine de celle-ci, une insulte faite à son Prophète relèverait d’exactement la même dynamique que le propos antisémite judéophobe[14]. Mais si l’on considère la Loi comme une nécessité a priori extra-mondaine qui précède et qui conditionne le monde lui-même, on aura à la fois échappé à ce double risque selon lequel le juif non-pratiquant serait nécessairement « antisémite » et de même qu’une insulte contre le prophète de l’Islam relèverait d’une « islamophobie » qui aurait le même statut moral que l’antisémitisme ; mais on aura aussi posé cette Loi comme étant possiblement identique justement à la loi a priori nécessaire et universelle accessible à la raison naturelle philosophique seule. Bref, on aura déjà entamé le processus de sécularisation, on aura déjà tranché en faveur d’Athènes. Voilà sûrement ce que G. Sfez entend souligner en précisant que « si, dans le champ des religions, la Loi est ce qui singularise le judaïsme, c’est aussi – tel est le paradoxe – ce qui dans la relation du religieux à son dehors, l’universalise. La Loi est ce qui relie juifs et Grecs, elle est ce que la religion a en partage avec la philosophie ou […] ce que la révélation a en partage avec l’autre point de vue, celui de la raison »[15]. Leur différence réside dans la positivité de la loi, ce qui veut dire, selon G. Sfez : « être juif, c’est avoir la loi derrière soi »[16] – l’avoir, non pas comme horizon idéal, mais comme donnée, et de contempler l’idéal (si l’on est philosophe) à partir de la prise en compte de cette donnée. Aussi est-il que, dans le monde grec par rapport au monde juif, il y a un renversement hiérarchique dans l’ordre de la positivité de la loi. Pour la philosophie grecque, la loi positive vient en dernier, et ne vaut que pour ceux qui sont « incapables de s’élever à la théorie »[17].
Ce qui caractérise le judaïsme, c’est son identification à la justice par le truchement de la Loi. Or, selon Strauss, cette identification est commune à la philosophie grecque, à cette différence près : chez les Grecs, la visée la plus haute, c’est la contemplation – la morale en est soit une condition soit un sous-produit nécessaire, mais accidentel ou secondaire ; chez les anciens hébreux, la justice – la soumission à la loi juste de Dieu – est la visée la plus haute, et la science n’est ni une fin en soi ni désirable pour elle-même. Par ailleurs, la philosophie présuppose la cité (car l’éducation pré-philosophique du philosophe présuppose les arts libéraux), là où la parole prophétique se profère en dehors de la cité, dans le désert. Ce qu’ont en commun Athènes et Jérusalem, le montre G. Sfez, c’est la centralité de la loi, une loi qui, dans les deux cas, existe sur un continuum entre loi divine et loi civile. Or, dans le cas de la philosophie, la finalité du rapport de l’homme à la loi est la contemplation de celle-ci, là où dans le cas de la Révélation, cette finalité, c’est la soumission, dans l’amour, à cette loi. La loi comme objet de contemplation, c’est le domaine des vérités a priori, universelles et nécessaires, et c’est à ce niveau-là qu’elle est loi divine – elle est identique à la structure éternelle des vérités incréées ; la loi révélée, qui ne demande qu’obéissance, n’est pas susceptible d’être contemplée car elle est impénétrable à l’intelligence humaine. Elle possède, en tant que positive, la même forme qu’une loi civile qui n’est pour le Grec que la première et imparfaite étape vers la theoria ; mais là où la loi civile est pour le grec d’origine humaine, elle est pour le jérusalémite d’origine divine. La loi civile positive du philosophe n’est qu’une création du philosophe-législateur, parfaite seulement dans la mesure où elle sert de propédeutique à la véritable fin de l’homme, la contemplation, ou dans la mesure où elle en fournit les conditions politico-matérielles de cette activité. Or lorsque cette loi positive même est d’origine divine et donc immuable et absolue, la soumission à cette loi devient la fin en soi de l’homme. Dans les deux cas, l’activité divine qui légitime la loi a lieu en dehors de la cité. Mais là où la contemplation solitaire apolitique du philosophe présuppose la cité puisqu’elle présuppose les arts en général et les arts libéraux en particulier, le prophétisme qui révèle la Loi dans le désert précède la cité qu’elle fonde et qui représente une dégradation par rapport à cette révélation[18].
Mais là où, chez Strauss, toute le puissance et la pertinence de la « question juive », c’est-à-dire de la persévérance du peuple juif dans sa spécificité toujours renouvelée, consistent en le retournement de la portée universelle de cette question vers son extérieur, chez G. Sfez son intérêt semble plus restreint ; là où, chez Strauss, l’intérêt de « rester juif » (non pas, assurément, en tant qu’individu, ce que Strauss refusa radicalement de faire, ayant opté, dans sa vie privée, obstinément en faveur d’ « Athènes », mais en tant que peuple – en public, donc) est identique à celui du témoignage dont la tension inhérente à cette question est porteuse, on a au contraire l’impression que chez G. Sfez cet intérêt est acquis et que l’emphase que reçoit la portée universelle de cette question (qui n’en est donc plus une, mais plutôt une valeur) a une tonalité et une valeur plus polémique et identitaire qu’épistémique. Si donc l’analyse de G. Sfez se réclame de celle de Strauss et prend son élan à partir d’elle, elle s’en diffère de façon subtile mais massive. En effet, là où Strauss prend à témoin la question juive en vue d’interroger à leur racine les présupposés théologico-politiques de la modernité, G. Sfez semble partir de ces présuppositions, s’en servant afin de défendre une singularité juive résolument moderne, et servant de conscience morale à cette modernité même. Selon G. Sfez, les Juifs sont le symbole, du fait de leur identification constitutive à la Loi dans son universalité, du refus de toute discrimination. Or, comme on l’a vu, Strauss refuse cette idée jusque dans son concept[19], puisque l’idée même de « discrimination » (au sens politique, qui est celui auquel G. Sfez l’entend ici) présuppose le point de vue libéral que récuse Strauss, et dont il voit en la judéité le refus. Si Strauss fait bien ressortir la signification universelle du « problème juif », comme l’accorde G. Sfez, celle-ci n’est point « l’affirmation du caractère irréductible de toute discrimination ». G. Sfez donne à la question juive une signification « libérale », ce que Strauss refuse radicalement de faire. Selon Strauss, comme on l’a vu, le problème juif dans sa signification universelle pour l’humanité est le symbole, non pas du caractère irréductible de toute « discrimination », mais du caractère irréductible du problème épistémico-existentiel qui est celui de la raison et de la révélation.
En revanche, G. Sfez fait bien ressortir l’adhésion discrète de Strauss à un messianisme séculier en ce qui concerne le salut final du peuple juif et la fin du Galout. Ce messianisme a deux caractéristiques saillantes ; d’abord, il est fondamentalement spinozien – c’est un point d’accord entre Strauss et Spinoza, et à ce titre la fin du Galout participe du Galout tel que Strauss le conçoit, dans la mesure où elle exige la prise en main par le peuple juif de son propre destin par des moyens militaires et politiques qui les assimilent aux autres Nations. (Au sens où Strauss l’entendait le Galout, Spinoza en demeure partisan selon les deux solutions au problème juif qu’il préconise : la solution majeure, l’assimilation au sein d’un Etat libéral ; et la solution mineure, mentionnée seulement une fois par Spinoza, celle du « rétablissement des Juifs dans leur Etat » si jamais à l’avenir la roue de la Fortuna se mettait de leur côté. Ces deux solutions spinoziennes sont, selon Strauss, à la fois dotées d’une noblesse certaine et dangereuse pour l’identité juive.) Ensuite, G. Sfez explique également ce en quoi le messianisme a également un caractère maïmonidien. Strauss affirme, à la suite de Maïmonide (c’est donc un point de tension avec le pôle spinoziste), que le Messie demeure inférieur au prophète-législateur Moïse, une infériorité déduite de la persistance de la Loi jusque dans l’âge messianique. Cette affirmation permet donc de souligner de façon suffisamment radicale la différence du judaïsme par rapport au christianisme. Le problème juif, pour L. Strauss mais aussi pour G. Sfez (ce qui contredit quelque peu son interprétation de la question juive comme le symbole de la lutte contre la discrimination, ici donc il se rapproche de Strauss après s’en être éloigné), est le symbole de la reconnaissance de l’existence du mal, et de la responsabilité devant le mal. Le « retour » à la Loi (et donc au judaïsme) est donc un retour à cette reconnaissance, à cette responsabilité. Le retour au judaïsme dans son authenticité est donc pour Strauss toujours un « retour » au sens fort, un retour à la Loi et donc à cette reconnaissance et à cette responsabilité. C’est pour cela que l’âge messianique ne transcende pas l’âge mosaïque, et que le Messie, qui ne dépasse donc pas le Prophète, est surtout une figure politique et non pas spirituelle. Il est celui qui sauvera son peuple en rétablissant leur royaume, leur souveraineté – et, partant, celle de l’ancienne loi, la loi de Moïse. La logique de ce « et partant » est celle qui est explicitée par la démonstration de Strauss qui veut montrer que le sionisme politique participe de façon superlative du Galout s’il n’est pas aussi un sionisme culturel : lorsqu’il n’est pas culturel, il est creux et inefficace ; mais que ce sionisme « culturel » ne peut pas ne pas être un sionisme religieux[20].
L’un des points les plus saisissants et les plus paradoxaux du texte de G. Sfez, c’est lorsqu’il fait valoir que l’antériorité de la loi implique que le monde fut créé en vue de la Loi (c’est-à-dire la Torah) plutôt que de comprendre la Torah comme une création ou une émanation du peuple juif et donc de voir l’Election comme antérieure à la Loi. Ce fait implique, le montre G. Sfez, une solidarité entre la récusation de la raison naturelle comme instance ultime et la récusation de « l’absolutisation de la valeur du sionisme politique »[21]. La seule raison naturelle « récuserait, dès lors, l’accès, en tant qu’homme simplement homme, à une responsabilité inconditionnelle qui se découvrirait au ras des phénomènes et ne trouverait dans la tradition de la révélation juive qu’une illustration comme une autre, comme elle récuserait la revendication égocentriste du peuple juif sur l’élection qui est sienne »[22].
Le paradoxe est donc que, alors que d’une part le seul recours à la raison naturelle nous oblige selon G. Sfez à « récuser la revendication égocentrique du peuple juif à l’élection » au nom de l’égalité de tous les hommes et de la non-donnéité de la révélation « spéciale » (pour le dire dans les termes de St. Thomas), d’autre part l’attitude fidéiste est elle aussi comme on l’a vu celle qui met la révélation de la Torah en amont même du monde et donc, a fortiori, avant l’élection du peuple juif. (Ce raisonnement rappelle la position juive orthodoxe qui tient le sionisme pour une abomination idolâtre.) Au mieux, de ce point de vue, le sionisme politique est un expéditif temporaire, un compromis avec le monde, qui, au mieux, comme on l’a vu, participe du Galout, et au pire comme l’affirme la position orthodoxe traditionnelle, parvient à détruire le judaïsme de l’intérieur en y introduisant le poison idolâtre et impie de l’espérance en le salut par la force[23]. Dans les deux cas, son péché originel est le fait d’avoir placé la contingence historique, fût-elle divine, de l’Élection, avant la Loi. Or, comme Strauss le démontre, le sionisme politique est rendu possible par ce nationalisme romantique purement laïque dont la généalogie remonte à la Révolution française (et, de façon dialectique, à l’appropriation inversée des ses valeurs au nom de la résistance des nations germaniques à leur exportation par Napoléon).
Sfez fait bien ressortir[24] cette pensée straussienne de l’exemplarité du judaïsme comme problème se situant dans l’intervalle, non pas cette fois-ci entre raison et révélation, mais entre l’antériorité de la Loi comme fondement de toute moralité absolue et la croyance, subjective, difficile et parfois absente, que l’affirmation de cette antériorité présuppose. Cette (in)croyance, cette croyance difficile ou impossible, est posée comme un des deux termes de cet intervalle parce que Strauss a choisi d’aborder ce « problème » que constitue sa propre judéité non pas en Juif mais en philosophe : son choix est « d’avoir tranché pour la philosophie et de vivre dans le conflit » entre la philosophie et son autre, la Révélation, un conflit qu’il s’est pourtant résolu à penser philosophiquement. Celui qui refuse de penser ce conflit, c’est Heidegger, affirme G. Sfez à la fin de sa contribution, dans la mesure où Heidegger refuse de penser le politique. Et, dans la mesure où Heidegger refuse de penser la Loi, on peut ajouter qu’il refuse de penser (« les conséquences de »[25]) l’Être dans la mesure où il refuse de penser le bien et le mal.[26] Mais de là on ne peut faire dire à Strauss, comme G. Sfez le fait, que Heidegger serait aussi loin de la philosophie que de l’éthique, ni que Heidegger incarnerait sans équivoque « l’Adversaire » aux yeux de Strauss. La citation de De la tyrannie, quand bien même on pouvait l’interpréter en ce sens, serait toujours à prendre cum grano salis, à la fois selon les critères straussiens de l’écriture exotérique[27], et selon la date de la rédaction du texte (1950 – Strauss met Heidegger « entre parenthèses » jusqu’en 1953 environ, le temps d’une double digestion : celle de son influence décisive sur lui, et celle de sa perfidie politique spectaculaire). On ne saurait sous-estimer cette importance décisive que l’enseignement de Heidegger a eu pour Strauss et à quel point il a été déterminant pour son projet et sa trajectoire philosophiques. Pour Strauss, Heidegger était « le seul grand penseur de notre temps » qui « dépasse de loin l’ensemble de ses contemporains en matière d’intelligence spéculative », et affirme que « personne n’a interrogé les prémisses de la philosophie de façon aussi radicale que Heidegger » et que c’était « lui seul qui a ouvert la voie vers un retour authentique à la philosophie ancienne »[28].
Au sujet de la solution sioniste à la « question juive » à laquelle Strauss donne un appui à la fois mitigé sur le plan théologico-philosophique et inconditionnel sur le plan politique, il peut être éclairant d’y comparer la position d’Emmanuel Levinas, qui évolua d’un antisionisme intransigeant vers un sionisme modéré. En effet, il est frappant de comparer les conclusions diamétralement opposées que tirent Strauss (et Theodor Herzl), d’un côté, et Levinas, de l’autre, d’un seul et même événement (ou d’événements d’un même type). Il est bien connu que l’idée sioniste germa dans l’esprit du correspondant parisien d’un journal autrichien en 1895 lors de l’éclatement de l’Affaire Dreyfus. « Si, se disait Herzl en somme, un honnête homme peut être déshonoré et emprisonné injustement, et du seul fait qu’il soit juif, même jusque dans le pays des Lumières et de la Révolution, alors les juifs ne sont véritablement les bienvenus nulle part – il leur faut un ‘chez eux’ où ils seraient souverains, comme tout autre peuple est, en droit ou en fait, maître chez lui. » C’est-à-dire que, dans l’esprit du fondateur du sionisme, le cas français a servi de cas limite permettant de révéler le caractère chimérique de la solution assimilationniste : prenant comme point de départ le haut degré d’assimilation déjà à l’œuvre dans l’aire civilisationnelle germanique et dans l’empire austro-hongrois en particulier, la perception d’un échec relatif de cette assimilation dans une France perçue comme synonyme même d’émancipation et donc comme horizon de cette assimilation dans le reste de l’Europe eut un effet dévastateur sans l’esprit d’un Herzl dont la famille avait été bercée par la synthèse judéo-allemande humaniste. Comme déjà remarqué, cet événement eut dans la vie de Herzl un effet strictement analogue, dans la vie de L. Strauss, à celui produit pas le souvenir d’enfance des réfugiés des pogroms russes faisant irruption dans la tranquillité allemande de sa maison juive en 1905.
Toute autre fut la réaction d’Emmanuel Levinas, qui y vit à l’opposé le signe merveilleux du triomphe de la justice qu’incarne cette France terre promise de l’émancipation citoyenne et humaniste, et chez qui l’aspect saillant de l’Affaire Dreyfus ne fut pas qu’un Français de confession israélite fut victime de persécution antisémite, mais que le pays se déchirât pour lui et qu’il fût réhabilité : « un pays où l’on se déchire pour le sort d’un petit capitaine juif est un pays où il faut se dépêcher de se rendre », selon l’injonction du père d’Emmanuel Levinas, injonction qui fut suivi d’effet. A la différence de Herzl l’autrichien cosmopolite, Levinas le lithuanien du shtetl percevait le miracle français républicain depuis un arrière-plan où la persécution était la norme, et il a donc fait sien l’antisionisme républicain comme conséquence logique de l’émancipation de 1789 (« Tout refuser aux juifs comme nation et tout accorder aux juifs comme individus », selon la formule de Stanislas de Clermont-Tonnerre). Ce faisant, Levinas adopte à la fois le messianisme diasporique de Franz Rosenzweig (L’étoile de la Rédemption [1921], qui influença également Strauss, qui en fit néanmoins une lecture beaucoup plus critique) et l’antisionisme politique de l’Alliance israélite universelle dont il dirigea l’Ecole normale[29]. Or on pourrait rapprocher ce messianisme diasporique résolument religieux de Levinas (et de l’Alliance israélite universelle) du « sionisme culturel », lui aussi nécessairement religieux, que Strauss appelle de ses vœux, et dont le sionisme politique n’était que la coquille vide, la carapace protectrice. Et si Levinas tira de l’Affaire Dreyfus les conclusions aux antipodes du sionisme qu’on a vues au sujet de cette « France… pays où les prophéties se réalisent » (aux accents quelques peu « coheniens »)[30], il ne fut pas de même s’agissant de cet événement absolu que fut la Shoah, qui lui fit reconnaître la nécessité de cette carapace protectrice spécifiquement juive. En effet, si le point saillant à ses yeux dans l’Affaire Dreyfus fut le refus final du peuple français d’accepter ce qui avait jusque-là constitué une quasi-constante historique en Europe, la persécution antijuive, la Shoah manifesta au contraire une faillite collective de cette Europe dont la France n’était pas exempte, et une cruauté dont l’extrémité dépassait presque l’entendement. C’était, comme le dit Danielle Cohen-Levinas dans sa contribution intitulée « Ce siècle où Dieu mourait. L’idéal de la civilisation moderne à l’épreuve de l’hitlérisme. Etude sur Leo Strauss et Emmanuel Levinas », l’idéal de la civilisation moderne même qui était mis à l’épreuve par l’hitlérisme : « La disproportion entre la souffrance et tout théodicée se montra à Auschwitz avec une clarté qui crève les yeux »[31]. Selon Danielle Cohen-Levinas, l’épreuve de la Shoah représente « la nuit » qui envahit et qui ébranle la raison occidentale de l’extérieur, depuis son extérieur métaphysique impensé et impensable. Le propos de D. Cohen-Levinas est d’ausculter cet effondrement et cet envahissement à l’aune de la « mort de Dieu » nietzschéenne. Si en effet chez Nietzsche cette morte qui se déroule sous le signe du nihilisme représente l’« épuisement et [la] déréliction des croyances sur lesquelles la vérité érigea sa légitimité »[32], c’est que la raison et la conscience occidentales portèrent en elles déjà le germe de leur propre achèvement nihiliste depuis Platon et le christianisme. Or, comme l’a si bien analysé L. Strauss, Nietzsche fut à la fois fin diagnosticien de ce nihilisme et celui qui l’incarna, en l’assumant ouvertement, de façon la plus complète. C’est cela même que l’analyse de D. Cohen-Levinas fait bien ressortir lorsqu’elle rappelle que chez Nietzsche le nihilisme, où une pure volonté de puissance émerge d’un relativisme cognitif pur et assumé, peut être « une manière divine de penser »[33]. Ainsi D. Cohen-Levinas fait bien ressortir les points communs aux généalogies straussienne et lévinassienne du nihilisme nazi ; dans la conférence de Strauss de 1941 intitulée « Sur le nihilisme allemand »[34], qui préfigure de façon plus crue l’analyse à la fois plus feutrée et plus extensive du Droit naturel et histoire, Strauss décrit le nihilisme nazi comme une sous-espèce du nihilisme allemand en général, lui-même dérivé du « militarisme allemand » interprété comme une réaction politico-philosophique à la modernité libérale (d’origine française et surtout anglaise) : aux aspirations à la fois universalisantes et matérialisantes de celle-ci, le romantisme et l’idéalisme allemands opposent une tentative de retour aux valeurs prémodernes, à la physique des intérêts, une réactivation de la morale – au calcul épithumotique, l’héroïsme du thumos. Or, comme un retour simpliciter aux Anciens s’avéra impossible quant à la philosophie de la nature et de la connaissance qui étayait leur morale, cette affirmation « moraliste », privée de tout contenu spéculatif et donc de toute portée objective, deviendra de plus en plus une simple affirmation « héroïco-militaire » de soi-même et de sa « culture » particulière face à la « civilisation »[35]. Le militarisme allemand issu, selon Strauss, de l’idéalisme allemand est un moralisme sans morale, c’est-à-dire sans contenu. Ce relativisme des valeurs est la contrepartie de l’abandon de la connaissance « objective » aux seules Naturwissenschäften, c’est-à-dire aux sciences des « faits », cette invention moderne – en ceci la problématique straussienne s’inspire assez directement de la thématique husserlienne de la « crise » des sciences européenne qui se solde par cette bifurcation de la vie et de la connaissance humaines en « culture », porteuse de « valeurs », et en « sciences » énonciatrices des « faits ». C’est cette situation de distinction entre « faits » et « valeurs » portée par les sciences sociales post-wébériennes, que Strauss n’aura de cesse de dénoncer, notamment lors des deux premiers chapitres de Droit naturel et histoire, et qui est responsable de la relativisation de valeurs, reléguées aux Weltanschauungen (soit donc à la subjectivité individuelle, soit à celle d’un peuple). (D. Cohen-Levinas commet un contre-sens en affirmant le contraire – que Strauss aurait affirmé que le péché des sciences sociales a été de « détruire la distinction fondamentale entre le fait et la valeur ».[36] Mais l’essentiel de son argument, qui demeure valable, n’est pas infirmé par cette erreur. Il serait toutefois crucial de corriger cette erreur dans toute édition future du volume afin que les lecteurs peu familiers de la pensée de Strauss ne soient induits en erreur concernant cette idée centrale chez lui.)
Le nihilisme allemand résulte donc, selon Strauss, de l’exacerbation d’un militarisme allemand lui-même le résultat d’un moralisme privé (par le relativisme cognitif qui ne sera pleinement assumé que par la « manière divine de penser » de Nietzsche) du contenu objectif. Ce moralisme sans contenu ou ce souci de Sittlichkeit, du mode de vie éthique compris comme Eigentlichkeit, Danielle Cohen-Levinas a le grand mérite de le souligner, est constitutif de tout le « système » de l’idéalisme allemand ; le supposé déracinement du peuple juif devient une sorte de métonymie de l’universalisme moderne[37] ; et c’est E. Levinas qui souligne le mieux cette « résistance du judaïsme contre la métaphysique allemande, et en particulier contre Hegel »[38]. A cette « éthicité » totalement relative à, et constituée par, la vie historiale d’un peuple, le génie de sa langue, sa mythologie, etc., s’oppose la morale biblique, porteuse du sens du mal élémental. Ce dernier est l’apport de Jérusalem, totalement absent chez les Grecs, comme en témoigne le fameux intellectualisme moral de Socrate, et que la philosophie occidentale n’intégrera qu’à partir d’Augustin, grâce justement à cet apport. C’est à ce relativisme romantique de la langue (du mythe, du texte…) comme constitutive de l’être que s’opposent Levinas et Strauss, même si les Levinas (Danielle Cohen comme Emmanuel) croient en la possibilité de la synthèse prophético-moderne de Hermann Cohen à laquelle Strauss n’adhère point[39]. Mais pour Levinas comme pour Strauss, « le judaïsme est une réponse, une alternative à la crise de la civilisation européenne »[40]. Mais là où Levinas, justement en raison de son adhésion à la synthèse cohenienne qui se manifeste dans le républicanisme français, n’adhère que tardivement et modérément au sionisme, on voit ici à l’œuvre chez Strauss ce glissement dialectique qu’il fait explicitement sien dans sa conférence « Pourquoi nous restons juifs » : les Juifs sont, dans un premier temps, un peuple comme un autre, qui doit à ce titre se constituer relativement à une langue, des textes, un mythos, et dont les valeurs sont donc relatives à ce mythos ; mais, comme on l’a vu, ce sionisme culturel est appelé inéluctablement à devenir sionisme religieux (en tout cas Strauss le nomme ainsi, même si on peut tout aussi bien considérer qu’il pourrait s’agir d’un retour au judaïsme religieux tout court), dans la mesure où le texte qui constitue la vie de ce peuple ne renvoie pas seulement à lui-même de façon close et autoréférentielle, mais il renvoie à la Loi divine, à la morale absolue dont il est porteur. Comme le résume Danielle Cohen-Levinas, l’expérience juive n’est pas seulement celle du texte mais celle de la Loi. Mais les problèmes herméneutiques inhérents à cette loi, au fait que cette loi soit encastrée dan un texte, rendent indissoluble la pertinence du philosopher, selon l’analyse heureuse de Danielle Cohen-Levinas.
Marc de Launay, dans sa contribution intitulée « Livre juif ou livre grec ? Sur Genèse I », propose une analyse critique de l’herméneutique que propose Strauss du chapitre I de la Genèse dans sa conférence de 1957[41]. Elle est à situer dans le contexte du livre en deux volumes de Marc de Launay, Lectures philosophiques de la Bible, dont l’article ici publié se trouve aussi intégré au deuxième volume[42], et donc à replacer dans celui de son projet général de l’élaboration d’une herméneutique biblique. Le chapitre de M. de Launay ne peut se comprendre qu’à partir de ce projet et ses principes, et hors ce contexte la critique qu’il effectue de Strauss est difficilement intelligible. La thèse principale de M. de Launay dans cette contribution est que Strauss, dans sa conférence, aurait projeté des catégories philosophiques sur la Bible dans la lecture qu’il en fait, une lecture qui aurait donc pour effet de faire violence au texte même en le dénaturant. D’ailleurs, L. Strauss n’aurait pas vu que Bible et philosophie « sont nées d’un même tournant de la culture où le statut du mythe a été mise en cause grâce à la promotion d’une autre manière de comprendre le langage »[43]. Ce en quoi consiste ce tournant, M. de Launay ne le précise jamais tout à fait, mais se contente de le décrire allusivement comme une distance prise par rapport à une substantialisation ontologique d’un langage qui décrirait littéralement l’ontogenèse de la nature dont le mythe serait porteur[44] ; le récit de la Genèse représente ainsi, non pas une cosmogénèse littérale rivale aux mythes païens, mais un usage éthique de la parole qui vise à soumettre l’intelligence spéculative à des normes. Ainsi, « le texte [biblique] suggère qu’il n’est pas réellement en train de décrire les étapes d’élaboration du monde physique, mais qu’il est en train de multiplier les écarts par rapport aux mythes dont le contenu obéit à pareil ambition, et qu’il installe à chaque étape […] une autre construction, […] une précession de l’éthique »[45].
Par ailleurs, M. de Launay affirme également que « c’est la Bible, en effet, qui a introduit la notion d’histoire telle que nous la comprenons aujourd’hui encore »[46]. Mais la Bible représente-elle cette coupure entre mythe et histoire ? Et notre compréhension actuelle de « l’histoire » remonte-t-elle à cette prétendue coupure ? Il semble difficile de l’affirmer. Dans la mesure où « la notion d’histoire telle que nous la comprenons aujourd’hui encore » s’apparente à la simple « chronique », elle remonte aux annales assyro-babyloniennes (voire égyptiennes) ; mais ce n’est pas en ce sens-là qu’on entend « Histoire » lorsqu’on en fait remonter la parenté à Hérodote et à Thucydide : là, bien entendu, il s’agit de Ἱστορία, l’enquête rationnelle, qui se situe donc du côté de la philosophie, comme son ancêtre immédiat ou son double historico-littéraire. C’est donc, paradoxalement, M. de Launay qui semble vouloir réduire la Bible à un texte philosophique ou proto-philosophique. La Bible n’est pas un texte d’Histoire telle que nous l’entendons : ce n’est pas une enquête rationnelle concernant les causes des guerres et des grands événements humains[47] ; c’est tout autre chose, et le dire montre à quel point M. de Launay, à la différence de Leo Strauss, s’efforce de faire rentrer la Bible dans des catégories qui lui sont étrangères.
De façon quelque peu étonnante, M. de Launay prétend que Strauss serait passé à côté de cette singularité appartenant à la textualité biblique, du seul fait qu’il partirait du principe que la sagesse biblique est irréductible au savoir philosophique imputable à l’autonomie de la raison. Mais Strauss affirme que la catégorie même de « mythe » est étrangère à la Bible, tout comme celle de « nature », et partant même celle de « miracle » – qui dépend, dans son concept, de celles de « raison » et de « nature » (comme écart par rapport à une « nature » qui serait accessible à la « raison »)[48]. Là où M. de Launay soupçonne Strauss de lire la Bible comme une sorte de réponse implicite à la philosophie platonicienne par anticipation anachronique, la lecture straussienne se veut au contraire un laisser-apparaître résolument phénoménologique quant à sa méthode, qui s’efforce, par une ascèse cognitive, de laisser Révélation et raison, Bible et philosophie (platonicienne) apparaître telles qu’elles sont, sans tenter d’analyser l’une à partir des présupposés de l’autre. Or, selon Strauss, la seule façon de réduire ou d’éliminer le conflit et l’abime qui les sépare l’une de l’autre, c’est justement de s’efforcer de réduire l’une à l’autre en l’interprétant à partir des présupposés de l’autre. C’est ce notamment que fait Spinoza (et les Lumières après lui) en faveur de la « raison ». La méthode phénoménologique de Strauss, en revanche, laisse béante cette irréductibilité, et cette béance est, pourrait-on dire, le seul présupposé de son analyse. Ainsi, Strauss s’efforce de lire la Bible telle qu’elle se présente d’elle-même ; s’il la lit en philosophe, il ne cherche ni à la réduire à de la philosophie ni à y trouver des carences par rapport à son « autre » que serait la philosophie : il ne cherche « ni l’esquisse ni la ruine » d’une œuvre rationnelle, mais à lui permettre de venir en présence.
Or, de même que pour Marc de Launay, pour L. Strauss la Bible manifeste l’impossibilité de la science et la primauté de la morale. Ce point est même central dans l’interprétation par Strauss du livre 1 de la Genèse. Et cette approche de Strauss est motivée par son opposition radicale à l’herméneutique critique et polémique de la révélation en général par les Lumières, et notamment par Spinoza. La polémique de Leo Strauss avec l’herméneutique spinoziste de la religion et de la Bible est fondatrice de toute son œuvre, et sa lecture du texte biblique telle qu’on la trouve par exemple dans cette conférence de 1957 exemplifie ce projet. Hostile à toute tentative de « synthèse » entre les deux approches, Strauss rejette autant celle de la scolastique chrétienne (voir celle déjà effectuée en amont par les Pères de l’Eglise, c’est-à-dire par le christianisme en tant que tel) que celle de Hermann Cohen ; toute sa démarche peut être lue comme un refus de réduire foi et savoir, raison et révélation l’une à l’autre. Or M. de Launay reproche à Strauss d’être coupable de ce justement que celui-ci reproche à Spinoza : de prétendre mieux comprendre les auteurs bibliques qu’ils ne s’étaient compris eux-mêmes. Or ici – dans le passage même où il traite de la distinction straussienne entre « interprétation » (qui vise à comprendre le texte tel que l’auteur l’aurait lui-même compris), et « explication » (qui vise à arbitrer ce qui peut être vrai ou faux dans cette auto-compréhension de la part de l’auteur, et donc à mieux comprendre le texte que l’auteur lui-même), il commet ce qui semble être une faute d’interprétation, en attribuant à Strauss, par le biais d’une citation de Persécution et l’art d’écrire[49], une opinion que Strauss attribue en réalité à Spinoza, sur un mode critique. Là justement où, selon Strauss, Spinoza reproche à la Bible d’être en soi inintelligible puisque ses auteurs étaient irrationnels ou « pré-rationnels », et qu’il faudrait donc l’interpréter selon l’herméneutique universelle « fondamentalement identique à celle requise pour déchiffrer le livre de la nature ». Strauss précise que le « but de cette procédure est d’ouvrir un chemin indirect vers un livre qui n’est pas directement accessible, c’est-à-dire accessible par l’intermédiaire de son contenu »[50]. Strauss mobilise ici la distinction phénoménologique entre acte et contenu intentionnel[51], reprochant à Spinoza ce naturalisme réductionniste si typique des Modernes : Spinoza lit la Bible comme phénomène physique, sa langue n’étant que l’épiphénomène ou l’émanation des imaginations surexcitées et des préjugés déterminés par les milieux des auteurs, tout ce qui y est intelligible ne l’étant qu’« accidentellement ». Or, à la différence des arguments naturalistes auxquels avait affaire Husserl[52] et qui éliminent la possibilité du sens ou du contenu intentionnel en tant que tel, chez Spinoza ce réductionnisme qui assimile l’interprétation des œuvres de l’esprit à celle des œuvres de la nature ne s’applique qu’à certaines d’entre elles – à savoir, aux œuvres « irrationnelles » (« hiéroglyphes ») comme la Bible, mais non point à celles, comme les siennes, qui relèvent de la philosophie rationnelle, et que l’on peut saisir directement et conformément aux intentions de l’auteur. Le projet de Strauss est donc diamétralement opposé à celui de Spinoza très précisément sur ce plan ; Strauss affirme que la Bible n’est certes pas « intelligible » au sens où elle serait réductible à un sens purement philosophique ou rationnel et donc retraduisible sous une forme plus transparente à la raison humaine, mais au sens où une intelligence de la Bible est possible selon ses propres critères et selon son caractère propre, telle que ses auteurs l’entendent, précisément dans son altérité radicale par rapport aux critères philosophiques ou scientifiques d’intelligibilité.
In fine, la lecture de M. de Launay est encombrée par le malentendu (beaucoup plus courant dans les médias anglo-américains qu’en France[53]) selon lequel Strauss serait un crypto-spinoziste nietzschéen. Ainsi, M. de Launay part du présupposé, nulle part étayé par le texte de la conférence de Strauss, que celui-ci serait parti, lui, du présupposé que l’hétéronomie préconisée par la Bible serait pensée de façon consciente comme l’alternative à l’autonomie rationnelle préconisée par la philosophie, ce qui, selon M. de Launay, suppose que les auteurs de la Bible aurait eu clairement sous les yeux l’alternative philosophique et qu’ils auraient choisi la soumission craintive et abrutissante soit par faiblesse spirituelle, soit par calcul politique[54]. Quoi qu’ait pu être l’influence, durable et réelle, de Nietzsche sur Strauss, rien de saurait être plus faux concernant la problématisation straussienne concernant l’opposition entre raison et révélation. D’abord, il est évident que le Nietzsche qui influença durablement Leo Strauss n’était décidément pas le Nietzsche « des lumières » des années 1870, comme M. de Launay semble le croire, mais plutôt le dernier Nietzsche, celui des années 1880 ; et puis, ce que Strauss retient de Nietzsche, c’est son rejet de la modernité sur le plan moral (celui des « valeurs ») tout en rejetant (et en cela encore Strauss est fidèle à Husserl et à sa formation phénoménologique) cette espèce d’empirico-positivisme radicalisé qui a pu lui servir de gnoséologie. Nietzsche, dont Strauss a dit que « à 20 ans, [il] avait tout lu, et qu’[il] avait cru tout ce qu’[il] avait compris », a permis, avec Husserl et Heidegger, au jeune Strauss de détruire le carcan de la pensée moderne avec ses facilités et son inconséquence, mais ce justement afin de permettre son retour aporétique à l’alternative entre Athènes et Jérusalem dans toute la radicalité propre de son apparition, dépourvu justement ce réductionnisme moral faible, superficiel et nombriliste que Nietzsche traque, moque et dénonce dans sa Généalogie. Strauss envisage le « retour » à la Bible, à Jérusalem, justement comme une alternative radicale et tout aussi noble à même la plus noble version de la vie « athénienne », non pas comme une fuite et un renoncement devant sa condition tragique d’homme qui se fourre dans une hétéronomie enfantine, mais comme une courageuse et lucide assomption de cette condition et de l’insondabilité de son mystère.
Tout autre est la lecture que fait Heinz Wissmann, dans sa courte contribution intitulée « Strauss sur Jacobi », qui replace la pensée de Strauss dans le contexte des controverses intellectuelles qui furent les plus formatrices de celle-ci, à savoir la crise induite par la critique kantienne (après la critique spinoziste de la Révélation) de la métaphysique et les réponses à cette critique qui aboutirent à l’idéalisme allemand avant de mener plus en aval aux réponses diversement fournies par le néokantisme, l’empirisme logico-positiviste et la phénoménologie. La pensée de Strauss s’insère, sans trop l’afficher, dans l’interstice de ces controverses et de ces réponses, prenant notamment son élan, avant même sa découverte de la phénoménologie très peu de temps après, à partir de la célèbre « controverse du panthéisme », celle du « spinozisme ». C’est le débat entre Jacobi et Mendelssohn concernant le spinozisme de Lessing qui fit l’objet de la thèse de Strauss soutenue sous la direction de Cassirer en 1921. L’article de H. Wissman part de celui de Jean-Christophe Merle, paru dans les Cahiers de philosophie de l’université de Caen en 1993[55], et y rajoute l’aspect d’une prise en compte de la position de Cassirer et de la distance prise par la thèse de Strauss par rapport à celle-ci. Si Strauss s’oppose surtout à la lecture historicisante de son directeur de thèse et fait au contraire le pari de voir en la philosophie de Jacobi et en les positions de la controverse à laquelle il a pris part l’eidos d’un problème philosophique pérenne, il s’efforce d’y apercevoir un prototype de l’opposition phénoménologique et existentialiste au « nihilisme » (terme inventé par Jacobi) kantien. Au fond, ce qui est intéressant est que Heinz Wissmann lit Leo Strauss bien comme un nietzschéen, mais comme un nietzschéen inversé, quasi-kierkegaardien : la religion, c’est la santé robuste de l’instinct. Le saut de la foi est la saine affirmation de l’existence que nous autres post-kantiens ont du mal à accomplir car nous sommes devenus trop faibles pour croire, nous autres nihilistes. Un tel nietzschéanisme est compatible avec cette position prise dans la thèse de Strauss ; on le retrouve également en force à la fin de « Pourquoi nous restons juifs » : après son long éloge de Nietzsche comme l’auteur européen de la position « assimilationniste » la plus authentiquement philosémite, Strauss termine avec force pathos en plaidant que la foi juive est une « illusion héroïque » : cette illusion est un « rêve », et « on n’a jamais rêvé un rêve plus noble que celui-là. Il est certainement plus noble d’être victime du rêve le plus noble qui soit que de profiter d’une réalité sordide et de s’y vautrer. Le rêve est parent de l’aspiration. Et l’aspiration est une espèce de divination d’une vision énigmatique. »[56]
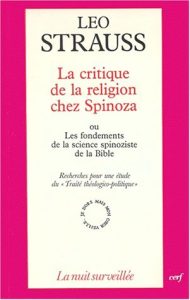 Si la critique spinoziste (la critique des Lumières) de la religion révélée, puis cette crise que générèrent les réactions à cette critique à l’aube du criticisme et de l’idéalisme allemands furent le point de départ de la problématisation straussienne, elle fournit également la matrice théologico-politique de la problématique sous-jacente à son étude des falâsifa médiévaux. Spinoza préfigure, aux yeux de Strauss, la tentative de l’idéalisme allemand pour effectuer une synthèse entre philosophie antico-médiévale et moderne : il s’agit, dans les deux cas, d’une sorte d’immanentisation de l’Un néoplationicien, où l’Un contient et soutient bel et bien le Multiple qui est appelé à être subsumé dans l’Un, mais, à la grande différence de Plotin, Spinoza « ne considère pas ce processus comme un processus de dégradation ou d’exténuation [descent or decay], mais comme un mouvement d’ascension ou de déploiement [ascent or unfolding] : la fin est plus haute que l’origine…. Spinoza paraît ainsi être à l’origine du type de système philosophique qui voit le processus fondamental comme un progrès. »[57]
Si la critique spinoziste (la critique des Lumières) de la religion révélée, puis cette crise que générèrent les réactions à cette critique à l’aube du criticisme et de l’idéalisme allemands furent le point de départ de la problématisation straussienne, elle fournit également la matrice théologico-politique de la problématique sous-jacente à son étude des falâsifa médiévaux. Spinoza préfigure, aux yeux de Strauss, la tentative de l’idéalisme allemand pour effectuer une synthèse entre philosophie antico-médiévale et moderne : il s’agit, dans les deux cas, d’une sorte d’immanentisation de l’Un néoplationicien, où l’Un contient et soutient bel et bien le Multiple qui est appelé à être subsumé dans l’Un, mais, à la grande différence de Plotin, Spinoza « ne considère pas ce processus comme un processus de dégradation ou d’exténuation [descent or decay], mais comme un mouvement d’ascension ou de déploiement [ascent or unfolding] : la fin est plus haute que l’origine…. Spinoza paraît ainsi être à l’origine du type de système philosophique qui voit le processus fondamental comme un progrès. »[57]
Mais la philosophie de Spinoza s’insère également dans le droit fil de la philosophie médiévale juive et islamique et ses controverses concernant la rationalité de la création et du cours du monde et, partant, l’accessibilité ou non pour la raison à Dieu et aux principes créateurs. Celles-ci furent parmi les questions centrales dont le kalâm, la théologie dialectique musulmane qui fournissait également à la théologie et à la philosophie juives leur structure conceptuelle, s’occupait. A un pôle du débat se trouvaient (pour ne rien dire des fondamentalistes hanbalites qui, à certaines choses près, rejettent le kalâm même) des mystiques tels que al-Ghazel et les ash’arites, affirmant la liberté et la souveraineté absolue de Dieu (ce qui amène notamment à l’occasionalisme du premier et au refus de toute intelligibilité nécessaire qui serait contraignante pour le Créateur), et à l’autre pôle se trouvent les mu’tazilites et les falâsifa et surtout, appartenant à cette dernière catégorie, les deux maîtres à penser de Strauss, al-Fârâbî et Maïmonide.
Géraldine Roux, dans sa contribution intitulée « La lecture straussienne du codage du Guide des perplexes de Maïmonide. Secrets et contradictions », interroge la pertinence de la lecture straussienne de ce grand texte arabe du RaMbaM, paru dans Persécution et l’art d’écrire sous le titre « Le caractère littéraire du Guide pour les perplexes » (ou : « Guide des égarés »)[58]. Plus encore que Platon ou Xénophon, on considère souvent que les auteurs centraux pour Strauss, ce sont al-Fârâbî et Maïmonide, puisque ceux-ci replacèrent la philosophie platonicienne en contexte de religion révélée, incarnant ainsi à eux seul toute la problématique théologico-politique athénienne-hiérosolymitaine qui était au centre des préoccupations straussiennes. La lecture straussienne de ces deux auteurs permet d’ailleurs de percevoir la relative équivalence entre judaïsme et islam aux yeux de Strauss, surtout en ce qui concerne l’idée de Révélation, du monothéisme et de la loi, ainsi que leur relation à la raison philosophique. Si Remi Brague voit dans l’herméneutique de Leo Strauss du crypto-chiisme[59], Géraldine Roux conteste, elle, l’attribution par Strauss d’une filiation mu’tazilite à Maïmonide à la faveur d’une influence ismaélienne. Selon Strauss, Maïmonide vise en réalité un kalâm « éclairé », qui ne serait ni la falsafa ni le kalâm proprement dits, mais qui serait à mi-chemin entre les deux. Le kalâm part d’une base dogmatique[60], tout comme la théologie chrétienne, faisant entièrement siens les concepts philosophiques mais sans autonomie par rapport à cette base : c’est une herméneutique rationnelle du donné révélé. La falsafa en revanche pose l’autonomie absolue et sui generis de la philosophie païenne (en l’occurrence, platonicienne et aristotélicienne) par rapport à la Révélation, affirmant discrètement ou ésotériquement la supériorité unilatérale de la première par rapport à la seconde, alors que Maïmonide se pose, lui, comme partisan de la Loi contre les falâsifa. Maïmonide présente son Guide non pas comme un ouvrage de fiqh (de science du droit divin positif – de la Charia ou de la Halakha)[61] mais de kalâm sans être partisan des thèses des mutakallimûn. Maïmonide vise à constituer donc une science de la Loi, qui se distingue du fiqh en ce que celui-ci traite du droit divin positif, alors que le kalâm trait (en principe) de la « véritable » Loi – la loi naturelle. Mais le kalâm existant, celui des mutakallimûn musulmans des siècles précédents, n’était pas le « véritable » kalâm, car comme nous venons de voir, il part d’une base dogmatique, ou plus précisément (car cela était aussi ce qui le distinguait du fiqh qui part explicitement et non pas implicitement de cette base dogmatique), ses prémisses sont « œuvre de l’imagination, tant que celui de Maïmonide est un kalâm de l’intellect »[62], qui part des prémisses purement rationnelles, ouvertes donc à la raison naturelle. Mais dans la mesure où il se pose donc en défenseur rationnel de la Loi, dont il renverse les prémisses (relativisant son contenu purement révélé et positif, arbitraire et inaccessible donc pour la raison naturelle, en y voyant l’Ersatz d’un contenu rationnel codé), il se rapproche subrepticement des falâsifa, tout en évitant le destin d’un Averroès aux thèses trop hardies, qui avait presque explicitement subordonné la loi révélée à la nécessité philosophique. Mais, là où Strauss affirme que l’enseignement ésotérique de Maïmonide ne serait suggéré énigmatiquement qu’à travers des contradictions et incohérences qui apparaissent en filigrane au lecteur attentif du texte, et que ce lecteur ne peut que deviner par des conjectures plausibles, la thèse de G. Roux est que ces conjonctures qui permettent une véritable intelligence des thèses secrètes du RaMbaM sont accessible à travers une connaissance intuitive à caractère synthétique. Ces synthèses s’apparentent à la divination prophétique, alors même que selon Maïmonide la prophétie n’est plus possible depuis la destruction du Temple et l’Exil ; si elles s’apparentent à une forme de rationalité supérieure, elles s’appuient sur l’imagination – non pas comme prémisse, mais comme milieu permettant de s’affranchir des lenteurs saccadées de la déduction propre à l’intelligence analytique. Cette contribution de G. Roux promet donc une relecture très ambitieuse du Guide de Maïmonide, à l’égal de celle de Strauss et voulant la dépasser, même si tout cela demeure plutôt ici à l’état de suggestion et d’hypothèse[63].
Le fil conducteur permettant de suivre le cheminement de la pensée de Leo Strauss est donc le problème théologico-politique. Celui-ci commence, comme on l’a vu, par une interrogation des prémisses de « l’étau » dans lequel les Juifs allemands et européens se trouvaient dans les années 1920, entre assimilation à un Etat libéral et « retour » à l’identité forcément porteuse d’une foi religieuse devenue moins évidente que pour les ancêtres, les Anciens ; il se prolonge dans l’examen approfondi qui occupera Strauss toute sa vie de l’écart entre raison et révélation telles que celles-ci n’ont pu être eidétiquement mises en évidence que par la philosophie politique médiévale musulmane et juive, puisque ces religions sont des religions de la Loi, d’une loi positive divine impénétrable par la raison humaine naturelle, et la philosophie en question était platonico-aristotélicienne, donc, pour, Strauss, le plein déploiement de la rationalité humaine dans sa recherche autonome du Bien. Ce vis-à-vis médiéval entre raison et révélation où les deux approches de la vérité en apparence irréconciliables s’affirment l’une face à l’autre dans toute leur étendue (quitte à chercher la synthèse, que Strauss estime impossible, du côté du christianisme) c’était finalement la réponse aporétique à la Rückfrage phénoménologique que Strauss s’était posée au sujet des origines du libéralisme, dans la mesure précise où celui-ci était à l’origine une neutralisation des questions qui étaient l’enjeu de la querelle entre raison et révélation. Si l’argument proprement philosophique le plus abouti et le plus décisif en faveur de cette neutralisation fut le Traité théologico-politique de Spinoza, le plus décisif du point de vue politique fut le Léviathan (et le De Cive) de Hobbes qui, en appliquant l’atomisme résolutif-compositif de Descartes à l’Etat et au corps social, obtint le contractualisme libéral par quoi l’Etat devient seulement le garant du bien-être corporel de ses sujets. Jean-Claude Monod, dans sa contribution au volume, interroge le jeu d’influences réciproques, les convergences et les divergences entre les critiques et les généalogies straussiennes et schmittéennes du libéralisme moderne. L’influence réciproque entre les deux hommes est bien connue, à partir de la publication de La Notion de politique en 1932 et la critique qu’en fit Strauss la même année[64], Strauss y voyant dans la notion schmittéenne de séparation catégorielle entre le politique et d’autres domaines tels que l’éthique, l’économique, l’esthétique, etc., les traces de la distinction libérale entre public et privée et sa neutralisation morale du politique. Cette influence réciproque se prolongera avec la publication par Strauss de son livre sur La Philosophie politique de Hobbes[65] en 1936 et celle par Schmitt de son Léviathan dans la théorie de l’état de Thomas Hobbes[66] en 1938.
Or, si les divergences entre, d’un côté, le juriste catholique antinazi sous Weimar ayant rallié le régime nazi en 1933, et, de l’autre, le philosophe juif ayant pu fuir ce même régime grâce à une bourse octroyée suite à une lettre de recommandation du premier, recouvrent bien évidemment l’interprétation antisémite que fit Schmitt (que ce fut par conviction ou par opportunisme) du mythe du Léviathan et du rôle des Juifs dans la déliquescence de l’Etat à la faveur de la société civile et des « droits de l’homme », Jean-Claude Monod fait ressortir l’étendue de leurs convergences, qui ne se résument pas à une commune détestation de la modernité libérale. Si l’expérience du régime nazi et du déferlement du « nihilisme allemand » lors de la seconde guerre mondiale acheva de relativiser l’antilibéralisme de Strauss, il n’en était pas de même aux prémices de celui-là lorsque Strauss était au plus fort de son antilibéralisme réactionnaire avant le reflux, comme en témoigne sa fameuse lettre à Karl Löwith du 19 mai 1933, citée par J.-C. Monod. Mais ce que J.-C. Monod fait bien ressortir, c’est aussi un parallélisme plus subtil entre les deux penseurs. Si, comme le rappelait Hannah Arendt avec ironie (et un brin de mauvaise foi)[67], Strauss aurait soutenu les nazis si seulement ils avaient voulu d’un Juif comme lui, l’histoire du rapport du catholique Schmitt au parti n’est éloigné de celui de Strauss que par une différence de degré (correspondant en partie à celle entre l’hostilité absolue des nazis par rapport aux Juifs et leur hostilité relative par rapport au catholicisme) : ayant milité contre l’arrivée au pouvoir des nazis jusqu’en 1932, Schmitt a été marginalisé par le pouvoir à partir de 1935 et a frôlé la liquidation en raison de son catholicisme revendiqué, de sa proximité passée aux Juifs tel que Strauss ou Hans Eisler[68] et de ses positions légitimistes antinazies d’autrefois, malgré tous ses efforts pour montrer patte blanche au régime entre 1933 et 1938, notamment à travers ses théories antisémites non dépourvues de sincérité[69]. Schmitt, dans son livre sur Hobbes, a fini par reconnaître que, contrairement même à ce que Strauss avait initialement affirmé dans le sien, ce ne sont pas les Juifs qui étaient vus par Hobbes comme étant l’origine de toute sédition sectaire et la menace principale envers la souveraineté de l’Etat, mais bien l’Eglise catholique (avec les fondamentalistes protestants) qui étaient visés par l’auteur du Léviathan. Là où Hobbes a voulu revenir à la subordination du religieux au politique et à l’identification antique et païenne du sacré à l’appartenance à la cité, la brèche introduite par le judaïsme qui consistait au contraire à subordonner la cité terrestre au religieux transcendant(al) a été radicalisée par le christianisme ; et J.-C. Monod rappelle que, d’un autre point de vue, la ligne de partage se trouve entre christianisme d’un côté et paganisme, judaïsme et islam de l’autre, dans la mesure où ces deux derniers identifient la Loi divine à la loi civile, ne laissant, en principe, aucun espace entre les deux[70].
Ainsi, Strauss inclut, du moins après 1932, l’antique judaïsme parmi ses « Anciens », aux côtés des Grecs, et la techouvah, le repentir, une des deux modalités du « retour ».
Mais – et c’est là une des caractéristiques centrales de la philosophie, ou plutôt de l’attitude philosophique straussienne – ce retour est nécessairement aporétique. Mais, contrairement à ce que croyait le premier Strauss, celui des années 1920 auteur de la Religionskritik Spinozas, cette aporie ne tient point au caractère définitif et irréfutable de la triomphe politique et philosophique de la modernité ; non, elle tient désormais plutôt au caractère indécidable de l’alternative entre raison et révélation. Ce qui s’est passé entretemps chez Strauss, c’était sa rencontre pédagogique avec Heidegger, dont il a dit 30 ans plus tard que « personne n’a interrogé la présupposition de la philosophie aussi radicalement » qu’il ne n’a fait, qu’il « rendit possible pour la première fois après de nombreux siècle de voir les racines de la tradition telles qu’elles sont et ainsi peut-être de savoir […] que ces racines sont les seules racine naturelles et saines », et qu’il voyait « la possibilité ouverte malgré lui par Heidegger : la possibilité d’un retour authentique à la philosophie classique [ancienne], à la philosophie d’Aristote et de Platon »[71]. Or, que ce ne fut pas uniquement le retour aux Grecs que l’éblouissement heideggérien rendit possible pour le jeune Strauss, mais aussi et tout autant le retour au judaïsme – ou en tout cas la contemplation philosophique de la possibilité de ce retour (que Strauss ne saura, tel Moïse resté au seuil de la Terre promise, effectuer réellement). C’est ce que montre l’inédit de Strauss traduit en fin de volume. Comme l’indique le traducteur à juste titre dans son introduction au texte, celui-ci « mime laborieusement » le style de Heidegger, un an après qu’il a été bouleversé par la prestation de son maître à penser face à son ancien directeur de thèse (Cassirer) à Davos. Le sujet proposé de cette conférence de 1930 devant une organisation de jeunesse sioniste était « La situation religieuse actuelle », mais Strauss consacre l’ensemble de la conférence à démontrer l’inanité philosophique d’un tel sujet. « La question de l’actuelle situation religieuse n’est pas un thème sérieux. Ce qui est sérieux, dans l’intention de cette question, est l’interrogation portant sur la vie juste », dit-il en conclusion de sa conférence[72]. La question religieuse comme thématique exclusive est d’emblée écartée comme étant inaccessible en tant que telle, car « il serait impossible de distinguer la situation philosophique de la situation religieuse, et d’en exclure cette dernière […] je substituerai donc à l’intitulé ‘situation religieuse’ celui-ci : situation spirituelle [geistige] du présent »[73]. Il profite de cette substitution pour assimiler « Geist » à la conscience intentionnelle[74], et il suit Heidegger en faisant valoir que celle-ci possède la structure ouverte et incomplète d’une question[75]. Or cette question que se pose l’esprit, c’est la question de l’être, et, dans la mesure où l’esprit qui n’a pas en lui-même de « situation » puisqu’il se tend toujours vers l’universel et vers l’être en tant que tel est néanmoins toujours le nôtre, celui des hommes situés dans un éternel présent [Gegenwart], cette question [Frage] qu’il se pose, ou plutôt ce questionnement [Fragen] qu’il est en son essence est toujours selon Strauss la question de la vie bonne et de la vie juste, la question éthico-politique qui débouche sur celle de l’être en tant qu’être du fait de l’indécidabilité épistémique devant la source abyssale de tout questionnement, de toute conscience et de tout être. (Je signale que la traduction de ce texte comporte une grave erreur de transcription du grec : à la page 389 des GS 2, Strauss évoque la « question pôs biôteon [πῶς βιωτέον] », « comment faut-il vivre ? », que le traducteur transforme (LSJP p. 190) en « prôs biôteôn », ce qui ne veut rien dire.) C’est, explique Strauss par la suite de son exposé, la Destruktion méthodique de la tradition avec ses couches successives de sédimentation (dont les plus épaisses sont celles laissées par les Lumières, qui ne se posent point de questions mais n’imposent que des réponses) qui seule permet de revenir aux choses mêmes, aux choses humaines qui se révélaient tant aux Grecs qu’aux Hébreux. Aussi expose-t-il ici sa fameuse thèse sur la Caverne de Platon, selon laquelle nous autres Modernes, situés tels que nous sommes en aval de notre conditionnement par la tradition et par le progrès, qui n’est que progression de ce recouvrement de l’être par des préjugés, nous nous situons dans une dépendance souterraine encore plus profonde de la Caverne ; et ce n’est qu’en déconstruisant cette tradition que nous puissions remonter vers la cité ancienne, c’est-à-dire vers la Caverne de Platon, c’est-à-dire vers la condition humaine naturelle. Cette condition, cette Caverne originelle est déjà plus près de la vérité en dehors de la Caverne que ne l’est notre condition actuelle, elle est celle à partir de laquelle seule nous pourrons contempler le problème théologico-politique tel qu’il se présente à l’homme.
***
[1] Leo Strauss, « Nicolas Machiavel », in L. Strauss et J. Cropsey, Histoire de la philosophie politique, trad. fr. O. Sedeyn, Paris, PUF Quadrige, 1994, pp. 321-322.
[2] Et non pas « sectes », un faux ami, comme le traduit O. Sedeyn.
[3] Voir Droit naturel et histoire, pp. 19-43
[4] Daniel Cohen-Levinas, Marc De Launay, Gérard Sfez, Leo Strauss, judaïsme et philosophie, Beauchesne, Paris, 2016 [désormais LSJP]
[5] Cf. L. Strauss, « Avant-propos à la traduction anglaise de La critique de la religion de Spinoza » (1965), tr. fr. dans Le testament de Spinoza, G. Almaleh, A. Baraquin, M. Depadt-Ejchenbaum (tr./ed.), Paris, Le cerf, 1991, pp. 306-307.
[6] Cf. L. Strauss, « Qu’est-ce que la philosophie politique ? », dans Qu’est-ce que la philosophie politique ?, tr. fr. O. Sedeyn, Paris, PUF, 1992, pp. 54-55 ; L. Strauss, Droit naturel et histoire, tr. fr. M. Nathan et E. de Dampierre, Paris, Flammarion, pp. 156-219 ; L. Strauss, La critique de la religion chez Hobbes : une contribution à la compréhension des Lumières, tr. fr. C. Pelluchon, Paris, PUF, 2005 ; L. Strauss, La philosophie politique de Hobbes, tr. fr. A. Enegrén et M. de Launay, Paris, Belin, 1991, pp. 159-186.
[7] LSJP p. 42.
[8] La philosophie politique serait l’« eccentric core » de la philosophie en tant que telle. Seth Benardete, « Leo Strauss’ City and Man », in R. Burger et M. Davis (eds.), Seth Benardete: Archeology of the Soul. Platonic Readings of Ancient Poetry and Philosophy, South Bend Indiana, St. Augustine’s Press, 2012, p. 360 (Political Science Reviewer, 1978, p.5).
[9] LSJP p. 46.
[10] LSJP p. 45.
[11] « Pourquoi nous restons juifs », p. 26-27.
[12] LSJP p.46.
[13] Strauss, « Avant-propos à la traduction anglaise de La critique de la religion de Spinoza », tr. cit., p. 288.
[14] Un point sur le rapport à l’islam : G. Sfez affirme que ce qui différencie le judaïsme de l’islam du point de vue théologico-politique du rapport entre loi divine et loi civile, c’est une rupture dans le continuum ente celles-ci dans le judaïsme, une « béance » qui permettrait à la loi civile de ne pas être entièrement absorbée par la Loi divine, et qui serait absente dans l’islam (49-50). Selon Remi Brague, l’idée que Strauss se fait de la Révélation, de la Loi comme donnée en tant que factum brutum indiscutable et totalisant relèverait d’un tropisme « musulman » chez lui, né de sa propension à lire les grecs à partir des falâsifa musulmans comme al Fârâbî ou juifs « islamisés » comme Maïmonide. Strauss ne saurait donc thématiser cette « béance » puisqu’il avait cette vision « musulmane » du factum brutum de la Révélation (R. Brague suggère par ailleurs que la fameuse herméneutique straussienne de l’ésotérisme serait inspirée non pas du Talmud mais du Chi’isme). Voir Remi Brague, « Athens, Jerusalem, Mecca: Leo Strauss’s “Muslim” understanding of Greek Philosophy », dans Poetics Today, vol. 19, no. 2, Hellenism and Hebraism Reconsidered (Eté 1998), Duke Univ. Press, 235-254.
[15] LSJP p. 47.
[16] LSJP p. 48.
[17] LSJP p. 49.
[18] « Progrès ou retour ? », dans L. Strauss, La renaissance du rationalisme politique classique, tr. fr. P. Gugliemina, Gallimard, 1993, pp. 330-331 (« Progress or Return », The Rebirth of Classical Political Rationalism, ed. T. Pangle, U. Chicago Press, 1989, pp. 250-251.
[19] « Pourquoi nous restons juifs », op. cit., p. 18.
[20] Voir supra notre explication de cette démonstration que Strauss répète dans « Pourquoi nous restons juifs ? », dans la « Préface » à l’édition anglaise de Spinozas Regionskritik et dans « Progrès ou retour ? ».
[21] LSJP, p. 71.
[22] Ibid.
[23] Finalement, la position de Strauss à l’égard du sionisme est semblable, du moins sur le plan théorique, à celle de Yechahahou Leibowitz : une affirmation du sionisme et de son Etat comme nécessité politique adossée au refus de confondre les registres politiques et religieux, alors même que ce refus est fondé sur l’affirmation de l’identité purement religieuse, halakhique, du peuple juif voué donc à perdre son essence et son âme si le sionisme politique devait se constituer en valeur absolue. Voir sur ce point et sur l’ensemble de ces questions plus généralement J. Rogove, « Assimilation, modernité, identité : dans l’étau théologico-politique selon Leo Strauss et Emmanuel Levinas », dans Etudes philosophique 2023/1, PUF.
[24] LSJP, p. 78.
[25] Strauss, « Mise au point » dans De la tyrannie, suivi de Correspondances avec Alexandre Kojève, Paris, Gallimard, 1997, dernière page, cité par Sfez p. 80.
[26] LSJP, p. 80.
[27] Cf. L. Strauss, La persécution et l’art d’écrire, tr. fr. O. Sedeyn, Paris, Presses Pocket, 1989, pp. 55-70.
[28] «An Unspoken Prologue to a Public Lecture at St. John’s College in Honor of Jacob Klein », in Strauss, Jewish Philosophy and the Crisis of Modernity, ed. Kenneth Hart Green, Albany, SUNY Press, 1997, p. 250. Cf. Jacques Taminiaux, “Sur la dette de Leo Strauss envers le premier enseignement de Heidegger”, in Sillages phénoménologiques. Auditeurs et lecteurs de Heidegger, Brussels, Ousia, 2002, pp. 205-224 ; François Coppens, « Les prémisses du rationalisme occidental : Leo Strauss et le problème de Socrate », in M.-A. Lescouret La dette et la distance. De quelques élèves et lecteurs juifs de Heidegger, Paris, éd. de l’éclat, 2014, pp. 51-61 ; John Rogove, « Introduction », in, J. Rogove et P. D’Oriano, Heidegger and His Anglo-American Reception, Springer, 2022, surtout pp. xiv-xviii.
[29] Françoise Mies, « Levinas et le sionisme », in Joëlle Hansel (sld), Levinas à Jerusalem, Klincksieck, Paris, 2007.
[30] Levinas, « L’espace n’est pas une dimension », dans Difficile Liberté, Paris, Alban Michel, 1963, (LGF 2016 p. 388).
[31] Levinas, « La souffrance inutile », dans Entre nous, Paris, Grasset, 1991, p. 115, cité par Danielle Cohen-Levinas dans LSJP, p. 85.
[32] LSJP, p. 89.
[33] Ibid.
[34] Tr. fr. par O. Sedeyn dans Nihilisme et politique, Paris, Payot & Rivages, 2001.
[35] Strauss, Nihilisme et politique, op. cit., pp. 35-40.
[36] LSJP, pp. 92 et 102.
[37] Voir par exemple Hegel, « L’esprit du judaïsme », dans l’Esprit du christianisme et son destin, Paris, Vrin, p. 127.
[38] LSJP, p. 97.
[39] Sur cette synthèse cohenienne entre Athènes et Jérusalem – entre la justice de Socrate et celle des Prophètes bibliques, vers laquelle l’Histoire tend selon Hermann Cohen, et qui est la prémisse de la vision progressiste de l’Histoire, et la critique que Strauss en fait, voir J. Rogove, « Assimilation, modernité, identité : dans l’étau théologico-politique selon Hermann Cohen, Leo Strauss et Emmanuel Levinas », Etudes philosophiques (2023/1), PUF. Cf. H. Cohen, Religion der Vernunft aus des Quellen des Judentums, Joseph Melzer Verlag, Darmstadt, 1919 ; et L. Strauss, « Jerusalem and Athens, Some Preliminary Reflections », in L. Strauss, Studies in Platonic Political Philosophy, ed. Thomas Pangle, University of Chicago Press, 1983.
[40] LSJP, p. 101.
[41] Tr. fr. par O. Sedeyn comme « Sur l’interprétation de la Genèse », dans Pourquoi nous restons juifs, op. cit.
[42] M. de Launay, L’événement du texte. Lecture philosophique de la Bible, vol. II., Paris, Hermann, col. « Le bel aujourd’hui », 2015.
[43] LSJP, p.
[44] « L’univers du mythe comprend le langage comme animé par les mêmes forces substantielles qui innervent la nature ; ce que le texte biblique produit, dans sa forme, c’est la subversion de ce continuum : au sein du texte biblique se donne voix un usage linguistique qui systématiquement soumet la nature à une désubstantialisation radicale au profit de valeurs qui ne doivent plus rien à une ontologie cosmologique, mais tout à une symbolique tirée d’une histoire singulière, peu importe qu’elle soit reconstruite ou réécrite dans rigueur scientifique, car le sens de ces valeurs n’a plus pour origine des puissance naturelles, et il ne se forge qu’à travers le langage […]. » M. de Launay, L’événement du texte, op. cit., p. 20.
[45] LSJP, p. 117.
[46] M. de Launay, L’événement du texte, op. cit., p. 8. Si cette affirmation ne se trouve pas directement dans le texte publié dans LSJP, elle accompagne l’explication que M. de Launay donne des éléments de ce qu’il affirme être la révolution en quoi aurait consisté l’événement textuel de la Bible que, selon lui, Strauss n’aurait pas compris.
[47] Telle fut la rupture initiée dès l’incipit de son Enquête par Hérodote : Ἡροδότου Ἁλικαρνησσέος ἱστορίης ἀπόδεξις ἥδε, ὡς μήτε τὰ γενόμενα ἐξ ἀνθρώπων τῷ χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα τε καὶ θωμαστά, τὰ μὲν Ἕλλησι τὰ δὲ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα, ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ἄλλα καὶ δι’ ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν ἀλλήλοισι. Hérodote propose le premier de mener une enquête factuelle, concernant « ta genomena ex anthropôn », et les causes de la guerre. Voir Seth Benardete, Herodotean Inquiries, Nijhoff, 1969, pp. 1-11.
[48] Cf. Strauss, « Jérusalem et Athènes. Réflexions préliminaires », tr. fr. O. Sedeyn dans Pourquoi nous restons juifs, op. cit., pp. 140-141.
[49] Hachette, 1989, pp. 211-212.
[50] Ibid., p. 211.
[51] Cf. Husserl, Recherche Logique V.
[52] Voir La philosophie comme science rigoureuse, première partie.
[53] Voir J. Rogove, « Politique platonicienne et libéralisme. La réception de Léo Strauss aux Etats-Unis », dans Archives de Philosophie (CNRS/Centre Sèvres), Tome 86 cahier 2, 2023 ; voir aussi Catherine et Michael Zuckert, The Truth About Leo Strauss. Political Philosophy and American Democracy, U. Chicago Press, 2006 ; pour un exemple outrancier de ce type de littérature, voir le pamphlet de Anne Norton, Leo Strauss and the Politics of American Empire, New Haven, Yale University Press, 2004.
[54] LSPJ, pp. 124-125.
[55] « Leo Strauss et l’idéalisme allemand », Cahiers de philosophie politique et juridique, N°23, 1993, Presses universitaires de Caen, pp. 139-163.
[56] « Pourquoi nous restons juifs », op. cit., p. 35.
[57] « Préface » à l’édition anglaise de Spinozas Religionskritik, tr. fr. dans Le testament de Spinoza, op. cit., p. 285.
[58] Repris dans l’excellent recueil de Remi Brague, L. Strauss, Maïmonide, qui, outre ce texte de la Persécution, inclut une traduction inédite du second livre de Strauss, Philosophie und Gesetz (1935), plusieurs autres textes de Strauss sur Maïmonide qui sillonnent 30 années (dont certains écrits par Strauss en français), et un long commentaire de R. Brague.
[59] Voir note supra.
[60] Selon Ibn Khaldoun, la science humaine se divise en deux : sciences « traditionnelles », qui incluent et fiqh et kalâm, et sciences « philosophiques », c’est-à-dire falsafa, autrement dit toute science autonome par rapport à la Révélation. Voir son Muqaddima. Cf. Harry Wolfson, The Philosophy of the Kalam, Harvard, 1976.
[61] Selon Maïmonide, son grand ouvrage de fiqh, c’est plutôt le Mishneh Torah. Voir Strauss, « Le caractère littéraire du Guide des égarés », tr. fr. p. 210.
[62] Strauss, « Le caractère littéraire… » dans Maïmonide, op. cit., p. 212.
[63] Une suggestion trouvant sa plus ample expression dans sa monographie parue un an avant le colloque, en 2010 aux Editions du Cerf : G. Roux, Du prophète au savant. L’horizon du savoir chez Maïmonide.
[64] Carl Schmitt, La Notion de politique, Flammarion, 2009 ; Leo Strauss, « Remarques sur La notion de politique de Carl Schmitt » (1932), in C. Schmitt : Parlementarisme et démocratie, Paris, Seuil, 1988, pp.187-214.
[65] Tr. fr. A. Engren, M. de Launay, Belin, 2000.
[66] Le Seuil, 2002.
[67] E. Young-Bruehl, Hannah Arendt, biographie, tr. fr. J. Roman et E. Tassin, Calmann-Lévy, 1999, pp. 125-126.
[68] Le compositeur communiste élève de Schoenberg, collaborateur de Bertolt Brecht et fils du célèbre auteur du Kantlexikon, Rudolf Eisler.
[69] Voir le commentaire de George Schwab dans sa traduction anglaise du Leviathan in der Staatslehre des Th. Hobbes (Greenwood Press, 1996), beaucoup plus explicite que J.-C. Monod au sujet de l’hostilité réciproque entre Schmitt et le régime nazi après sa brève période de proximité au pouvoir, surtout à partir de 1936 et des attaques survenues contre lui dans l’organe des SS, qui souhaitaient sa mort.
[70] LSJP, p. 172. Monod cite Strauss : « l’idée de la loi divine comme d’une loi une et totale qui est en même temps loi religieuse, loi civile et loi morale » face à laquelle « ce n’est pas la Bible et le Coran, c’est peut-être le Nouveau Testament, c’est certainement la Réforme et la philosophie moderne qui ont amené la rupture avec la pensée antique ». (« Quelques remarques sur la science politique de Maïmonide et de Fârâbî », dans GS vol. 2, p. 126.
[71] « Un préambule qui n’a pas eu lieu », dans Pourquoi nous restons juifs, op. cit., pp. 116-117.
[72] LSJP, p. 192.
[73] Ibid., p. 179. Le texte est traduit des Gesammelte Schriften, band 2, pp. 377-391.
[74] « L’esprit n’est pas une chose [Ding] situable qui pourrait avoir une situation. L’esprit est effectif dans la vue, la recherche, la croyance, le désir, l’espoir, la quête de raisons, la justification [Rechenschaften-Fordern und Rechenshaft-Geben], la responsabilité, l’interrogation et la réponse. » (ibid., loc. cit. GS. p. 379).
[75] Voir Heidegger, qui identifie l’intentionnalité à l’être lui-même, qui se manifeste à soi-même comme une question, celle de l’être, dans son cours de Marbourg de l’été 1925 (GA 20, Prolégomènes à l’histoire du concept du temps) auquel Strauss a probablement assisté juste avant son départ de Marbourg pour Berlin pour commencer son livre sur Spinoza à l’Akademie für die Wissenschaft des Judentums.







