Commenter la parution du livre de C. Layet suppose, avant d’en venir à la thèse très clairement défendue par ce livre, de revenir aux circonstances qui en ont rendu l’écriture nécessaire. Ces circonstances pourraient être purement académiques et elles le sont pour partie : il y a peu d’études sur Hölderlin, moins encore de monographies ; lorsque la poésie de Hölderlin est étudiée, sa philosophie – ou sa position dans l’histoire de la philosophie – ne l’est pas toujours du même coup ; et évoquer à l’inverse la position de Hölderlin pour ou dans la philosophie oblige immanquablement à sortir de la seule étude littéraire pour revenir à Heidegger et à la manière dont ce penseur a fait tenir à Hölderlin un rôle déterminant dans l’identification du site qui nous est propre, celui de la fuite des dieux, et de la nécessité d’une méditation d’un grec plus originaire que celui de Platon, dont Hölderlin fut, avant Heidegger et selon lui, le chantre et le traducteur. Il était donc urgent de relire le penseur-poète Hölderlin et de se faire le devoir de le lire malgré Heidegger, c’est-à-dire hors de lui.
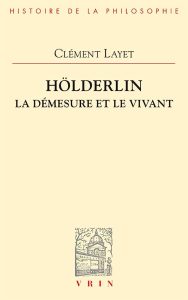 À ce titre, l’ouvrage publié il y a déjà deux ans par Clément Layet revêt une importance fondamentale, ne serait-ce que parce que ce livre, par son ambition d’exhaustivité dans la lecture du poète, n’est comparable à nul autre. L’auteur rend donc pour ainsi dire au poète un service précieux voire inespéré : faire apparaître, dans un texte d’une rigueur et d’une érudition irréprochables, ce que peut être l’unité, en un sens secrète, ou du moins retenue, du parcours intellectuel et philosophique de Hölderlin, depuis les premiers écrits de jeunesse jusqu’à ses derniers poèmes, rédigés dans l’effondrement de ses facultés. Cette remarque liminaire doit suffire à faire comprendre combien ce livre doit d’être célébré.
À ce titre, l’ouvrage publié il y a déjà deux ans par Clément Layet revêt une importance fondamentale, ne serait-ce que parce que ce livre, par son ambition d’exhaustivité dans la lecture du poète, n’est comparable à nul autre. L’auteur rend donc pour ainsi dire au poète un service précieux voire inespéré : faire apparaître, dans un texte d’une rigueur et d’une érudition irréprochables, ce que peut être l’unité, en un sens secrète, ou du moins retenue, du parcours intellectuel et philosophique de Hölderlin, depuis les premiers écrits de jeunesse jusqu’à ses derniers poèmes, rédigés dans l’effondrement de ses facultés. Cette remarque liminaire doit suffire à faire comprendre combien ce livre doit d’être célébré.
La poésie et a fortiori la pensée : l’ambition herméneutique de Layet se situe bien à la croisée de ces deux axes, cherchant à commenter littérairement les poèmes et à analyser philosophiquement les essais mais aussi et surtout à montrer comment poésie et philosophie s’entr’appartiennent, relevant de la même dimension et s’octroyant réciproquement leur possibilité. C’est en sa position philosophique qu’Hölderlin dut se faire poète et sa manière de poétiser fut d’être aussi philosophe. Coappartenance des lettres et de la philosophie qui supposait, pour qu’on la laisse apparaître, une double culture qui n’est pas le moindre mérite du commentateur.
Une telle ambition ne va pas sans difficultés. La plus formelle, mais non la plus négligeable est celle de l’éclatement : si la pensée de Hölderlin reçoit son unité d’une tâche devant laquelle le poète ne recula jamais, sa poésie disperse cette tâche en tentatives multiples dont l’exégèse littéraire ne manque pas de faire du livre de Layet une succession de tableaux relativement séparés les uns des autres plutôt qu’un chemin rythmé par une pulsation imperturbable. De fait, celui qui réclamerait de Layet une compréhension thétique de la doctrine de Hölderlin serait surpris : il est clair qu’une telle doctrine, que le poète ne formula jamais sous une forme arrêtée, n’existe pas et qu’on n’en trouvera pas dans ce livre une explicitation virtuelle. La difficulté appartient à la chose même : pourquoi Hölderlin, s’il fut aussi philosophe, si ses poètes sont porteurs d’une véritable tentative de penser, ne fut-il pas seulement ou complètement philosophe ? Seule l’interprétation des poèmes peut donner la mesure d’une réponse et c’est à cet exercice que Layet se livre avec méthode et probité, quitte à risquer par moments de substituer au fil conducteur d’un raisonnement proprement philosophique une juxtaposition de commentaires dont la succession est exclusivement chronologique.
Méthode et probité ne signifient certes aucunement que Layet n’a pas, sur Hölderlin, une thèse, qui est autant sa manière de lire que d’avoir été frappé par ce qu’il a lu. Layet défend un certain nombre de positions sur la compréhension hölderlinienne de la relation de l’Un au multiple, et de la langue à la révélation de la vérité, mais aussi sur la compréhension de la paix, du bien et du mal, à laquelle devrait selon lui nous conduire le poète. Et cette compréhension consiste partout, au fond, à remettre en cause la relation que Hölderlin doit entretenir à Heidegger, et la proximité que le second a cherché à construire avec le premier : lire Hölderlin pour lui-même, selon Layet, c’est d’abord le libérer de Heidegger, donner le champ libre d’une interprétation du poète qui ne soit pas commandée par le seul établissement du rapport entre poésie et pensée de l’Être, et pas non plus par le souci de retrouver chez Hölderlin une image anticipée du monde grec tel que Heidegger l’aura inlassablement reconstruit. Or, l’apport essentiel de ce contournement du massif heideggerien est pour Layet et sans nul doute aussi pour son lecteur de mesurer plus librement la relation que la poésie de Hölderlin noue au christianisme et au judaïsme, relation que Heidegger avait quant à lui passé presque entièrement sous silence.
Ambition particulièrement engageante, donc, difficile à mesurer – mais il s’agira au fond aussi d’établir si Layet la mesure bien lui-même. Et pour cela, de se demander si la thèse centrale du livre, celle d’une « harmonie » entre le divin biblique et le divin grec que Hölderlin aurait plus que tout autre et par d’autres moyens que la philosophie, essentiellement réussis à percer – thèse qui aboutit finalement à une double récusation : celle de l’Ereignis comme lieu central de la poésie hölderlinienne, celle, soutenue par Heidegger mais soutenable aussi par ailleurs, de l’étrangeté réciproque du chrétien et du grec – si cette thèse, qui sert de mesure d’explication à la folie de Hölderlin, dispersé dans le multiple qu’il a lui-même tenu pour l’expression nécessaire de la présence des dieux, est, au fond, véritablement recevable, du moins telle qu’elle se trouve ici formulée.
Ce serait alors le statut – poétique, philosophique, théologique – de Hölderlin lui-même qui serait engagé par cette question. Hölderlin est-il bien – telle est la thèse de Layet – le « sauveur » attendu, le réconciliateur ultime de ce qui ne fut jamais ultimement séparé : la poésie grecque, son divin, son tragique, son rapport si singulier au monde d’un côté – et le salut chrétien de l’autre ? Ou bien la séparation – du grec et du chrétien – prime-t-elle sur la volonté, délibérée et inlassable jusqu’à l’exaltation et l’effondrement, de retrouver l’harmonie ?
Déployer l’espace de ces questions difficiles requiert des préalables. Pour commencer, Hölderlin ne saurait concerner les tâches de la philosophie sans s’inscrire à son tour dans l’histoire qui est celle de cette dernière. C’est à démontrer une telle inscription que Layet commence donc, à bon droit, par s’ingénier. Mais c’est à une singulière interprétation de l’histoire que l’auteur, du même coup, se livre : si Hölderlin, « au-delà des limites kantiennes », ouvert à « une toute autre activité que celle du seul esprit humain », si Hölderlin, dérangeant ou débordant l’époque de la subjectivité absolue dans laquelle il a surgi lui-même – si Hölderlin nous concerne, c’est parce que « tout ce dont nous faisons l’expérience en ce début du XXIème siècle » rappelle la nécessité de dire ce que Hölderlin a tenté de rencontrer : « que soient reconnus d’autres droits que les droits humains, d’autres devoirs que ceux de respecter notre prochain, mais d’abord une autre relation, antérieure aux droits et aux devoirs : une attention pour les vivants, pour les choses, qui nourrisse aussi notre désir de coexister » (p. 14).
Sans en prononcer le mot, Layet estime donc que nous pouvons trouver chez Hölderlin les ressources du surmontement du nihilisme qui caractérise notre temps, nihilisme que les Lumières kantiennes, sans dire qu’elles suffisent à en donner la mesure, ne suffisent pas, en tous cas, à combattre efficacement. Hölderlin comme arme pour faire triompher « l’attention », la « relation », le « désir de coexister » : comment serait-ce possible sans que l’oeuvre de Hölderlin ne s’avère révélatrice – et détentrice – de possibilités nouvelles pour la pensée et pour la situation de l’homme dans le monde ? Au titre de quoi Hölderlin serait-il alors le libérateur de ces possibilités, le peintre de ce nouveau regard ?
Et si l’on peut adresser une troisième question, mais cette fois à Layet lui-même, ne moralise-t-il pas excessivement ce qu’il exige de Hölderlin ? Nous comprenons en effet que la véritable urgence que se donne Layet n’est au fond pas académique, elle est morale: le monde est au comble de son mal et requiert, pour se réajuster à son bien, la parole hölderlinienne. Celle-ci apparaît comme remède au rétrécissement de l’expérience même dans laquelle elle est prononcée: expérience de la présence paisible du divin, à laquelle nous sommes partout arrachés. Or, si la poésie apparaît comme un bien, en un sens d’emblée différent de l’interprétation heideggerienne de la formule suivant laquelle « là où est le danger croît aussi ce qui sauve » – car dans cette formule il n’est question que de sauver la vérité de l’être et non « les droits des vivants et des choses » -, si donc Layet lit Hölderlin suivant un impératif moral, cette moralisation même interroge: jusqu’à quel point fait-elle partie du projet de Layet, dans quelle mesure lui est-elle consubstantielle au point d’en révéler le sens, et surtout jusqu’à quel point en commande-t-elle l’allure académique: une opposition à l’appropriation heideggerienne de Hölderlin ?
 L’auteur trouve la réponse à ces questions chez Hölderlin lui-même. Il reconnaît à Hölderlin une interrogation radicale : « il s’est interrogé… sur la nécessité qu’il y ait du vivant » (p. 14), non pas en lui assignant, de manière « pré-critique », une cause transcendante, inconditionnée, mais bien en « dégageant, progressivement, une autre position métaphysique » où la pensée et la nature seraient susceptibles de cesser de s’opposer. Hölderlin métaphysicien : c’est déjà contrevenir à l’enseignement de Heidegger. Layet rappelle que Heidegger eut de Hölderlin une lecture historiale, le considérant comme placé sous la décision de « l’arrivée ou la fuite du dieu », et comme affranchi de l’essence de la technique (p. 16), mais tout cela dans le cadre d’une « adversité envers les religions » (p. 17) qui « situait Heidegger en porte-à-faux de Hölderlin » : Hölderlin, en effet, « fait entendre la voix de cette relation » entre les humains est « ce qui leur est autre », « répond à l’exigence du divin lui-même », et ce faisant, la compréhension heideggerienne de la tâche de la pensée n’est pas à la mesure du rapport que Hölderlin entretient à la Révélation biblique. À l’inverse, en tournant Hölderlin vers une certaine justification de l’inscription de l’humain dans un monde et une nature, en le tournant vers une compréhension du vivant plutôt que vers une poésie remémorant seulement – ou exclusivement – la destination de l’être, Layet semble soustraire Hölderlin à la pensée de l’appropriation pour le rendre à une dimension qui fut aussi la dimension chrétienne, inspirée, de la création. Toute la question est de savoir jusqu’à quel point la substitution du second point de vue au premier est tenable, et jusqu’à quel point elle porte le livre de Layet lui- même.
L’auteur trouve la réponse à ces questions chez Hölderlin lui-même. Il reconnaît à Hölderlin une interrogation radicale : « il s’est interrogé… sur la nécessité qu’il y ait du vivant » (p. 14), non pas en lui assignant, de manière « pré-critique », une cause transcendante, inconditionnée, mais bien en « dégageant, progressivement, une autre position métaphysique » où la pensée et la nature seraient susceptibles de cesser de s’opposer. Hölderlin métaphysicien : c’est déjà contrevenir à l’enseignement de Heidegger. Layet rappelle que Heidegger eut de Hölderlin une lecture historiale, le considérant comme placé sous la décision de « l’arrivée ou la fuite du dieu », et comme affranchi de l’essence de la technique (p. 16), mais tout cela dans le cadre d’une « adversité envers les religions » (p. 17) qui « situait Heidegger en porte-à-faux de Hölderlin » : Hölderlin, en effet, « fait entendre la voix de cette relation » entre les humains est « ce qui leur est autre », « répond à l’exigence du divin lui-même », et ce faisant, la compréhension heideggerienne de la tâche de la pensée n’est pas à la mesure du rapport que Hölderlin entretient à la Révélation biblique. À l’inverse, en tournant Hölderlin vers une certaine justification de l’inscription de l’humain dans un monde et une nature, en le tournant vers une compréhension du vivant plutôt que vers une poésie remémorant seulement – ou exclusivement – la destination de l’être, Layet semble soustraire Hölderlin à la pensée de l’appropriation pour le rendre à une dimension qui fut aussi la dimension chrétienne, inspirée, de la création. Toute la question est de savoir jusqu’à quel point la substitution du second point de vue au premier est tenable, et jusqu’à quel point elle porte le livre de Layet lui- même.
Quel est ce rapport entre la pensée et la nature ? C’est d’abord contre Kant, dans le souci d’une « unification réelle » (p. 20) du sujet et de l’objet dans le « sentiment de la beauté », que Hölderlin essaie de transgresser leur opposition dont le criticisme n’est que la répétition. Essai qui inscrit Hölderlin dans l’idéalisme allemand cherchant à « surmonter la fracture entre la liberté et la nature » (p. 21). « L’être » aura été pensé, dès 1795, comme la solution de ce problème : il est la « liaison du sujet et de l’objet » (p. 25) ; dans l’être est une liaison absolue, ce qui « est », est absolument. Mais « être » relie aussi bien deux termes pour les réunifier alors qu’ils sont séparés (p. 26): d’où la question formulée par Layet et qu’à ses yeux, Hölderlin «ne cessera plus d’examiner » : « pourquoi cette instance principielle doit-elle se scinder si elle est un principe d’unité » (p. 27) ? Et d’autre part, comment l’être peut-il être dit de manière absolue, avant même que le sujet qui parle ne soit posé, sans que cela n’assimile à une position dogmatique ? Suivant Platon, Hölderlin soutient d’abord que l’absoluité de l’union existe en nous sous la forme d’un désir prouvant qu’elle nous précède (p. 29), et prouvant aussi qu’elle nous appelle : « l’être n’est pas entièrement séparé de l’humanité », l’être « porte un intérêt à l’humain » (p. 30), et c’est pourquoi il nous appartient de réconcilier la séparation même qui nous met à distance de l’absolu. Toute culture conserve donc un lien essentiel avec la nature, sous la forme d’une « impulsion formatrice » (p. 32- 33) qui aura pour contenu cette réconciliation même. Ce qui suppose aussi la possibilité d’harmoniser toutes les cultures entre elles (p. 34).
Tout ceci place le jeune Hölderlin sous l’autorité souveraine de « l’un différencié en lui- même » dont Héraclite était le messager et sous le sceau duquel tout l’idéalisme allemand est placé. Toute l’affaire de Hölderlin est de penser l’union et sa différenciation non seulement dans la pensée – dialectiquement – mais aussi dans la vie – naturellement, l’union de la pensée et de la nature étant, derechef, « l’essence de la beauté » (p. 36). « L’un différencié en soi-même » correspondant à cet idéal de beauté, c’est-à-dire à la disparition du conflit entre le sujet et l’objet. La beauté sera, en elle- même, « principe d’unité et de différenciation » (p. 37), et c’est pourquoi la parole qui participe à ce principe devra elle-même être poétique : la langue poétique, non conceptuelle, est la seule à « retrouver l’unité à même la différence » (p. 38). à condition toutefois que le poème ne soit pas œuvre purement humaine, soit « fruit d’une relation entre l’esprit et le dehors » (p. 39), image de soi du principe lui-même. Layet souligne la dimension théologique de cette compréhension de l’Un comme créateur et de la langue comme inspirée (p. 40-43). Mais surtout Hölderlin achève d’identifier Dieu lui-même à un Verbe, « la poésie assume librement sa propre sacralité » (p. 43) et devient au fond la divinité même du dieu. C’est à une certaine conception de la langue, spirituelle, que se rattache alors Hölderlin.
Toutefois – question récurrente chez Layet –, cette conception de la langue poétique n’est- elle pas un simple rêve et comment échapper à cette objection ? Hölderlin ne transgresse-t-il pas Luther – la parole de Dieu ne se donnant que dans les Saintes Ecritures et non dans quelque vision humaine – autant que Kant et aussi gravement (p. 44-45) ? Hölderlin tombe-t-il sous le coup de l’accusation portée par Kant contre les enthousiastes, qui prétendent à une connaissance immédiate du suprasensible (p. 49) ? Hölderlin, d’autant plus qu’il devint fou, « a-t-il confondu l’activité de son esprit avec une réalité extérieure ? » (p. 54). Hölderlin le soutient cependant et malgré ce soupçon : sa propre langue est légitimée par un principe divin. « Chaque image est le support d’une telle monstration » du principe (p. 55) : « l’image conduit l’esprit jusqu’aux choses mêmes, en produisant la sensation de leur présence ». Mais cela à condition que l’image « se sépare d’elle-même », s’efface pour « faire exister la relation qui n’aurait pas de vie sans elle ». En cela, l’image est « vivante ». Elle donne vie à ce qu’elle montre, loin de simplement reposer sur lui : « les vivants montrent l’originaire qui les conditionne. Mais l’originaire n’existe pas sans cette monstration » (p. 55). Aussi « l’image est le conditionné montrant la condition, l’apparition de l’originaire dans la »lumière de la vie » » (p. 56). Autrement dit encore, « le principe ne serait pas vivant sans la vie réellement vécue et réellement finie ». La monstration est donc « circulaire » ; mais a-t-elle pour autant « valeur de preuve » ?
Layet ne répond pas mais souligne d’abord l’urgence de la question. Ce que montre Hölderlin pourrait, en effet, venir compléter la pensée kantienne sacralisant la dignité humaine. C’est autre chose que sacralise en effet Hölderlin, « au-delà des limites de l’humanité », : la relation de l’esprit et de la nature, qui répond peut-être de proche en proche à la dévastation planétaire (p. 57), ou plutôt qui est incommensurable à cette dévastation puisque l’originaire recherché par Hölderlin dans sa mise en images poétiques « se déplace lui-même » à chaque fois qu’il se donne dans la langue, en sorte que l’avènement de cet originaire demeure un événement poétique et non un dogme. Mais cet événement pourrait être salutaire quoiqu’il ne soit pas possible, en raison de la distance qui, déjà, nous sépare de Hölderlin, que « notre monde soit hölderlinien » (p. 57).
Layet articule cette problématique générale au commentaire du poème « Art et Nature, ou Saturne et Jupiter ». L’art ne saurait se réconcilier avec la nature sans « intérioriser sa provenance naturelle » (p. 63). La tâche de l’art se confond alors avec son propre contenu (p. 64). Mais quelle est la nécessité de cette tâche, et à nouveau, ne faut-il pas la tenir pour arbitraire ? Réponse de Layet, s’appuyant sur Plotin cette fois : cette nécessité, c’est la beauté même qui la porte puisque la beauté exige qu’il y ait d’elle une image, en sorte que l’image est toujours en relation à sa source. C’est ainsi la nature qui aurait « exigé » de l’art qu’il en produise la mémoire. « Il n’y a » donc « plus de beauté initiale, mais un mouvement d’imitation et d’arrachement qui confère au beau sa beauté antérieure » (p. 66). Et cette complémentarité de la nature et de l’art, c’est « la vie pure » (p. 66), qui « commence dans la réflexion, comme conscience de leurs insuffisances respectives, et s’accomplit dans la production artistique » (p. 66). De fait, c’est « l’écart » entre nature et art qui « mérite d’être qualifié de divin », et si l’art est affaire humaine, c’est au sens où « l’humain se trouve lié à une instance qui le dépasse » (p. 66). La vie est donc faite de « liens vivants », est essentiellement déchirure et la nature n’est pas, chez Hölderlin, un en-soi mais bien une « tension indépassable » qui donne vie et mort, génération et corruption – du poème en tous cas (p. 67). Et par là, on comprend que le poème n’est pas que « figuration symbolique », puisqu’il « effectue ce dont il parle », « rend présente, sensible, l’opposition principielle au moyen d’une harmonisation effective » (p. 67).
Une telle interprétation de la langue poétique engage une révision de la théologie (p. 69). Dieu ne peut plus être seulement tenu pour un concept inconnaissable voire pour le concept de l’inconnaissable. Il doit s’inscrire dans un « espace relationnel ». Or cet espace s’ouvre dès lors que « l’homme entretient avec la nature une relation qui transcende ses seuls besoins » (p. 70) : non seulement l’humain s’y différencie de l’animal (par une « vie supérieure ») mais le divin s’avère le lieu même de cette différenciation : « en l’absence d’une telle représentation, la »connexion supérieure » ne pourrait même pas être établie » (p. 71-72). Si l’humain est un pôle de sa relation à la nature, cette relation a besoin d’un autre pôle pour se maintenir. Avec une difficulté : si le divin conditionne le « destin supérieur » de l’homme, il est à son tour conditionné par ce destin. À nouveau, ne tourne-t-on pas dans un cercle (p. 72) ? Au contraire, selon Layet : certes, la « connexion supérieure » de l’homme avec sa propre vie est l’épreuve de la « reconnaissance » et de la « satisfaction », mais cette connexion prolonge, sans la contredire, la « satisfaction corporelle » qui est le propre de la vie animale. Or, comment la vie peut-elle abriter elle-même la possibilité de ce prolongement, sinon parce que la « représentation », par laquelle l’homme se lie à sa propre vie, « conserve la détermination du vivant » (p. 73) ? Encore faut-il dire que la représentation donne accès, de par soi, à une « connexion supérieure » au seul esprit humain, abrite autrement dit la trace de sa propre transcendance (p. 74), que les Anciens appelaient le divin. Cependant, et à nouveau, comment affirmer la réalité du divin ? C’est d’abord la nécessité d’une connexion des hommes au- delà des animaux qui l’atteste (p. 76), et de fait, les dieux et l’esprit correspondent à ce que crée la vie dans sa satisfaction infinie à l’égard d’elle-même. Aussi « l’esprit est le produit de l’union indissociable des humains avec leur sphère » (p. 77). Il est, autrement dit, partiellement issu de l’imagination humaine, mais il implique un principe relationnel avec un monde extérieur, il implique que le divin soit dans le monde, sans pourtant se trouver lui-même dans le monde, car le divin n’est pas du monde, il est notre relation au monde, introuvable dans l’un des pôles séparés de ce qu’il met en relation (p. 78-79). Le divin reste ainsi à distance, ce qui prémunit Hölderlin de l’hubris (p. 80).
« Principes relationnels », poésie et philosophie ne sont plus, dès lors, des « instruments de domination » mais « commémoration et gratitude » (p. 84), « union harmonique » où « chacun honore son dieu à travers des représentations poétiques, et tous un dieu communautaire, où chacun fête mythiquement sa vie supérieure et tous une vie communautaire supérieure, la fête de la vie » (p. 84 citant Hölderlin lui-même). Ce principe relationnel de la poésie est attesté selon Layet par une analyse du rôle de l’image comme union harmonique (p. 91).
Cependant, à ce stade de la lecture et s’étendant à l’ensemble du livre, une question se pose : comment pensée et poésie peuvent-elles s’articuler sans que la première n’offense la seconde, ou plus précisément encore, comment penser la poésie ?
La thèse de Layet sur le statut de la langue de Hölderlin paraît contenue dans son dernier chapitre, intitulé « Nul ne saisit / Dieu seul », et c’est à André du Bouchet que Layet en emprunte la formulation : « clôture paradoxale qui, en contenant les choses, les laisserait échapper – puis s’en approcherait de nouveau, en tant que choses lointaines » (p. 335). Ainsi « l’image indique l’étendue » qui la sépare des choses « sans la traverser ». Donc, finalement, « souveraineté de la distance » qui « s’impose à l’Un en le poussant à se différencier » (p. 335), pour « devenir vivant », et dont l’image est le « fruit » (p. 335), et précisément en tant qu’elle ne « ressemble pas » à l’Un puisqu’elle « unifie là où le principe est traversé par la scission » (p. 336). Hölderlin trancherait à ce titre sur toute philosophie de l’unification, dans le sujet (Fichte, Kant, Schiller) : « le principe exige indéfiniment de se tenir dans une langue qui ait la teneur du lieu initial, qui reste ancrée dans le non- moi : poésie » (p. 337). Pour autant, la poésie de Hölderlin est philosophie : « Hölderlin conçoit dès lors le fondement de toute réalité comme la relation qui unit la pensée avec les choses » (p. 336), position qui n’est ni réaliste ni idéaliste, mais qui est distinction et unification des pôles.
Ainsi, l’unification est impossible « sur les plans théorique et pratique » mais « cette impossibilité même fait sentir le réel, par-delà toute pensée » (p. 337). De fait, la poésie, « parole humaine qui laisse venir le mystère», doit être considérée philosophiquement comme le « commencement et la fin » (p. 337), puisque la poésie « libère du désir d’unification absolue », retrouve « le monde comme ce qui lui résiste sans vouloir nier cette résistance » (p. 338).
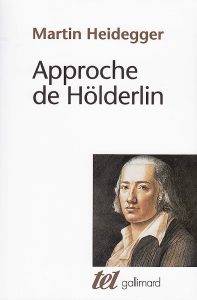 A ce titre, Layet souligne que Hölderlin « a répondu au besoin d’unité éprouvé par son époque » (p. 339), mais aussi « l’impossibilité de le résoudre comme l’élément le plus réel ». Hölderlin aurait vu « la force de négation constitutive de l’unité la plus profonde », une négativité plus haute, donc, que la négativité hégélienne ! En cela, parce qu’il place une « relation » au « fondement de toute réalité » plutôt qu’une « instance mondaine », Hölderlin intéresse Heidegger, parce qu’il s’est soustrait d’avance à l’ontothéologie (p. 339), et plus encore, parce qu’il annonce un autre commencement pour la pensée, celui de la relation, que Heidegger va toujours entendre (selon Layet) comme Ereignis. (Il faut revenir pour mesurer ce glissement de la relation hölderlienne à la relation appropriante, à la lecture heideggerienne de Hölderlin en détail : Blanchet). L’interprétation que Layet lui-même propose de l’Ereignis repose sur celle du dispositif technique comme pouvant « rendre sensible à l’apparaître en général, tel qu’il est essentiellement lié à sa disparition » (p. 340), en sorte que « le dispositif offre la chance de mesurer que tout événement appropriant (Ereignis) appartient à la dépropriation (Enteignis ». Or, cette « connexion latente » entre les choses et leur retrait aurait été celle qu’aurait expérimenté Hölderlin. (Tout cela est irrecevable mais à quelles conditions devient-il nécessaire de le démontrer?) Or, selon Layet, ce parallélisme entre la relation hölderlienne et la relation heideggerienne ne tient plus à l’instant où Heidegger estime que Hölderlin « »attend » lui aussi un dieu adverse et ultime » (p. 340), advers au Dieu biblique. Hölderlin n’attend pas de dernier dieu : il « institue la vie de l’unité » des traditions grecque, juive et chrétienne, « à partir de leurs différences et de leurs replis historiques », unification dont Layet a montré qu’elle repose sur une mécompréhension, par Hölderlin, du judaïsme essentiellement réduit à une « annonce de la révélation christique » (p. 341). Quoiqu’il en soit pour l’instant, Hölderlin n’exclut pas le Dieu biblique du principe de relation, et ainsi, ne se contente pas de « clore l’histoire de la métaphysique » (p. 341), il maintient aussi « les conditions à partir desquelles les traditions religieuses n’ont pas cessé d’être vivantes et de pouvoir rester actives » (p. 341) puisqu’il « voit toute manifestation des choses comme une révélation ». De fait, Hölderlin n’est pas, tant s’en faut, celui qui oppose radicalement pensée et religion, et l’harmonie qu’il s’efforce d’atteindre est irréductible à l’Ereignis et offensée par l’Ereignis.
A ce titre, Layet souligne que Hölderlin « a répondu au besoin d’unité éprouvé par son époque » (p. 339), mais aussi « l’impossibilité de le résoudre comme l’élément le plus réel ». Hölderlin aurait vu « la force de négation constitutive de l’unité la plus profonde », une négativité plus haute, donc, que la négativité hégélienne ! En cela, parce qu’il place une « relation » au « fondement de toute réalité » plutôt qu’une « instance mondaine », Hölderlin intéresse Heidegger, parce qu’il s’est soustrait d’avance à l’ontothéologie (p. 339), et plus encore, parce qu’il annonce un autre commencement pour la pensée, celui de la relation, que Heidegger va toujours entendre (selon Layet) comme Ereignis. (Il faut revenir pour mesurer ce glissement de la relation hölderlienne à la relation appropriante, à la lecture heideggerienne de Hölderlin en détail : Blanchet). L’interprétation que Layet lui-même propose de l’Ereignis repose sur celle du dispositif technique comme pouvant « rendre sensible à l’apparaître en général, tel qu’il est essentiellement lié à sa disparition » (p. 340), en sorte que « le dispositif offre la chance de mesurer que tout événement appropriant (Ereignis) appartient à la dépropriation (Enteignis ». Or, cette « connexion latente » entre les choses et leur retrait aurait été celle qu’aurait expérimenté Hölderlin. (Tout cela est irrecevable mais à quelles conditions devient-il nécessaire de le démontrer?) Or, selon Layet, ce parallélisme entre la relation hölderlienne et la relation heideggerienne ne tient plus à l’instant où Heidegger estime que Hölderlin « »attend » lui aussi un dieu adverse et ultime » (p. 340), advers au Dieu biblique. Hölderlin n’attend pas de dernier dieu : il « institue la vie de l’unité » des traditions grecque, juive et chrétienne, « à partir de leurs différences et de leurs replis historiques », unification dont Layet a montré qu’elle repose sur une mécompréhension, par Hölderlin, du judaïsme essentiellement réduit à une « annonce de la révélation christique » (p. 341). Quoiqu’il en soit pour l’instant, Hölderlin n’exclut pas le Dieu biblique du principe de relation, et ainsi, ne se contente pas de « clore l’histoire de la métaphysique » (p. 341), il maintient aussi « les conditions à partir desquelles les traditions religieuses n’ont pas cessé d’être vivantes et de pouvoir rester actives » (p. 341) puisqu’il « voit toute manifestation des choses comme une révélation ». De fait, Hölderlin n’est pas, tant s’en faut, celui qui oppose radicalement pensée et religion, et l’harmonie qu’il s’efforce d’atteindre est irréductible à l’Ereignis et offensée par l’Ereignis.
Or, si l’Ereignis en dépend, cela n’a-t-il pas des conséquences ultimes sur la tâche d’une pensée comme celle de Heidegger, qui prétend se mesurer à l’éclat du paraître ? Encore faudrait-il, pour répondre, mesurer la place du Dieu biblique dans Hölderlin, ce à quoi s’ingénie Layet dans les chapitres intermédiaires !
Langue oecuménique, la poésie de Hölderlin est essentiellement pacifiante et respectueuse, loi morale qui dépasse celle de Kant (p. 343, du moins c’est ce que je comprends). Cette situation a permis une interprétation judaïsante de Hölderlin, comme « capable d’atteindre la judéité » (p. 344). Hölderlin aurait, tel un prophète, « consacré sa vie à la présence de Dieu, au risque du rejet et de l’isolement » (p. 345) ; il aurait « vécu historiquement, c’est-à-dire en ayant conscience que chaque fragment du temps et de l’espace participe de la Révélation » (p. 345). Ou encore : « d’abord liée à la nature puis devenant réalité spirituelle, l’existence de Hölderlin effectue le passage du mythologique au messianique » (p. 346). On peut se demander ce qui autorise ce glissement d’une révélation divine commune, à une Révélation entendue maintenant comme le nom propre d’une histoire sainte. Hölderlin est-il finalement aussi grec que chrétien, grec et chrétien à parts égales, ou bien plus juif et chrétien que grec, à l’inverse de ce que soutenait Heidegger mais de fait, en renouvelant l’exclusion déjà établie par Heidegger entre le grec et le chrétien ? La foi de Hölderlin s’accomode-t-elle en vérité de l’oecuménisme ?
Au regard de celui-ci, Heidegger est accusé par Layet d’avoir « négligé le point de vue de l’autre », de s’être illégitimement « dispensé d’être attentif aux pôles de relation » (p. 346), bref d’avoir abstrait Hölderlin de sa spiritualité biblique. Il « n’en a pas tiré les conséquences réelles qui s’imposaient sur les plans du savoir et de l’éthique » (p. 346) : accusation qui remet en cause, de proche en proche, l’ensemble de la tâche de la pensée. Et c’est spécialement au judaïsme, dont Heidegger aurait voulu « dénier tout avenir spirituel » voire « contribuer à son éradication », que cette accusation est liée : ignorance et violence de Heidegger qui « suffisent à exiger une autre pensée de l’histoire que la sienne », une pensée qui, précisément « lit Hölderlin comme une Révélation » !
Layet conclut. « Lire Hölderlin nous aura conduit jusqu’au lieu, comme antérieur aux divergences entre le Nom biblique, le logos grec, le Verbe incarné ou l’Ereignis heideggerien, où leurs différentes orientations se révèlent nécessaires à la vie de l’unité », mais d’une unité « que la pensée imagine à travers la parole poétique mais où elle n’entre pas », puisque cette unité reçoit son foyer d’un « besoin de se manifester, où le divin devient lui-même » (p. 347), besoin qui est un « besoin de l’autre où l’unicité se retire ». La manifestation du divin, ainsi, « n’existe pas en tant que point », « n’existe qu’à travers les mots échangés, qu’à travers les images qui le montrent en trahissant son indétermination » (p. 347).
Layet s’appuie finalement sur un commentaire du poème Patmos d’où provient le vers : « Nul ne saisit / Dieu seul ». Absolutiser Dieu est tâche impossible. Mais cette difficulté même peut être absolutisée puisqu’elle provient de Dieu, de la plénitude de toutes choses en Dieu (p. 348). De fait, Dieu peut bien être saisi, mais non par une souveraine solitude : par l’amour, dont Layet fait ici l’essence de la parole échangée. Johannisme, selon Layet : Dieu est verbe, « fait exister le monde en créant les lettres qui feront venir les choses » (p. 349). Mais de fait, l’existence humaine, par « l’infinité des liens qu’elle entretient aux autres choses », existe comme finie : ainsi le danger d’une vie mortelle, solitude, est-il aussi le lieu salutaire où le principe relationnel peut survenir. Ainsi, « c’est dans la menace même de la finitude, dans la faiblesse propre à toute existence finie, dans les limites de sa détermination que s’éprouve l’origine impensable de toute réalité » (p. 349), puisque « la présence de l’autre est bonne, est même la condition de toute bonté » (p. 350). Mais l’autre n’est pas nécessairement autrui, c’est la vie même qui, « en supportant tout par elle-même », parce qu’elle est « relation », « peut jouer le rôle de l’autre » (p. 350). L’Un, à nouveau, n’unifie que sa propre différence d’avec soi, que sa propre altérité à soi.
Pensée salutaire parce qu’elle est le remède à toute hégémonie, à toute infinitisation de la vie en tant que telle. La finitude de la vie, qui est son danger, laisse finalement réapparaître sa vérité même, cet « impossible à unifier » (p. 351). Cette endurance, cette humilité qui sont finalement le site propre de Hölderlin le prémunissent finalement de toute « exaltation », laquelle vient tant se confondre pour finir avec la folie individuelle qu’avec l’hubris universelle, collective ou mondiale (p. 352-353). La vie n’est pas « universellement seule », elle est « provenance commune de la vie et de la mort », « ombre projetée sur la terre » (p. 353).
Nous comprenons maintenant comment penser la poésie : elle ménage la proximité du lointain sans en offenser la distance, sans s’en prétendre souveraine. Et ce lointain dont la poésie ménage la présence, plus délicatement – plus salutairement – que toute théologie, c’est le divin. C’est alors que nous rencontrons à nouveau la question de la nature de ce divin dont Hölderlin fit incessamment la belle et terrible expérience. Si la thèse de Layet est celle de l’unité harmonique, cette unité est d’abord celle du grec et du chrétien, réunis dans une instance unifiante et néanmoins toujours éclatée : le « divin ». Le dieu chrétien n’est-il que la manifestation du « divin » ? Vieille question heideggerienne : l’essence du divin appartient-elle au sacré, ou bien le sacré est-il d’abord celui d’un dieu voire de Dieu ? Tout le pari de Hölderlin, qui le conduit peut-être au délire, est l’unification des dieux sous le divin. Qu’en penser ? Et s’agit-il du divin des Grecs ? Ou aussi du Dieu biblique – et quel peut être le sens de ce « aussi » si singulièrement prononcé ?
Salutaire est le manque de Dieu (p. 189-190), parce qu’il abrite de « l’illusion de se croire absolument uni en Dieu » (p. 190). La « solitude » de l’homme, incapable de « dire une fois pour toutes l’essence du divin » (p. 191), est salutaire. De même, il s’agit pour le poète de se rapporter aux dieux présents « comme s’ils étaient au loin », de maintenir « une distance suffisante » (p. 191). Il ne s’agit donc pas de la « dédivinisation du monde » lue par Heidegger et dont le christianisme est rendu responsable, à l’encontre de toute évidence hölderlinienne (cf Chemins, p. 323). Mais « faut-il inverser la thèse… pour affirmer que le Dieu de Hölderlin serait le Père, le Fils et le Saint-Esprit de la Trinité chrétienne ? » (p.194). Certes, il n’est pas que Dionysos, et il n’est pas soutenable de dire comme Heidegger que « les poètes sont ceux des mortels qui, chantant gravement le dieu du vin, ressentent la trace des dieux enfuis, restent sur cette trace, et tracent ainsi aux mortels le chemin du revirement » (Chemins, p. 326-7). Mais « l’attente » hölderlienne est irréductible « à l’attente, partagée par tout chrétien, d’une diffusion d’une Saint-Esprit à travers l’humanité » : « s’en tenir à une telle alternative, entre chrétien et non chrétien, reviendrait à s’enfermer dans une impasse, d’où Hölderlin serait absent » (p. 197).
Layet pose alors la question centrale : « en quelle mesure le dieu de Hölderlin est-il le dieu des chrétiens ? Un dieu peut-il être celui d’une religion déterminée seulement dans une certaine mesure ? » (p. 197). Il précise : « la relation d’opposition harmonique peut-elle affecter la distinction entre chrétien et non chrétien ? Si elle l’affecte, c’est que celle-là précède celle-ci. Mais si l’opposition harmonique peut affecter la distinction, n’est-ce pas aussi parce qu’elle entretien un rapport spécifique avec le christianisme ? » (p. 197).
Ce rapport spécifique ne peut toutefois apparaître qu’à la lumière de l’attachement hölderlin pour les Grecs et particulièrement la tragédie grecque. Quelle en est la mesure ? Les Grecs ont, de naissance, le sens du « pathos sacré » (p. 203), le « feu du ciel », qui doit éclairer la « sobriété » du poète allemand moderne (p. 204). Hölderlin aura précisément expérimenté « le sentiment d’avoir partagé l’expérience native des Grecs », celle du divin « écrasant de beauté » (p. 205). Les Grecs sont ainsi la « médiation » par laquelle Hölderlin peut tisser une « relation avec son lieu de vie, avec sa propre origine » (p. 205). cette médiation protège alors de l’exaltation issue d’une proximité trop grande de l’originaire (p. 206).
Layet résume alors ce que Hölderlin va trouver chez Pindare et Sophocle, qu’il traduit : « cœur double, Hölderlin trouve dans Pindare à la foi ce qui manque à son temps, le »feu du ciel », et ce qu’un Allemand doit s’attacher à préserver dans son effort artistique pour s’unir avec le dieu, doit paradoxalement cultiver alors qu’il en dispose, doit lui aussi apprendre et réapprendre : la »sobriété ». Par la loi, la médiateté, la relation, l’image [la mythologie], se présentent à l’humain le Très-haut, l’infini, la vérité, le dieu. À condition qu’un tiers soit garant de leur relation comme de leur séparation, les immorrtels et les mortels peuvent entretenir un dialogue. Mais qu’advient-il si l’humain renie la nécessité d’une telle communication à travers la distance ? C’est alors au dieu de rétablir la séparation par la violence. Telle est la loi spécifique du poème tragique que Hôlderlin étudie en traduisant Sophocle. » (p. 221).
Layet consacre un long chapitre au Sophocle de Hölderlin, c’est-à-dire autrement dit à ce que Hölderlin demande à Sophocle et obtient de lui. Le Sophocle de Hölderlin peut ainsi être largement interrogé à partir de celui de Heidegger.
Le propre du poème tragique, selon Hölderlin, c’est de laisser s’avancer la source originaire de l’être en tant qu’elle est distante. Le tragique est l’image même de cette distance. L’apparition singulière de la vie est l’un des « multiples visages d’une puissance d’avènement infini » (p.229), et à ce titre, le tragique décrit l’appartenance de cette fragile apparition de la vie à la « faiblesse ». Dans le drame tragique, « la mort ou le malheur des humains manifeste la puissance des dieux » (p.229). « Le héros tragique ne renvoie à l’originaire qu’en étant annulé. » Le dieu se montre précisément dans cet anéantissement du héros, en sorte que « le vivant singulier qui arrive dans le monde ne remplace jamais la force qui le fait naître » (p.230). Le propre du tragique tel que le lit Hölderlin est donc de faire apparaître cette faiblesse même de la vie et le caractère nécessairement médiat de l’originaire qui n’apparaît que dans cette faiblesse. Compris comme punition de la démesure, le tragique dit au fond cette impossibilité, pour le fini, de s’infinitiser. Le tragique est donc tout simplement «l’acceptation de la mort individuelle» (p.230). Le tragique est la restauration de la mesure entre divin et humain, mesure que l’hubris venait contester (p.232). Or ce n’est pas seulement l’hubris ancienne qui vient la contester mais aussi la modernité, qui ne comprend plus la distance entre l’humain et le divin comme sacré, inviolable, et se trouve donc prise dans « l’absence de destin » (p.232) à laquelle équivaut l’aspiration à l’immortalité ou à la divinité (p.233). La tragédie vient ainsi souligner la monstruosité d’une union du divin et de l’humain en tant que fantasme qui est aussi un fantasme moderne. « Le tragique purifie de tels fantasmes en exposant leur impuissance devant le malheur et la mort » (p. 234). Mais pour Layet, le fantasme n’est pas seulement celui d’Oedipe voulant venger Laïos, c’est aussi celui « des modernes (qui) croient pouvoir penser la liberté humaine en niant l’existence de Dieu ou inversement…s’unir avec Dieu en niant les limites infranchissables de la condition humaine » (P.232), ou encore celui du philosophe « qui croit réduire le monde à l’ensemble des représentations d’un sujet transcendantal » (p. 234). Peut-on tout mettre ici sur le même plan et ce plan est-il celui que nomme l’hubris tragique ?
Antigone, par exemple, est en « insurrection » (p.236), et ce « parce qu’elle n’accorde à la mort aucune prise sur sa détermination » (p.237). Antigone est « trop fidèle au divin » et « néglige la distance qui l’en sépare » (p.239). La cité se retourne cependant en sa faveur (p.243), reconnaissant, avec sobriété et sans exaltation, le feu céleste (p.244). Sensibles au céleste, les Grecs ne le « saisissent » pas mais conservent leur « maîtrise de soi », au point toutefois de « rompre le lien avec la nature » (p.256). Tout repose donc sur l’équilibre harmonique qui ne cesse de se rompre et qu’il faut pourtant remémorer : « la recherche de la clarté n’a donc de sens que si la sensibilité au feu du ciel est préservée, et réciproquement ». C’est cet idéal, celui de la « simplicité grecque », que Hölderlin cherche lui-même à écrire (p.258).
C’est plus loin que l’articulation du grec au chrétien devient décisive. Hölderlin modifie le texte sophocléen en le traduisant, de « Zeus » à « Dieu », et cela parce que la langue et l’esprit de notre temps sont « soumis à un Zeus plus authentique » (cité p.269). Layet comprend que le divin, dans la modernité, « ne se réduit pas au dieu chrétien conçu de manière orthodoxe, mais est constitué par des représentations chrétiennes du divin » (p.269). On est doublement surpris par cette remarque, qui 1) s’autorise à voir dans le christianisme une représentation, 2) s’autorise à opposer un Dieu « orthodoxe » à un « divin » qu’on devine « libre » de cette orthodoxie. On demandera doublement : de quel droit ?
Si Hölderlin affecte au Dieu chrétien un surcroit d’authenticité, c’est à raison de sa médiateté : Dieu est « vrai homme et vrai Dieu », c’est-à-dire « intercesseur », fonction qui était déjà grecque, et qui n’empêche pas que ce Dieu coure le risque d’être aimé de manière immédiate, fusionnelle : aucun privilège véritable du christianisme, donc. Mais il y a autre chose. Hölderlin remarque que, si nous ne recevons plus de destin au sens grec, nous quittons le monde autrement, et non moins profondément : avec lenteur (p.271). Nous expérimentons, autrement dit, la vie dans sa durée plutôt que dans la violence de sa destruction, et cette lenteur de la mort, nous la voyons depuis la possibilité de la résurrection (p.272), ou plus précisément, depuis l’antécédence de la vie sur la mort et le triomphe de la vie sur la mort (p.273). Le dieu chrétien est celui qui exerce une contrainte sur la terre, qui renverse la nature (p.274-5), tandis que les dieux grecs épousent la mortalité même (p.274).
Ainsi la thèse de Layet se précise-t-elle : le dieu chrétien est simplement le visage moderne du divin. « Le Christ est le dernier des dieux grecs au sens où il est lui-même un dieu sensible, un dieu de beauté » (p.286), écrit Layet à la lumière du commentaire de l’hymne « Patmos ». Le Christ, cependant, est une figure inouïe puisqu’il rend possible l’impossible, « seul homme dont le courage soit à la mesure du ciel » (p.286). Mais alors, demande Layet, le Christ, « forme la plus accomplie du divin », « inclut-elle aussi la mémoire de ses frères » grecs (p. 287) ?
Il maintient en tous cas la distance dans laquelle veut se tenir le divin et qui est marquée par la Croix (p.290-1). « Avènement d’une relation saine et vivante à travers la distance. » (p. 293). La faiblesse dans laquelle le dieu, médiatement, apparaît est maintenant sa propre faiblesse, une faiblesse qu’il a voulue : Dieu a voulu le fini (p.296-7). Mais il infinitise, il divinise alors notre existence mortelle, il est entré dans le monde (p .302). La poésie est alors poésie de l’esprit, de la présence mondaine distante de Dieu.
Il n’en reste pas moins que la divinité du Christ est « porteuse de mort », parce que par son excellence elle annule toutes les autres (p. 303). Or, cet événement par lequel Dieu « met fin à toute distanciation », « règne à jamais comme unique » correspond précisément à sa mort. Pour Hölderlin selon Layet, l’infini ne peut cependant jamais se poser que comme un dehors, ne peut s’absolutiser et quitter la relation au fini qui ne cesse, en vérité, de le révéler comme infini (p.304-5). Contrairement à Hegel, Hölderlin ne veut pas dissoudre la vie finie, et n’interprète pas le Christ comme celui qui vient faire disparaître la vie mortelle, mais au contraire comme celui qui vient nouer de nouvelles « relation réelles » entre cette vie mortelle et le divin (p. 305). Cette relation sera par exemple l’image (p. 306), conformément à la doctrine luthérienne condamnant l’iconoclasme mais non la représentation du divin. L’image renvoie précisément pour Hölderlin à cette relation entre le terrestre et le divin qui se noue en elle : à la « lumière de la vie » (p. 307). L’image renvoie à la vie parce qu’elle « rend un ce qui a été reçu un » : elle est la vie même, au sens où « de même que la lumière est ce par quoi une vie advient, la vie concrétise à son tour la lumière ». Une telle pensée n’est toutefois pas seulement chrétienne, elle est déjà juive – kaballistique – et elle est déjà grecque – « supérieurement tournée vers la beauté de l’apparaître » (p. 309). Les trois religions manifestent donc chacune la vérité, sans que leur diversité ne soit reconductible à une dialectique. Autrement dit elles coexistent sans s’enchaîner. « En resaisissant la pensée juive de la création par la parole divine, la pensée grecque de la beauté de toute manifestation, la pensée chrétienne de la divinité de la corporéité mortelle, Hölderlin ne surmonte pas les Révélations successives de Dieu. Il les reconduit à leur principe vital et les remet ainsi à l’indéterminabilité de l’avenir » (p. 311). Il n’y a donc pas « d’effectuation progressive » de l’Esprit, pas de vérité absolue, mais « différentes manifestations du même foyer impensable », et ce bien que « le Christ expose pourtant le cortège divin au péril d’une clôture ».
Cette argumentation soulève, de proche en proche, une série de questions. La première porterait sur la pertinence d’assigner au Dieu chrétien, voire au Dieu biblique, le statut d’un « Dieu de beauté » voire d’une « représentation », étant entendu que Layet – et non Hölderlin – comprend le dogme biblique comme la « représentation moderne du divin ». La dimension historique singulière d’un Dieu qui, nom propre, s’avance et se révèle à la face des nations pour effacer tous les autres s’accommode mal, en effet, d’une telle assignation.
 Rappelons à ce titre l’argumentation très précise de D. Franck, tel qu’il l’a présentée dans son ouvrage Le nom et la chose. Langage et vérité chez Heidegger (Vrin, 2017), au moment de s’interroger sur la proposition heideggerienne suivant laquelle « plus initial que tout dieu est l’être ». D. Franck demandait alors : « mais le Dieu d’Israël révélé en Christ peut-il prendre place dans un tout ou un ensemble ? » (p. 244). Heidegger avait lui posé la question, et y répondait : « comment le pourrait-il si la divinité du dieu repose dans le grand repos depuis lequel il reconnaît les autres dieux ? » (GA 97, p. 369). Le Dieu biblique n’en admet pas d’autre et aucun syncrétisme ne saurait le tenir dans la proximité voire dans la coappartenance à d’autres dieux voire au divin en général, pour autant sans doute que le divin soit un genre – « Dieu est unique en son genre », affirmait K. Barth que D. Franck cite à cette occasion (Dogmatique de l’Eglise, I, p. 498, cité p. 245), et qui ajoutait aussi, à l’évidence contre le syncrétisme défendu par Layet : « que tout ce qui est déité et divin, soit toujours Dieu lui-même et donc toujours l’Un, cela constitue justement la simplicité de Dieu ». Partant, la révélation de Dieu est l’anéantissement de tous les autres dieux, sans que rien d’eux ne subsiste : la révélation est la dédivinisation des dieux grecs, ni au sens de la préservation salutaire de leur essence distanciée, ni au sens du nihilisme qui serait constitué par la fuite des dieux. Sans doute un tel propos ouvre-t-il une difficulté : Dieu ne saurait en effet s’opposer aux autres dieux sans appartenir à la même dimension qu’eux. La jalousie même de Dieu en romprait donc la singularité. Toutefois, le soutenir est impossible, toujours selon D. Franck : Dieu n’est pas lui-même parmi d’autres dieux mais seulement pour le peuple élu, en sorte que son unicité ne consiste jamais à se séparer d’autres dieux mais à se révéler lui-même, acte par lequel il est l’Unique. L’unicité du Dieu biblique est un acte et non l’appartenance ontologique à un genre. D. Franck en conclut que « le mot dieu n’a absolument pas le même sens selon qu’il s’agit de celui d’Israël, fût-il révélé en Christ, ou de ceux que la Bible nomme les nations » (p. 248), et le syncrétisme est donc théologiquement et même lexicalement irrecevable.
Rappelons à ce titre l’argumentation très précise de D. Franck, tel qu’il l’a présentée dans son ouvrage Le nom et la chose. Langage et vérité chez Heidegger (Vrin, 2017), au moment de s’interroger sur la proposition heideggerienne suivant laquelle « plus initial que tout dieu est l’être ». D. Franck demandait alors : « mais le Dieu d’Israël révélé en Christ peut-il prendre place dans un tout ou un ensemble ? » (p. 244). Heidegger avait lui posé la question, et y répondait : « comment le pourrait-il si la divinité du dieu repose dans le grand repos depuis lequel il reconnaît les autres dieux ? » (GA 97, p. 369). Le Dieu biblique n’en admet pas d’autre et aucun syncrétisme ne saurait le tenir dans la proximité voire dans la coappartenance à d’autres dieux voire au divin en général, pour autant sans doute que le divin soit un genre – « Dieu est unique en son genre », affirmait K. Barth que D. Franck cite à cette occasion (Dogmatique de l’Eglise, I, p. 498, cité p. 245), et qui ajoutait aussi, à l’évidence contre le syncrétisme défendu par Layet : « que tout ce qui est déité et divin, soit toujours Dieu lui-même et donc toujours l’Un, cela constitue justement la simplicité de Dieu ». Partant, la révélation de Dieu est l’anéantissement de tous les autres dieux, sans que rien d’eux ne subsiste : la révélation est la dédivinisation des dieux grecs, ni au sens de la préservation salutaire de leur essence distanciée, ni au sens du nihilisme qui serait constitué par la fuite des dieux. Sans doute un tel propos ouvre-t-il une difficulté : Dieu ne saurait en effet s’opposer aux autres dieux sans appartenir à la même dimension qu’eux. La jalousie même de Dieu en romprait donc la singularité. Toutefois, le soutenir est impossible, toujours selon D. Franck : Dieu n’est pas lui-même parmi d’autres dieux mais seulement pour le peuple élu, en sorte que son unicité ne consiste jamais à se séparer d’autres dieux mais à se révéler lui-même, acte par lequel il est l’Unique. L’unicité du Dieu biblique est un acte et non l’appartenance ontologique à un genre. D. Franck en conclut que « le mot dieu n’a absolument pas le même sens selon qu’il s’agit de celui d’Israël, fût-il révélé en Christ, ou de ceux que la Bible nomme les nations » (p. 248), et le syncrétisme est donc théologiquement et même lexicalement irrecevable.
Si Hölderlin donne donc au Dieu chrétien un rôle parmi les dieux, ce n’est pas un rôle semblable à celui des autres dieux puisque d’un Dieu aux autres il y a solution de continuité. Le christianisme n’est pas le prolongement du grec, fût-ce un prolongement éloigné du grec ou étranger au grec : le christianisme est l’avènement d’une vérité qui rompt à jamais l’unité de la vérité grecque, l’unité du divin dont pensée et poésie forment la mémoire distante, la veille salutaire. Pour autant, il est bien clair que Hölderlin tient à remémorer la vérité biblique, à lui accorder une place et même la place centrale dans sa propre tentative. Mais C. Layet mesure-t-il bien en quel sens ?
Revenons aux pages que Layet consacre à l’hymne « Patmos » (p. 286 sq) et demandons- nous si son interprétation du rôle que Hölderlin fait jouer au Christ est recevable. En affirmant que le Christ est « frère de Dionysos et d’Héraclès », et que « leur Père est le même », bref que le Dieu incarné est un représentant du Divin, Layet, outre qu’il contrevient à l’unicité du Dieu de la Révélation, aligne ce que Hölderlin prend soin de dissocier : le Christ n’est-il pas appelé par lui l’Unique, der Einzige ? Et son absolue singularité ne tient-il pas à ce que Jésus, Dieu mortel, donne à la mort un sens incomparable à nulle autre, « bouleverse définitivement l’horizon vers lequel peut s’orienter l’existence mortelle » (p. 286) ? Sans nul doute, mais dès lors, le Christ n’est pas qu’un dieu parmi d’autres, un frère dans une fratrie, et si le Christ coupe court à l’histoire grecque des mortels confrontés aux divins, renouvelle l’essence de la mortalité, il y a solution de continuité entre celle-ci et celui-là. Si, de fait, le Christ donne à la mort un sens dont rien de grec n’est la mesure, alors que la mortalité des mortels face au divin est pourtant la mesure du grec, n’est-ce pas que le Christ est le dieu des dieux, l’unique dieu, et que Layet produit à ce sujet des analyses dont il ne semble pas tirer les conclusions nécessaires ?
Dieu médiat, se donnant dans une clarté distante, une clarté qui doit traverser l’épreuve radicale de la mort en sorte de sanctifier cette épreuve même, le Christ n’est-il pas au fond ce Dieu dont la divinité octroie celle de tous les autres dieux, le plus beau qui mesure toute beauté ? Mais dès lors, le Christ n’est-il pas cette lumière qui ne relève pas du champ de ce qu’elle éclaire, le dieu des dieux, le dieu unique ? Et la dimension apostolique de ce dieu qui requiert d’être dit n’est-elle pas au même titre la vérité même du divin, l’essence même de la dimension dans laquelle se tient Hölderlin au moment de nommer cette vérité, telle qu’il la trouve à dire ?
Peut-être, mais à cette condition, il cesse d’être recevable de soutenir avec C. Layet que le divin est « impossible à unifier ». Mais quel est alors le champ du divin si le syncrétisme ne le définit plus ? Celui l’un existant dans la différence avec soi: le dieu, c’est le lointain apparaît, dans sa proximité, comme lointain. C’est cette langue idéaliste qui aura servi de dénominateur commun au grec et au chrétien. Or, le problème posé alors est double: d’une part, cette langue a pour vérité un nom chrétien avant tout, celui du Christ ; et d’autre part, pourtant, cette langue est grecque avant tout. Que la lumière du Vivant éclaire ce qui est grec plutôt que de porter hors de ce qui est grec, n’est-ce pas le plus troublant enseignement du poète Hölderlin ?
Toutefois, que veut dire : grec avant tout ? Si le grec ne dit plus la même chose que le chrétien, puisqu’il appartient à la beauté et que le Christ est la beauté – si le grec relève d’une dimension qui n’est pas celle du christianisme mais dont l’intelligibilité attend celle du christianisme, alors le grec devra, pourtant, être pensé en ce qu’il a de propre, c’est-à-dire en cette attente. Or, le domaine grec de l’attente, Layet l’a montré, c’est l’économie de la proximité et de la séparation d’avec le dieu : c’est le se-montrer du dieu se refusant, le refus du dieu au cœur de la manifestation. Et n’était-ce pas déjà ce que Heidegger avait pensé sous le nom d’aletheia ? Or, la caractérisation grecque du domaine de la manifestation vraie comme aletheia est passée sous silence par Layet. Mais en est-il libre pour autant ? Aucunement : sa conception idéaliste de la proximité comme écart et de l’écart comme proximité dépend au contraire toute entière de l’aletheia telle qu’elle est constituée et reconstruite par Heidegger dans son rapport à la lethè. De fait, si Layet pense pouvoir s’affranchir de Heidegger, c’est au prix de la conscience de devoir toujours dépendre de lui.
Qu’en est-il en effet de l’aletheia comme essence du grec ? Heidegger n’a cessé lui-même de l’affirmer : c’est dans Hölderlin qu’il en aura, précisément, trouvé la mesure. Hölderlin, en recherchant – comme Layet lui-même s’y attarde longuement – le dénominateur commun de l’être et de la pensée, aura en effet rencontré plutôt leur coappartenance, le domaine où réciproquement l’un est tendu à l’autre, tendu vers l’autre : le domaine de l’Un, dont la beauté ne signifie rien d’autre que cette lumière par laquelle la vision peut voir et ce qui se voit peut se manifester à elle. Réciprocité radicale qui, ne pouvant être englobée par aucun troisième terme, n’a d’autre source qu’elle-même, en sorte que l’Un n’est jamais qu’un Deux, qu’une différenciation d’avec soi – et cette différenciation n’est elle-même à son tour rien d’autre que le secret de toute manifestation, ce qui ne fut jamais aussi bien nommé que par le mot grec d’aletheia, désignant, comme y aura inlassablement insisté Heidegger, la retenue secrète, la lethè, sous laquelle se produit tout dévoilement, toute vision et toute pensée.
Layet, nous avons commencé par le dire, écrit son livre contre la manière heideggerienne de s’approprier Hölderlin. Et le motif de son opposition à Heidegger porte d’abord et essentiellement, nous l’avons vu, sur la dénonciation d’une ignorance heideggerienne relative à la place du Christ chez Hölderlin. Il nous appartient toutefois désormais, de proche en proche, de nous demander si cette opposition est bien justifiée par cela même que Layet dénonce. Certes, Heidegger ne veut rien savoir de ce qui est chrétien, veut lire Hölderlin de cette volonté de ne rien en savoir, et à ce titre sa lecture est sans doute insuffisante. Mais elle n’est pas pour autant irrecevable puisque Heidegger a vu l’aletheia et que l’aletheia est aussi ce que Layet rencontre, à l’intérieur cependant d’une dimension, celle du Dieu unique, que Heidegger n’a pas vue, ne pouvait ou ne voulait voir. De fait, l’auteur pourrait élargit la vision heideggerienne plus qu’il ne l’abolit ; il le pourrait car son livre conduit à interroger de la manière la plus radicale l’impensé de la position de Heidegger ; mais il le pourrait seulement, car Layet ne réalise pas cette possibilité, puisque c’est depuis un intenable syncrétisme et non depuis la relation entre le beau et la beauté même qu’il envisage l’articulation du grec et du chrétien.
Il y a plus. Si Layet peut dénoncer la destruction du monde liée à l’offense perpétuelle du divin et de la distance qui doit en vérité nous séparer de lui, liée à l’insurrection des mortels contre la retenue dans laquelle se tient la mesure de la vie – si Layet peut mener cette dénonciation, n’est- ce pas parce qu’il a reconnu l’aletheia comme étant le site que nous habitons et dont la fureur technique nous déloge ? N’est-ce pas l’aletheia et elle seule qui détermine mesure et démesure ? Réciproquement, atteindre l’aletheia, n’est-ce pas une manière d’entendre l’appel du Dieu unique dont nous avons à attendre la vérité, à espérer le salut face au danger d’hubris qui nous menace ? Dieu inaperçu certes de Heidegger – mais il cesse pour autant d’être nécessaire d’exclure radicalement celui-ci pour inclure radicalement celui-là. Au contraire, que le Christ de Hölderlin soit la vérité de ses dieux grecs, n’aurait-ce pas pu être la véritable mesure d’une explication avec Heidegger et avec le danger dont le poète en temps de détresse serait susceptible de nous sauver ?
Il est alors possible de poser pour conclure une ultime question, découlant de toutes les autres. Layet, revenons-y une dernière fois, ne va pas sans subordonner sa propre lecture de Hölderlin à un impératif moral : celui de retrouver les conditions d’une harmonie, c’est-à-dire d’une nouvelle loi, d’une loi renouvelée, non seulement entre les êtres raisonnables mais aussi avec la nature et le vivant. Or, à cet impératif semble à ses yeux répondre le poète puisque celui-ci énonce les conditions sous lesquelles nous pourrions, à le lire, nous installer dans la retenue nécessaire au respect d’autrui comme de toute manifestation en général. Il nous faut alors, lisant à notre tour Layet, nous demander si cet impératif tel qu’il est par lui formulé est bien suffisant pour donner la mesure de l’oeuvre supposée s’y ajuster. À une telle demande, il est finalement nécessaire de répondre négativement : si la lecture de Hölderlin apparaît salutaire, ce n’est pas seulement au sens où elle réconcilie la pensée avec le vivant mais au sens, plus large, où elle laisse s’avancer la loi même qui rassemble tous les étants, la loi de l’Être, sous laquelle les étants, abrités dans leur dévoilement, peuvent alors proprement être respectés, mais sans la remémoration de laquelle ils sont au contraire aussitôt offensés – mais cette loi ne peut être proclamée que là où s’entendent aussi les conditions dernières de l’expérience du divin, conditions qui ne sont plus seulement celles du syncrétisme mais celles de l’entente d’une voix absolument singulière, la voix du Dieu unique, venu nous mesurer – et nous permettre de nous mesurer – à notre propre mortalité. Ce n’est ainsi, plus seulement le terrestre et le céleste que Hölderlin vient préserver de la destruction mais la loi de l’être qui est pour lui mesure vivante de l’Esprit, de cette vérité venue en personne, menacée par la démesure propre à la pensée lorsqu’elle devient sourde à l’aletheia – avant Heidegger – et plus sourde encore à son domaine secret de provenance – avec Heidegger encore.








