L’homme pécheur1 est à tous égards un ouvrage déroutant, dont la démarche et les méthodes ne manqueront pas de décontenancer le lecteur non-averti. Il propose en effet de déployer une vaste réflexion dont l’ampleur ne tient pas seulement à l’impressionnante longueur de l’ouvrage (environ 700 pages d’analyses denses et complexes, systématiquement scandées par un nombre conséquent de notes en bas de page), mais surtout, à la quantité et à la diversité de l’immense somme de références mobilisées pour les besoins du projet que se donne l’auteur : produire une interprétation de la formule de Luther selon laquelle l’homme serait à la fois juste et pécheur.
Au-delà de l’immense variété des lectures et des analyses mises en œuvre, c’est fondamentalement la méthodologie adoptée par l’auteur qui ne laissera pas de troubler le lecteur rompu aux études académiques plus traditionnellement circonscrites dans le cadre de la recherche universitaire. Car les outils herméneutiques de Claude Brunier-Coulin ne connaissent nulle frontière ni cloisonnement : ils empruntent autant aux arts ― d’abord la littérature, mais également le cinéma, la poésie, etc. ― qu’à la linguistique, à la psychanalyse, aux courants les plus hétéroclites de la philosophie ― de l’existentialisme à la théosophie iranienne ― et enfin à la théologie2.
D’autre part, nul préjugé relatif à la dignité culturelle de ses références n’embarrasse l’auteur et ne le retient de poursuivre son entreprise interprétative là où l’on ne l’attend pas : la matière de sa réflexion emprunte aussi bien au Vilain Petit Canard d’Andersen dont la reproduction intégrale ouvre le livre, qu’à James Joyce ou à Amélie Nothomb, à Aragon ou à J.-K. Rowling ; l’étude d’Augustin côtoie celle de Harry Potter ou de « Zorglub »3 ; les analyses puisent ainsi sans scrupule leur aliment dans un gigantesque fonds éclectique dont le dénominateur commun est d’offrir un « texte » présentant la continuité d’une pensée humaine au travail. C’est ce qu’indique explicitement le développement conclusif de l’ouvrage, dont le caractère délibérément « ouvert » est à l’image de l’ensemble du livre : absolument rétif à toute forme de catégorisation définitive : « C’est le texte qui fournit la base de cette recherche que nous avons exploré à travers plusieurs types de textes : le conte, le roman, la biographie, la bande dessinée, le discours philosophique, l’œuvre théologique. De par sa structure le texte signifie, il faut y chercher les conditions de son sens. Il ne se découvre pas entièrement devant nous, mais demande à être dévoilé »4.
Cependant, c’est dans cette extrême variété de la matière textuelle dont l’ouvrage s’inspire que nous reconnaissons l’une des sources de la difficulté de L’homme pécheur : outre sa densité, le livre présente un projet dont la complexité est telle qu’il n’en devient que difficilement intelligible pour le lecteur. L’accumulation et l’enchaînement des références, des catégories et des schèmes de pensée d’un paragraphe à l’autre et souvent en une même page, rend difficilement perceptible l’unité et la cohérence d’ensemble de la démarche. Au fil de ces analyses si riches et si impressionnantes par leur érudition et leur approfondissement, nous n’avons cessé de nous interroger sur le fil directeur à la fois méthodologique et thématique de l’ouvrage, tant le cheminement nous a paru tortueux, et tant à chaque station, nous avons cru nous perdre loin de la question initialement posée. Malgré les multiples développements récapitulatifs ― et parfois même singulièrement répétitifs ― que l’auteur concède à intervalles réguliers, les dimensions mêmes du livre et la complexité des détours proposés rendent périlleuse la compréhension durable de son unité. De là cette étrange impression d’inachèvement5 et d’éclatement, à l’issue de notre lecture : cette somme absolument vertigineuse impose au lecteur de s’appliquer à chaque instant à reparcourir ses souvenirs pour renouer le fil de l’analyse, se l’approprier et en reconstituer l’unité. Mais la tâche n’est pas aisée et nous ne croyons pas y être parvenue. À l’issue de cette première approche, peut-être nous faudrait-il donc une nouvelle fois sur le métier remettre notre ouvrage…
A. Le monde des images
Que signifie la formule de Luther selon laquelle l’homme est « simul justus et peccator », c’est-à-dire « à la fois juste et pécheur » ? Pour le comprendre, il ne suffit pas de résoudre le syntagme en ses unités de sens pour en produire une compréhension rationnelle dépassant la contradiction logique apparente. Il y va en effet avec la notion d’homme pécheur, d’une « catégorie fondamentale de l’existence »6 que l’imagination est plus à même de saisir qu’un discours rationaliste nécessairement contenu dans le cadre rigide du principe de contradiction. C’est ainsi à partir de l’affirmation de la puissance créatrice de l’imagination et en vertu de sa fonction cognitive spécifique, que peut se comprendre le mystère de l’homme à la fois juste et pécheur.
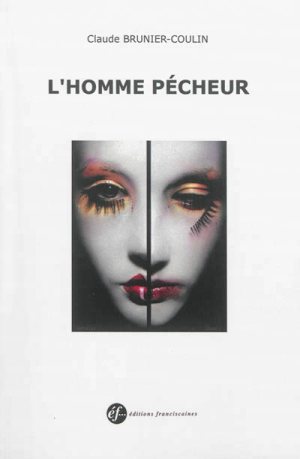
L’originalité de la perspective adoptée tient notamment à la source où elle puise pour mettre en avant ce pouvoir propre de l’imagination : la philosophie mystique islamique lue et interprétée par Henry Corbin. Ce dernier construit en effet le concept d’« imaginal » pour rendre compte de la positivité de ce pouvoir actif et visionnaire de l’imagination, par lequel cette dernière ouvre sur un monde qui demeurerait interdit d’accès aux seules facultés sensible et intellectuelle :
« Que cette imagination active dans l’homme (il faudrait dire Imagination agente, comme la philosophie médiévale parlait de l’Intelligence agente), ait sa fonction noétique […] propre, c’est-à-dire qu’elle nous donne accès à une région et réalité de l’Être qui sans elle nous reste fermée et interdite, c’est ce qu’une philosophie scientifique, rationnelle et raisonnable ne pouvait envisager. Il était entendu pour elle que l’imagination ne sécrète que de l’imaginaire, c’est-à-dire de l’irréel, du mythique, du merveilleux, de la fiction »7.
Capacité de projection des formes spirituelles dans le monde sensible et réciproquement de spiritualisation des formes, l’imagination créatrice ou pouvoir de l’imaginal, se distingue d’une simple puissance hallucinatoire ou d’un imaginaire purement fantaisiste. Elle nous contraint à surmonter la séparation ― traditionnelle en Occident ― du sensible et de l’intelligible, pour nous ouvrir sur un intermonde spécifique, tenant le milieu entre sensible et intelligible, où la fiction ne s’oppose pas à la vérité et où l’image est investie d’une puissance révélatrice. L’auteur emprunte à Shihâboddîn Yahyâ Sohravardî 8 la caractérisation de cette fonction cognitive propre de l’imagination. L’imagination est en effet décrite comme « un organe de pénétration dans le monde intermédiaire qu’est le monde imaginal, où le spirituel prend subtilement corps et où le corporel se spiritualise »9.
Le monde imaginal est le lieu des images qui apparaissent au sujet dans leur pouvoir cognitif propre. Il est surtout le miroir du réel et le lieu de l’expérience que l’âme fait du divin, offrant ainsi une forme épiphanique de la beauté de Dieu. Dès lors, c’est selon cette configuration spéculaire régulièrement reconduite que sera interprétée l’énigme du « simul justus et peccator », car le miroir confirme au sujet sa nature de juste et de pécheur : il permet de penser la situation de l’homme face à Dieu. L’imaginal permet ainsi de comprendre la condition de l’homme pécheur. Il constitue le schème adéquat permettant de saisir le « simul » du « simul justus et peccator », parce qu’il met en présence les opposés que la seule raison dianoétique échoue à se représenter, et qu’il le fait dans l’ordre du visuel.
La fable du Vilain Petit Canard apparaît ici comme un motif allégorique offrant sous la forme d’un fil directeur, l’occasion d’une saisie de cette condition de l’homme pécheur et justifié. La situation du Petit Canard présente un certain nombre d’analogies avec celle de l’humanité : son existence particulière d’être dominé et victime d’un déni de tout droit d’exister l’apparente à celle, universelle, d’une humanité marquée par le péché originel et posant la question de son droit à se sentir juste. Or, c’est en se regardant dans une mare comme en un miroir, qu’il se découvre non vilain, mais transformé en beau cygne blanc, justifié.
Le miroir est ainsi le lieu où l’homme se découvre transformé, justifié. Mais comment précisément comprendre cette notion de justification ? Cette question fait l’objet de la deuxième partie de l’ouvrage.
B. La justification
La « justification » désigne cette transformation de l’homme pécheur en homme sauvé par la grâce de Dieu. Bon lors de sa création, l’homme s’est rendu pécheur et a rompu l’alliance. C’est comme pécheur qu’il demeure justifié par Dieu, indépendamment de toute action et de toute intervention de son libre arbitre, c’est-à-dire par la foi et sans les œuvres.
Au fondement de la Réforme, se trouve la décision prise au XVIe siècle par le moine augustinien Martin Luther, d’assumer pleinement le mystère de la justification de l’homme par Dieu telle qu’elle est formulée dans L’Épître aux Romains :
« Car je n’ai pas honte de l’Évangile : il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif d’abord, puis du Grec. C’est en lui en effet que la justice de Dieu est révélée, par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit : “Celui qui est juste par la foi vivra” »10.
Jusqu’à présent, Luther admettait que le devoir de l’homme envers Dieu consistait à agir conformément au bien et à se voir, en retour, justifié par Dieu par la faveur de sa grâce. On considérait traditionnellement que si les œuvres seules ne pouvaient gagner à l’homme son salut, il demeurait néanmoins une part de liberté et de participation de l’homme à l’œuvre de la grâce, dans la mesure où la justification impliquait sa transformation intérieure. Mais marqué par l’influence d’Augustin, c’est sur l’invincible puissance du péché en l’homme et sur sa passivité foncière, que Luther insiste désormais : ce n’est pas par ses bonnes œuvres que l’homme peut être justifié, mais par un don absolu de Dieu, une grâce dont le mystère échappe à toute condition :
« le chrétien est à la fois “juste et pécheur” : il est entièrement juste, car Dieu lui pardonne son péché par la parole et le sacrement […]. Face à lui-même cependant, il reconnaît par lui-même qu’il demeure aussi totalement pécheur, que le péché habite encore en lui »11.
Cl. Brunier-Coulin résume en ces termes les implications de la position luthérienne sur la justification : « La justice de Dieu devient alors un don et c’est ce don qui remplit la condition de la justification de l’homme. Ce dernier n’a rien à faire pour être justifié, il doit recevoir le don de Dieu par la foi. La justification est un processus où Dieu est le seul acteur et où l’homme a un rôle essentiellement passif »12. En d’autres termes, la grâce de Dieu est irréductiblement mystérieuse et absolument inconditionnelle : c’est un don qui n’est guère suspendu aux bonnes œuvres. L’homme n’est pas à l’origine de la justice divine, sa justification lui est complètement extrinsèque. Cette position célèbre a suscité la division au sein de l’Église chrétienne, en raison de la continuité ― récusée par l’Église catholique ― qu’elle semblait instaurer entre le péché conçu comme privation originelle de la justice d’une part, et l’inclination vers le mal d’autre part.
Sur le plan théologique, le débat s’est soldé à la fin des années 1990 par la publication par la Fédération Luthérienne Mondiale et l’Église catholique, d’une Déclaration conjointe sur la Doctrine de la Justification, relevant les convergences existant entre les thèses catholiques et les thèses protestantes portant sur la justification. Selon l’interprétation commune de la justification, il faut comprendre cette dernière dans le dispositif trinitaire et admettre que c’est par la foi en l’action action salvifique du Christ que l’homme reçoit en son cœur l’Esprit Saint et qu’il se trouve accepté par Dieu, non par son mérite.
De la sorte, le monde n’est justifié et rendu signifiant que par la grâce de Dieu. La question de la justification implique « de nous reconnaître justifiés par la compréhension nouvelle que nous avons de nous-mêmes »13. Être juste, c’est donc d’abord se voir dans le miroir et se découvrir comme étant juste, c’est-à-dire se voir transformé. C’est pourquoi, la catégorie de l’imaginal semble offrir l’outil herméneutique le plus à même de rendre compte d’une telle vision. La découverte de soi vient d’un voir, d’un face-à-face où l’image révèle autant qu’elle cèle. Il faut poser que « je me vois donc je suis »14. Le miroir devient à partir de là un motif thématique et une catégorie herméneutique traversant tout le reste de l’ouvrage et présidant notamment aux études d’Ulysse (J. Joyce) et de Mercure (A. Nothomb).
C. Le miroir comme objet théologique
Dans la troisième partie de l’ouvrage, l’auteur ne se contente pas de sonder la puissance signifiante des productions fictionnelles, il entend établir une théologie faisant jouer à plein la fonction spéculaire : « Je me regarde dans le miroir constitue l’expérience à partir de laquelle nous tâchons, désormais dans cette partie, d’établir une théologie »15. La référence majeure ici est constituée par l’œuvre du théologien protestant Karl Barth (1886-1968), lue à travers le modèle spéculaire : la connaissance des rapports entre l’homme et Dieu en constitue le fondement. Il s’agit de redonner sa place au Deus absconditus (« Dieu caché »), de cesser de partir de l’homme pour saisir ce qui vient de Dieu. C’est dans le cadre d’une dialectique de l’appel et de la réponse que le rapport de l’homme et de Dieu est ainsi inscrit. La révélation apparaît dans le monde imaginal, au sein de la parole divine. Mais c’est l’interprétation qui la fait descendre dans le monde réel. Notre monde imaginal offre l’interprétation de notre monde réel et permet à l’âme de se réaliser par son imagination active. Présentant ainsi comme en un miroir les choses celées par le monde réel, il en constitue le dévoilement et réalise une théophanie : l’invisible est ce qui se révèle dans le visible. Mais l’image ainsi révélée est structurée comme un appel et a vocation à se déployer comme une injonction à l’égard d’autrui : à l’avènement de la parole divine répond la prédication qui est un impératif exprimé dans le monde réel. L’image n’est pas en effet ce qui ressortit de l’ordre de l’irréel : elle n’est pas une reproduction mimétique passive et servile du réel. Elle l’interroge et en détermine la réorganisation voire la transfiguration. Le miroir est ainsi d’essence épiphanique : il manifeste le réel en son cœur au lieu de le refléter sur un mode appauvrissant.
C’est par la foi ou connaissance de Dieu lui-même que la transformation du cœur du croyant s’opère. Cette transformation peut être saisie sous la catégorie transitionnelle de l’événement : le passage de l’état de pécheur à l’état transformé. Mais il ne s’agit pas là de la conversion d’un état en l’autre ni même d’une suppression de l’un par l’autre. L’homme vit toujours et simultanément comme un homme totalement pécheur qui est justifié par le décret éternel de Dieu. Cela peut se comprendre par référence à la catégorie du voir. La justification possède deux faces : d’une part le regard en arrière de l’homme, vers le monde imaginal de son passé, d’autre part, son regard en avant vers le monde réel où se déploie sa conduite. Analogiquement, lorsque le vilain petit canard se voit transformé en beau cygne dans la mare, il saisit ce qui est déjà présent. Il se voit tel qu’il est. De même, l’homme n’accède à la justification que par un acte de foi qui est une vision du décret éternel de Dieu : la vision seule et non la raison, peut ouvrir à ce qui est déjà présent.
Conclusion
Si la justification est un voir, c’est que nous sommes ce qui y est vu. Voyant et visible sont identiques, c’est-à-dire qu’ils révèlent plusieurs dimensions du même être. L’homme pécheur est juste dès lors qu’il se voit juste : « la justification se fait par les yeux de la foi »16. Ce n’est donc pas comme être monstrueux intimement constitué par la contradiction, que l’homme se révèle à la fois juste et pécheur. Il faut comprendre la fonction de conjonction à travers le face à face qui se joue lorsque le sujet se regarde dans le miroir :
« Le sens du “et” dans “pécheur et juste” est celui du face-à-face lorsque le sujet se regarde dans le miroir. Comme le sujet qui se regarde précède son image, le sujet pécheur précède le sujet juste de même que le monde réel précède le monde imaginal. La préposition “et” a un sens eschatologique. Elle a aussi un sens d’exclusion et non de réunion car il signifie que l’homme est définitivement pécheur et que c’est son “tel-état” »17.
Cette eschatologie ne renvoie pas à une conversion future. Le passage qu’est la justification échappe à la succession temporelle ordinaire, comme le formule l’auteur en citant Karl Barth :
« Nous sommes donc justifiés et pourtant nous péchons tous les jours. Nous vivons sur une frontière, c’est un mystère, “le mystère de l’homme irrémédiablement déchu de Dieu et inamissiblement lié à Dieu, mystère qui se voile dans la dualité d’Adam et du Christ afin de se dévoiler dans leur unité” »18.
La formule « simul justus et peccator » lie ainsi deux états différents en même temps qu’elle exprime le mouvement de l’un vers l’autre : le « simul » n’est pas statique mais dynamique parce que l’homme est destiné à être justifié, mais que le pécheur est contenu dans l’homme justifié. C’est ainsi dans le Christ que se réalise exemplairement l’unité du juste et du pécheur : « La conséquence est que, quoi que nous fassions, nous participons, en Jésus-Christ à son union avec son Père. Cette union avec le Père, en Jésus-Christ est en nous de manière cachée. Elle est, de cette façon, voilée, elle est ontologique, invisible, eschatologique. Le péché est la raison de ce voilement, il est un voile jeté sur notre existence authentique »19.
- Claude Brunier-Coulin, L’homme pécheur. Investigations sur un modèle critique de la justification, Éditions franciscaines, 2013.
- Pour mesurer l’originalité du cheminement intellectuel de l’auteur, on se reportera à la reconstruction autobiographique qu’il propose sur son propre site internet : http://www.claudebrunier-coulin.net/biographie.
- Zorglub est un personnage de bande dessinée inventé par André Franquin, qui apparaît en 1961 dans l’album Z comme Zorglub. Il fait l’objet d’une étude particulière aux p. 423 sq.
- L’homme pécheur, op. cit., p. 666.
- À ce propos, il ne nous semble pas possible de passer sous silence un détail regrettable qui ne rend pas justice aux qualités d’érudition et de spéculation manifestées dans cet ouvrage : le nombre perturbant de « coquilles », erreurs typographiques et autres approximations orthographiques qui parsèment en chaque page l’ensemble du texte. Ces erreurs parfois fâcheuses ont contribué à nourrir l’impression d’inachèvement laissée par la lecture de l’ouvrage.
- L’homme pécheur, op. cit., p. 9.
- H. Corbin, Corps spirituel et terre céleste. De l’Iran mazdéen à l’Iran shî’ite, éd. Buchet-Chastel, 1979, 3e éd., coll. « Essais et Documents », Paris, 2005, p. 8, cité par Cl. Brunier-Coulin, L’homme pécheur, op. cit., p. 117, note n°25.
- Philosophe mystique islamique du XIIe siècle après J.-C. qui fut à l’origine d’une grande philosophie de l’illumination conciliant et parachevant les sagesses grecque et orientale.
- Shihâboddîn Yahyâ Sohravardî, L’Archange empourpré. Quinze traités et récits mystiques, trad. H. Corbin, éd. Fayard, coll. « L’Espace intérieur », Paris, 1976, p. 96, cité par Cl. Brunier-Coulin, L’homme pécheur, op. cit., p. 179.
- Rm. 1, 16-17.
- Martin Luther, Œuvres, éd. Labor et Fides, Genève 1999, tome XII, Commentaire de l’Épître aux Romains (scolies, suite et fin) (1516), p. 65-66.
- L’homme pécheur, op. cit, p. 321.
- L’homme pécheur, op. cit., p. 376.
- Ibid., p. 377.
- Ibid., p. 437.
- Ibid., p. 574.
- Ibid., p. 629.
- Ibid., p. 629.
- Ibid., p. 638.








