Introduction
L’ouvrage[1] fait un effet radical, et lorsqu’on le referme, l’on se sent ragaillardi face à toute épreuve que la vie aurait à nous offrir de nouveau. Cet ouvrage, c’est Rupture(s) de Claire Marin.
Le titre donne une idée d’emblée précise du contenu : ces cent cinquante pages traversent les déceptions relationnelles, les séparations brutales, les brisures du corps, les deuils et, surtout, le bouleversement qui en résulte dans celui qui les vit.
L’introduction peut sembler assez prévisible : nous souffrons de nombreuses ruptures dans notre vie, que nous tentons tous, tant bien que mal, de surmonter. Il faut toutefois noter dès les premières lignes un effort propre à la philosophie pour distinguer les termes et préciser le sens du concept propre de « rupture » :
« La torture est une torsion. L’étymologie nous le rappelle. La rupture, qu’on la choisisse ou qu’on la subisse, nous inflige une torsion psychique et physique insupportable, il nous faut supporter la déformation de notre identité, de notre existence. » (p. 12)
Tout l’ouvrage oscillera entre deux pôles : l’idée, d’une part, que la rupture occasionne une blessure irrémédiable, telle que l’on ne pourra plus jamais retrouver l’état antérieur et naïf qui l’a précédée ; et celle, d’autre part, que la rupture nous transforme, au point de renouveler notre être de part en part. Pour autant, Claire Marin ne cède pas à la facilité d’un discours typique des ouvrages de développement personnel :
« Je résisterai […] à la tentation de l’optimisme en balayant d’emblée les lectures simplificatrices et positives de la rupture et du recommencement. On aimerait y voir l’occasion d’une vie neuve, d’une page blanche, de donner une valeur rétrospective à un échec en le transformant en savoir, en richesse, en expérience. Il y aurait des vertus de l’échec. Vraiment ? Mais la rupture n’est parfois qu’un gâchis, un manque de courage, une lâcheté. […] Et l’échec n’est souvent rien d’autre que lui-même, pauvre, décevant, un pur raté. La plupart des échecs ne nous apprennent rien. » (p. 20)
D’entrée de jeu, le ton de l’ouvrage est donné : de l’ordre de l’essai philosophique, bien plus proche de la psychanalyse que du développement personnel, il recourt très souvent à la première personne — ce « je » inclusif du lecteur. Il emprunte majoritairement à la littérature — Pierre Autréaux, Pierre Bergounioux, Christian Bobin, Albert Cohen, Vincent Delecroix, Marguerite Duras, Annie Ernaux, Philippe Forest, Charles Juliet, Henri Michaux… etc., mais aussi aux essais — Anne Dufourmantelle par exemple — pour faire de la philosophie : Claire Marin puise dans la littérature contemporaine autant d’exemples auxquels tout un chacun peut s’identifier. Qui n’a pas vécu la perte d’un être cher, la rupture soudaine dans le train de la vie qu’occasionnent un accident, une blessure ? Qui n’a pas, peut-être, découvert que la personne à laquelle on tenait — parent, ami — n’est plus un socle stable, et n’a pas été bouleversé par l’évanouissement soudain, mais définitif, de celle foi en l’autre ? Si les sources philosophiques classiques sont explicites — Bergson en particulier, Kierkegaard, Nietzsche ou Spinoza entre autres —, l’ouvrage emprunte aussi bien à des philosophes contemporaines — Chantal Jaquet, Catherine Malabou par exemple — qu’à la psychanalyse : Freud, Winnicott, Anne Dufourmantelle en particulier.
Si l’ouvrage est polyphonique, ces paroles sont avant tout mises au service d’une pensée homogène de la rupture, déclinée en autant d’acceptions possibles du concept et de son épreuve. Chaque chapitre, de longueur inégale, étaye dès lors un type de rupture.
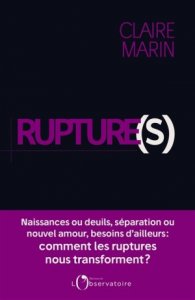
Cassure
Ainsi traverse-t-on tout d’abord la fuite à soi et aux autres, la discontinuité éprouvée dans l’être et qui oblige à tout quitter pour un nouvel horizon : ce premier chapitre fait l’office d’une présentation du questionnement. La « rupture » n’est pas seulement à entendre comme ce que l’on subit des autres, mais avant tout comme une expérience personnelle : quelque chose en nous « rompt », et c’est avant tout nous-mêmes qui devons nous séparer, partir, devenir autre. Avec, toujours, le risque de se perdre plutôt que de se (re)trouver :
« il arrive malheureusement que l’on rompe pour suivre sa folie intime, sa ligne de sorcière. Il y a, dans toute rupture, l’espoir de se trouver et le risque de se perdre » (p. 29).
À l’occasion d’une « rupture amoureuse » (chapitre 2), la séparation d’avec l’autre est aussi une séparation d’avec soi-même. Lorsque le couple se disloque, l’unité à laquelle on s’était identifié se fragmente et l’on a l’impression de s’être perdu. Mais c’est aussi parce que l’on s’est trop perdu dans l’autre qu’il faut parfois s’en séparer pour retrouver le chemin à soi. Du départ de l’autre, ou du départ qui s’impose à soi, résulte une sensation de gouffre parfois ; et pourtant il le fallait, il fallait s’évader de ce duo qui devenait un solo et qui nous éloignait de notre authenticité propre. Mais suis-je seulement, si soudain l’autre nie jusqu’à mon existence ? Ce départ signe en même temps la propre démolition de celui qui est quitté :
« Violence du désamour, blessure narcissique ; la rupture amoureuse est démolition en règle de l’ego. “Ta silhouette s’est perdue comme un petit détail dans un paysage”, écrit Lou Andreas-Salomé à Rilke dans une lettre de rupture. Qui resterait insensible à ces mots, prononcés ou écrits par l’être aimé ? » (pp. 35-36).
Alors l’on se perd parfois dans une frénésie sexuelle qui témoigne moins d’un appétit de vivre que du sentiment de mort à soi lorsque l’amour-propre est anéanti :
« La libido débridée dit quelque chose de la violence qui nous a traversés et en partie détruits, presque anéantis. Elle dit quelque chose de ce néant fiché en nous. Elle est l’expression par le corps et dans la relation à autrui de l’expérience de la perte par ailleurs si difficilement communicable. Exploitant la proximité symbolique de la sexualité et de la mise à mort, cette “effervescence amoureuse” est en réalité une manière de rejouer une double mise à mort, approchée dans le drame, mise à mort de soi et d’autrui. Mise à mort de celui que l’on était, dans sa naïveté, sa confiance en la vie, et deuil d’une insouciance perdue dans le rapport aux autres et au monde […]. » (pp. 139-141)
Se perdre pour se trouver
Réagir à la rupture en anesthésiant la perte de soi, en fuyant la relation à l’autre. Après la rupture, ou à son origine, l’urgence est aux retrouvailles avec soi : celui qu’on a pu nier dans la relation amoureuse, effacer, mais peut-être déjà parce qu’avant la relation l’on ne coïncidait pas avec soi-même. S’il faut rompre, c’est parce que la rupture est parfois condition de l’existence propre :
« Nous avons parfois le sentiment de ne pas être celui que nous sommes, de jouer un rôle, d’être en marge de notre propre vie, sans y adhérer, comme si un souffle d’air passait toujours entre le monde et nous, un voile de brouillard qui le rend flou, sans saveur, sans goût. Ce monde-là n’est pas fait pour nous, nous ne pouvons pas noue en contenter. On ne saurait pas dire pourquoi, on le pressent simplement, on éprouve un malaise et une honte à se fondre dans cette vie. On est agité, instable, inquiet. On ressent un manque, une insatisfaction, une tension intérieure s’intensifie d’une manière si pressante qu’il devient nécessaire de rompre avec celui que l’on était. » (p. 64, chapitre 3).
Si Claire Marin appuie surtout son propos sur Lambeaux et Dans la maison de Charles Juliet, le chapitre 3 est placé sous le signe du « faux self » théorisé par le psychanalyste Winnicott. Il faut rompre avec le masque et le rôle que l’on joue, pour mieux se donner à soi. Ce type d’expérience est commun, parce que nous ne faisons chacun qu’endosser divers rôles en alternance, et que notre identité sociale est toujours construite. Aussi
« La rupture est[-elle] en réalité arrachement sans cesse recommencé, allers-retours intérieurs, inquiétude. Elle est un long travail intime de déprise, de distanciation et d’apaisement affectif. Il faut apprivoiser la violence des sentiments qu’elle suscite en soi. Il faut les tolérer comme l’effet inévitable du bouleversement que produit la rupture et les dompter au fur et à mesure. Que je rompe ou que je sois rompu, la rupture est cataclysme intérieur. » (p. 75).
Pour autant, les ruptures pour retrouver un noyau identitaire supposent qu’il y en ait un, ce que la philosophie n’assure pas absolument. Il se pourrait que notre être propre soit pluriel, se décline à l’infini, et que notre existence résulte d’autant de ruptures que de facettes de notre être. Ainsi, au chapitre 4, Claire Marin explore-t-elle « Le plaisir de la dispersion » :
« Ne sommes-nous pas faits de la succession de petites ruptures, la juxtaposition d’identités sans lien qui se combinent au gré des circonstances ? Notre identité est-elle autre chose que cet arrangement de fragments d’être que les aléas disposent sans nécessité ni loi ? Pire, n’y a-t-il pas un plaisir, voire un besoin à être profondément multiple, à ne pas être enfermé dans une identité ? »
De fait, l’on pense à Blaise Pascal et David Hume qui, à leur façon, ont tous deux remis en question l’unité d’un « moi ». Mais après avoir souligné à quel point la rupture se faisait au motif d’une recherche d’un « soi » plus unitaire, Claire Marin montre dans quelle mesure cette recherche, loin d’être vaine, permet d’explorer toutes les facettes et les déclinaisons d’une telle unité.
Désintégration physique
Jusqu’au moment où l’unité du sujet se morcelle par le corps : c’est le thème du chapitre 5 — « L’être accidenté ». À partir de Bras cassé, d’Henri Michaux, elle relève le primat du corps dans l’unité de l’être, et la brisure radicale dans le sentiment même de soi que peut occasionner la fêlure du corps. La fracture du bras est une rupture parce qu’elle oblige à se latéraliser différemment, et à se penser soi-même comme étranger à soi, à se découvrir autrement :
« L’accident est alors une chance d’investir cette part de nous et d’ “investiguer”, comme le dit Michaux. Que m’apprend mon être gauche sur moi-même ? On pourrait l’interpréter comme une figure de vulnérabilité, un être différent, amoindri, moins agile, mais c’est aussi, par l’attention qu’il demande, un être qui agit autrement, qui observe le monde et s’y rapporte selon des modalités différentes, qui porte un autre regard, dans un décillement peut-être de tout ce qui semblait trop connu ou évident. » (pp. 95-96).
Nous faisons à cette occasion l’expérience d’une désorientation, qui suppose de requestionner nos orientations habituelles et nos automatismes. On ne doit pas pour autant nier le désarroi qu’occasionne l’accident, voire la maladie, aussi bénigne soit-elle ; mais
« Faire de l’accident une expérience de pensée, une expérience qui donne à penser, c’est convertir cette souffrance en une expérience qui délivre du sens. Chaque être souffrant espère donner une signification, une raison à cette expérience absurde de la souffrance physique. Ce qui peut nous réconforter, c’est bien l’idée que nous y expérimentons un autre versant de notre personnalité. » (p. 97).
N’être qu’un
Cette interrogation des ruptures identitaires s’entrelace aux bouleversements qu’entraîne l’enchâssement relationnel avec ces autres que l’on aime, de diverses manières, au point de tisser une partie de notre identité avec eux. Dès le chapitre 2, Claire Marin avait souhaité évoquer « la rupture amoureuse ». Mais c’est véritablement au chapitre 6 que l’on comprend à quel point cette rupture ne fait que réactiver la rupture première de la naissance.
« La naissance constitue pourtant bien la première des ruptures, par les profondes transformations qu’elle présuppose et engendre. » (p. 99)
Cette rupture première est celle du passage d’un état d’apesanteur intra-utérine à celui de la gravité terrestre, passage de l’enveloppement amniotique à la dilatation de soi à l’air libre, qui bouleverse le vécu du nouveau-né. Passage du deux à l’un, défusion. Cette rupture est réactivée aussi pour la femme qui a vécu neuf mois de grossesse, et qui soudain se sépare :
« La naissance est la rencontre de deux étrangers qui ont vécu pendant des mois dans la plus grande proximité possible, proximité corporelle mais aussi sans doute psychique. On comprend alors que cette naissance puisse être ressentie et pensée comme un arrachement d’une grande violence. C’est ce double mouvement d’arrachement/attachement, de séparation et de paration, c’est-à-dire de protection de l’enfant, qui se joue autour de la naissance et de ses prolongements soutenants. » (p. 101).
Le chapitre met en évidence la boucle rétroactive allant du nouveau-né à sa mère, et le paradoxe d’une naissance-rupture qui initie la vertu régénératrice de chaque rupture ultérieure. Si les ruptures sont autant de déchirures, mais fortes aussi de naissances à soi, c’est parce que la naissance initie un tel cycle. Il faut que le nourrisson soit accompagné, « porté » selon Winnicott ; « la naissance ne suffit pas », dit la philosophe et psychanalyste et Anne Dufourmantelle. Encore faut-il qu’un environnement bienveillant ait pris soin d’assurer une transition entre le nourrisson et le monde, faute de quoi la rupture peut être vécue comme un effondrement létal :
« Il faut prolonger par la douceur du toucher, la chaleur du peau-à-peau, les paroles rassurantes chuchotées, le sentiment d’être constamment entouré de présence, d’attention, de corps bienveillants. Au corps utérin, il faut en substituer un autre, chimérique, fait de voix, de caresses, de pressions douces appliquées à l’enfant, chair de mots et de touchers qui le rassurent tout en lui permettant d’élaborer petit à petit la perception de son corps propre. » (p. 105)
Le nourrisson est vulnérable, et à chaque nouvelle rupture, je fais l’épreuve de ma vulnérabilité et de ma dépendance à l’égard d’autrui. La séparation physique d’avec le corps maternel ne suffit pas à s’autonomiser, à devenir un être à part entière : « naître ne suffit pas » à devenir soi.
Survivre à l’autre
Pourtant, si ceux qui assurent la transition en s’occupant de l’enfant lui sont essentiels, ils peuvent aussi s’avérer toxiques. C’est l’objet du chapitre 7 : « Rompre avec sa famille ». S’appuyant essentiellement sur Pense aux pierres sous tes pas d’Antoine Wauters, Claire Marin explore la nécessité que nous pouvons avoir d’échapper à l’emprise de celles et ceux qui, certes, ont assuré notre survie physique, mais ont aussi contribué à notre anesthésie psychique. Comment se séparer de ceux que l’on aime sans culpabilité ? Comment devenir soi, lorsque l’on a tissé son identité propre dans une dépendance asphyxiante ?
« Parfois, le lien familial fait de moi un “otage”, me privant d’une vie psychique propre. Il est alors nécessaire de se séparer pour naître à soi et provoquer l’irréparable d’une déprise, la réponse vitale à l’emprise d’une mère sur sa fille. Dans les cas étudiés par Anne Dufourmantelle, la sauvagerie maternelle laisse sur le corps des jeunes filles les stigmates d’une présence vampirisante. Le corps amaigri dit quelque chose du “festin cannibale” auquel se livre la mère dévorante. Il faut alors, pour la jeune fille, “vomir, mourir, naître” : vomir la mère en soi qui phagocyte la fille. L’expulser de soi, “choisir de naître pour retrouver un corps qui sera le [sien]”. […] L’expulsion de la mère est renaissance psychique […]. Pour cela, il faut assumer le risque de la coupure […]. Pour tout simplement renaître à soi. Mais cela suppose d’affronter la culpabilité d’une mise à mort de la mère. » (pp. 115-116)
L’on peut saisir ici à quel point la rupture est avant tout psychique : rompre avec la confiance que l’on accordait à autrui, plutôt qu’avec son être physique et réel.
Parfois, quoique bien différemment, l’être physique est toujours présent, mais son esprit a disparu, et en sa présence l’on n’est plus aux côtés de la personne que l’on connaissait : le chapitre 8 intitulé « Disparitions » évoque de façon centrale le texte de Michel Malherbe à propos de son épouse atteinte de la maladie d’Alzheimer :
« L’autre est là, mais il est déjà inatteignable, dans un ailleurs. Est-il encore lui-même ? Comment supporter cette torture affective d’un tel délitement de l’être aimé ? » (p. 129)
C’est cette fois l’identité perdue de l’autre qui nous rompt et nous brise : la question est de savoir si l’on est en présence de la personne aimée malade, ou si l’on a affaire à quelqu’un d’autre. La rupture s’impose aussi pour celui qui assiste à la dégradation de l’être aimé : il faut rompre, pour dissocier de celui qui ne nous connaît plus les souvenirs heureux de celui que l’on chérissait.
Ce qui m’échappe
La fin de l’ouvrage : « Traverser la nuit » et « Rupture des contrats » consiste en deux chapitres très brefs, comme si Claire Marin cherchait à se retirer du lien tissé avec le lecteur, avec attention et bienveillance. « Traverser la nuit », c’est tenter de rompre avec le contrôle conscient pour lâcher prise et s’endormir. Il arrive que l’on n’y parvienne pas :
« Cette incapacité à dormir nous tue à petit feu. L’insomnie est l’impossible lâcher-prise, le refus du sommeil comme abandon. Passer par la nuit, accepter de disparaître, dans l’oubli du jour passé et l’absence à soi, voilà ce dont une conscience vive a besoin pour affronter les lendemains. » (p. 141)
Il faut parvenir à lâcher le passé, à rompre avec l’avant pour créer de l’après. Mais cet « après » réitère parfois un passé douloureux. Le très beau chapitre final :
« Rupture des contrats » évoque le refus de voir surgir un tel retour de la maladie, du deuil à faire, comme si l’on n’avait pas encore payé suffisamment de la souffrance éprouvée. La rupture antérieure semblait s’être négociée en échange d’une vie meilleure, et voilà que tout s’effondre à nouveau. Dans les dernières pages, Claire Marin encourage le lecteur à trouver la « force d’affronter l’incertitude de la vie » (p. 151), comme des enfants le sourire aux lèvres.
Conclusion
La force de l’ouvrage Rupture(s), quant à lui, repose sur son aptitude à nous laisser songeurs, rêveurs, à agir le lecteur et, en quelque sorte, à le (re)mobiliser. Il agit tel un pansement, en nommant les ruptures qui n’ont pu que laisser un vide ; surtout, il fournit une liste d’ouvrages entre littérature, essai et philosophie, où l’on sait que l’on pourra puiser autant de mots qui témoignent, mais aussi soignent, pensent et symbolisent la rupture pour mieux nous donner de quoi la dépasser.
[1] Claire Marin, Rupture(s), Paris, Éditions de l’Observatoire, mai 2019.








